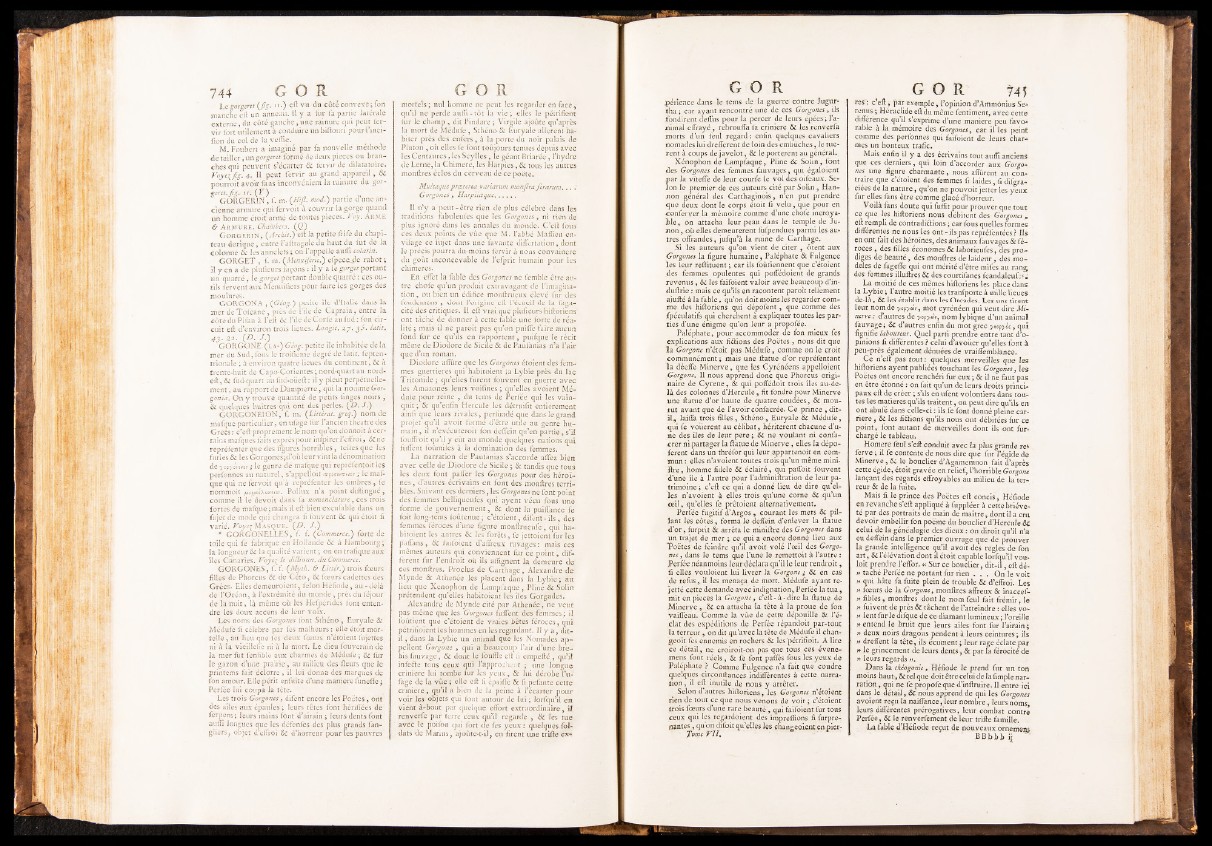
L e gorgent ( fig. J / . ) e f t v u d u c ô t é c o n v e x e ; f o n
m a n c h e e f t u n a n n e a u . I l y a f u r l a p a r t i e l a t é r a l e
e x t e r n e , d u c ô t é g a u c h e , u n e r a i n u r e q u i p e u t 1 e r -
v i r f o r t u t i l e m e n t à c o n d u i r e u n b i f t o u r i p o u r l ’ i n c i -
l i o n d u c o l d e l a v e l î i e .
M . F o u b e r t a im a g i n é p a r f a n o u v e l l e m é t h o d e
d e t a i l l e r , u n gorgent f o rm é d e d e u x p i è c e s o u b r a n c
h e s q u i p e u v e n t s ’ é c a r t e r 6c f e r v i r d e d i l a t a t o i r e .
y°ye{fig. 4. I l p e u t f é r v i r a u g r a n d a p p a r e i l , 6c
p o u r r o i t a v o i r f a n s i n c o n v é n i e n t l a r a i n u r e d u gorgent,
fig. 11. ( Y )
G O R G E R I N , f . m. (Hifl. mod.) partie d une ancienne
armure qui fervoit à couvrir la gorge quand
un homme étoit armé de toutes pièces. Foy. Arme
& A rmure. Chambers. (Q )
G o r g er in , (.Archit. ) e f t l a p e t i t e f r i f e d u c h a p i t
e a u d o r i q u e , e n t r e l ’ a f t r a g a l e d u h a u t d u f u t d e l a
c o l o n n e 6c l e s a n n e le t s ; o n l ’ a p p e l l e a u f f i colarin.
G O R G E T , f . m . (Menuiferie.) e fp e c c u .d e r a b o t ;
i l y e n a d e p lu l i e u r s f a ç o n s : i l y a l e gorget p o r t a n t
u n q u a r r é , l e gorget p o r t a n t d o u b l e q u a r r é : c e s o u t
i l s f e r v e n t a u x M e n u i f i e r s p o u r f a i r e l e s g o r g e s d e s
G O R G O N A , (Gèog.) p e t i t e î l e d ’ I t a l i e d a n s l a
m e r d e T o f c a n e , p r è s d e l ’i l e d e C a p r a ï a , e n t r e l a
c ô t e d u P i i 'a n à l ’ e f t 6c l ’î l e d e 'C o r f e a u f u d : f o n c i r c
u i t e f t d ’ e n v i r o n t r o i s l i e u e s . Longit. z y . 3 J . latit.
4g . z z . ( D . J . )
G O R G O N E ( la-) Géog. p e t i t e î l e in h a b i t é e d e l à
m e r d u S u d , f o u s l e t r o i f i e m e d e g r é d e l a t i t . f e p t e n -
î r i o n a l e ; à e n v i r o n q u a t r e l i e u e s d u c o n t i n e n t , & à
t r e n t e - h u i t d e C a p o - C o r i e n t e s ; n o r d - q u a r t a u n o r d -
e f t , 6c f u d - q u a r t a u f u d - o i i e f t : i l y p l e u t p e r p é t u e l l e m
e n t , a u r a p p o r t d e D a m p i e r r e , q u i l a n o m m e Gor-
gonia. O n y t r o u v e q u a n t i t é d e p e t i t s l in g e s n o i r s ,
& q u e l q u e s h u î t r e s q u i o n t d e s p e r l e s . { D . J . )
G O R G O N E I O N , f . m . (Littérat. greq.) n o m d e
m a l q u e p a r t i c u l i e r , e n u f a g e f u r l ’ a n c i e n t h é â t r e d e s
G r e c s : c ’ e f t p r o p r e m e n t l e n o m q u ’ o n d o n n o i t à c e r t
a in s m a f q u e s f a i t s e x p r è s p o u r in l p i r e r l ’ e f f r o i , & n e
r e p r é f e n t e r q u e d e s f i g u r e s h o r r i b l e s , t e l l e s q u e l e s
f u r i e s 6c l e s G o r g o n e s ; d ’o ù l e u r v i n t l a d é n o m i n a t i o n
d e yoeyôvuov ; l e g e n r e d e m a f q u e q u i r e p r é f e n t o i t l e s
p e r f o n n e s a u n a t u r e l , s ’ a p p e l l o i t «spofuMnov ; l e m a l q
u e q u i n e f e r v o i t q u 'à r e p r é f e n t e r l e s o m b r e s , l e
n o m m o i t popiùwiuw. P o l l u x n ’ a p o i n t d i f t i n g u é ,
c o m m e i l l e d e v o i t d a n s f a nomenclature, c e s t r o i s
f o r t e s d e m a f q u e ; m a i s i l e f t b i e n e x c u f a b l e d a n s u n
f u j e t d e m o d e q u i c h a n g e a i i f o u v e n t 6c q u i é t o i t f i
v a r i é . Voye^ Masque. ( D . J.)
* G O R G O N E L L E S , f . f . {Commerce.') f o r t e d e
t o i l e q u i f e f a b r i q u e e n H o l l a n d e 6c à H a m b o u r g ;
l a lo n g u e u r 6c l a q u a l i t é v a r i e n t ; o n e n t r a f i q u e a u x
î l e s C a n a r i e s . Voyelle diclionn. du Commerce.
G O R G O N E S , f . f . (Myth. & Littér.) t r o i s foe u r s
f i l l e s d e P h o r c u s & d e C é t o , 6 c foe u r s c a d e t t e s d e s
G r é e s . E l l e s d e m e u r a i e n t , f é l o n H é l i o d e , a u - d e l à
d e l ’ O c é a n , à l ’ e x t r é m i t é d u m o n d e , p r è s d u f é j o u r
d e l a n u i t , l à m ê m e o ù l e s H e f p é r id e s f o n t e n t e n d
r e l é s d o u x a c c e n s d e l e u r v o i x .
L e s n om s d e s Gorgones f o n t S t h é n o , E u r y a l e &
M é d u f e l i c é l é b r é p a r fe s m a lh e u r s : e l l e é t o i t m o r t
e l l e , a u l i e u q u e l e s d e u x foe u r s n ’ é t o i e n t f u j e t t e s
n i à l a v i e i l l e f f e n i à l a m o r t . L e d i e u f o u v e r a i n d e
l a m e r f u t f e n f ib l e a u x c h a rm e s d e M é d u f e ; 6c f u r
l e g a z o n d ’u n e p r a i r i e , a u m i l i e u d e s f l e u r s q u e l e
p r i n t e m s f a i t é c l o r r e , i l l u i d o n n a d e s m a r q u e s d e
f o n a m o u r . E l l e p é r i t e n f u i t e d ’u n e m a n i é r é f u n e f t e ;
P e r f é e lu i c o u p a l a t ê t e .
L e s t r o i s Gorgones, d i f e n t e n c o r e l e s P o è t e s , o n t
d e s a î l e s a u x é p a u l e s ; l e u r s t ê t e s f o n t h é r i f f é e s d e
f e r p e n s ; l e u r s m a in s f o n t d ’ a i r a in ; l e u r s d e n t s f o n t
a u f f i l o n g u e s q u e l e s d é f e n f e s d e s p lu s g r a n d s f a n -
g u e r s , o b j e t d ’ e f f r o i 6 c d ’h o r r e u r p o u r l e s p a u v r e s
mortels ; nul homme ne peut les regarder en face,
qu’il ne perde auffi - tôt la vie ; elles le pétrifient
fur le champ , dit Pindare ; Virgile ajoute qu’après
la mort de Médufe , Sthéno & Euryale allèrent habiter
près des enfers, à la porte du noir palais de
Pluton , où elles fe font toujours tenues depuis avec
les Centaures, les Scylles, le géant Briarée, l’hydre
de Lerne, la Chimere, les Harpies, 6c tous les autres
monftres éclos du cerveau de ce poète.
Multaque proeterta variarum monfira ferarum. . , l
Gorgones , Harpiiceque. . . . . .
Il n’y a peut-être rien de plus célébré dans les
traditions fabuleufes que les Gorgones, ni rien de
. plus ignoré dans les annales du monde. C’eft foiis'
ces deux points de vue que M. l’abbé Maffieu en-
vifage ce fujet dans une lavante diflertation, dont
le précis pourra du-moins fervir à nous convaincre
du goût inconcevable de l’efprit humain pour les
chimères.
En effet la fable des Gorgones ne femble être autre
chofe qu’un produit extravagant de l’imagination
, ou bien un édifice monftrueux élevé fur des
fondemens , dont l’origine eft l’écueil de la faga-
cité des critiques. 11 eft vrai que plufieurs hiftoriens
ont tâché de donner à cette fable une forte de réalité
; mais il ne paroît pas qu’on puiffe faire aucun
fond fur ce' qu’ils en rapportent, puifque le récit
même de Dioaore de Sicile & de Paufanias n’a l’air
que d’un roman.
Diodore allure que les Gorgones étoient des femmes
guerrières qui habitoient la Lybie près du lac
Tritonide ; qu’elles furent fouvent en guerre avec
les Amazones leurs voifines ; qu’elles avoient Médufe
pour reine , du tems de Perfée qui les vainquit
; & qu’enfin Hercule les détruilit entièrement
ainfi que leurs rivales, perfuadé que dans le grand
projet qu’il avoit formé d’être utile au genre humain
, il n’exécuteroit fon deffein qu’en partie, s’ il
louffroit qu’il y eût au monde quelques nations qui
fulfent foûmifes à la domination des femmes.
La narration de Paufanias s’accorde allez bien
avec celle de Diodoré de Sicile ; & tandis que tous
les deux font palier les Gorgones pour des héroïnes,
d’autres, écrivains en font des monftres terribles.
Suivant ces derniers, les Gorgones ne font point
des femmes belliqueufes qui ayent vécu fous une
forme de gouvernement, 6c dont la puiffance fe
foit long-tems loûtenue ; c’étoient, difent - ils , des
femmes féroces d’une figure monffrueufe, qui habitoient
les antres 6c les forêts , fe jettoient fur les
paffans, 6c faifoient d’affreux ravages : mais ces
mêmes auteurs qui conviennent fur ce point, different
fur l’endroit où ils affignent la demeure de
ces monftres. Proclus de Carthage, Alexandre de
Mynde & Athenée les placent dans la Lybie ; au
lieu que Xenophon de Lampfaque, Pline 6c Solin
prétendent qu’elles habitoient les îles Gorgades.
Alexandre de Mynde cité par Athenée, ne veut
pas même que les Gorgones fulfent des femmes ; il
loûtient que c’étoient de vraies bêtes féroces, qui
pétrifioient les hommes en les regardant. Il y a , dit-
il , dans la Lybie un animal que les Nomades appellent
Gorgone , qui a beaucoup l’air d’une brebis,
fauvage, 6c dont le fouffle eft li empefté , qu’il
infeéte tous ceux qui l’approchei t ; une longue
crinière lui tombe fur les yeux, & lui dérobe l’u-
fage de la vue ; elle eft fi épaiffe & fi pefante cette
crinière, qu’il a bien de la peine à l’écarter pour
voir les objets qui font autour de lui ; lorfqu’il en
vient à-bout par quelque effort extraordinaire, il
renverfe par terre ceux qu’il regarde , 6c les tue
avec le poilon qui fort de fes yeux : quelques fol-
dats de Marius, ajoûte-t-i1, en firent ime trifte ex-
4>érience dans le tems de la guerre contre Jugur*
tha ; car ayant rencontré une de ces Gorgones , ils
fondirent deffus pour la percer de leurs épées ; l’animal
effrayé, rebrouffa là crinière 6c lesrenverfa
morts d’un feul regard: enfin quelques cavaliers
nomades lui drelferent de loin des embûches, le tuèrent
à coups de javelot, & le portèrent au général.
Xénophon de Lampfaque, Pline 6c Solin, font
des Gorgones des femmes fauvages, qui égaloient
par la vïteffe de leur courfe le vol des oifeaux. Selon
le premier de ces auteurs cité par Solin, Han-
non général des Carthaginois, n’en put prendre
que deux dont le corps étoit fi v elu , que pour en
conferver la, mémoire comme d’une chofe incroyable,
ôn attacha leur peau dans le temple de Ju-
non, où elles demeurèrent fulpendues parmi les ai>
très offrandes , jufqu’à la ruine de Carthage.
Si les auteurs qu’on vient de citer , ôtent aux
Gorgones la figure humaine, Paléphate & Fulgence
ïes leur reftituent ; car ils foutiennent que c’étoient
des femmes opulentes qui poffédoient de grands
revenus, 6c les faifoient valoir avec beaucoup d’in-
duftrie : mais ce qu’ils en racontent paroît tellement
ajufté à la fable, qu’on doit moins les regarder comme
des hiftoriens qui dépofent, que comme des
fpéculatifs qui cherchent à expliquer toutes les parties
d’une énigme qu’on leur a propofée.
Paléphate, pour accommoder de fon mieux fes
explications aux fixions des Poètes, nous dit que
ïa Gorgone n’étoit pas Médufe, comme on le croit
communément ; mais une ftatue d’or repréfentant
la déeffe Minerve, que les Cyrénéens appelloient
Gorgone. Il nous apprend donc que Phorcus originaire
de Cyrene, & qui poffédoit trois îles au-delà
des colonnes d’Hercule, fit fondre pour Minerve
une ftatue d’or haute de quatre coudées, & mourut
avant que de l’avoir confacrée. Ce prince , dit-
il., lailfa trois filles , Sthéno, Euryale 6c Médufe,
qui fe voiierent au célibat, héritèrent chacune d’une
des îles de leur pere ; 6c ne voulant ni confa-
crer ni partager la ftatue de Minerve, elles la dépo-
ferent dans un thréfor qui leur appartenôit en commun
: elles n’avoient toutes trois qu’un même mini-
ftre, homme fidele & éclairé, qui paffoit fouvent
d’une île à l’autre pour l’adminiftration de leur patrimoine
; c’eft ce qui a donné lieu de dire qu’ elles
n’avoient à elles trois qu’une corne 6c qu’un
oe il, qu’elles fe prêtoient alternativement.
Perfée fugitif d’Argos , courant les mers & pillant
les côtes, forma le deffein d’enlever la ftatue
d’o r , furprit & arrêta le miniftre des Gorgones dans
un trajet de mer ; ce qui a encore donné lieu aux
Poètes de feindre qu’il avoit volé l’oeil des Gorgones
, dans le tems que l’une le.remettait à l’autre :
Perfée néanmoins leur déclara qu’il le leur rendroit,
ii elles vouloient lui livrer la Gorgone ; 6c en cas
de refus, il les menaça de mort. Médufe ayant re-
jetté cette demande avec indignation, Perfée la tua,
mit en pièces la Gorgone, c’eft - à - dire la ftatue de
Minerve , 6c en attacha la tête à la proue de fon
vaiffeau. Comme la vûe de cette dépouille & l’éclat
des expéditions de Perfée répandoit par-tout
la terreur , on dit qu’avec la tête de Médufe il chan-
geoit fes ennemis en rochers 6c les’pétrifioit. A lire
ce détail, ne croiroit-on pas que tous ces évene-
mens font réels, & fe font paflés fous les yeux de
Paléphate ? Comme Fulgence n’a fait que coudre
quelques circonftances indifférentes à cette narration
, il eft inutile de nous y arrêter.
Selon d’autres hiftoriens, les Gorgones n’étoient
rien de tout ce que nous venons de voir ; c’étoient
trois foeurs d’une rare beauté , qui faifoient fur tous
ceux qui les regardoient des impreflions fi furpre-
ïiantes, qu on difoit qu’elles les changeoient en pier-
Tvrne V I I%
res : c’e ft , jpâr exemple, l’opinion d’Ammônius Se*
renus ; Heraclide eft du même fentiment, avec cette
différence qu il s’exprime d’une maniéré peu favorable
à la. mémoire des Gorgones 9 car il les peint
comme des perfonnes qui faifoient de leurs charmes
un honteux trafic.
Mais enfin il y a des écrivains tout auffi anciens
que ces derniers, qui loin d’accorder aux Gorgo*
nés une figure charmante, nous affûrent au contraire
que c’étoient des femmes fi laides, fi difgra-
ciées de la nature, qu’on ne pouvoit jetter les yeux
fur elles fans être comme glacé d’horreun
Voilà fans doute qui fuffit pour prouver que tout
ce que les hiftoriens nous débitent des Gorgones ,
eft rempli de contradictions ; car fous quelles formes
differentes ne nous les ont-ils pas repréfentées ? Ils
en ont fait des héroïnes, des animaux fauvages & féroces
, des filles économes & laborieufes, des prodiges
de beauté, des monftres de laideur, des modèles
de fageffe qui ont mérité d’être mifes au rang
des femmes illuftres 6c des courtifanes fcandaleufes4
La moitié de ces mêmes hiftoriens les place dans
la Lybie ; l’autre moitié les tranfporte à mille lieues
de-là, 6c les établit dans les Orcades. Les uns tirent
leur nom de yopym, mot cyrénéen qui veut dire Minerve
: d’autres de yopyw, nom lybique d’un animal
fauvage; 6c d’autres enfin du mot grec >top>dç.,,quï
lignifie Laboureur. Quel parti prendre entre tant d’opinions
fi différentes ? celui d’avoiier qu’elles font à
peu-près également dénuées de vraiffemblance.
Ce n’eft pas tout: quelques merveilles que les
hiftoriens ayent publiées touchant les Gorgones, les
Poètes ont encore renchéri fur eux ; & il ne faut pas
en etre étonné : on fait qu’un de leurs droits principaux
eft de créer ; s’ils en ufent volontiers dans tou*
tes les matières qu’ils traitent, on peut dire qu’ils en
ont abufe dans celle-ci : ils fe font donné pleine carrière
, 6c les fixions qu’ils nous ont débitées fur ce
point, font autant de merveilles dont ils ont fur*
chargé le tableau»
Homere feul s’eft conduit avec la plus grande re*
ferve ; il fe contente de nous dire que fur l’égide de
Minerve, 6c le bouclier d’Agamemnon fait d’après
cette égide, étoit gravée en relief, l’horrible Gorgone
lançant des regards effroyables au milieu de la terreur
& de la fuite»
Mais fi le prince des Poètes eft concis , Héfiode
en revanche s’eft appliqué à fuppléer à cette briévé*
té par des portraits de main de maître, dont il a cru
devoir embellir fon poème du bouclier d’Hercule 6c
celui de la généalogie des dieux : on diroit qu’il n’a
eu deffein dans le premier ouvrage que de prouver
la grande intelligence qu’il avoit des réglés de fon
art, & l’élévation dont il étoit capable lorfqu’il vouloir
prendre l’effor. « Sur ce bouclier, dit-il, eft dé-
» taché Perfée ne portant fur rien . . . On le voit
» qui hâte fa fuite plein de trouble 6c d’effroi. Les
» loeurs de la Gorgone, monftres affreux & inaccef-
» fibles, monftres dont le nom feul fait frémir, le
» fuivent de près & tâchent de l’atteindre : elles vo-
» lent fur le difque de ce diamant lumineux ; l’oreille
.» entend le bruit que leurs aîles font fur l’airain ;
» deux noirs dragons pendent à leurs ceintures ; ils
» dreffent la tête, ils écument ; leur rage éclate par
h le grincement de leurs dents, & par la férocité de
» leurs regards ».
Dans la théogonie , Héfiode le prend fur un ton
moins haut, 6c tel que doit être celui de la fimple narration
, qui ne fe propofe que d’inftruire. Il entre ici
dans le détail, 6c nous apprend de qui les Gorgones
avoient reçu la naiffance, leur nombre, leurs noms
leurs différentes prérogatives, leur combat contre
Perfée, 6c le renverfement de leur trifte famille.
La fable d’Héfiode reçut de nouveaux ornement
B B b b b ij