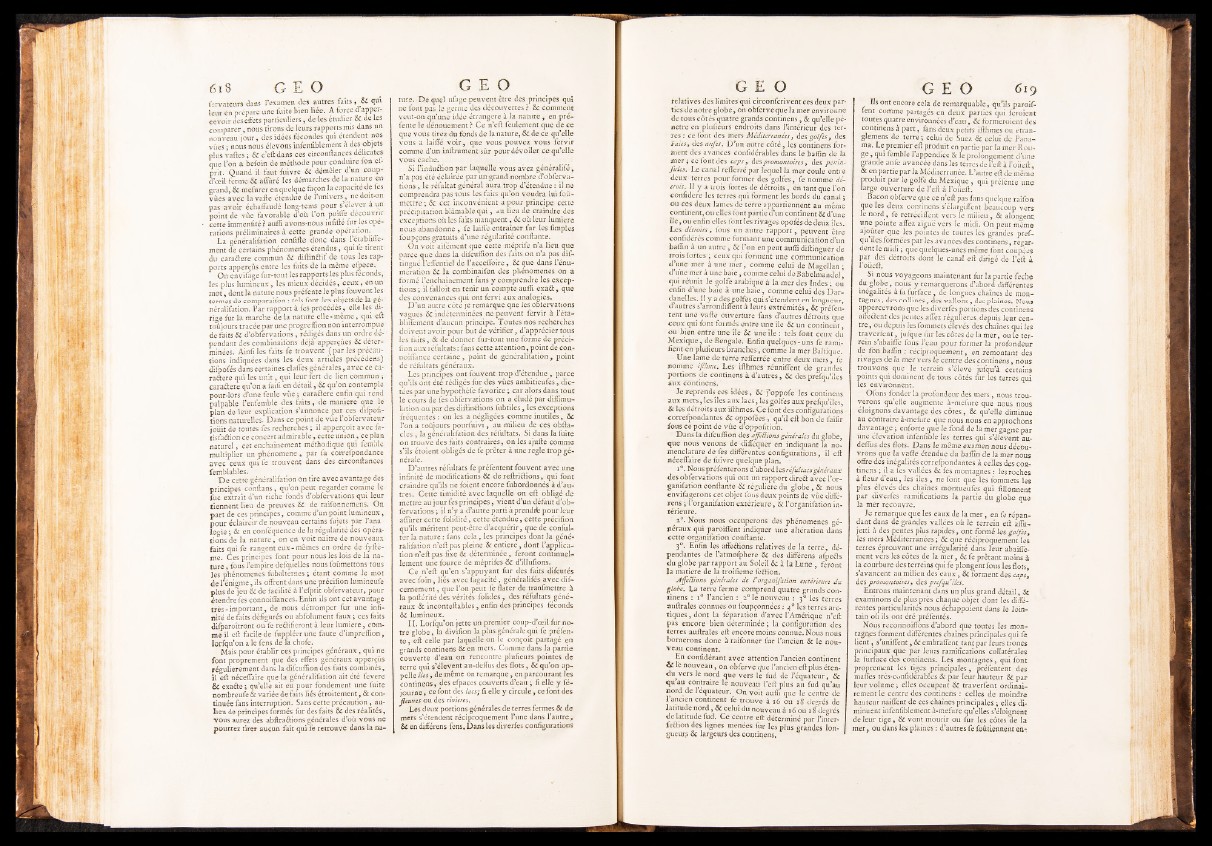
fervateurs dans l’examen des autres faits, 6c qui
leur en prépare une fuite bien liée. A force d apper-
cevoir des effets particuliers, de les étudier & de les
comparer, nous tirons de leurs rapports mis dans un
nouveau jour, des idées fécondes qui étendent nos
vîtes ; nous nous élevons infenfiblement à des objets
plus vaftes ; 6c c’eft dans ces circonftances délicates
que l’on a befoin de méthode pour conduire Ion ef-
prit. Quand il faut fuivre 6c démêler d’un coup-
d’ceil ferme & afluré Tes démarches de la nature en
grand, 6c mefurer en quelque façon la capacité de les
vîtes avec la vafte étendue de l’univers, ne doit-on
pas avoir échaffaudé long-tems pour s’elever à un
point de vue favorable d’où l’on puiffe découvrir
cette immenfité ? aufli avons-nous inlifté fur les opérations
préliminaires à cette grande operation.
La généralifation confifie donc dans l etabliffe-
ment de certains phénomènes étendus, qui le tirent
du caraélere commun 6c diftindlif de tons les rapports
apperçûs entre les faits de la meme efpece.
On envifage fur-tout les rapports les plus féconds,
les plus lumineux, les mieux décidés, ceux, en un
mot, dont la nature nous préfente le plus fouvent les
termes de comparaifon : tels font les objets de la ge-
néralifation. Par rapport à les procédés, elle les dirige
fur la marche de la nature elle-même, qui eft
toujours tracée par une progrelïlon non interrompue
de faits & d’obfervations, rédigés dans un ordre dépendant
des combinaifons déjà apperçûes & déterminées.
Ainfi les faits fe trouvent ( par les précautions
indiquées dans les deux articles précédens)
difpofés dans certaines clalfes generales , avec ce caractère
qui les unit, qui leur fert de lien commun ;
caractère qu’on a faifi en detail, 6c qu on contemple
pour-lors d’une feule vue ; cara&ere enfin qui rend
palpable l’enfemble des faits, de maniéré que le
plan de leur explication s’annonce par ces difpofi-
tions naturelles. Dans ce point de vue l’obfervateur
joiiit de toutes fes recherches ; il apperçoit avec fa-
tisfaélion ce concert admirable, cette union, ce plan
naturel , cet enchaînement méthodique qui femble
multiplier un phénomène , par fa coïrefpondance
avec ceux qui fe trouvent dans des circonftances
femblables.
D e cette généralifation on tire avec avantage des
principes conftans, qu’on peut regarder comme le
fuc extrait d’un riche fonds d’obfervations qui leur
tiennent lieu de preuves 6c de raifonnemens. On
part de ces principes, comme d’un point lumineux,
pour éclaircir de nouveau certains fujets par 1 analogie
; & en conféquence de la régularité des opérations
de la nature, on en voit naître de nouveaux
faits qui fe rangent eux-mêmes en ordre de fyftè-
me. Ces principes font pour nous les lois de la nature
, fous l’empire defquelles nous foûmettons tous
les phénomènes fubalternes ; étant comme le mot
de l’énigme, ils offrent dans une précifion lumineufe
plus de jeu 6c de facilité à l’efprit obfervateur, pour
étendre fes connoiffances. Enfin ils ont cet avantage
très-important, de nous détromper fur une infinité
de faits défigurés ou abfolument faux ; ces faits
difparoîtront ou fe rectifieront à leur lumière, comme
il eft facile de fuppléer une faute d’impreffion,
lorfqu’on a le fens de la chofe.
Mais pour établir ces principes généraux, qui ne
font proprement que des effets généraux apperçûs
régulièrement dans la difcuffion des faits combinés,
il eft néceffaire que la généralifation ait été fevere
& exa&e ; qu’elle ait eu pour fondement une fuite
nombreufe & variée de faits liés étroitement, & continuée
fans interruption. Sans cette précaution, au-
lieu de principes formés fur des faits 6c des réalités,
vous aurez des abftraftions générales d’où vous ne
pourrez tirer aucun fait qui fe retrouve dans la nature.
De quel ufage peuvent être des principes qui
ne font pas le germe des découvertes ? 6c comment
veut-on qu’une idée étrangère à la nature , en préfente
le dénouement ? Ce n’eft feulement que de ce
que vous tirez du fonds de la nature, 6c de ce qu’elle
vous a laifle v o ir , que vous pouvez vous fervir
comme d’un inftrument sûr pour dévoiler ce qu’elle
vous cache.
Si l’indudion par laquelle vous avez généralifé,
n’a pas été éclairée par un grand nombre d’obfervations
, le réfultat général aura trop d’étendue : il ne
comprendra pas tous les faits qu’on voudra lui foû-
mettre ; 6c cet inconvénient a pour principe cette
précipitation blâmable q u i, au lieu de craindre des
exceptions où les faits manquent, 6c où leur lumière
nous abandonne , fe laiffe entraîner fur les fimples
foupçons gratuits d’une régularité confiante.
On voit aifément que cette méprife n’a lieu que
parce que dans la difcuffion des faits on n’a pas dif-
tingué l’effentiel de l’acceffoire, 6c que dans l’énumération
6c la combinaifon des phénomènes on a
formé l’enchaînement fans y comprendre les exceptions
; il falloit en tenir un compte auffi exaCt, que
des convenances qui ont fervi aux analogies.
D ’un autre côte je remarque que les obfervations
vagues 6c indéterminées ne peuvent fervir à l’éta-
bliffement d’aucun principe. Toutes nos recherches
doivent avoir pour but de vérifier, d’apprécier tous
les faits, & de donner fur-tout une forme de précifion
aux réfultats : fans cette attention, point de con-
noifi'ance certaine, point de généralifation , point
de réfultats généraux.
Les principes ont fouvent trop d’étendue ,, parce
qu’ils ont été rédigés fur des vûes ambiticufes, die*
tées par une hypothèfe favorite ; car alors dans tout
le cours de fes obfervations on a éludé par diffimu-
lation ou par des diftinétions fubtiles, les exceptions
fréquentes : on les a négligées comme inutiles, 6c
l’on a toûjours pourfuivi, au milieu de ces obfta-
cles , la généralifation des réfultats. Si dans la fuite
on trouve des faits contraires, on les ajufte comme
s’ils étoient obligés de fe prêter à une réglé trop générale.
D ’autres réfultats fe préfentent fouvent avec une
infinité de modifications 6c de reftridions, qui font
craindre qu’ils ne foient encore fubordonnés à d’autres.
Cette timidité avec laquelle on eft obligé de
mettre au jour fes principes, vient d’un défaut d’obfervations
; il n’y a d’autre parti à prendre pour leur
affûrer cette folidité, cette étendue, cette précifion
qu’ils méritent peut-être d’acquérir, que de conful-
ter la nature : fans cela, les principes dont la généralifation
n’eft pas pleine & entière, dont l’application
n’eft pas fixe & déterminée, feront continuellement
une fource de méprifes 6c d’illufions.
Ce n’eft qu’en s’appuyant fur des faits difcutés
avec foin, liés avec fagacité, généralifés avec discernement
, que l’on peut fe dater de tranfmettre à
la poftérité des vérités folides , des réfultats généraux
& inconteftables, enfin des principes féconds
6c lumineux.
11. Lorfqu’on jette un premier coup-d’oeil fur notre
globe, la divifion la plus générale qui fe préfente
, eft celle par laquelle on le conçoit partagé en
grands continens 6c en mers. Comme dans la partie
couverte d’eau on rencontre plufieurs pointes de
terre qui s’élèvent au-deffus des flots, & qu’on appelle
îles, de même on remarque, en parcourant les
continens, des efpaces couverts d’eau ; fi elle y fé-
journe, ce font des lacs; fi elle y circule, ce font des
fleuves ou des rivières.
Les deux portions générales de terres fermes & de
mers s’étendent réciproquement l’une dans l’autre ,
6c en différens fens. Dans les diverfes configurations
relatives des limites qui circonfcrivent ces deux parties
de notre globe, on obferveque la mer environne
de tous côtés quatre grands continens, & qu’elle pénétré
en plufieurs endroits dans ^intérieur des terres
: ce font des mers Méditerranées, des golfes, des
baies, des anfes. D ’un autre côté, les continens forment
des avances confidérables dans le baffin de la
mer j ce font des caps, des promontoires, des penin-
fules. Le canal reflerré par lequel la mer coule entre
deux terres pour former des golfes, fe nomme détroit.
Il y a trois fortes de détroits, en tant que l’on
confidere les terres qui forment les bords du canal ;
ou ces deux lames de terre appartiennent au même
continent, ou elles font partie d’un continent 6c d’une
île , ou enfin elles font les rivages opofés de deux îles.
Les détroits, fous un autre rapport, peuvent être
confidérés comme formant une communication d’un
baffin à un autre, 6c l’on en peut auffi diftinguer de
trois fortes ; ceux qui forment une communication
d ’une mer à une mer, comme celui de Magellan ;
d’une mer à une baie, comme celui de Babelmandel *
qui réùnit le golfe arabique à la mer des Indes ; ou
enfin d’une baie à une b aie, comme celui des Dardanelles.
Il y a des golfes qui s’étendent en longueur,
d’autres s’arrondiffent à leurs extrémités, 6c préfentent
une vafte ouverture fans d’autres détroits que
ceux qui font formés entre une île 6c un continent
ou bien entre une île & une île : tels font ceux du
Mexique , de Bengale. Enfin quelques-uns fe ramifient
en plufieurs branches, comme la mer Baltique.
Une lame de terre reflerrée entre deux mers, fe
nomme iflhme. Les ifthmes réunifient de grandes
portions de continens à d’autres, 6c des prefqu’iles
aiix- côntinens.
Je reprends cés idées, 6c j’oppofe les continens
aux mers, les îles aux lacs, les golfes aux prefqu’îles,
& les détroits aux ifthmes. Ce font des configurations
correfpondantes & oppofées / qu’il eft bon de faifir
fous ce point de vûe d’oppofition.
Dans la difcuffion des affections générales du globe,
que nous venons de difféquer en indiquant la nomenclature
de fes différentes configurations, il eft
néceflaire de fuivre quelque plan.
i °. Nous préfenterons d’abord les réfultats généraux
des obfervations qui ont un rapport direû avec l’or-
ganifation confiante 6c régulière du globe, & nous
envifagerons cet objet fous deux points de vûe différens
; Torganifation extérieure^ & l’organifation intérieure.
t z°. Nous nous occuperons des phénomènes généraux
qui paroiffent indiquer une altération dans
cette organifation confiante.
3°. Enfin les affections relatives de la terre, dépendantes
de l’atmofphere 6c des différens afpeCts
du globe par rapport au Soleil 6c à la Lune , feront
la matière de la troifieme feftion.
Affections générales de Vorganifation extérieure du j
globe. La terre ferme comprend quatre grands continens
: i° l’ancien : z° le nouveau : 30 les terres
auftrales connues ou foupçonnées : 40 les terres arctiques
, dont la féparation d’avec l’Amérique n’eft
pas encore bien déterminée ; la configuration des
terres auftrales eft encore moins connue. Nous nous
bornerons donc à raifonner fur l’ancien & le nouveau
continent.
En confidérant avec attention l’ancien continent
& l’e nouveau, on obferve que l’ancien eft plus étendu^
vers le nord que vers le fud de l’équateur, 6c
qu au contraire le nouveau l’efl plus au fud qu’au
nord de lequateur. On voit auffi que le centre de
l ’ancien continent fe trouve à 16 ou 18 degrés de
latitude nord, 6c celui du nouveau à 16 ou 18 degrés
de latitude fud. Ce centre eft déterminé par l’inter-
fedion des lignes menées fur les plus grandes lon-
gueurp 6c largeurs des continens.
Ils ont encore cela de remarquable, qu’ils paroifi
fent comme partagés en deux parties qui feroient
toutes quatre environnées d’eau, 6c formeroient des
continens a part, fans deux petits ifthmes ou étran-
glemens de terre ; celui de Suez & celui de Panama.
Le premier eft produit en partie par la mpr Rouge
, qui femble 1 appendice & le prolongement d’une
grande anfe avancée dans les terres de l’eft à l’oiieft,
& en partie par la Méditerranée. L’autre eft de même
produit par le golfe du Mexique , qui préfente une
large ouverture de l’eft à l’oüeft.
Bacon obferve que ce n’eft pas fans quelque raifon
que les deux continens s’élargiflent beaucoup vers
le nord, fe retréciffent vers le milieu , & alongent
une pointe affez aiguë vers le midi. On peut même
ajouter que les pointes de toutes les grandes prefqu’îles
formées par les avances des continens, regardent
le midi ; que quelques-unes même font coupées
par des détroits dont le canal eft dirigé de l’eft à
l’oüeft. 0
Si nous voyageons maintenant fur la partie feche
du globe, nous y remarquerons d’abord différentes
inégalités à fa furface, de longues chaînes de montagnes,
des collines,des vallons, des plaines. Nous
appercevrons que les diverfes portions des continens
affeélent dès pentes affez régulieres.depuis leur centre
, ou depuis les fpmmets élevés des chaînes qui les
traverfent, jufque fur les côtes de la mer, ou le ter-
rein s’abaifle fous l’eau pour former la profondeur
de fon baffin : réciproquement, en remontant des
rivages de la mer vers le centre des continens, nous
trouvons que le terrein s’élève jufqu’à certains
points qui dominent de tous côtés fur les terres qui
les environnent.
Ofons fonder la profondeur des mers, nous trouverons
qu’elle augmente à-mefure que nous nous
éloignons davantage des côtes, 6c qu’elle diminue
au contraire à-mefure que nous nous en approchons
davantage ; enforte que le fond de la mer gagne par
1 une élévation infenfible les terres qui s’élèvent au-
deffus des flots. Dans le même examen nous découvrons
que la vafte étendue du baffin de la mer nous
offre des inégalités correfpondantes à celles des continens
; il a fes vallées 6c fes montagnes : les roches
à fleur d’eau, les îles , ne font que -les fommets les
plus élevés des chaînes montueufes qui fillonnent
par diverfes ramifications la partie du globe que
la mer recouvre.
Je remarque que les eaux de la mer, en fe répandant
dans de grandes vallées où le terrein eft affu-
jetti à des pentes plus rapides, ont formé les golfes,
les mers Mediterranees ; 6c que réciproquement les
terres éprouvant une irrégularité dans leur abaiffe-
ment vers les côtes de la mer, 6c fe prêtant moins à
la courbure des terreins qui fe plongent fous les flots,
s’avancent au milieu des eaux, 6c forment des caps,
des promontoires, des prefqu'îles.
Entrons maintenant dans un plus grand détail, &
examinons de plus près chaque objet dont les différentes
particularités nous échappoient dans le lointain
ou ils ont été préfentés.
Nous reconnoiffons d’abord que toutes les montagnes
forment différentes chaînes principales qui fe
lient, s’uniffent, 6c embraffent tant par leurs troncs
principaux que par leurs ramifications collatérales
la furface des continens. Les montagnes, qui font
proprement les tiges principales, préfentent des
mafles très-confidérables & par leur hauteur & par
leur volume ; elles occupent 6c traverfent ordinairement
le centre des continens : celles de moindre
hauteur naiffent de ces chaînes principales ; elles diminuent
infenfiblement à-mefure qu’elles s’éloignent
de leur tige, 6c vont mourir ou fur les côtes de la
mer, ou dans les plaines : d’autres fe foûtiennent en-.