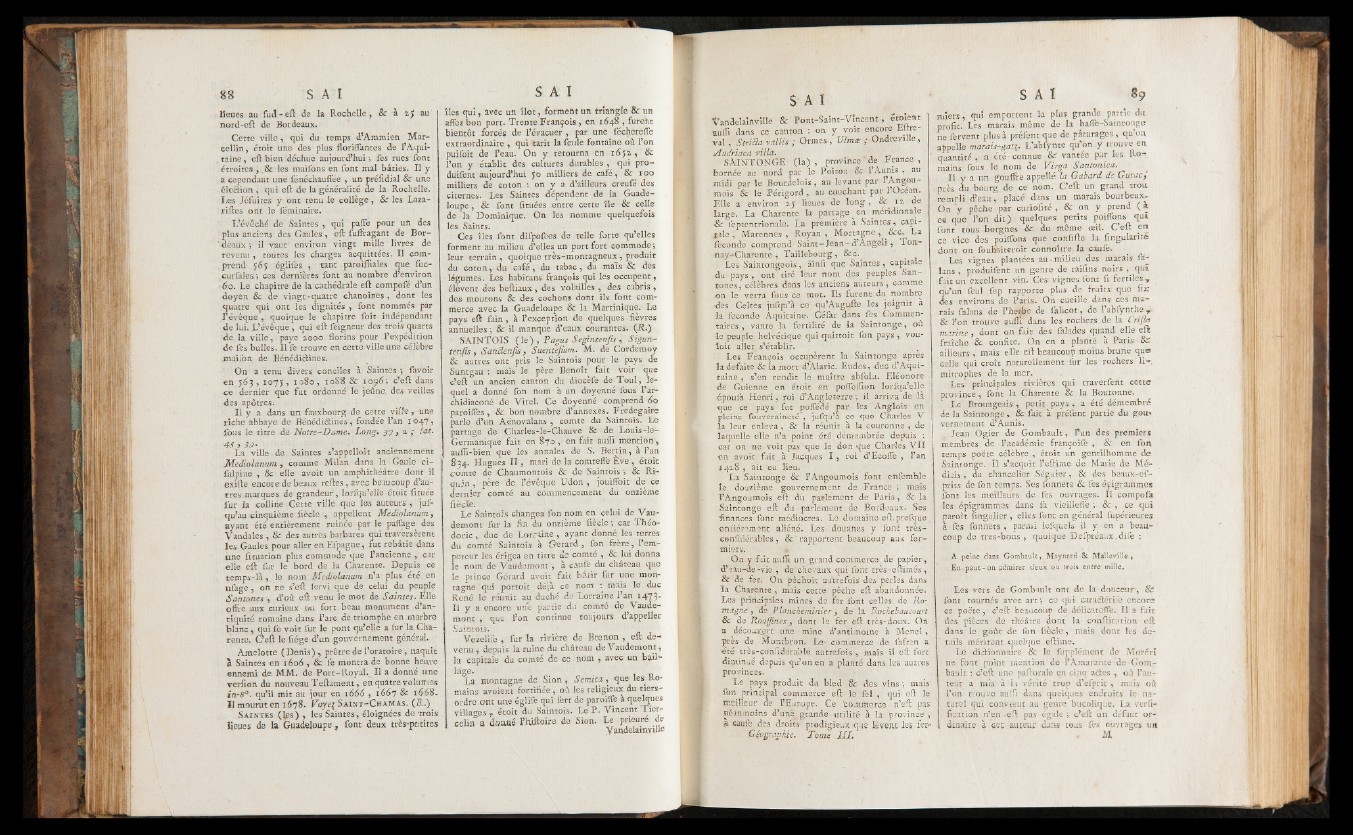
88 S A I
lieues au fud-e ft de la Rochelle, & à 25 au
nord-eft de Bordeaux.
Cette v ille , qui du temps d’Ammien Marcellin,
étoit une des plus floriffantes de l’Aquitaine,
eft bien déchue aujourd’hui-, fes rues font
étroites , _& les maifons en font mal bâties. Il y
a cependant une fénéchauffée , un préfidial & une
éleétion , qui eft de la généralité de la Rochelle. I
Les Jéfuites y ont tenu le collège, 8c les Laza-
riftes ont le féminaire.
L’évêché de Saintes , qui pafle pour un des
plus anciens des Caules, eft fuftragant de Bordeaux
; il vaut environ vingt mille livres de
revenu , toutes les charges acquittées. Il com-
, prend 565 églifes , tant paroiffiales que fuc-
curfales -, ces dernières font au nombre d’environ
60. Le chapitre de la cathédrale eft compofé d’un
doyen 8c de vingt-quatre chanoines , dont les
quatre qui ont les dignités , font nommés par
l’évêque , quoique le chapitre foit indépendant
de lui. L’évêqiiè, qui eft feigneur des trois quarts
'de la v ille , paye 2000 florins pour l’expédition
de fes bulles. Il le trouve en cette ville une célèbre
maifon de Bénédi&ines.
’ On a tenu divers conciles à Saintes ; favoir
en 563 , 1075 , 1080, 1088 & 10$6-, c’eft dans
ce dernier que fut ordonné le jeûne, des veilles
des apôtres.
Il y a dans un fauxbourg de celte v ille , une
riche abbaye de Bénédiétines, fondée l’an 1 0 4 7 »
fous le titre de Notre-Dame. Long. 3 7 , a ; lot.
45 > 37- g S S l ; -
La ville de Saintes s’appelloit anciennement
Mediolànum, comme Milan dans la Gaule ci-
falpine , & elle avoit un amphithéâtre dont il
exifte encore de beaux reftes, avec beaucoup d’autres
marques de grandeur, lorfqu’elle étoit fituée
lur la colline Cette ville que les auteurs , juf-
qu’au cinquième ftècle , appellent Mediolànum,
ayant été entièrement ruinée par le paffage des
Vandales , 8c des autres barbares qui traversèrent
les Gaules pour aller en Efpagne, fut rebâtie dans
une fituation plus commode que l’ancienne, car
elle eft fi ir le bord de la Charente. Depuis ce
temps-là, le nom Mediolànum n’ a plus été en
ufage, on ne s’eft fervi que de celui du peuple
Santanes , d’où eft venu le mot de Saintes. Elle
offre aux curieux usi fort beau monument d’antiquité
romaine dans l’arc de triomphe en marbré
blanc, qui fe voit fur le pont qu’elle a fur la Charente.
C’ eft le liège d’un gouvernement général.
Amelotte (D en is ) , prêtre de l’oratoire, naquit
à Saintes en 1606, 8c fe montra de bonne heure
ennemi de MM. de Port-Royal. Il a donné une
verfion du nouveau Teftament, en quatre volumes
zn-8°. qu’il mit au jour en 1666 , 1667 & 166$.
Il mourut en 1A78. Voye{ Saînt- C hamas. ( & y
Saintes (fes) , les Saintes, éloignées de trois
lieues de la Guadeloupe * font deux très-petites
s a 1
îles qui, avec un îlo t , forment un triangle & un
allez bon port. Trente François, en 1648 , furent
bientôt forcés de l’évacuer , par une féchereffe
extraordinaire , qui tarit la feule fontaine où l’on
puifoit de l’eau. On y retourna en 1652 , 8c
l’on y établit des cultures durables , qui pro-
duifent aujourd’hui 50 milliers de café, & 100
milliers de coton : on y a d’ailleurs creufé des
citernes. Les Saintes dépendent de la Guadeloupe
, 8c font fituées entre cette île 8c celle
de la Dominique. On les nomme quelquefois
les Saints.
- Ces îles font difpofees de telle forte qu’elles
forment au milieu d’ elles un port fort commode;
leur, terrain , quoique très-montagneux, produit
du coton, du café, du tabac, du maïs & des
légumes. Les habitans françois qui les occupent,
élèvent des beftiaux, des volailles , des ■ cabris ,
des moutons & des cochons dont ils font commerce
avec la Guadeloupe & la Martinique. Le
pays eft fain, à l’exception de quelques fièvres
annuelles ; & il manque d’eaux courantes. (R.)
SAINT OIS ( le) , Pagus Segintenjis , Sigun-
tenjis , 1Sanâenjis, Suentèjium. M. de Cordemoy
& autres ont pris le Saintois pour le pays de
Suntgau : mais le père Benoît fait voir que
c’eft un ancien canton du diocèfe de Toul, lequel
a donné foh nom à un doyenne fous l’ ar-
chidiaconé de Vitel. Ce doyenné comprend 60
paroiffes, 8c bon nombre d’annexes. Fredëgaire
parle d’un Aënovalans , comte du Saintois. Le
partage de Charles-le-Chauve & de Louis-le-
Germanique fait en 870 , en fait auffi mention,
aufii-bien que les annales de S. Bertin, à l’ an
834. Hugues I I , mari de la comtefle Ève , étoit
c'omte de Chaumontois & de Saintois ; & Ri-
q ijn , père de l’évêque Udon , jouiflbit de ce
dernier comté au commencement du onzième
fiècïe. '
Le Saintois changea fon nom en celui de Vau-
demont fur la fin du onzième fiècle ; car Théo-
dorie,. duc de Lorraine, ayant donné les terres
du comté - Saintois à Gérard , fon frère, l’empereur
les érigea en titre û«3 comte , & lui donna
le nom de Vaudemont, à caufe du château que
le prince Gérard avoit fait bâtir fur une montagne
qui portoit déjà ce nom : mais le' duc
René le réunit au duché de Lorraine l’ an 1473*
Il y a encore une partie du comte de Vaudemont
, que l’on continue toujours d’appeller
Saintois.
Vezelife , fur la rivière de Brenon , eft devenu
, depuis la ruine du chateau de Vaudemont,
la capitale du comté de ce nom , avec un bail-
La montagne de Sion , Semita , que les^ Romains
avoient fortifiée, où les religieux du tiers-
ordre ont une églïfe qui fert de paroiffe à quelques
villages t étoit du Saintois. Le P. Vincent Tier-
celin a dnnné l’hiftoire de Sion. Le prieuré de
yandelainville
S A I
Vandelaifivllle & Pont-Saint-Vmcent -, étolent
-aufïi dans ce canton : on y voit encore Eltre-
v a l , Stricla vallis ; Ormes,, Ulmoe ; ■ Ondrcyille,
Audriaca villa.
SÀINTONGE ( l a ) , province'de France,
bornée au nord par le Poitou 8c l’Aunis , au
midi par le Boùrdelois, au levant par 1 Angou-
mois 8c le Périgord, au couchant par l’Océan.
Elle a environ 2-5 lieues de lo n g , 8c 12 de
large. La Charente la partage en méridionale.
■ 8c leptentrionale. La première à Saintes, capitale
, Marennés , Royan , Mortagne , 8cc. La
fécondé comprend Saint-Jean-d’A n geli, Ton-
tiay-Charente , Taillebourg, &c.
• Les Saintongeois, âînfi que Saintes, capitale
du pays , ont tiré leur nom des peuples San-
tones, célèbres dans les anciens auteurs, comme
on le verra fous ce mot. Ils furent du nombre
•des Celtes jufqu’ à ce' -qu’Augufte les joignit a
la fécondé Aquitaine. Céfar dans fes Commentaires
, vante la fertilité de là Saintonge, ou
le peuple helvétique qui quittoit fon pays, vou-
loit aller s’établir.
Les François occupèrent la Saintonge apres
la défaite 8c la mort d’Alaric. Eudes, duc d’Aquitaine
, s’ en rendit le maître abfolu. Eléonore
de Guienne en étoit en poffeffion lorfqu’elle
époufa Henri, roi d’Angleterre; il arriva de là
que ce pays fut poffédé par les ' Anglois en
pleine fouveraineté , jufqu’a ce que Charles V
la leur enleva, & la réunit à la couronne , de
laquelle elle n’ a point été démembrée depuis :
car on ne voit pas que le don que Charles V i l
en avoit fait à Jacques I , roi d’Ecoffe , l’an
1428 , ait eu lieu.
La Saintonge 8c l’Angoumois font enfemble
le douzième gouvernement de France ; niais
l’Angoumois eft du parlement de Paris, & la
Saintonge eft du' parlement de Bordeaux. Ses
finances font médiocres. Le domaine eft>prefque .
entièrement aliéné. Les douanes y font tres-
confîdérables, & rapportent beaucoup aux fermiers.
On y fait auffi un grand commerce de papier,
d’eau-de-vie , de chevàux qui font très-eftimés ,
& de fer. On pêchoit autrefois' des'perles dans
la Charente, mais cette pêche eft abandonnée.
Les principales mines de fer l'ont celles de Ro-
:màgne, de Plancheminier, de la Rochebaucourt
8c de Roujjînes, dont le fer eft très-doux. On
a découvert une mine d’antimoine à M en e l,
près de Montbron. Le" commerce de fafran a
'été très-cônfidérable autrefois , mais il eft fort
diminué depuis qu’on en a planté dans les. autres
provinces.
Le pays produit du bled 8c des vins ; mais
fon principal commerce eft le fel , qui eft le
meilleur de l’Europe. Ce commerce n’eft pas
néanmoins d’une grande utilité à la province ,
a caufe des droits prodigieux que lèvent les fei>
• Gfrgraphie. Tome I I I ,
S A I 89
mîers, qui emportent la plus grande partie du
profit. Les marais même de la baffe-Saintonge
ne-fervent plus à préfent que de pâturages , qu on
appelle marais-gat\. L’ablynte qu’on y trouve en
quantité, a été connue 8c vantée par les Romains
fous le nom de Virga Santonica.
Il y a un gouffre appelle la Gabard de Guracf
près du bourg de ce nom. C’eft un grand trou
rempli d’eau, placé dans un marais bourbeux.
On y pêche par curiofité , 8c on y prend ( a
es que l’on dit) quelques petits poiffons qui
font tous borgnes 8c du même oeil. C’ eft en
ce vice des poiffons que confifte la. fingularit©
dont on fouhàiteroit connoître la caufe.
Les vignes plantées au * milieu des marais fa-*
lans , produifent un genre de raifins noirs , qui
Tait un excellent vin. Ces vignes font fi fertiles,
qu’un fèiil fep rapporte plus de fruits que fix
des environs de Paris. On cueille dans ces Marais
falans de l’hesbe de falicot, de l’abfyntheÿ
8c l’on trouve auffi dans les rochers de la Crifla
marine , dont on fait des falades quand elle eft
fraîche 8c confite. Ôn en a planté à Paris &
ailleurs , mais elle eft beaucoup moins brune qu©
- celle qui croît naturellement fur les rochers li-r.
mitrophes de la mer.
Les principales rivières qui traverfent cette
province, font la Charente 8c la Boutonne.
Le Brouageais , petit pays, a été démembre
de la Saintonge, & fait à préfent partie du gou-«
vernement d’Aunis.
Jean Ogier de Gombault, l’ un des premiers
membres de l’académie françoile , 8c en fon
temps poëte célèbre , étoit un gentilhomme de
SainrOnge. Il s’acquit l’eftime de Marie de Mé-
dicis, du chancelier Séguier, 8c des beaux-el-
prits de fon temps. Ses fonnets 8c fes épigrammes
font les meilleurs de fes ouvrages. Il compofa
les épigrammes dans fa vieilleflë ; & , ce qui
paroît fingulier , elles font en général fupérieures
a fes fonnets , parmi lefquels il y en a 'béait-
| coup de très-bons , quoique Delpréaax .dite ;
A peine dans Gombault, Maynard & Maüeville ,
En peut-pn admirer deux ou trois entre mille.
Les vers de Gombault ont de la douceur-, &
font tournés avec art ; ee qui caractérise encore
ce poëte,' c’ eft beaucoiwp de délicateffe. Il a fait
des pièces de théâtre dont la conftitution eft
dans, le goût de fon fiècle, mais dont les détails
méritent quelque eftime.
Le dictionnaire 8c le fupplément de Morérî
ne font point mention de l’Amarante de Gombault
: c’eft une paftorale en cinq actes , où l’auteur
a mis à la vérité trop d’efprit , mais où
l’ on trouve àüffi dans quelques endroits le naturel
qui convient au genre bucolique. La verfi-
iica tion n’en /-eft pas égale ; c’ eft un défaut ordinaire
à «et auteur dans tous fes ouvrages un
I M.