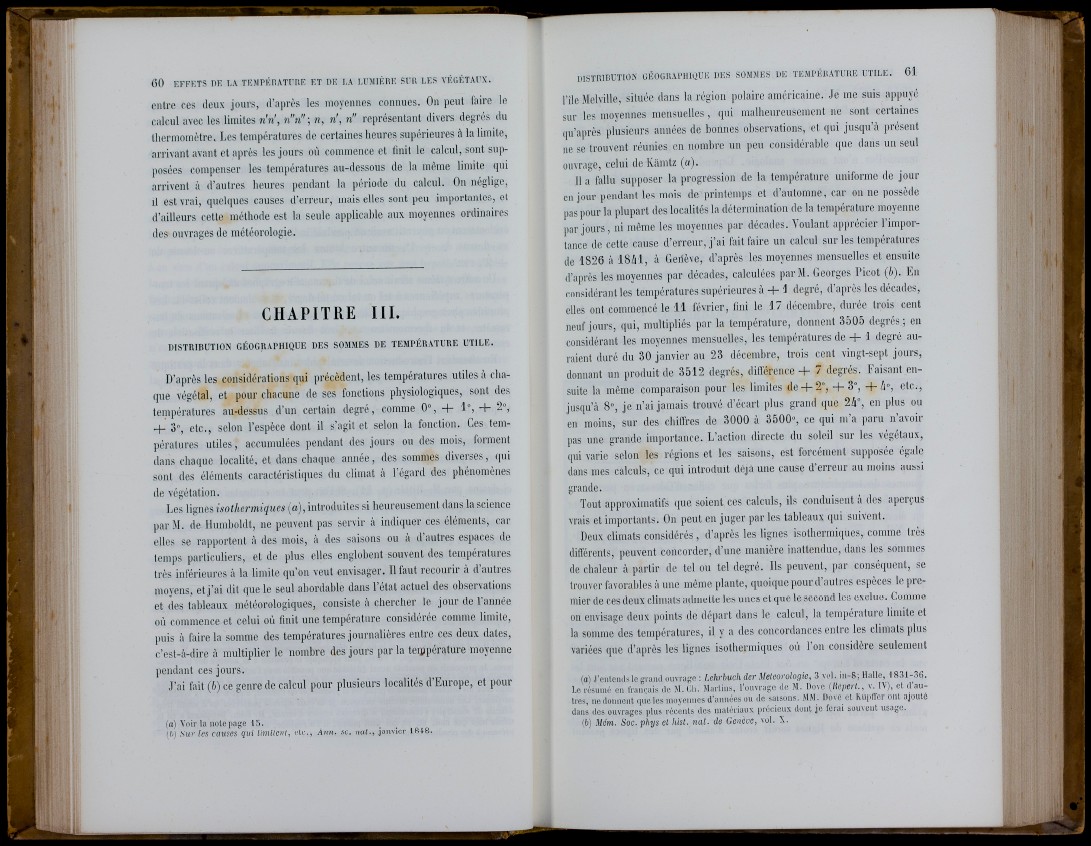
6 0 EFFKTS nE LA TEMPKRATt'RE ET DE LA LUMIÈRE SUR LES VÉGÉTAUX.
entre ces deux jours, d'après les moyennes connues. On peut faire le
calcul avec les limites n'n\ nV;n, n', n" représentant divers degrés du
thermomètre. Les températures de certaines heures supérieures à la limite,
arrivant avant et après les jours où commence et finit le calcul, sont supposées
compenser les températures au-dessous de la même limite qui
arrivent à d'autres heures pendant la période du calcul. On néglige,
il est vrai, quelques causes d'erreur, mais elles sont peu importantes, et
d'ailleurs cette méthode est la seule applicable aux moyennes ordinaires
des ouvrages de météorologie.
CHAPITRE III.
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES SOMMES DE TEMPÉRATURE UTILE.
D'après les considérations qui précèdent, les températures utiles à chaque
végétal, et pour chacune de ses fonctions physiologiques, sont des
températures au-dessus d'un certain degré, comme 0% -f- 1°, - h 2°,
+ 0% etc., selon l'espèce dont il s'agit et selon la fonction. Ces températures
utiles, accumulées pendant des jours ou des mois, forment
dans chaque localité, et dans chaque année, des sommes diverses, qui
sont des éléments caractéristiques du climat à l'égard des phénomènes
de végétation.
Les lignes isothermiques (a), introduites si heureusement dans la science
par M. de Humboldt, ne peuvent pas servir à indiquer ces éléments, car
elles se rapportent à des mois, à des saisons ou à d'autres espaces de
temps particuliers, et de plus elles englobent souvent des températures
très inférieures à la limite qu'on veut envisager. Il faut recourir à d'autres
moyens, et j'ai dit que le seul abordable dans l'état actuel des observations
et des tableaux météorologiques, consiste à chercher le jour de l'année
où commence et celui où finit une température considérée comme limite,
puis à faire la somme des températures journalières entre ces deux dates,
c'est-cà-dire à multiplier le nombre des jours par la température moyenne
pendant ces jours.
J'ai fait {h) ce genre de calcul pour plusieurs localités d'Europe, et pour
(a) Vnir la notepage 15.
(/)) Sur ¡es cansos qui UmiletU, etc., Ánn. se. nal-, janvier 1848.
mSTRIBUÏlON GÉOGRAPUiaUE UES SOMMES DE TEMPÉRATURE UTILE. 61
l'iie Melville, située dans la région polaire américaine. Je me suis appuyé
sur les moyennes mensuelles, qui malheureusement ne sont certaines
qu'après plusieurs années de bonnes observations, et qui jusqu'à présent
ne se trouvent réunies en nombre un peu considérable que dans un seul
ouvrage, celui de Kamtz (a).
11 a fallu supposer la progression de la température uniforme de jour
en jour pendant les mois de printemps et d'automne, car on ne possède
pas pour la plupart des localités la détermination de la température moyenne
par jours, ni même les moyennes par décades. Voulant apprécier l'importance
de cette cause d'erreur, j'ai fait faire un calcul sur les températures
de 1826 à I8/1I, à Genève, d'après les moyennes mensuelles et ensuite
d'après les moyennes par décades, calculées par M. Georges Picot (b). En
considérant les températures supérieures à -4- i degré, d'après les décades,
elles ont commencé le 11 février, fini le 17 décembre, durée trois cent
neuf jours, qui, multipliés par la température, donnent 3505 degrés; en
considérant les moyennes mensuelles, les températures de + 1 degré auraient
duré du 30 janvier au 23 décembre, trois cent vingt-sept jours,
donnant un produit de 3512 degrés, différence + 7 degrés. Faisant ensuite
la même comparaison pour les limites cle-f 2°, + 3% etc.,
jusqu'à 8", je n'ai jamais trouvé d'écart plus grand que 2Zi", en plus ou
en moins, sur des chiffres de 3000 à 3500% ce qui m'a paru n'avoir
pas une grande importance. L'action directe du soleil sur les végétaux,
qui var ie\elon les régions et les saisons, est forcément supposée égale
dans mes calculs, ce qui introduit déjà une cause d'erreur au moins aussi
grande.
Tout approximatifs que soient ces calculs, ils conduisent à des aperçus
vrais et importants. On peut en juger par les tableaux qui suivent.
Deux climats considérés, d'après les lignes isothermiques, comme très
différents, peuvent concorder, d'une manière inattendue, dans les sommes
de chaleur à partir de tel ou tel degré. Ils peuvent, par conséquent, se
trouver favorables à une même plante, quoique pour d'autres espèces le premier
de ces deux climats admette les unes et que le second les exclue. Comme
on envisage deux points de départ dans le calcul, la température limite et
la somme des températures, il y a des concordances entre les climats plus
variées que d'après les lignes isothermiques où l'on considère seulement
(a) J'entends le grand ouvrage : Lehrhuch der Meieorologie, 3 vol. in-8; Halle, 1 831-36.
Le résumé en IVançais de M. Ch. Marlins, l'ouvrage de M. Dove (liepert., v. IV), et d'autres,
ne donnent que les nmyeinies d'années ou de saisons. MM. Dove et KuplTcr ont ajoute
dans des ouvrages plus récents des matériaux précieux dont je ferai souvent usage.
(b) Mém. Soc. phys cl hist. nat. de Genève, vol. X.
fe
l
MvlimiifV.j
" ttr ^
ip
.R!. t