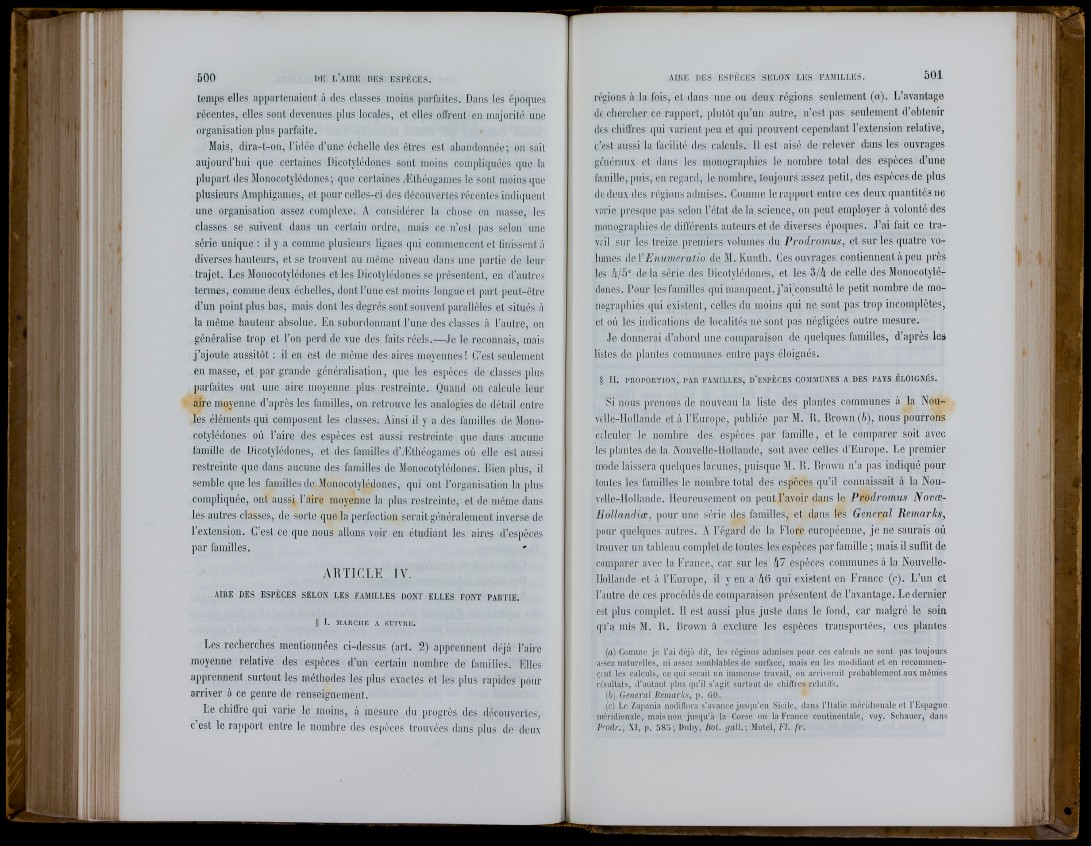
I.
. . . i
"f!
• .i-t
500 DE LAIRE DES ESPÈCES.
temps elles appartenaient à des classes moins parfaites. Dans les époques
récentes, elles sont devenues plus locales, et elles offrent en majorité une
organisation plus parfaite.
Mais, dira-t-on, l'idée d'une échelle des êtres est abandonnée; on sait
aujourd'hui que certaines Dicotylédones sont moins compliquées que la
plupart des Monocotylédones; que certaines /Ethéogamcs le sont moins (jue
plusieurs Amphigames, et pour celles-ci des découvertes récentes indi({ucnt
une organisation assez complexe. A considérer la cliose en masse, les
classes se suivent dans un certain ordre, mais ce n'est pas selon une
série unique : il y a comme plusieurs lignes qui commencent et Unissent à
diverses hauteurs, et se trouvent au même niveau dans une partie de leur
trajet. Les Monocotylédones et les Dicotylédones se présentent, en d'autres
termes, comme deux échelles, dont l'une est moins longue et part ])eut-etre
d'un point plus bas, mais dont les degrés sont souvent parallèles et situés à
la même hauteur absolue. En subordonnant Tune des classes à l'autre, on
généralise trop et l'on perd de vue des faits réels.—Je le reconnais, mais
j'ajoute aussitôt : il en est de même des aires moyennes! C'est seulement
en masse, et par grande généralisation, que les espèces de classes plus
parfaites ont une aire moyenne plus restreinte. Quand on calcule leur
aire moyenne d'après les familles, on retrouve les analogies de détail entre
les éléments qui composent les classes. Ainsi il y a des familles de Monocotylédones
où l'aire des espèces est aussi restreinte que dans aucune
famille de Dicotylédones, et des familles d'/Ethéogames où elle est aussi
restreinte que dans aucune des familles de Monocotylédones. Bien plus, il
semble que les familles do Monocotylédones, qui ont l'organisation la plus
compliquée, ont aussi l'aire moyenne la plus restreinte, et de même dans
les autres classes, de sorte que la perfection serait généralement inverse de
l'extension. C'est ce que nous allons voir eu étudiant les aires d'espèces
par familles.
ARTICLE IV.
AIRE DES ESPÈCES SELON LES FAIVULLES DONT ELLES FONT PARTIE.
§ L MARCHE A SUIVRE.
Les recherches mentionnées ci-dessus (art. 2) apprennent déjà l'aire
moyenne relative des espèces d'un certain nombre de familles. Elles
apprennent surtout les méthodes les plus exactes et les plus rapides pour
arriver à ce genre de renseignement.
Le chiffre qui varie le moins, à mesure du progrès des découvertes,
c'est le rapport entre le nondjre des espèces trouvées dans plus de deux
AlKE ms ESi'ÈCES SELON LES FAMiLLES. 50 1
régions à la fois, et dans une ou deux régions seulement (a). L'avantage
de cherclier ce rapport, plutôt qu'un autre, n'est pas seulement d'obtenir
des chiffres qui varient peu et qui prouvent cependant l'extension relative,
c'est aussi la facilité des calculs. 11 est aisé de relever dans les ouvrages
généraux et dans les monographies le nombre total des espèces d'une
famille, puis, en regard, le nombre, toujours assez petit, des espèces de plus
de deux des régions admises. Comme le rapport entre ces deux quantités ne
varie presque pas selon l'état de la science, on peut employer à volonté des
monographies de différents auteurs et de diverses époques. J'ai fait ce travail
sur les treize premiers volumes du Frodromus^ et sur les quatre volumes
deWEmimeraiio de M. KnidJi. Ces ouvrages contiennent à peu près
les /i/5" delà série des Dicotylédones, et les 3//i de celle des Monocotylédones.
Pour les familles qui manquent, j'ai'consulté le petit nombre de monographies
qui existent, celles dii moins qui ne sont pas trop incomplètes,
et où les indications de localités ne sont pas négligées outre mesure.
Je donnerai d'abord une comparaison de quelques familles, d'après les
listes de plantes communes entre pays éloignés.
§ fl. PROPORTION, PAR FAMILLES, D'ESPKCES COMMUNES A DES PAYS ÉLOIGNÉS,
Si nous prenons de nouveau la liste des plantes communes à la Nouvelle
Hollande et à l'Europe, publiée par M. R. Brown (6), nous pourrons
calculer le nombre des espèces par famille, et le comparer soit avec
les plantes de la Nouvelle-Hollande, soit avec celles d'Europe. Le premier
mode laissera quelques lacunes, puisque M. R. Brown n'a pas indiqué pour
toutes les familles le nombre total des espèces qu'il connaissait à la Nouvelle
Hollande. Heureusement on peut l'avoir dans le Prodromus Novoe-
Iloïlandioe^ pour une série des familles, et dans les General Remarks^
pour quelques autres. A l'égard de la Flore européenne, je ne saurais où
trouver un tableau complet de toutes les espèces par famille ; mais il suffit de
comparer avec la France, car sur les /i7 espèces communes à la Nouvelle-
Hollande et à l'Europe, il y en a Zi6 qui existent en France (c). L'un et
l'autre de ces procédés de comparaison présentent de l'avantage. Le dernier
est plus complet. Il est aussi plus juste dans le fond, car malgré le soin
qu'a mis M. B. Brown à exclure les espèces transportées, ces plantes
(a) Comme je l'ai déjà dit, les régions admises pom* cos calculs ne sont pas toujours
assez natureUes, ni assez semblables de surfacc, mais en les modiiiant et en recommeuçant
les calculs, ce (pii serait nn immense travail, on arriverait probablement aux mômes
résultats, d'autant ])lus qu'il s'ag'it surtout de chiiTrcs relatifs.
{b] General Remarks, p. 60.
(c) Le /apania nodiilora s'avance jusqu'en Sicile, dans l'Italie méridionale et l'Espagne
méridionale, mais non jusqu'à la Corse ou la France continentale, voy. Schauer, dans
Prodï\, XI, p. 585; Duby, Bot. gall.-, Mutel, FL fr.
ffe
I
f
é
I
1