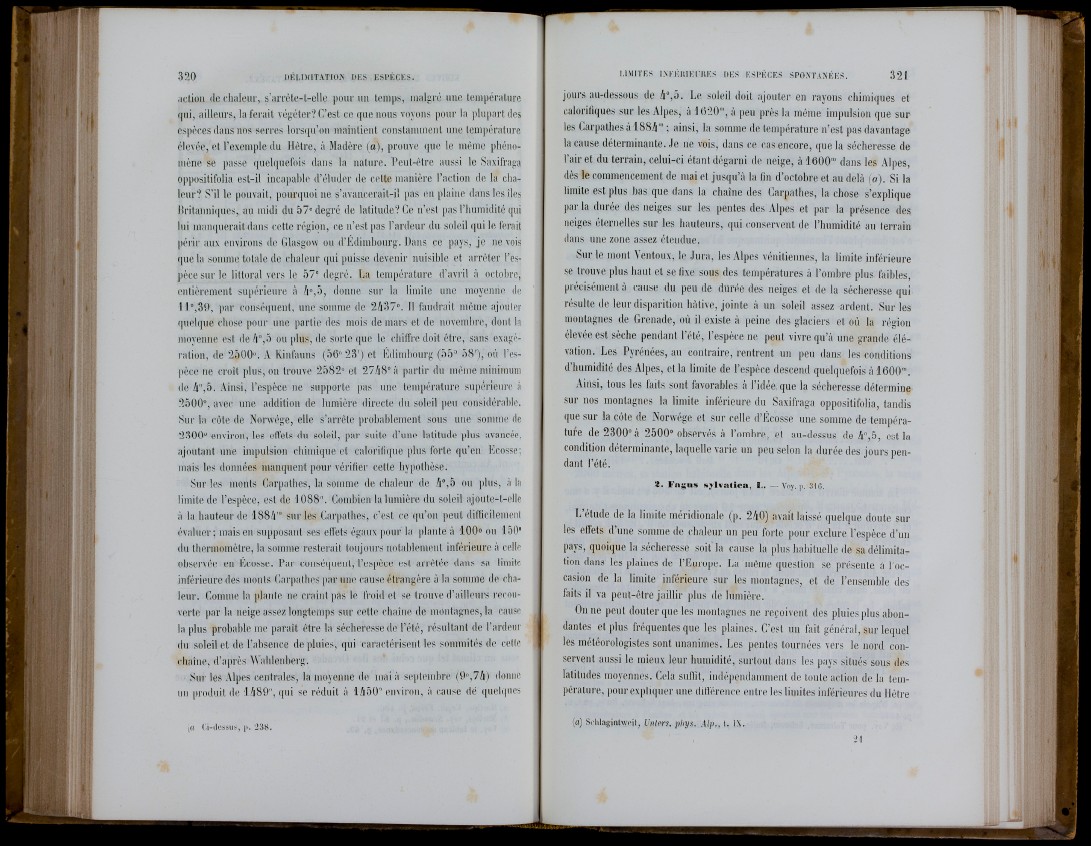
f- « ; Ml«
« -f I--. .
^ " iMè'
I Í
t
¥ i
t ' .
f Í ^
\ 'i i
:4a
i'H •
.'i
Ê
'•if
320 DELIMlTATIOiX DES ESPECES.
action (le clialeur, s^irrèle-L-elle pour un temps, malgré une température
qui, ailleurs, lai'erait végéter? C'est ce que nous voyous pour la plupart des
espèces dans nos serres lorsqu'ou maintient constamment une température
élevée, et l'exemple du Jlètre, à Madère (a), prouve (¡ue le même pliénomène
se passe (jnelquefois dans la nature. Peut-être aussi le Saxifrai^a
oppositifolia est-il incapal)le d'éluder de cette manière l'action de la chaleur?
S'il le pouvait, pourquoi ne s'avancerait-il pas en plaine dans les îles
J5ritanniques, au midi du 57« degré de latitude? Ce n'est pas l'humidité qui
lui manquerait dans cette région, ce n'est pas l'ardeur du soleil qui le ferait
périr aux environs de Glasgow ou d\Edimbourg. Dans ce pays, je ne vois
que la sonmie totale de chaleur qui puisse devenir nuisible et arrêter l'espèce
sur le littoral vers le 57" degré. La température d'avril à octobre,
ejrtiôrement supérieure à /|%5, donne sur la limite une moyenne do
11%39, par couséiiuent, une somme de 2/l37^ Il faudrait môme ajouter
fpielque chose pour une partie des mois de mars et de novembre, dont hi
moyenne est de A",5 ou plus, de sorte ([ue le chiifre doit être, sans exagération,
de 2500". A Kinfauns (56^23') et lidind)ourg (55^ 58% où l'espèce
ne croît plus, on trouve 2582° et 27/i8' à partir du même minimum
de Ainsi, l'espèce ne supporte i)as ime température supérieure à
2500% avec une addition de lumière directe du soleil peu considérable.
Sur la côte de Norwége, elle s'arrête probablement sous une somme de
2300^ environ, les effets du soleil, par suite d'une latitude plus avancée,
ajoutant une impulsion chimique et calorifique plus forte qu'en Ecosse;
mais les données manquent pour vérifier cette hypothèse.
Sur les monts Carpathes, la somme de chaleur de Zi%5 ou plus, à la
limite de l'espèce, est de 1088' \ Cond^ien la lumière du soleil ajoute-t-elle
à la hauteur de ISBZi'" sur les Carpathes, c'est ce (pi'on peut difficilenieni
évaluer ; niais en supposant ses efléts égaux j)our la plaute à 100° ou 150"
du thermomètre, la somme resterait toujours notablement inférieure à celle
observée en Ecosse. Par conséquent, l'espèce est arrêtée dans sa limite
inférieure des monts Carpathes par une cause étrangère à la somme de chaleur.
Comme la plaute ne craint pas le froid et se trouve d'ailleurs recouverte
par la neige assez longtemps sur cette chaîne de montagnes, la cause
la plus probable me paraît être la sécheresse de l'été, résultant de l'ardeur
du soleil et de l'absence de pluies, qui caj'actérisent les sommités de cetle
chaîne, d'après Wahlenberg.
Sur les Alpes centrales, la moyenne de mai à septeud)re (9%7[\) donne
un produit de 'i/l89'\ qui se réduit à 1/|50" environ, à cause dé (luelqnes
I.l.MrrES INKKUlKniKS DES ESPÈCES SPONTANÉES. 321
jours au-dessous de Le soleil doit ajouter en rayons chimiques et
calorifiques sur les Alpes, à i 620" , à peu près la même impulsion que sur
les Carpathes à I88/4'" ; ainsi, la somme de température n'est pas davantage
la cause déterminante. Je ne vois, dans ce cas encore, que la sécheresse de
Tair et du terrain, celui-ci étant dégarni de neige, à 1600"' dans les Alpes,
dès le commencement de mai et jusqu'à la fin d'octobre et au delà (a). Si la
limite est plus bas que dans la chaîne des Carpathes, la chose s'explique
par la durée des neiges sur les pentes des Alpes et par la présence des
neiges éternelles sur les hauteurs, qui conservent de l'humidité au terrain
dans une zone assez étendue.
Sur le mont Ventoux, le Jura, les Alpes vénitiennes, la limite inférieure
se trouve plus haut et se fixe sous des températures à l'ombre plus faibles,
précisément à cause du peu de durée des neiges et de la sécheresse qui
résulte de leur disparition hâtive, jointe à un soleil assez ardent. Sur les
montagnes de Grenade, où il existe à peine des glaciers et où la région
élevée est sèche pendant l'été, l'espèce ne peut vivre qu'à une grande élévation.
Les Pyrénées, au contraire, rentrent un peu dans les conditions
d'humidité des Alpes, et la limite de l'espèce descend quelquefois à 1600"'.
Ainsi, tous les faits sont favorables à l'idée que la sécheresse détermine
sur nos montagnes la limite inférieure du Saxífraga oppositifolia, tandis
que sur la côte de Norwége et sur celle d'Ecosse une somme de température
de 2300° à 2500« observés à l'ombre, et au-dessus de est la
condition déterminante, laquelle varie un peu selon la durée des jours pendant
l'été.
2. Fa^us H^U'saiici^, B.. — Voy. ji.
L'étude de la limite méridionale (p. 2/i0) avait laissé quelque doute sur
les effets d'une somme de chaleur un peu forte pour exclure l'espèce d'un
pays, quoique la sécheresse soit la cause la plus habituelle de sa délimitation
dans les plaines de l'Europe. La même question se présente à l'occasion
de la limite inférieure sur les montagnes, et de l'ensemble des
faits il va peut-être jaillir plus de lumière.
On ne peut douter que les montagnes ne reçoivent des pluies plus abondantes
et plus fréquentes que les plaines. C'est un fait général, sur lequel
les météorologistes sont unanimes. Les pentes tournées vers le nord conservent
aussi le mieux leur humidité, surtout dans les pays situés sous des
latitudes moyennes. Cela suffit, indépendamment de toute action de la température,
pour expliquer une difï'éreiice en tre les limites inférieures du Hêtre
(a) SchlaginUveit, Unlers, phys, Alp,, 1. iX.
S I