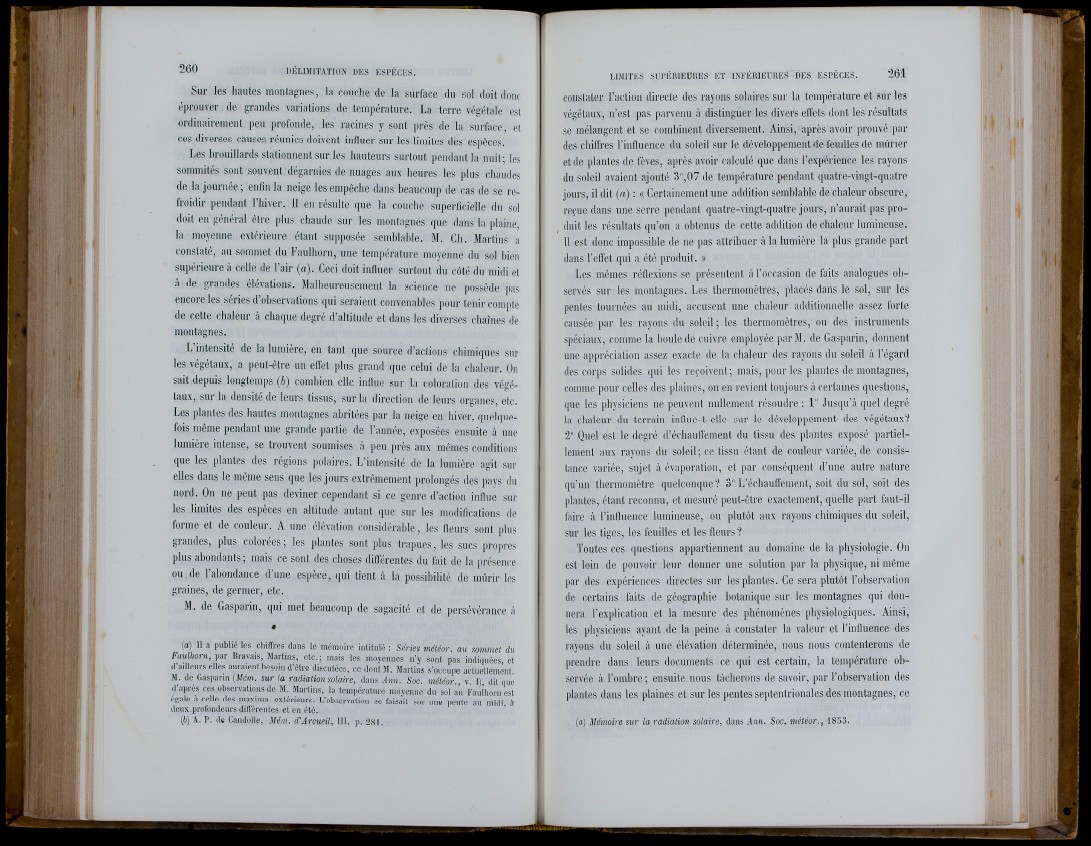
r
'1
eß.
4
fi
- V ir
V f
0t 5•
ïrï ^
h í .1
i
f
260 DÉLIMITATION DES ESPÈCES.
Sur les hautes montagnes, la couche de la surface du sol doit donc
éprouver de grandes variations de température. La terre végétale esl
ordinairement peu profonde, les racines y sont près de la surfoce, et,
ces diverses causes réunies doivent influer sur les limites des espèces.
Les brouillards stationnent sur les hauteurs surtout pendant la nuit; les
sommités sont souvent dégarnies de nuages aux heures les plus chaudes
de la journée ; enfin la neige les empêche dans beaucoup de cas de se refroidir
pendant l'hiver. Il en résulte que la couche superficielle du sol
doit en général être plus chaude sur les montagnes que dans la plaine,
la moyenne extérieure étant supposée semblable. M. Ch. Martins a
constaté, au sommet du Faulliorn, une température moyenne du sol bien
supérieure à celle de l'air (a). Ceci doit influer surtout du côté du midi et
à de grandes élévations. Malheureusement la science ne possède pas
encore les séries d'observations qui seraient convenables pour tenir compte
de cette chaleur à chaque degré d'altitude et dans les diverses chaînes de
montagnes.
L'intensité de la lumière, en tant que source d'actions chimiques sur
les végétaux, a peut-être un effet plus grand que celui de la chaleur. On
sait depuis longtemps (b) combien elle influe sur la coloration des végétaux,
sur la densité de leurs tissus, sur la direction de leurs organes, etc.
Les plantes des hautes montagnes abritées par la neige en hiver, quelquefois
même pendant une grande partie de l'année, exposées ensuite à une
lumière intense, se trouvent soumises à peu près aux mêmes conditions
que les plantes des régions polaires. L'intensité de la lumière agit sur
elles dans le même sens que les jours extrêmement prolongés des pays du
nord. On ne peut pas deviner cependant si ce genre d'action influe sur
les limites des espèces en altitude autant que sur les modifications de
forme et de couleur. A une élévation considérable, les fleurs sont plus
grandes, plus colorées; les plantes sont plus trapues, les sucs propres
plus abondants; mais ce sont des choses difl'érentes du fait de la présence
ou de l'abondance d'une espèce, qui tient à la possibilité de mûrir les
graines, de germer, etc.
M. de Gasparin, qui met beaucoup de sagacité et de persévérance i\
(a) 11 a publie les chiffres dans le memoire intituló : Séries météor, au sommet du
Faulhorn, par Bravais, MarUns, etc.; mais les moyennes n'y sont pas indiquées et
iVaiWenvs elles auraient besoin d'etre discutées, ce dont M. Martins s'occupe actuellement
M. de Gasparin {Mëm. sur la radiation solaire, dans Ami. Soc. météor,, v. ï) dit que
d'après ces observations de M. Martins, la température moyenne du sol au Faulhorn est
égale à celle des maxima extérieurs. L'observation se faisait sur une pente an midi à
deux profondeurs différentes et en été. '
(p) A. P. de Candolle, Mém. d'Arcueil, III, p. 281.
LIMITES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DES ESPÈCES. 261
constater l'action directe des rayons solaires sur la température et sur les
végétaux, n'est pas parvenu à distinguer les divers effets dont les résultats
se mélangent et se combinent diversement. Ainsi, après avoir prouvé par
des chiffres l'influence du soleil sur le développement de feuilles de mûrier
et de plantes de fèves, après avoir calculé que dans l'expérience les rayons
du soleil avaient ajouté S%07 de température pendant quatre-vingt-quatre
jours, il dit (a) : « Certainement une addition semblable de chaleur obscure,
reçue dans une serre pendant quatre-vingt-quatre jours, n'aurait pas produit
les résultats qu'on a obtenus de cette addition de chaleur lumineuse.
11 est donc impossible de ne pas attribuer à la lumière la plus grande part
dans l'effet qui a été produit. »
Les mêmes réflexions se présentent à l'occasion de faits analogues observés
sur les montagnes. Les thermomètres, placés dans le sol, sur les
pentes tournées au midi, accusent une chaleur additionnelle assez forte
causée par les rayons du soleil; les thermomètres, ou des instruments
spéciaux, comme la boule de cuivre employée par M. de Gasparin, donnent
une appréciation assez exacte de la chaleur des rayons du soleil à l'égard
des corps solides qui les reçoivent; mais, pour les plantes de montagnes,
comme pour celles des plaines, on en revient toujours à certaines questions,
que les physiciens ne peuvent nullement résoudre : 1" Jusqu'à quel degré
la chaleur du terrain influe-'t-elle sur le développement des végétaux?
2' Quel est le degré d'échauffement du tissu des plantes exposé partiellement
aux rayons du soleil; ce tissu étant de couleur variée, de consistance
variée, sujet à évaporation, et par conséquent d'une autre nature
qu'un thermomètre quelconque? o''L'échauffement, soit du sol, soit des
plantes, étant reconnu, et mesuré peut-être exactement, quelle part faut-il
faire à l'influence lumineuse, ou plutôt aux rayons chimiques du soleil,
sur les tiges, les feuilles et les fleurs?
Toutes ces questions appartiennent au domaine de la physiologie. On
est loin de pouvoir leur donner une solution par la physique, ni même
par des expériences directes sur les plantes. Ce sera plutôt l'observation
de certains faits de géographie botanique sur les montagnes qui donnera
l'explication et la mesure des phénomènes physiologiques. Ainsi,
les physiciens ayant de la peine à constater la valeur et l'influence des
rayons du soleil à une élévation déterminée, nous nous contenterons de
prendre dans leurs documents ce qui est certain, la température observée
ù l'ombre; ensuite nous tacherons de savoir, par l'observation des
plantes dans les plaines et sur les pentes septentrionales des montagnes, ce
(a) Mémoire sur la radiation solaire, dans Ann. Soc, météor., 1853.
i è