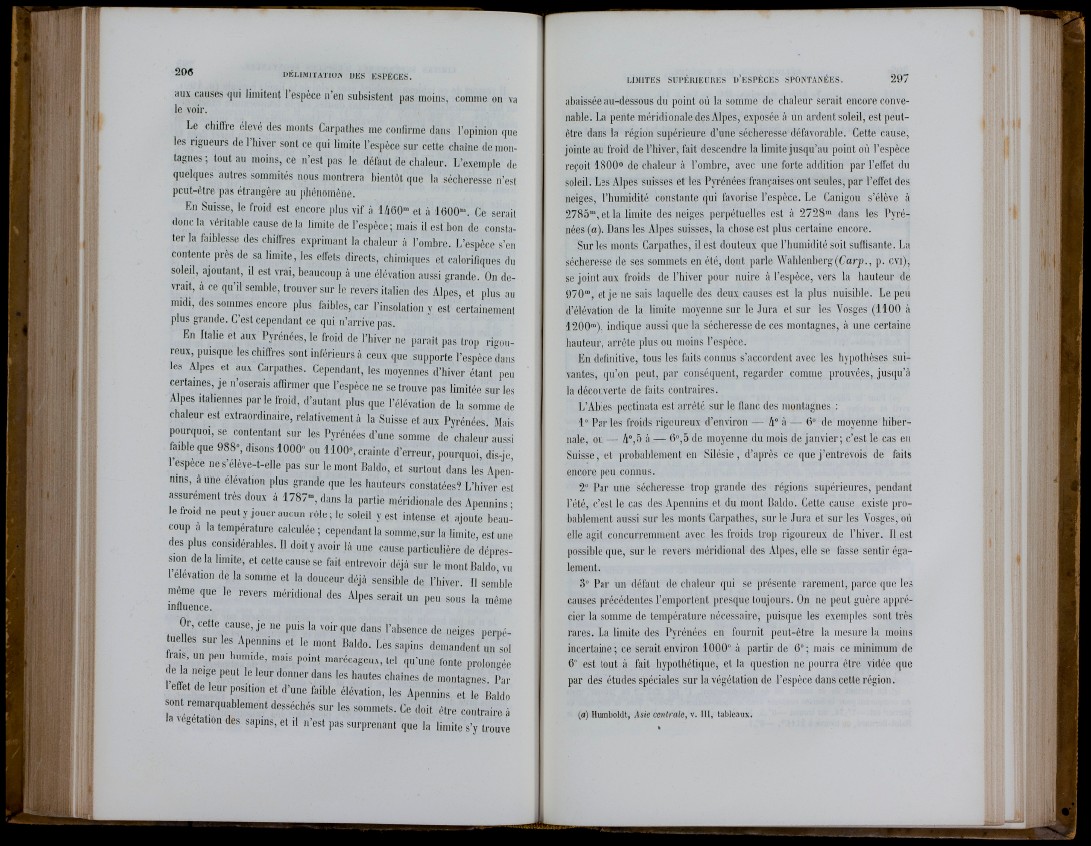
h } iij|J
I
' m 1
» > 1
I s f i
h f "1
r-5Lci « lMiKiilj
4 ^ ^ ...
•Mi
f • 1 ,
¿•î . ...l'B!.. ..Ij: tl 'I
J V iJ
Willi
il i '
^ *t't ríi; !
- i } . , .
« , • • I, í
h I
2 9 6 DÉLIMITATION DES ESPÈCES.
aux causes qui limitent l'espèce n'en subsistent pas moins, comme on va
le voir.
Le chilïre élevé des monts Carpathes me confirme clans l'opinion que
les rigueurs de l'hiver sont ce qui limite l'espèce sur cette chaîne demontaernes
; tout au moins, ce n'est pas le défaut de chaleur. L'exemple de
quelques autres sommités nous montrera bientôt que la sécheresse n'est
peut-être pas étrangère au phénomène.
En Suisse, le froid est encore plus vif à l/i60'" et à 1600"'. Ce serait
dónela véritable cause delà limite de l'espèce; mais il est bon de constater
la faiblesse des chiffres exprimant la chaleur à l'ombre. L'espèce s'en
contente près de sa limite, les effets directs, chimiques et calorifiques du
soleil, ajoutant, il est vrai, beaucoup à une élévation aussi grande. On devrait,
à ce qu'il semble, trouver sur le revers italien des Alpes, et plus au
midi, des sommes encore plus faibles, car l'insolation y est certainement
plus grande. C'est cependant ce qui n'arrive pas.
En Italie et aux Pyrénées, le froid de l'hiver ne paraît pas trop rigoureux,
puisque les chiffres sont inférieurs à ceux que supporte l'espèce dans
les Alpes et aux Carpathes. Cependant, les moyennes d'hiver étant peu
certaines, je n'oserais affirmer que l'espèce ne se trouve pas limitée sur les
Alpes Italiennes parle froid, d'autant plus que l'élévation de la somme de
chaleur est extraordinaire, relativement à la Suisse et aux Pyrénées Mais
pourquoi, se contentant sur les Pyrénées d'une somme de chaleur aussi
faible que 988°, disons 1000" ou 1100°, crainte d'erreur, pourquoi dis-je
l'espèce nes'élève-t-elle pas sur le mont Baldo, et surtout dans les Apennins,
à une élévation plus grande que les hauteurs constatées^ L'hiver est
assurément très doux à 1787", dans la partie méridionale des Apennins •
le froid ne peut y jouer aucun rôle; le soleil y est intense et ajoute beaucoup
a la température calculée; cependant la somme,sur la limite, est une
des plus considérables. Il doit y avoir là une cause particulière de dépression
de la limite, et cette cause se fait entrevoir déjà sur le mont Baldo vu
1 elevation de la somme et la douceur déjà sensible de l'hiver. Il semble
meme que le revers méridional des Alpes serait un peu sous la même
influence.
Or, cette cause, je ne puis la voir que dans l'absence de neiges pernéuelles
sur les Apennins et le mont Baldo. Les sapins demandent un sol
frais, un peu humide, mais point marécageux, tel qu'une fonte prolongée
çle la neige peut le leur donner dans les hautes chaînes de montagnes. Par
1 effet de leur position et d'une faible élévation, les Apennins et le Baldo
sont remarquablement desséchés sur les sommets. Ce doit être contraire à
la vegetation des sapins, et il n'est pas surprenant que la limite s'y trouve
-
LIMITES SUPÉRIEURES D ESPÈCES SPONTANEES. 297
abaissée au-dessous du point où la somme de chaleur serait encore convenable.
La pente méridionale des Alpes, exposée à un ardent soleil, est peutêtre
dans la région supérieure d'une sécheresse défavorable. Cette cause,
jointe au froid de l'hiver, fait descendre la limite jusqu'au point où l'espèce
reçoit 1800O de chaleur à l'ombre, avec une forte addition par l'effet du
soleil. Les Alpes suisses et les Pyrénées françaises ont seules, par l'effet des
neiges, l'humidité constante qui favorise l'espèce. Le Canigou s'élève à
2785™, et la limite des neiges perpétuelles est à 2728'^ dans les Pyrénées
(a). Dans les Alpes suisses, la chose est plus certaine encore.
Sur les monts Carpathes, il est douteux que l'humidité soit suffisante. La
sécheresse de ses sommets en été, dont parle Wahlenberg(Carp., p. cvi),
se joint aux froids de l'hiver pour nuire à l'espèce, vers la hauteur de
970", et je ne sais laquelle des deux causes est la plus nuisible. Le peu
d'élévation de la limite moyenne sur le Jura et sur les Vosges (1100 à
1200"'), indique aussi que la sécheresse de ces montagnes, à une certaine
hauteur, arrête plus ou moins l'espèce.
En définitive, tous les faits connus s'accordent avec les hypothèses suivantes,
qu'on peut, par conséquent, regarder comme prouvées, jusqu'à
la découverte de faits contraires.
L'Abies pectinata est arrêté sur le liane des montagnes :
l'' Par les froids rigoureux d'environ — à — de moyenne hibernale,
ou — /i®,5 à — 6^,5 de moyenne du mois de janvier; c'est le cas en
Suisse, et probablement en Silésie, d'après ce que j'entrevois de faits
encore peu connus.
2" Par une sécheresse trop grande des régions supérieures, pendant
l'été, c'est le cas des Apennins et du mont Baldo. Cette cause existe probablement
aussi sur les monts Carpathes, sur le Jura et sur les Vosges, où
elle agit concurremment avec les froids trop rigoureux de l'hiver. Il est
possible que, sur le revers méridional des Alpes, elle se fasse sentir également.
o'' Par un défaut de chaleur qui se présente rarement, parce que les
causes précédentes l'emportent presque toujours. On ne peut guère apprécier
la somme de température nécessaire, puisque les exemples sont très
rares. La limite des Pyrénées en fournit peut-être la mesure la moins
incertaine ; ce serait environ 1000" à partir de 6"; mais ce minimum de
6" est tout à fait hypothétique, et la question ne pourra être vidée que
par des études spéciales sur la végétation de l'espèce dans cette région.
(a) Humboldt, Asie contrale, v. 111, tableaux.
If,.
I" • I
• ' .si-:
I .'V