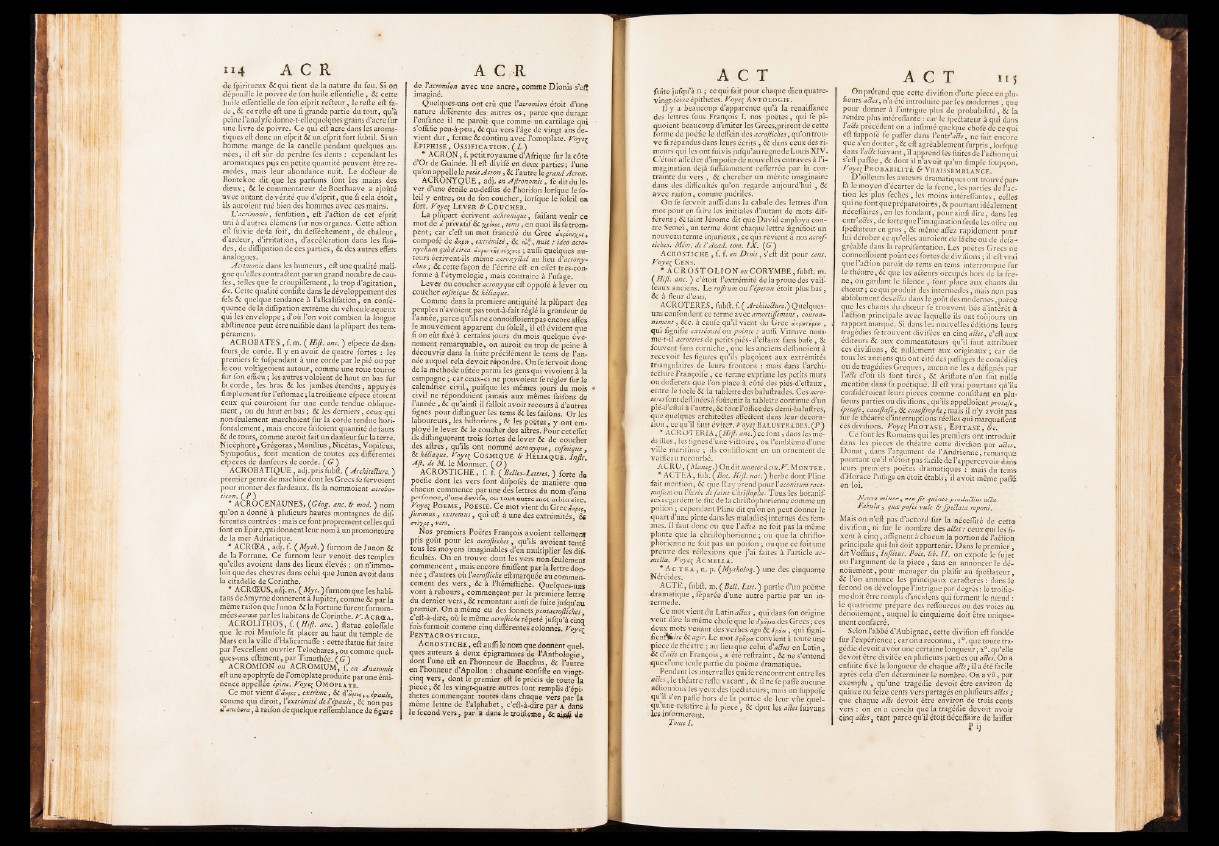
îi 4 A C R
de fpiritueux & qui tient de la nature du feu. Si on
dépouille le poivre de fon huile effentielle, 6c cette
huile effentielle de fon efprit reéleur, le relie eft fade
, 6c ce relie elt une li grande partie du tout, qu’à
peine l’analyfe donne-t-elle quelqües grains d’acre fur
une livre de poivre. Ce qui ell acre dans les aromatiques
ell donc un efprit 6c un efprit fort fubtil. Si un
homme mange de la canelle pendant quelques années
, il ell sur de perdre fes dents ; cependant les
aromatiques piÿs en petite quantité peuvent être re-
medes, mais leur abondance nuit. Le doâeur de
Bontekoe dit que les parfums font les mains des
dieux ; &c le commentateur de Boerhaave a ajouté
■ avec autant de vérité que d’efprit, que li cela etoit,
ils auroient tué bien des hommes avec ces mains.
L’acrimonie, fenfation, ell l’aélion de cet efprit
uni à d’autres élémens fur nos organes. Cette aélion
ellfuivie de4a foif, du defféchement, de chaleur,
d’ardeur, d’irritation, d’accélération dans les fluides
, de diflipation de ces parties, 6c des autres effets
analogues.
Acrimonie dans les humeurs, ell une qualité maligne
qu’elles contrarient par un grand nombre de caille
s , telles que le croupiffement, le trop d’agitation,
&c. Cette qualité conlille dans le développement des
fels 6c quelque tendance à l’alkalifation, en confé-
quence de la diflipation extrême du véhicule aqueux
qui les ènveloppe ; d’où l’on voit combien la longue
abllinence peut êtrenuifiblè dans la plupart des tem-
péramens.
ACROBATES , f. m. ( Hifi. anc, ) efpece de dan-
feurs.de corde. Il y en avoit de quatre fortes : les
premiers fe fufpendant à une corde par lepié ou par
le cou voltigeoient autour, comme une roue tourne
fur fon eflîeu ; les autres votaient de haut en bas fur
la corde, les bras 6c les jambes étendus, appuyés
Amplement fur l’eftomac ; la troifieme efpece étoient
ceux qui couroient fur une corde tendue obliquement
, ou du haut en bas ; 6c les derniers, ceux qui
non-feulement marchoient fur la corde tendue hori-
fontalement, mais encore faifoient quantité de fauts
6c de tours, comme auroit fait un danfeur fur la terre.
Nicéphorè, Grégoras, Manilius, Nicétas, Vopifcus,
^»ympofius, font mention de toutes ces differentes
eipeces de danfeurs de corde. ( G )
ACROBATIQUE, adj.pris fubft. ( Architecture. )
premier genre de machine dont les Grecs fe fervoient
pour monter des fardeaux. Ils la nommoient acroba-
ticon. ( P )
* ACROCENAUNES, (Géog. anc. & moi. ) nom
qu’on a donné à plufieurs hautes montagnes de différentes
contrées : mais ce font proprement celles qui
font en Epire,qui donnent leur nom à un promontoire
de la mer Adriatique.
* ACRCEA, adj. f. (Mytk.) furnom de Junon 6c
de la Fortune. Ce furnom leur venoit des temples
qu’elles avoient dans des lieux élevés : on n’immo-
loit que des chevres dans celui que Junon avoit dans
la citadelle de Corinthe.
* ACRCEUS, adj. m. ( Myt. ) furnom que les habi-
tans deSmyrne donnèrent à Jupiter, comme 6c par la
même raifon que Junon & la Fortune furent furnom-
mées acroeoe parles habitans de Corinthe. F. Acroea.
ACROLITKOS, f. ( Hiji. anc. ) flatue coloffale
que le roi Maufole fît placer au haut du temple de
Mars en la ville d’Halicarnaffe : cette flatue fut faite
par l’excellent ouvrier Telochares, ou comme quelques
uns efliment, par Timothée. (G )
ACROMION une apophyfe de ou l’omoplateproduite ACROMIUM, f. en Anatomie
efl nence appellee Foye[ Omoplate.
par une émiépine.
Ce mot vient d’axpof, extrême, 6c d’ô^oç,, épaule
comme qui diroit, Y extrémité de l'épaule, 6c non pas
ù'anchera, à raifon de quelque reffemblance de figure
A C R
de T 'acromion avec une ancre, comme D ionis s’eft
imaginé.
Quelques-uns ont cru que Y acromion étoit d’une
nature différente des autres o s , parce que durait
l’enfance il ne paroît que comme un cartilage qui
s’oflifie peu-à-peu, Se qui vers l’âge de vingt ans devient
dur, ferme 6c continu avec l’omoplate. Foyeç
Epiphise , Ossification. ( L )
* ACRON, f. petit royaume d’Afrique fur la côte
d’Or de Guinée. Il efl divifé en deux parties ; l’une
qu’on appelle le petit Acron , & l’autre \e grand Acron.
A CRONYQUE, adj. en Agronomie, fe dit du lever
d’une étoile au-deffus de x’horifon lorfque lefo-
leil y entre; ou de fon coucher, lorfque le foleil ea
fort. Voyc{ Lever & Coucher.
La plupart écrivent achronique, fàifant venir ce
mot de à privatif 6c ^pevoç, tems, en quoi ils fe trompent;
car c’efl un mot francife du Grec àxpovuxoç,
çompofé de dupov, extrémité, 6c , nuit : ideo acro-
nychum qubdcirca I kùov vu^toç ; aufli quelques auteurs
écrivent-ils meme acronycial au lieu à'acrony-
çhus j,6c cette façon de l’écrire efl en effet très-conforme
à l’étymologiç, mais contraire à l’ufage.
Lever ou coucher acronyque efl oppofé à lever ou
çoucher cofmique 6c héliaque.
Comme dans la première antiquité la plupart des
peuples n’avoient pas tout-à-fait réglé la grandeur de
l’année, parce qu’ils ne connoiffoientpas encore affez
le mouvement apparent du foleil, il efl évident que
fi on eût fixé à certains jours du mois quelque événement
remarquable, on auroit eu trop de peine à
découvrir dans la fuite précifément le tems de l’année
auquel cela devoit répondre. On fe fervoit donc
de la méthode ufitée parmi les gens qui vivoient à la
campagne ; car ceux-ci ne pouvoient fe régler fur le
calendrier civil, puifque les mêmes jours du mois
civil ne répondaient jamais aux mêmes faifons de
l’année , & qu’ainfi il falloit avoir recours à d’autres
lignes pour diflinguer les tems 6c les faifons. Or les
laboureurs, les hiftoriens, 6c les poètes, y ont employé
le lever 6c le coucher des affres. Pour ceteffet
ils diftinguerent trois fortes de lever & de coucher
des affres, qu’ils ont nommé acronyque, cofmique ,
& héliaque. Voye£ Cosmique & HÉLIAQUE. Intir.
AJi. de M. le Monnier. ( O )
ACROSTICHE , f. t. ( Belles-Lettres, ) forte do
poéfie dont les vers font difpofésde maniéré que
chacun commence par une des lettres du nom d’une
perfonne, d’une devife, ou tout autre mot arbitraire
Voyei POEME, POESIE. C e mot vient du G r e e f f ,
fummus , extremus, qui efl à une des extrémités 6i
trrixoç, vers.
Nos premiers Poètes François avoient tellement
pris goût pour les acrofiiehes, qu’ils avoient tenté
tous les moyens imaginables d’en multiplier les difficultés.
On en trouve dont les vers non-feulement
commencent, mais encore finiffent par la lettre donnée
; d’autres où Yacrofticke eftmarquée au commencement
des v e r s , & à Fhémiftiche. Quelques-uns
vont à rebours, commençant par la première lettre
du dernier v ers, 6c remontant ainfi de fuite jufqu’au
premier. On a même eu des fonnets pentacrofiiches 9
c’eft-à-dire, où le même acrofiiche répété jufqu’à cinq
fois formoit comme cinq différentes colonnes. Foyer
Pentacrostiche. x
A crostiche , efl auflîle nom que donnent queL
ques auteurs à deux épigrammes de l'Anthologie ^
dont l’une efl: en l’honneur de Bacchus, 6c l’autré
en l’honneur d’Apollon : chacune cônfifte en vingt-
cinq vers, dont le premier efl le précis de toute la
pièce; 6c les vingt-quatre autres font remplisd’épi-
thetes commençant toutes dans chaque vers par la
même lettre de l’alphabet, c’eft-à-dire par a dans
le fécond v ers, par b dans le troifieme, & ajjnfi de
A C T
fuite jufqu’à c i ; ce qui fait pour chaque dieu quatre-
vingt-feizeépithetes. Foye^ Antologie.
I f y a beaucoup d’apparence qu’à la renaiffance
des lettres fous François I. nos poètes, qui fe pi-
quoient beaucoup d’imiter les Grecs,prirent de cette
forme de poéfie le deffein des acrofiiehes, qu’on trouv
e fi répandus-dans leurs écrits , oc dans ceux des rameurs
qui les ont fuivis jufqu’au regne de Louis XIV.
C ’étoit affeéler d’impofer de nouvelles entraves à l’imagination
déjà fuffifamment refferrée par la contrainte
du vers , & chercher un mérite imaginaire
dans des difficultés qu’on regarde aujourd’hui , &
avec raifon, comme puériles.
On fe fervoit aufli dans la cabale des lettres d’un
mot pour en faire les initiales d’autant de mots dif-
fërens ; & faint Jérome dit que D avid employa contre
Semeï, un terme dont chaque lettre fignifioit un
nouveau terme injurieux, ce qui revient à nos acrof-
tickes. Mém. de l'Acad. tom. IX . (C )
Acrostiche , f. f. en Droit, s’eft dit pour cens.
Foyei Cens.
* A C R O S T O L IO N ouCÖRYMBE, fubft. m.
(Hi/l. anc, ) c’étoit l’extrémité de la proue des vaif-
féaux anciens. Le rofirùm ou l'éperon étoit plus bas,
& à fleur d’eau.
ACROTERES, fubft. f. ( Architecture.) Quelques-
uns confondent ce terme avec artiortifiement, couronnement
, &c. à caufe qu’il vient du Grec ctxpaTripiov,
qui lignifie extrémité ou pointe : aufli Vitruve nomme
t-il acroteres de petits piés-d’eftaux fans bafe, &
fouvent fans corniche, que les anciens deftinoient à
recevoir les figures qu’ils plaçoient aux extrémités
triangulaires de leurs frontons : mais dans l’archi-
teélure Françoife , ce terme exprime les petits murs
ou dofferets que l’ôn place à côté des pies-d’eftaux,
entre le foele & la tablette des baluftrades. Ces acroteres
font deftinées à foûtenir la tablette continue d’un
pié-d’eftal à l’autre, & fönt l’office des demi-baluftres,
que quelques architeéles affeélent dans leur décoration
, ce qu’il faut éviter. Foye[ Balustrades. CP)
* ACR.OTERIA, (Hifi- anc.) ce font, dans les médailles
, les fignes d’une vi&oire, ou l’emblème d’une
ville maritime ; ils confiftoient en un ornement de
vaiffeau recourbé.
A C R U , (Maneg.) On dit montera cru. F . M ONTER.
* A C T E A , fub. (Bot. Hifi. nat.) herbe dont Pline
fait mention, & que Ray prend pour Yaconitum race-
piofum ou Y herbe de faint Chriflophe. Tous les botanif
tes regardent le fuc de la chriftophorienne comme un
poifön ; cependant Pline dit qu’on en peut donner le
quart d’une pinte dans les maladies] internes des femmes.
Il faut donc ou que Yactea ne foit pas la même
plante que la chriftophorienne; ou que la chrifto-
phorienne ne foit pas un poifon ; ou que ce foit une
preuve des réflexions que j’ai faites à l’article ac-
mellà. Foye£ ACMELLA.
* A c: t e a , n. p. (Mytkolog. ) une des cinquante
Néréides.
A C T E , fubft. m. ( Bell. Lett. ) partie d’un poème
dramatique , féparée d’une autre partie par un intermède.
Ce mot vient du Latin actus , qui dans fon origine
veut dire la même chofe que le S'pa.p.a des Grecs ; ces
deuxmots venant des verbes ago Scé'pda , qui figni-
fient^fcire & agir. Le mot S'pS/xa convient à toute une
piece de théâtre ; au lieu que celui à'actus en Latin,
& d'acte en François, a été reftraint, & ne s’entend
que d’une feule partie du poème dramatique.
Pendant les intervalles qui fe rencontrent entre les
actes, le théâtre refte vacant, & il ne fe paffe aucune
a&ion fous les yeux des fpe&ateurs ; mais on fuppofe
qu’il s’en paffe hors de la portée de leur vûe quel-
qu’une relative à la piece, & dpnt les actes fuivans
les informeront.
Tome /,
A C T i i5
On prétend que cette divifion d’une piece en plufieurs
actes, n’a été introduite par les modernes , que
pour donner à^ l'intrigue plus de. probabilité, & la
rendre plus intereffante : car le fpeélateur à qui dans
lacté précédent on a infinué quelque chofe de ce qui
fuppofe fis paffer dans Y ente'acte, ne fait encore
que s’en douter, & eft agréablement furpris, lorfque
dans Y acte fuivant, il apprend lés fuitesde l’aélionquî
s eft paffee, 6c dont il n’avoit qu’un fimple foupçon»
F o y e ^ Pr o b a b il it é & V r a is e m b l a n c e .
D ailleurs les auteurs dramatiques ont trouvé par*
là le moyen d’écarter de la feene, les parties de l’action
les plus feches , les moins intéreffantes, celles
qui ne font que préparatoires, & pourtant idéalement
néceffaires, en les fondant, pour ainfi dire, dans les
entr 'actes, de forte que l’imagination feule les offre au
fpeélateur en gros , & même affez rapidement pouf
lui dérober ce qu’elles auroient de lâche ou de defai
gréable dans la repréfentation. Les poètes Grecs ne
connoiffoient point ces fortes de divifions ; il eft vrai
que Faction paroît de tems en tems interrompue fur
le théâtre, & que les aéleurs occupés hors de la feene,
ou gardant le filence font place aux chants du
choeur ; ce qui produit des intermèdes, mais non pas
abfolument des actes dans le goût des modernes, parce
que les chants du choeur fe trouvent liés d’intérêt à
l’a&ion principale avec laquelle ils ont toûjours un
rapport marqué. Si dans les nouvelles éditions leurs
tragédies fe trouvent divifées en cinq actes, c’eft aux
éditeurs 6c aux commentateurs qu’il faut attribuer
ces divifions, 6c nullement aux originaux ; car de
tous les anciens qui ont cité des paffagés de comédies
or de tragédies Greques, aucun ne les a défignés par
Yacte d’où ils font tirés, 6c Ariftote n’en fait nulle
mention dans fa poétique. Il eft vrai pourtant qù’ils
confidéroient leurs pièces comme confiftant en plufieurs
parties ou divifions, qu’ils âppelloientprotafe ,
epitafe, catafiafe., 6c catafirophe; mais il n’y ayoitpas
fur le théâtre d’interruptions réelles qui marquaflenf
ces divifions. Fôye^ Pr o t a s e , E p it a s e , &c.
Ce font les Romains qui les premiers ont introduit
dans les pièces de théâtre cette divifion par actes.
D onat, dans l’argument de l’Andrienne, remarqué
pourtant qu’il n’étoit pas facile de l’appercevoir dans
leurs premiers poètes dramatiques : mais du tems
d’Horace l’ufage en étoit établi ; il avoit même paflg
en loi.
Netivfi jninor, neu f it quinto productior a(tu
Fabula y quoe pofci vult & fpeclata, reponi.
Mais on n’çft pas d’aeïord fur la néceflité de cette
divifion, ni fur le nombre des actes: ceux qui les fixent
à cinq, aflîgnent à chacun la portion de l’aétion
principale qui lui doit appartenir. Dans le premier,
dit Voffius, Infiitut. Poët. lib. I I . on expofe le fujet
ou l’argument de la piece , fans en annoncer le dénouement,
pour ménager du plâifir au fpeélateur,
6c l’on annonce les principaux carafteres : dans le
fécond on développe l’intrigue par degrés : le troifieme
doit être rempli d’incidens qui forment le noeud :
■ le quatrième préparé des reffources ou des voies au
dénouement, auquel le cinquième doit être uniquement
eonfacré.
Selon l’abbé d’Aubignac, cette divifion eft fondée
fur l’expérience ; car on a reconnu, i °. que toute tragédie
devoit avoir une certaine longueur; i ° . qu’elle
devoit être divifée en plufieurs parties ou actes. On a
•enfuite fixé la longueur de chaque acte; il a été facile
après cela d’en déterminer le nombre. On a vû , par
exemple , qu’une tragédie devoit être environ dé
quinze ou feize cents vers partagés en plufieurs actes ;
que chaque acte devoit être environ de trois cents
vers : on en a conclu que la tragédie devoit avoir
çinq actes 2 tant parce qu’il çtoit néçeffaire de laiffer