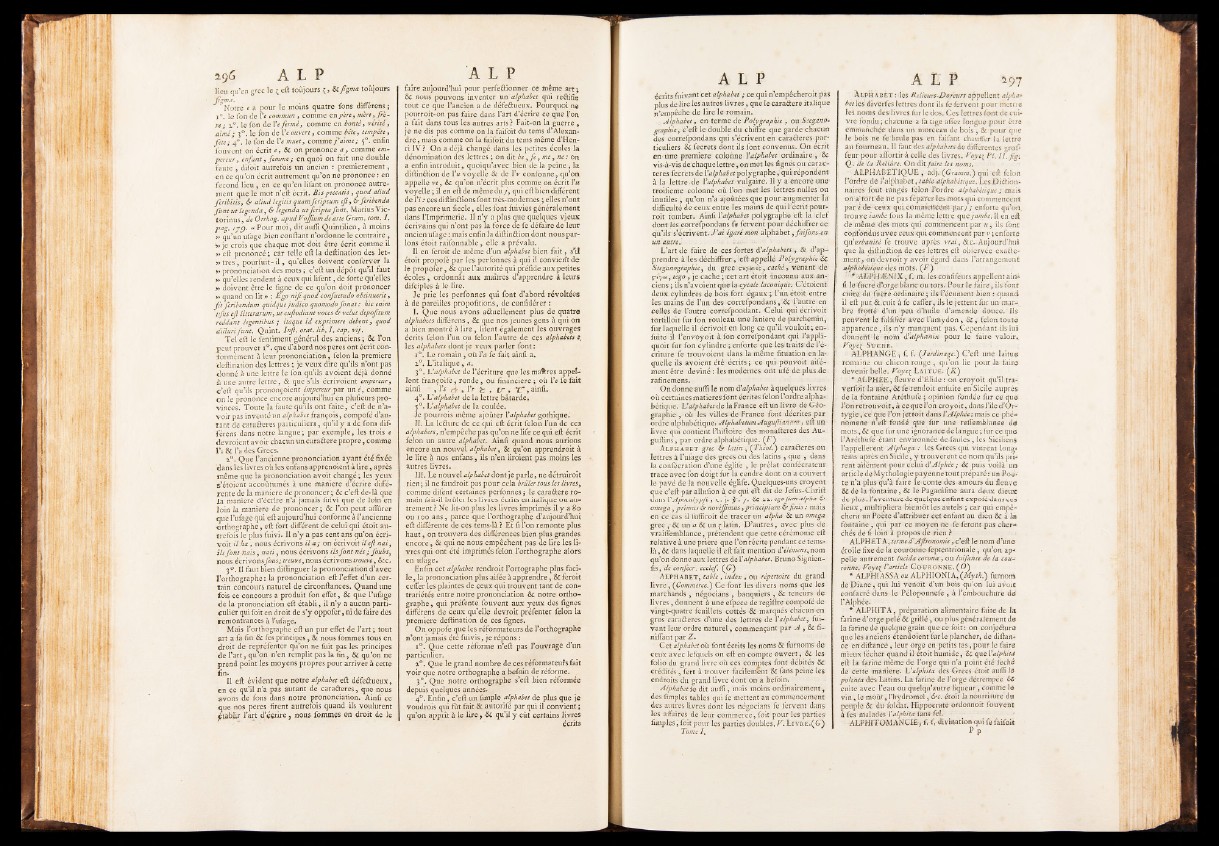
lieu qu’en grec le i eft toujours i> Ufigma toujours
° Notre e a pour le moins quatre fons différens;
i°. le fon de 1’« commun , comme en père, mère, frère;
i° . le fon de Ve fermé, comme en bonté, vérité,
aimé; 30. le fôn de Ve ouvert, comme bête, tempête,
fête; 40. le fon de Ve muet, comme j'aime; 50. enfin
fou vent on écrit e, & on prononce a , comme empereur
, enfant, femme ; en quoi on fait une double
faute , difoit autrefois un ancien : premièrement,
en ce qu’on écrit autrement qu’on ne prononce : en
fécond lieu , en ce qu’en lifant on prononce autrer
ment que le mot n’eft écrit. Bis peccatis, quod aliud
feribitis, & aliud legitis quamfcriptum ejl,& feribenda
funt ut legenda, & legenda ut feripta funt. Marius Vic-
torinus de Onhog. apudVojjium de arte Gram. tom. I .
pag. 179. « Pour moi, dit aulîi Quintilien, à moins
» qu’un ufage bien confiant n’ordonne le contraire,
»> je crois que chaque mot doit être écrit comme il
» eft prononcé ; car telle eft la deftination des let-
» t re s , pourfuit-il, qu’elles, doivent conferver la
» prononciation des mots ; c’eft un dépôt qu’il faut
» qu’elles rendent à ceux qui lifent, de forte qu’elles
» doivent être le ligne de ce qu’on doit prononcer
» quand on lit » : Ego niji quod confuetudo obtinuerit,
fïtfcribendum quidque judico quomodo fonat: hic enim
tfus ejl Litterarum, ut cujlodiant voces & velut depojitum
reddant legentibus ; itaque id exprimere debent, quod
dicluri funt. Quint. Inji. orat. lib. I. cap. vij.
Tel eft le fentiment général des anciens ; 8c l’on
peut prouver i° . que d’abord nos peres ont écrit conformément
à leur prononciation, félon la première
deftination des lettres ; je veux dire qu’ils n’ont pas
donné à une lettre le fon qu’ils avoient déjà donné
à une autre lettre, & que s’ils écrivoient empereur,
c ’eft qu’ils prononçoient émpereur par un é, comme
on !e prononce encore aujourd’hui en plulieurs provinces.
Toute la faute qu’ils ont faite, c’eft de n’avoir
pas inventé un alphabet françois, compofé d’autant
de caractères particuliers, qu’il y a de fons dif-
férens dans notre langue ; par exemple, les trois e
devroient avoir chacun un caraCtere propre, comme
Vi 8c 1’» des Grecs.
a°. Que l’ancienne prononciation ayant été fixée
dans les livres où les enfans apprenoient à lire, après
même que la prononciation avoit changé ; les yeux
s’étoient accoûtumés à une maniéré d’écrire différente
de la maniéré de prononcer; 8c c’eft de-là que
la maniéré d’écrire n’a jamais fuivi que de loin en
loin la maniéré de prononcer ; 8c l’on peut aflïirer
que l’ufage qui eft aujourd’hui conforme à l’ancienne
orthographe, eft fort différent de celui qui étoit autrefois
le plus fuivi. Il n’y a pas cent ans qu’on écri-
voit il ha, nous écrivons il a; on écrivoit il ejl nai,
ils font nais, nati, nous écrivons ils font nés; foubs,
nous écrivons fous; treuve, nous écrivons trouve, 8cc.
30. Il faut bien diftinguer la prononciation d’avec
l’orthographe : la prononciation eft l’effet d’un certain
concours naturel de circonftaneés. Quand une
fois ce concours a produit fon effet, 8c que l’ufage
de la prononciation eft établi, il n’y a aucun particulier
qui foit en droit de s’y oppofer, ni de faire des
remontrances à l’ufage.
Mais l’orthographe eft un pur effet de l’art ; tout
art a fa fin 8c fes principes, 8c nous fommes tous en
droit de repréfenter qu’on ne fuit pas les principes
de l’art, qu’on n’en remplit pas la fin, 8c qu’on ne
prend point les moyens propres pour arriver à cette
fin.I
l eft évident que notre alphabet eft défectueux,
en ce qu’il n’a pas autant de cara&eres, que nous
avons de fons dans notre prononciation. Ainfi'ce
que nos peres firent autrefois quand ils voulurent
établir l’art d’écrire, nous fommes en droit de le
faire aujourd’hui pour perfectionner ce même art ;
8c nous pouvons inventer un alphabet qui reftifie
tout ce que l’ancien a de défectueux. Pourquoi ne
pourroit-on pas faire dans l’art d’écrire ce que l’on
a fait dans tous les autres arts ? Fait-on la guerre ,
je ne dis pas comme on la faifoit du tems d’Alexandre
, mais comme on la faifoit du tems même d’Henri
IV ? On a déjà changé dans les petites écoles la
dénomination des lettres ; on dit be , f e ,m e , ne: on
a enfin introduit, quoiqu’avec bien de la peine, la
diftinCtion de Vu voyelle 8c de Vv confonne, qu’on
appelle ve, 8c qu’on n’écrit plus comme on écrit Vu
voyelle ; il en eft de même du7, qui eft bien différent
de l’i .* ces diftinCtions font très-modernes ; elles n’ont
pas encore un fiecle, elles font fuivies généralement
dans l’Imprimerie. Il n’y a plus que quelques vieux
écrivains qui n’ont pas la force de fe défaire de leur
ancien ufage : mais enfin la diftinCtion dont nous parlons
étoit raifonnable, elle a prévalu.
Il en feroit de même d’un alphabet bien fa it , s’il
étoit propofé par les perfonnes à qui il convient de
le propofer, 8c que l’autorité qui préfide aux petites
écoles , ordonnât aux maîtres d’apprendre à leurs
difciples à le lire.
Je prie les perfonnes qui font d’abord révoltées
à de pareilles propofitions, de confidérer :
I. Que nous avons actuellement plus de quatre
alphabets différens, 8c que nos jeunes gens à qui on
a bien montré à lire , lifent également les ouvrages
écrits félon l’un ou félon l’autre de ces alphabets f,
les alphabets dont je veux parler font :
i° . Le romain, où Va fe fait ainfi a.
2°. L’italique, a.
30. L'alphabet de l’écriture que les maîtres appellent
françoife, ronde, ou financière ; où Ve fe fait
ainfi - , Fs , IV £ , {/- , , ainfi,
40. L'alphabet de la lettre bâtarde.
50. L'alphabet de la coulée.
Je pourrois même ajoûter Valphabet gothique.'
II. La leCture de ce qui eft écrit félon l’un de ces
alphabets, n’epipêche pas qu’on ne life ce qui eft écrit
félon un autre alphabet. Ainfi quand nous aurions
encore un nouvel alphabet, 8c qu’ôn apprendroit à
le lire à nos enfans, ils n’en liroient pas moins les
autres livres.
III. Le nouvel alphabet dont je parle, ne détruiroit
. rien ; il ne faudroit pas pour cela brûler tous les livres,
comme difent certaines perfonnes ; le caraCtere romain
fait-il brûler les livres écrits en italique ou autrement
? Ne lit-on plus les livres imprimés il y a 80
ou 100 ans, parce que l’orthographe d’aujourd’hui
eft différente de ces tems-là ? Et fi l’on remonte plus
haut, op trouvera des différences bien plus grandes
encore, 8c qui ne nous empêchent pas de lire les livres
qui ont été imprimés félon l’orthographe alors
en ufage.
Enfin cet alphabet rendroit l’ortographe plus facile
, la prononciation plus aifée à apprendre, & feroit
ceffer les plaintes de ceux qui trouvent tant de contrariétés
entre notre prononciation & notre orthographe
, qui préfente fouvent aux yeux des lignes
différens de ceux qu’elle devroit préfenter félon la
première deftination de ces lignes.
On oppofe que les réformateurs de l’orthographe
n’ont jamais été fui v is , je répons :
i° . Que cette réforme n’eft pas l’ouvrage d’un
particulier.
20. Que le grand nombre de ces réformateufs fait
voir que notre orthographe a befoin de réforme.
30. Que notre orthographe s’eft bien réformée
depuis quelques années.
40. Enfin, c’eft un fimple alphabet de plus que je
voudrois qui fût fait 8c autorifé par qui il convient ;
qu’on apprît à le lire , 8c qu’il y eût certains livres
écrits
écrits fuivant cét alphabet ; ce qui ri’empêcherok pas
plus de lire lès autres livres, que le caraCtere italique
n’empêche de lire le romain.
. Alphabet, en terme de Polygraphie , ou Stegano-
graphie, 'c’eft le double du chiffre que garde chacun
des correfpondans qui s’écrivent en caraderes particuliers
8c fecrets dont ils font convenus. On écrit
en-une première colonne Valphabet ordinaire , 8c
visrà-vis de chaque lettre ,:çn met les lignés pu caractères
fecrets de V alphabet polygraphe,' qurrépondent
à la lettre.de \'alphabavu\garre. Il y a èncorè une>
troifieme colonne où l’on met les lettres nullès ou
inutiles , qu’on n’a àjoûtées que pour .augmenter là'
difficulté de ceux entre les mains de qui l’écrit pourrait
tomber. Ainfi Valphabet polygraphe eft la c le f
dont les çorrefpondans fe fervènt pour déchiffrer ce
qu’ils s’écrivent. J'ai égaré mort alphabet, faifons-en-
un autre. - - ~ -i
L’art de faire de ces fortes d1alphabets., & d’ap-'
prendre à lès déchiffrer ,':eft appelle P oly graphie Ac
Stegano graphie, du grec■ çiyftvoç, -caché.; venant de
ç-iya ,tego , je cache ;reet art étoit inconnu aux an-;
ciens ; ils n’a voient que lai cytalelaconique-i Côtoient-
deux cylindres de bois fort égaux ; Tun étoit entre
les mains dé l’un des correfpondans, 8c l’autre en
celles de l’autre corrèfpondant. Celui qui écrivoit
tortilloit fur fon rouleau une laniere de parchemin,
fur laquelle il écrivoit en long ce qu’il vôuloit; en-i
fuite il l’envpyoit à fon corrèfpondant qui l’appii-
quoit fur fon cylindre ; enforte que les traits de l’écriture
fe trouvoient dans la même fitüation en laquelle
ils avoient été' écrits; ce qui pOuvoit aifé-
ment être deviné : les modernes ont ufé dé plus>de.
rafinemens.
On donne aufli le nom d'alphabet à quelques livres
où certaines matières font écrites félon l’ordre alphabétique.
Valphabet de la France eft un livre de Géographie
, où les villes de France font décrites par
ordre alphabétique. Alphabetum Auguftiahum, eft un
livre qui contient l’hiftoire des monafteres des Au-
guftins, par ordre alphabétique. (E")
Alphabet grec & latin, (Theol.) caraCteres ou
lettres à l’ufage des grecs ou des latins , que , dans
la confécration d’une églife , le prélat confécrateur
trace avec fon doigt fur la cendre dont on a couvert
le pavé de la nouvelle églife. Quelques-uns croyent
que c’eft par allufion à ce qui eft dit de Jefus-Chrift
dans VApocalypfe , c. j. ÿ . 7. 8c 22. egofum alpha 6*
oméga, prïmùs & novijjimus , principium & finis : mais
en ce cas il fuffiroit de tracer un alpha & un oméga
grec ,' 8c un a & un £ latin. D ’autres, avec plus de
vraisemblance, prétendent que cette cérémonie eft
relative à une priere que l’on récite pendant ce tems- :
là , 8c dans laquelle il eft fait mention d'élèmens, nom i
qu’on donne aux lettres de Valphabet. Bruno Signien-
fis, de confecr. ecclef. (G )
Alphabet, table, index, ou répertoire du grand
liv ré, (Commerce.) Ce font les divers noms que les
marchands , négocians , banquiers , 8c teneurs de
livres, donnent à une efpece de regiftre compofe de
vingt-quatre feuillets cottés 8c marqués chacun en
gros cara&ères d’une des lettres de Valphabet, fui-
vant leur ordre naturel, commençant par A , 8c fi-
niflant par Z .
Cet alphabet où font écrits les noms & furnoms de
ceux avec lefquels cm eft en compte ouvert, 8c les
folio du grand livre où ces comptes font débités 8c
crédités, fert à trouver facilement 8c fans peine les
endroits du grand livre dont on a befoin*
Alphabet fe dit aufli, mais moins ordinairement,
des (impies tables qui fe mettent au commencement
des autres livres dont les négocians fe fervent dans
les affairés de leur commerce, foit pour les parties
fimples j foit pour les parties doubles, J7". Livre.(G)
Tome I,
Alphabet : les Relieurs-Doreurs appellent alpha-
b et lesdi verfes lettres dont ils fe fervent pour mettre
lelnoms desdivres fur le dos. Ces lettres font de cuivre
fondu ; chacune a fa tige affez longue pour être
èmmanchée 'dans un morceau de bois , 8t pour que
lé bois ne fe brûle pas en faifant chauffer la Ietrre
au fourneau* Il faut des alphabets Ae différentes grof4
feur pour affortir à celle des livres. Voye^ PL II. fige.
<2 * Ht la Reliure. Ort dit faire les noms.
ALPHABÉTIQUE , àdj.^Graww.) qui eft félon
l’ordre àé Valphabet, table alphabétique. Les Dictionnaires
fout rangés lélon l’Ordre alphabétique.; mais
oh a'-fôrt dé fie pas féparer les mots qui commencent
par i dé'ceùx qui. cômMeJl'È©nt--par/ y enforte qu’otl.
trouve ïambe fous la même lettre que jambe. Il en eft
dé mèmé :dés mots qui commencent par u , ils font
confondus avêo ceux qui commencent par v ; enforte
qn'urbanité fe trouve après vrai, &c-Aujourd’hui
que la chftinfUon de ces lçt.tres eft ohfervée exafte-
ment; on'devroit y avoir égard dans l’arrangement
alphabétique-des mots. { P j
'*~>A%jPHÆNIX , f. m. les cohfifeurs appellent airri
fi Idfticre dbtge blanc ou tors. Pour le faire, ils font
cùiré ditfticré Ordinaire ; ils l’écument bien :• quand
il eft put. &,eifit à fe Caflef, ils le jettent fur un marbre
ftçjtté' d’un 'peit :d’lktile d’amende douce.' Us
peù^èfttftè fal'fîfiér avec l’amydôn , 8c,. félon tout©
apparence , ils n’y manquent pas, Cependant-ils lui
dôhnéfit': lé •' ;noin à'alphoeftix pour le faire valoir».
Foyêi Sü-eftfe.
ALPH'ÀNGÈ, f, (Jardinage.') C ’efl: une Iaituô
romaine ou chicon rouge , qu’on lie pour la fair©
devenir belle, Vôyc{ L a itu e * (Â )
* ALPHÉE, fleuve d’Elide : on croyoit qu’il tra-
verfoit là trier jô i fè'tréfidoit enfuite en Sicile auprès
de la fontaine Aréthüfe j opinion fondée fur ce quô
l’ôn refrouvoit, à ce que l’on c royoit, dans l’île d’Or-
tygie ,'ce que l’on jettoit dans l’Alphée: mais ce phénomène
n’eft fondé que fur une reffemblance d©
mots, & que fur une ignorance de langue ; fur ce que
l’Àréthufê étant environnée de faules , les Siciliens
l’appelletent Alphaga : les Grecs qui vinrent long-
trèms après en Sicile, y trouvèrent ce nom qu’ils pri-*
rent âifément pour celui à'Alphée ; & puis voilà un
article de Mythologie payenne tout préparé : un Poète
n’a plus qu’ à faire le- conte des-amours du fleuve
& de la fontaine, & lé Pàganifme àùra deux dieux
de plus : l’aventure de quelque enfant expofé dans ces
lieux, multipliera bientôt les autels ; car qui empêchera
un Poète d’attribuer cet enfant au dieu & à la
fontaine , qui par ce moyen ne fe feront pas cher-*
chés dé fi loiii- à propos de rien ?
ALPHETÀ, terme d'Aftronomie, c’eft le nom d’une
étoile fixe de Iâ couronne- feptentrionale, qu’on ap«
pelle autrement lucida coronte, ou luifafite de la couronne.
Voÿei_ l'article COURONNE. (O)
* ALPHIASSA 0« ALPHIONIA, (Myth.) furnotn
dé D iane, qui lui verSOït d’un bois qu’on lui avoit
eonfacré dans le Péloponnefe , à l’embouchure de
l’Alphéè.
* ALPHITA, préparation alimentaire faite de la
farine d’orge pelé & grillé, ou plus généralement de
la farine de quelque grâin que ce foit : on conjecture
que les anciens étèndoient furie plancher, de diftan-
cè en diftancé , leur or^e en petits tas, pour le faire
mieux fécher quand il étoit humide, & que Valphitd
eft la fariné même de l’orge qui n’a point été léché
de cette maniéré. L'alphita des Grecs étoit aufli le
polenta dés Latins. La farine de Forge détrempée 85
cuite avec l’eau ou quelqu’autre liqueur, comme le
v in , le moût, l’hydromel , &c. étoit la nourriture du
peuple & du foldat. Hippocrate ordonnoit fouvent
à fes malades l'alphita fans fel.
ALPHITOMANCIE-v f. f,- divination- qui fe faifoit
p p