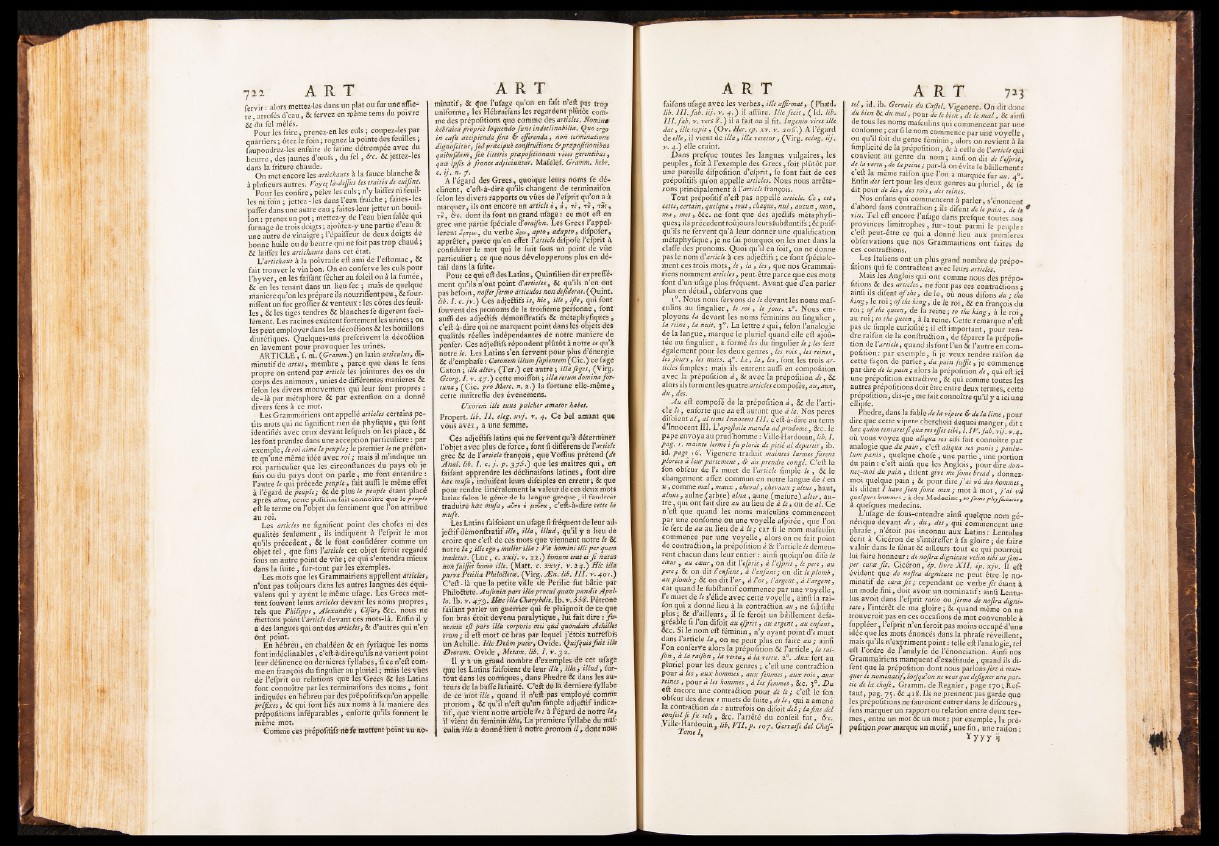
fcrvir : alors ftiettez-les dans un plat ou furuneaffie-
te, arrofés d’eau, & fervez en même tems du poivre
& du fel mêlés.
Pour les frire, prenez-en les culs ; conpez-Ies par
quartiers | ôtez le foin ; rognez la pointe des feuilles ;
ïaUpoudrez-les enfuite de farine détrempee avec du
beurre, des jaunes d’oeufs, du f e l , &c. & jettez-les
dans là friture chaude.
On met encore les artichauts à la fauce blanche oc
à plusieurs autres. Voyez là-dejfus les traités de wifint.
Pour lès confire, pelez les culs ; n’y laiffeZ ni feuilles
ni foin ; jettez-les dans l’eau fraîche ; faites-lès
paffer dans une autre eaü ; faites-leur jetter un bouillon
: prenez un pot ; mettez-y. de l’eau bien falée qui
fumage de trois doigts ; ajoûtez-y une partie d’eau &
uné autre de vinaigre ; l’épaiffeur de deux doigts de
bonne huile ou de beurre qni ne foit pas trop chaud ;
& Iriifféz les artichauts dans cet état.
Vartichaut à la poivrade eft ami de l’eftomac, &
fait trouver le vin bon. On en confervè les culs pour
l’hy ver, en les faifant fécher au foleil ou à la fumée,
& en les tenant dans un lieu fec ; mais de quelque
maniéré qu’on les prépare ils nourriflent peu, & four-
niflent un fuc groflier & venteux : les côtes des feuilles
, & les tiges tendres & blanches fe digèrent facilement.
Les racines excitent fortement les urines ; on
lès peut employer dans les décollions & les bouillons
diurétiques. Quelques-uns prefcrivent la décdétion
en lavement pour provoquer les urinés.
ARTICLE, f. m. ( Gramm.) en latin articulas, diminutif
de anus, membre , parce que dans le fens
propre on entend par article les jointures dès os du
corps des animaux, unies de différentes maniérés &
félon les divers mouveriiens qui leur font propres :
de-là par métaphore & par extenfion on a donné
divers fetis à cè mot.
Les Grammairiens ont appellé articles certains petits
mots qui ne lignifient rien de phyfiqile ; qui font
identifiés avec ceux deVant lefquels on les placé, 8c
lëS font prendre dans une acception particulière : par
exemple, le roi aimé le peuple; le premier le: ne préfen-
ié qu’une même idée avec roi ; mais il m indique un
roi particulier que les circonftaricés du pays oit je
fuis ou du pays dont on parle, mè font entendre :
l’âütre le qui précédé peuple, fait aufli lè même effet
à l’égard de peuple; & dé plus le pèuple étant placé
après aime, cette pôfitionfait connoîtrë que lepèUplé
eft le tèrme ôii l’objet du fentimént qué l’on attribue
àü roi.
Les articles ne fignifient point dès choies ni dès
qualités feulémëht, ils indiquent à l’efprit le mot
qu’ils précédent, 8c le font corifidérèr comme un
objet t e l, qitè fans Xarticle cet objet feroit regardé
fous un âutre point de Vüe ; cè qui s’eriteridra mieux
dans la füité ÿ fur-tôut par les éÿèmplës.
Les mots que les Grammairiens appellent articles>
ti’ônt pas toûjours dahs les autres langiiës dès équi-
valehs qui y ayènt le même lifage. Les Grecs mettent
fouvent leurs articles dévâht lès noms propres,
tels que Philippe, Alexandre -, Céfdr, & c . nous ne
mettons point l’article devant cès rilots-là. Enfin il y
a des langues qui ont dès articles, & d’autres qui n’en
ént point.
Eii hébreu, en chald'éen & en fyriàqùë lès noms
font indéclinables, c’èft-à-diré qü’ilS hé varient point
leitr définence ou dërhiérés fyllabés, fi cen’eftcomme
en françois du fingulier au pluriel $ màislèsvûès
dè l’éfprit ou relations qué lés Grées & les Latins
font connoîtrë par les fërminaifôn's dés noms , font
indiquées èn hébreu par dés prëpofitifs qu’on appelle
préfixes, & qui font liés aüx noms à là maniéré dés
prépofitions iriféparablés, enforté qu’ils forment lé
même mot. ...
Comme ces prépofitifs hé fé mettant point àu homînatif,
& que l’ufage qu’on en fait n’ éft pas trop
uniforme f les Mébraïfâns les regardent plutôt com-
me des prépofitions que comme dés articles. Nomirté
îubraicapr'Opriè loquendo fitnt indéeli/iahilid. Quo ergo
itï cajh àccipiénda fine & cjferènda , non tetminationc
digftofcïtïif,- fîdpmcipué corifiruftiône & proepôfitiônibùs
quibufdàffi, féù litteris pfeepofiikrnïiiü vices gereniibüs ,
qüoe ipfis à ftónte ddjiciufitur, Mafelef. Gfdhvfn. hebt,
c ^ ij .n . f .
A l’égard déS G rées, quoique leurs noms fe déclinent
, ë’eft-à-dirè qu’ils changent dé términaifon
félon lès divers rapports Ou Vues dé l’efprit qu’On a à
marquer,- ils ont encore un article é , >}, vè, t2,
T», é e. dont ils font un grand ufâgé : èe mót eft en
gréé Hhe partie fpéciale â'oraifon. Les Grecs l’appèl-
lerent aprpov, du verbe dpa, apto, adapto , difpOfer ,
apprêter, parce qu’en effet l’àtiicle difpofe l’efprit à
confidérer le riiot qui le fuit fotfS urt point de vue
particulier ; ce que nous développerons plus en détail
dans là fuite.
Pour ce qui eft dès Latins, Quihfilieri dit ëxpteffé-
ment qu’ils n’ont point à'articles, Si qu’ils ft’eft ont
pas befoin, hôfier fèrfho articulas hen défidétdt. (Quint.
lib. I . c.yv.) Cès adje&ifs is, hic, ilU, ißt, qui font
fouvent des pronoms de la troifieme perforine, font
auffi des adjeÔifs démohffratifs & hîétaphÿfique's ,
c’eft-à-dire qui ne marquent point dans les Objets dès
qualités réelles indépendantes dé notre manière de
penfer. Cès adjeôifs répondent plutôt à notre ce qu’à
notre le. Les Latins s’en fervèftt pour plus d’énergie
& d’emphafe : Catonem ilium fapitntètn (Cic.) cè fâgé
Càton ; ille àltér, (Ter.) cet autre ; illd fegès, (Virg.
Georg. /. v. 4 7 .) cetté moiffoft ; illd return domina for*
tuna , (Cic. pró Mare, ni 2 .) la fortuné ellè-ffiêmé,
cettè rtiàîtreffe des événèméns.
Uxorerh ille tuus pulcher amator habet.
Propert. lib. I I . eleg. xvj. r . 4. Ce bel amant que
vous a v é z, a une femme*
Cès adjeâifs latins qui ne fervent qu’à déterminer
l’objet avec plus de force j föht fi differens de Y article
grec & de Yarticle françois, que Voffilts prétend ([de
Ahoi. lib. I . Ci j . p. que les maîtres qui, eft
faifänt apprendre les déèlinaifOhs latines, fönt dire
heee müjh, induiférit leurs difciples ert erreur ; & que
pour rendre littéralement la valeur de ces deux mots
lätihs felbh lé génie de la langue gredué, il fàudroit
traduire heee tnufa, avfh » fxoii&u, c’eft-à-dire cette ld
ttiUfe.
Les Latins faiföiéht un üfdgé fi fréquent dé leur ad-
jeftif démônftratif i//cj ilia, illud, qu’il y a lieu dé
croire que c’eft de cés mots que vreriftent notre le &
hotrë là ; Ille ego, mulicriUa : Fve kàmlni Uli per'quem
IradètüTi (Lue, c. xx ij. v. ü i.) botinm trdtei f i ttutiUs
hóhfuifièi homo ille. (Matt. c. ie&vj. v. ïq . ) Hic illd
pàrVà Ptiilia Pkiiôcltta. (Virg. Æh. lib. I II. v. 40 /..)
C ’eft-là qtië là pétitè Vlllé dé Pètilie fht bâtie pat
Philbôéte. Aufohîoepàrs ilia procul puttin pahdit Apollo.
Ib. V. 4^9. Hlec iUa Ghutybdis. Ib. v. 55'B. Pétronè
faifant parler un guerrier qui fe plaignoit de ce que
fon bräs étbit devenu paralytique, lui fait dire : fit-
htràtà efl pars ilia córpöris ittei qUâ qu&ndcùit Achilles
ïrümy il eft mort te bras par lequel j’étôis autrefois
Un Achille. Iüe Dïâtn püter, Q vïàt. Quifqùis fuit ilh
•Htürum. Ovide , M'efäth. üb. I. v. $2.
Il y a im graad nombre d’exemples de cet ufage
qüe lés Latins Faifoiènt de leür illi, rlla , illud, fur-
tôut dahs lës cofhiques , dans Phèdre'& 'dans les auw
teurs de là baffe latinité. C ’e ft de la dêrniere fyllabe
de ce 'ntöt ille, quand il n’eft pas ‘employé comme
ptoriom , & qu’il n’eft qu’üh fimple adjeftif indicat
i f , que ‘vient notrè article^ .* à l’égard de notre la,
il Vrènt dû fémiiiih ilia , LU première fyllabe du maf-
culiu iHe a donhédiemà notre pronom i l , dont nous
faifons ufage avec les verbes, ille ajfirmat, ( Phaôd.
lib. III. fab. iij. v. 4 . ) il affûre. Ille fecit, (Id . lib.
Ill.fa b . v. vers 8. ) il a fait ou il fit. Ingenio vires ille
dat, ille rapit, (Qv. Hcr. ep. xv. v. 206'.') A l’égard
de elle, il vient de.ilia, illd veretur , (Virg. eclog. iij.
v. 4.) elle craint.
Dans prefque toutes les langues vulgaires, les
peuples, foit à l’exemple des Grecs, foit plûtôt par
une pareille difpofition d’efprit, fe font fait de ces
prëpofitifs qu’on appelle articles. Nous nous arrêterons
principalement à Y article françois.
Tout prépofitif n’eft pas appellé article. Ce , cet,
cette, certain, quelque , tout, chaque, nul, aucun , mon,
ma, mes,&cc. ne font que des ajeftifs métaphyfi-
ques ; ils precedent toûjours leurs fubftantifs ; & puif-
qu’ils ne fervent qu’à leur donner une qualification
métaphyfique , je ne fai pourquoi on les met dans la
claffe des pronoms. Quoi qu’il en foit, on ne donne
pas le nom à!article à ces adjeftifs ; ce font fpéciale-
ment ces trois mots, le , la , les, que nos Grammairiens
nomment articles, peut-être parce que ces mots
font d’un ufage plus fréquent. Avant que d’en parler
plus en détail, obfervons que
i° . Nous nous fervons de le devant les noms maf-
culins au fingulier, le roi, le jour. 20. Nous employons
la devant les noms féminins au fingulier,
la reine, la nuit. 30. La lettre s qui, félon l’analogie
de la langue, marque le pluriel quand elle eft ajoutée
au fingulier, a formé les du fingulier le; les fert
également pour les deux genres, les rois, les reines,
les fours, les nuits. 40. Le, la, les, font les trois articles
fimples : mais ils entrent aufli en compofition
avec la prépofition à , & avec la prépofition de, &
alors ils forment les quatre articles compofés, au, aux,
du, des.
Au eft compofé de la prépofition à , &c de l’article
le, enforte que au eft autant que à le. Nos peres
difoient al, al tems Innocent III. c’eft-à-dire au tems
d Innocent III. L’apofioile manda adprodome, &c. le
pape envoya au prud’homme : Ville-Hardouin, lib. /.
pag. 1. mainte lerme i fu plorée de pitié aldepartir, ib.
id. page^ /(f, Vigenere traduit maintes larmes furent
plorèes à leur partement, & du prendre congé. C ’eft le
fon obfcur de Ve muet de Y article fimple le , & le
changement affez commun en notre langue de l en
u , comme mal, maux, cheval, chevaux ; al tus, haut,
ùlnus, aulne (arbre) alna, aune (mefure) alter, autre
, qui ont fait dire au au lieu de à le, ou de al. Ce.
n’eft que quand les noms mafeulins commencent
par une confonne ou une voyelle afpirée, que l’on
fe fert de au au lieu de à le; car fi le nom mafeulin
commence par une voyelle, alors on ne fait point
de contraction, la prépofition à & l’article le demeurent
chacun dans leur entier : ainfi quoiqu’on dife le
coeur , au coeur , on dit Yefprit, à l'efprit, le pere, au
pere; & on dit C enfant, à l'enfant; on dit le plomb ,
au plomb ; & on dit l’or, à l'or, L'argent, à l'argent,
car quand le fubftantif commence par une voyelle,
1’« muet de le s’élide avec cette voyelle, ainfi la rai-
fon qui a donné lieu à la contraûion au , ne fijbfifte
plus ; & d’ailleurs, il fe feroit un bâillement defa-
greable fi l’on difoit au efprit, au argent, au enfant,
& c . Si le nom eft féminin, n’y ayant point à'e muet
dans l’article la, on ne peut plus en faire au ; ainfi
1 on conferVe alors la prépofition & l’article, la rai-
fon , a la raifon , la vertu, à la vertu. i°. Aux fert au
pluriel pour les deux genres ; c’eft une contraction
pour a les , aux hommes , aux femmes, aux rois, aux
reines, pour à les hommes, aies femmes, &c. 3*. Du eft éneore une contraction pour de le ; c’eft le fon
obfcur des deux e muets de fuite, de le, qui a amené
la contraction du : autrefois on difoit deù; la fins del
confeil f i fu tels , & c. l’arrêté du confeil fut, &c..
Ville-Hardouin , Hb, VII. p. /07, Gervaife del Chaf-
Tamel,
tel, id. ib. GerOais du Càfiel. Vigenere. Oft dit donc
du bien & du mal, pour de le bien , de le m al, & ainfi
de tous les noms mafeulins qui commencent par une
confonne ; car fi le nom commence par une voyelle,
ou qu il foit du genre féminin, alors on revient à la
umplrcite de la prépofition, & à celle de YanicU qui
convient au genre du nom ; ainfi on dit de C efprit-,
de U venu, de U peine ; par-là on évite le bâillement t
c eft la meme raifon que l’on a marquée fur du. 4°.
Enfin des fert pour les deux genres au pluriel 5c fe
dit pour de U s, des rois, des reinest
Nos enfans qui commencent à parler, s'énoncent
d abord fans contraction ; ils difent de le pain, de U *
vin. Tel eft encore l’ufage dans prefque toutes nos
provinces limitrophes, fur-tout parmi le peuple.:
c eft peut-ctre ce qui a donné lieu aux premières
obfervations que nos Grammairiens ont faites de
ces contractions.
Les Italiens ont un pliis grand nombre de prépofitions
qui fe contractent avée leurs articles.
Mais les Anglois qui ont comme nous des prépofitions
& des articles, ne font pas ces contractions ;
ainfi ils difent o f the, de le , où nous difons du ; tht
king, le roi ; ofthe king, de le roi, & en françois du
roi ; o f the queen, de la reine ; to the king, à le roi,
au roi; to the queen, à la reine. Cette remarque n’eft
pas de fimple curiofité ; il eft important, pour rendre
raifon de la conftruCtion, de lëparer la prépofition
de Y article, quand ils font l’un & l’autre en compofition:
par exemple, fi je veux rendre raifon de
cette façon de parler, du pain fujfit, je commence
par dire de le pain; alors la prépofition de, qui-eft ici
une prépofition extraûive, & qui comme toutes les
autres prépofitions doit être entre deux termes, cette
prépofition, dis-je, me fait connoîtrë qu’il y a ici une
ellipfe.
Phedre, dans la fable de la vipère & de la lime , pour
dire que cette vipere cherchoit dequoi manger, dit t
hoec quum tentaretfiqua res effet cibi, l. IV. fab. vij. v .4.
ou vous voyez que aliqua res cibi fait connoîtrë par
analogie que du pain , ■ c’eft aliqua res punis ; paulu-
lum punis , quelque chofe , une partie, une portion
du pain : c’eft ainfi que les Anglois, pour dire donnez
moi du pain, dif ent give me fomebread , donnez-
moi quelque pain ; & pour dire j'a i vu des hommes ,
ils difent I hâve feen forne men ; mot à mot, j'a i vâ
quelques hommes ; à des Médecins, to fomephyficians,
à quelques médecins.
L ’ufage de fous-entendre ainfi quelque nom générique
devant de, du, des, qui commencent une
phrafe , n’étoit pas inconnu aux Latins: Lentulus
écrit à Cicéron de s’intéreffer à fa gloire ; de faire
valoir dans le fénat & ailleurs tout ce qui pourroit
lui faire honneur : de nofira dignitate velim tibi utfim-
per cura fit. Cicéron, ép. livre X I I . ép. xjv. Il eft
évident que de nofira dignitate ne peut être le nominatif
de cura f it ; cependant ce verbe fit étant à
un mode fini, doit avoir un nominatif : ainfi Lentulus
avoit dans l’efprit ratio ou Jermo de nofira dignitate,
l’intérêt de ma gloire ; & quand même on ne
trouveroit pas en ces occafions de mot convenable à
fuppléer, l’efprit n’en feroit pas moins occupé d’une
idée que les mots énoncés dans la phrafe réveillent,
mais qu’ils n’expriment point : telle eft l’analogie, tel
eft l’ordre de l’analylé de l’énonciation. Ainfi nos
Grammairiens manquent d’exa&itude, quand ils difent
que la prépofition dont nous parlonsf in à marquer
le nominatif, lorjqidon ne veut que dejigner Une partie
de la chofe, Gramm. de Regnier, page 170 ; Refi
taut, pag. 75. & 418. Ils ne prennent pas garde que
les prépofitions ne fauroient entrer dans le difcour.s,
fans marquer un rapport ou relation entre deux termes
, entre un mot 8c un mot : par exemple, la prépofition
pour marque un motif, une fin, une raifon ;
Y y y ÿ ij