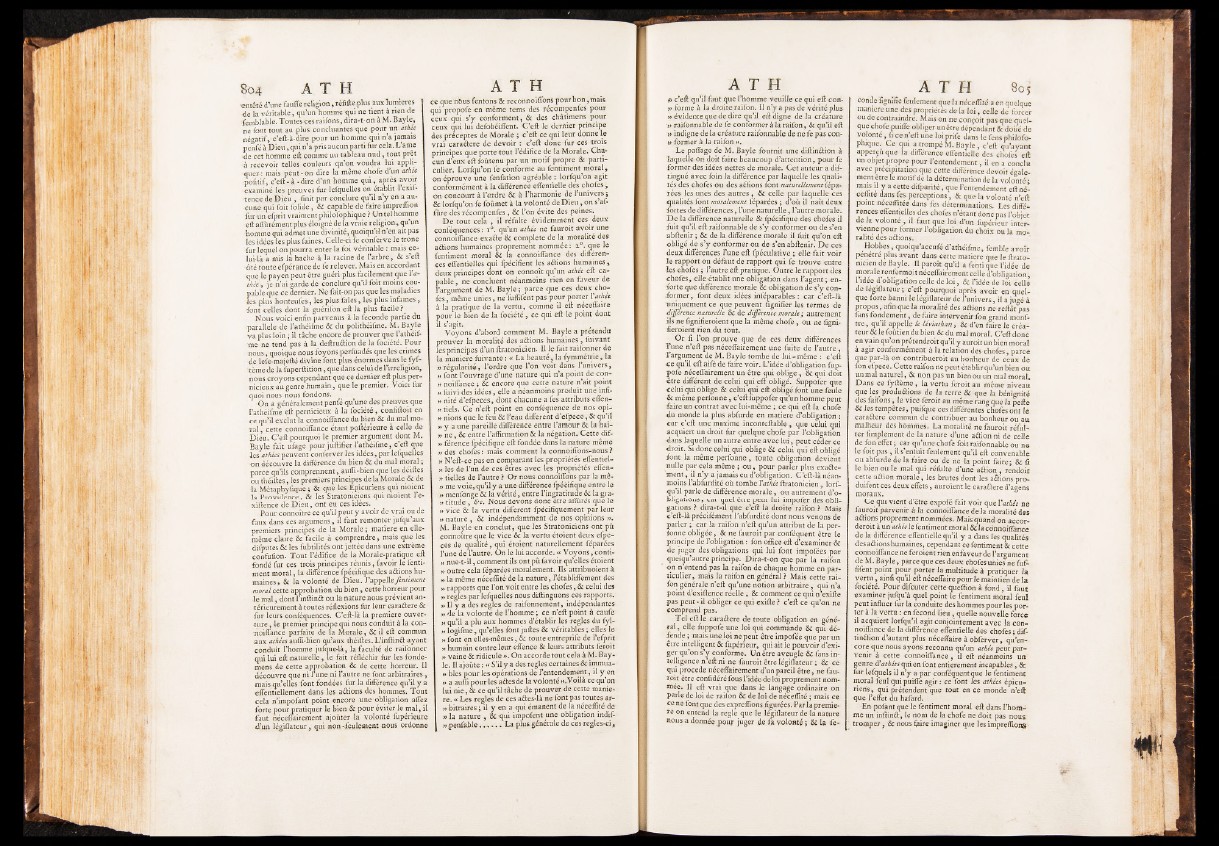
entêté d'une finiflé religion, réfifepliisaitxlumisïes
de la véritable , qu'un hopame qui ne tient à rien de
Temblable. Toutes çes raifons, djra-ri on à M. Bayle,
ne font tout au plus concluantes tp e .pour un zthit
négatif, c’eft-à-dire pour un homme qui n’a jamais
penfé à Dieu, qui n’â pris aucun parti fur cela. L’ame
de cet homme eft comme uu tableau nnd, tout prêt
à recevoir telles couleurs qu’on voudra lui appli- •
•quer-: mais peut- on dire la même chofe d’un athée
pofitif, c’eft - à -dire d’un homme qui, après avoir
examiné les preuves fur lefquelles on établit 1 existence
de Dieu , finit par conclure qu’il n’y en a aucune
qui foit folide, & capable de faire impreflion
fur lin efpïit vraiment philofophique ? Un tel homme
eft affurément plus éloigné de la vraie religion, qu’un
homme qui admet une divinité, quoiqu’il n’en ait pas
ies idées les plus faines. Celle-ci fe conferve le tronc
-fur lequel on pourra enter la foi véritable : mais celui
là a mis la hache-à la racine de l’arbre , & s’eft
-ôté toute efpérance de fe relever. Mais en accordant
que le payen peut être guéri plus facilement que l’athée;
je n’ai garde de conclure qu’il foit moins coupable
que ce dernier. Ne faitron pas que les maladies
les plus honteufes, les plus -fales, les plus infâmes,
•font celles dont la guérifon eft la plus facile?
Nous voici enfin parvenus à la fécondé partie du
■ parallèle de l’athéifme 8c du polithéifme. M.^ Bayle
va plus loin ; il tâche encore de prouver que l’athéif-
me -ne tend pas à la deftruCtion de la fociété. Pour
nous, quoique nous foyons perfuades que les crimes
de lefe-majefté divine font plus énormes dans le fyf-
tème de la fuperftition, que dans celui de l’irreligion,
nous croyons cependant que ce dernier eft plus pernicieux
au genre humain, que le premier. Voici fur
quoi nous nops fondons.
On a généralement penfé qu’une des preuves que
Pathéifme eft pernicieux à la fociété, confiftoit en
ce qu’il exclut la connoiffance du bien & du mal moral
, cette connoiffance étant poftérieure à celle de
Dieu. C ’eft pourquoi le premier argument dont M.
Bayle fait ufage pour juftifier l ’athéifme, c’eft que
les athées peuvent conferver les idées, par lefquelles
on découvre la différence du bien 8c du mal moral ;
parce qu’ils comprennent, aufli-bien que les deiftes
ou théiftes, les premiers principes delà Morale & de
-la Métaphyfique ; & que les Epicuriens qui nioient
la Providence, & les Stratoniciens qui nioient l’e-
xiftence de Dieu, ont eu ces idées.
Pour connoître ce qu’il peut y avoir de vrai ou de
•faux dans ces argumens , il faut remonter jufqu’aux
premiers principes de la Morale ; matière en elle-
même claire 8c facile à comprendre, mais que les
difputes 8c les fubtilités ont jettée dans une extrême
confufion. Tout l’édifice de la Morale-pratique eft:
fondé fur ces trois principes réunis, favoir le fenti-
ment moral, la différence fpécifique des aCtions humaines,
& la volonté de Dieu, rappelle fentiment
moral cette approbation du bien, cette horreur pour
le mal, dont l’inftinCt ou la nature nous prévient antérieurement^
toutes réflexions fur leur caraCtere &
fur leurs conféquences. C ’eft-là la première ouverture,
le premier principe qui nous conduit à la con-
-noiffance parfaite de la Morale, 8c il eft commun
aux athées aufli-bien qu’aux théiftes. L’inftinCt ayant
conduit l’homme jufque-là, la faculté de raifonner
qui lui eft naturelle, le fait réfléchir fur les fonde-
-mens de cette approbation 8c de cette horreur. Il
découvre que ni l’une ni l’autre ne font arbitraires,
mais qu’ elles font fondées fur la différence qu’il y a
effentiellement dans les actions des hommes. Tout
cela n’impofant point encore une obligation affez
forte pour pratiquer le bien & pour éviter le mal, il
faut héceffairement ajouter la volonté fupérieure
d’un légiflateur, qui non -feulement nous ordonne
ce que nous fentons & reconnoiffons pour b on , mais
qui propofe -en même tems des récompenfes pour
ceux qui.s’y conforment, & des châtimens pour
ceux qui lui defobéiffent. C’eft le dernier principe
des préceptes de Morale ; c’eft ce qui leur donne le
vrai caraCtere de devoir : c’eft: donc fur ces trois
principes que porte tout l’édifice de laMorale. Chacun
d’eux eft foûtenu par un motif propre & particulier.
Lorfqu’on fe conforme au fentiment moral ,
on éprouve une fenfation agréable : lorfqu on agit
conformément à la différence effentielle des chofes -,
on concourt à l’ordre 8c à l’harmonie de l’univers ;
& lorfqu’on fe foûmet à la volonté de D ieu , on s’afi
fûre des récompenfes , 8c l’on évite des peines.
De tout cela , il réfulte évidemment ces deux
conféquences : i°. qu’un athée ne fauroit avoir une
connoiffance exaCte 8c complété de la moralité des
a étions humaines proprement nommée: z°. que le
fentiment moral 8c la connoiffance des différences
effentielles qui fpécifient les a étions humaines ,
deux principes dont on connoît qu’ un athée eft capable
, ne concluent néanmoins rien en faveur de
l’argument de M. Bayle; parce que ces deux chofes
, même unies, ne fuffifent pas pour porter 1 athet
à la pratique de la vertu, comme il eft néceffaire
pour le bien de la fociété, ce qui eft le point dont
il s’agit.
Voyons d’abord comment M. Bayle a prétendu
prouver la moralité des aétions humaines , fuivant
les principes d’un ftratonicien. Il le fait raifonner de
la maniéré fuivante : « La beaute, la fymmetrie, la
»régularité, l’ordre que l’on voit dans l’univers,
» font l’ouvrage d’une nature qui n’a point de con-
» noiffance ; 8c encore que cette nature n’ait point
» fuivi des idées, elle a néanmoins produit une infi-
» nité d’efpeces, dont chacune a fes attributs effen-
» tiels. Ce n’eft point en conféquence de nos opi-
» nions que le feu & l’eau different d’efpece, & qu’il
» y a une pareille différence entre l’amour 8c la hai-
» ne, & entre l’affirmation & la négation. Cette dif-
» férence fpécifique eft fondée dans la nature même
» des chofes: mais comment la connoiffons-nous?
» N’eft-ce pas en comparant les propriétés effentiel-
» les de l’un de ces êtres avec les propriétés effen-
» tielles de l’autre ? Or nous connoiffons par la mê-
» me voie, qu’il y a une différence fpécifique entre le
» menfonge 8c la vérité, entre l’ingratitude 8c la gra-
» titude , 6’c. Nous devons donc être affûrés que le
» vice & la vertu different fpécifiquement par leur
» nature , & indépendamment de nos opinions ».
M. Bayle en conclut, que les Stratoniciens ont pu
connoitre que le vice 8c la vertu étoient deux efpe-
ces de qualité, qui étoient naturellement féparées
l’une de l’autre. On le lui accorde. « V oyons, conti-
» nue-t-il, comment ils ont pû favoir qu’elles étoient
» outre cela féparées moralement. Ils attribuoient à
» la même néceflité de la nature, l’établiffement des
» rapports que l’on voit entre les chofes, & celui des
» réglés par lefquelles nous diftinguons ces rapports.
» Il y a des réglés de raifonnement, indépendantes
» de la volonté de l’homme ; ce n’eft point à caufe
» qu’il a plu aux hommes d’établir les réglés du fyl-
» logifme, qu’elles font juftes 8c véritables ; elles le
» font en ellès-mêmes, & toute entreprife de l’efprit
» humain contre leur effence & leurs attributs feroit
» vaine & ridicule ». On accorde tout cela à M. Bayle.
Il ajoûte : « S’il y a des réglés certaines & immua-
» blés pour les Opérations de l’entendement, il y en
» a aufli pour les aCtes de la volonté ». Voilà ce qu’on
lui nie, & ce qu’il tâche de prouver de cette maniéré.
« Les réglés de ces aCtes-là ne font pas toutes ar-
» bitraires ; il y en a qui émanent de la néceflité de la nature , &qui impofent une obligation indif-
»penfable. La plus générale de ces regles-ci,
#> c’eft qu’il faut que l’homme veuille ce qui eft con-
» forme à la droite raifon. Il n’y a pas de vérité plus
» évidente que de dire qu’il eft digne de la créature
» raifonnable de fe conformer à la raifon, & qu’il eft
» indigne de la créature raifonnable de ne fe pas con-
» former à la raifon ».
Le paffage de M. Bayle fournit une diftinCtion à
laquelle on doit faire beaucoup d’attention, pour fe
-former des idées nettes de morale. Cet auteur a distingué
avec foin la différence par laquelle les qualités
des chofes ou des aétions font naturellement (épatées
les unes des autres , 8c celle par laquelle ces
qualités font moralement féparées ; d’où il naît deux
fortes de différences, l’une naturelle,. l’autre morale.
D e la différence naturelle & fpécifique des chofes il
fuit qu’il eft raifonnable de s’y conformer ou de s’en
abftenir ; 8c de la différence morale il fuit qu’on eft
obligé de s’y conformer ou de s’en abftenir. De ces
deux différences l’une eft fpéculative ; elle fait voir
le rapport ou défaut de rapport qui fe trouve entre
les chofes ; l’autre eft pratique. Outre le rapport des
chofes, elle établit une obligation dans l’agent ; en-
forte que différence morale 8c obligation de s’y conformer
, font deux idées inféparables : car c’eft-là
uniquement ce que peuvent fignifier les termes de
différence naturelle 8c de différence morale; autrement
ils ne fignifieroient que la même chofe, ou ne figni-
fieroient rien du tout.
Or fi l’on prouve que de ces deux différences
l ’une n’eft pas néceffairement une fuite de l’autre ,
l’argument de M. Bayle tombe de lui-même : e’eft
•ce qu’il eft aifé de faire voir. L’idée d’obligation fup-
pofe néceffairement un être qui oblige , 8c qui doit
être différent de celui qui eft obligé. Suppofer que
celui qui oblige & celui qui eft obligé font une feule
& même perlonne, c’eft luppofer qu’un homme peut
faire un contrat avec lui-même ; ce qui eft la chofe
du monde la plus abfurde en matière d’obligation :
car c’eft une maxime inconteftable , que celui qui
acquiert un droit fur quelque chofe par l’obligation
dans laquelle un autre entre avec lui, peut céder ce
droit. Si donc celui qui oblige 8c celui qui eft obligé
font la même perfonne, toute obligation devient
nulle par cela même ; o u , pour parler plus exactement
, il n’y a jamais eu d’obligation. C ’eft-là néanmoins
l’abfurdité où tombe l’athée ftratonicien, lorf-
qu’il parle de différence morale, ou autrement d’obligations;
car quel être peut lui impofer des obligations
? dira-t-il que c’eft la droite raifon ? Mais
c ’eft-là précifément l’abfurdité dont nous venons de
parler ; car la raifon n’eft qu’un attribut de la perfonne
obligée, & ne fauroit par conféquent être le
principe de l’obligation : fon office eft d’examiner 8c
de juger des obligations qui lui font impofées par
quelqu’autre principe. Dira-t-on que par la raifon
' on n’entend pas la raifon de chaque homme en particulier,
mais la raifon en général? Mais cette raifon
générale n’eft qu’une notion arbitraire, qui n’a
point d’exiftence réelle ; 8c comment ce qui n ’exifte
pas peut - il obliger ce qui exifte ? c’eft ce qu’on ne
comprend pas.
Tel eft le caraCtere de toute obligation en général,
elle fuppofe une loi qui commande & qui défende
; mais unejoi ne peut être impofée que par un
être intelligent & fupérieur, qui ait le pouvoir d’exiger
qu’on s’y conforme. Un être aveugle 8c fans intelligence
n’eft ni ne fauroit être légiflateur ; & ce
qui procédé néceffairement d’un pareil être, ne fauroit
être confidéré fous l’idée de loi proprement nommée.
Il eft vrai que dans le langage ordinaire on
parle de loi de raifon 8c de loi de néceflité ; mais ce
ce ne font que des exprefîions figurées. Par la première
on entend la réglé que le légiflateur de la nature
nous a donnée .pour juger de la volonté > & la feconae
iîgnifîe feulement que la nêce/TIfé a en quelque
maniéré une des propriétés de la lo i, celle de forcer
ou de contraindre. Mais on ne conçoit pas que quelque
chofe puiflè obliger un être dépendant & doüé de
yolonte, fi ce n’eft une loi prife dans le fens philofo-
phiquej Ce qui a trompé M. Ba yle, c’eft qu’ayant
apperçu que la différence effentielle des chofes eft
un objet propre pour l’entendement, il en a conclu
avec précipitation que cette différence devoit également
être le motif de la détermination de la volonté ;
maIs 7 * Crtte difParité > <ïlle l’entendement eft né-
cefüté dans fes perceptions, & que la volonté n’eft
point neceflitée dans fes déterminations. Les différences
effentielles des chofes n’étant donc pas l’objet
de la volonté , il faut que loi d’un fupérieur intervienne
pour former l’obligation du choix ou la moralité
des avions.
Hobbes, quoiqu’accufé d’athéifme, femble avoir
pénétré plus avant dans cette matière que le ftratonicien
de Bayle. Il paroît qu’il a fentique l’idée de
morale renfermoit néceffairement celle d’obligation *
l’idée d’obligation celle de lo i, 8c l’idée de loi celle
de légiflateur; c’eft pourquoi après avoir en quelque
forte banni le légiflateur de l’univers, il a jugé à
propos, afin que la moralité des aâions ne reftât pas
fans fondement, de faire intervenir fon grand monfi-
tre , qu’il appelle le léviathan, & d’en faire le créateur
& le foûtien du bien & du mal moral, C ’eft donc
en vain qu’on pretendroit qu’il y auroit un bien moral
à agir conformément à la relation des chofes, parce
que par-là on contribueroit au bonheur de ceux de
fon efpece. Cette raifon ne peut établir qu’un bien ou
un mal naturel, & non pas un bien ou un mal moral.
Dans ce fyfteme, la vertu feroit au même niveau
que les productions de la terre 8c que la bénignité
des faifons, le vice feroit au même rang que la pefte
8c les tempêtes , puifque ces différentes chofes ont le
caraCtere commun de contribuer au bonheur ou au
malheur des hommes. La moralité ne fauroit réful-
ter Amplement de la nature d’une aCtion ni de celle
de fqn effet ; ca'r qu’une chofe foit raifonnable ou ne
le foit pas , ils’entùit feulement qu’il eft convenable
ou abfurde de la faire ou de ne la point faire; 8c fi
le bien ou le mal qui réfulte d’une aCtion , rendoit
cette aCtion morale, les brutes dont les actions pro-
duifent cës deux effets, auroient le cara&ere d’agens
moraux.
Ce qui vient d’être expofé fait voir que l’athée ne
fauroit parvenir à la connoiffance delà moralité des
aCtions proprement nommées. Mais quand on accor-
deroit à un athée le fentiment moral 8c la connoiffance
de la différence effentielle qu’il y a dans les qualités
des aCtions humaines, cependant ce fentiment & cette
connoiffance ne feroient rien en faveur de 1-argument
de M. Bayle, parce que ces deux chofes uhies ne fuffifent
point pour porter la multitude à pratiquer la
vertu, ainfi qu’il eft néceffaire pour le maintien de la
fociété. Pour difeuter cette queftion à fond, il faut
examiner jufqu’à quel point le fentiment moral feui
peut influer fur la conduite des hommes pour les porter
à la vertu : en fécond lieu, quelle nouvelle force
il acquiert lorfqu’fl agit conjointement avec la connoiffance
de la différence effentielle des chofes ; distinction
d autant plus néceffaire à obferver, qu’en-
core que nous ayons recopnu qu’un athée peut parvenir
à cette connoiffance, il eft néanmoins un
genre à*athéesqui en font entièrement incapables, &
lur lefquels il n’y a par conféquent que le fentiment
moral feul qui puiffe agir : ce font les athées épicuriens
, qui prétendent que tout en ce monde n’eft
que l’effet du hafard.
En polànt que le fentiment moral eft dans l’homme
un inftinét, le nom de la chofe ne doit pas nous
tromper, & nous feire imaginer que les impreflions