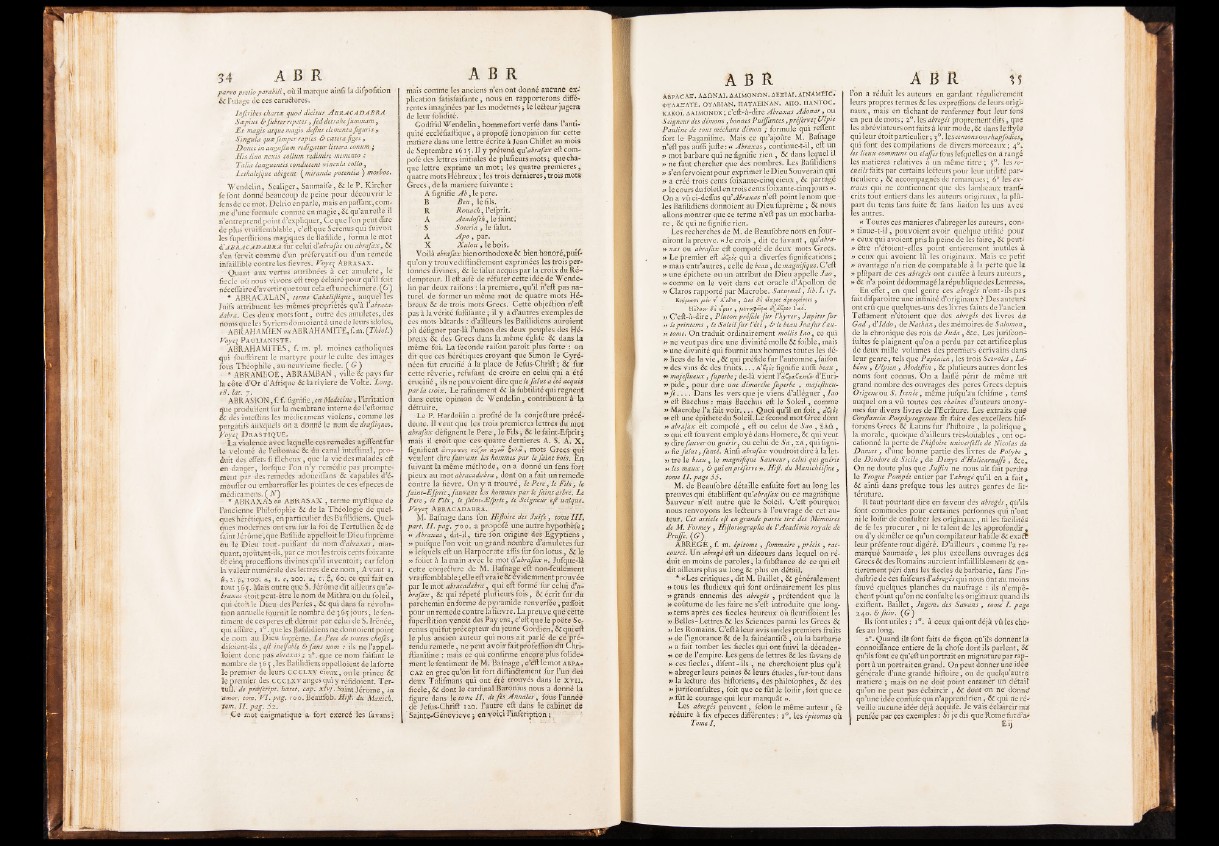
parvo pretio parabüi, où il marque ainfi la difpofition
6c Tuiage de ces cara&eres.
Infcribes chartes q u o d dicitur A b R A C A D A B R A
Soepius & fubter répétés , fed detrahefummani ,
E t ma gis atque magis dejînt elemtnta figuris ,
Singula quee femper rapies & ccstera figes ,
Donec in angufeum redigatur littera conum ;
His lino nexis collum redimire memento :
T alla languentis conducent vincula collo ,
LethaleJ'que abigent ( miranda potentia ) morbps.
Wendelin, Scaliger, Saumaife, & le P. Kircher
fe font donné beaucoup de peine pour découvrir le
jfens de ce mot. Delrio en parle, mais en paffant, comme
d’une formule connue en magie, & qu’au relie il
n’entreprend point d’expliquer, Ce que l’on peut dire
de plus vraiffemblable, c’eft que Serenus qui fuivoit
les fuperftitions magiques de Balilide, forma le mot
à? ABRACADABRA lùr celui d'abrafac ou abrafax, 6c
s’en fervit comme d’un préfervatif ou d’un remede
infaillible contre les fievres. Voye{ A b r a s a x .
• Quant aux vertus attribuées à cet amulete, le
fiecle où nous vivons ell trop éclairé pour qu’il foit
néceffaire d’avertir que tout cela ell une chimere. (G)
* ABRACALAN, terme Cabalifiique, auquel les
Juifs attribuent les mêmes propriétés qu’à Yabraca-
dabra. Ces deux mots font, outre des amuletes, des
noms que les Syriens donnoient à une de leurs idoles.
ABRAHAMIEN 0«ABRAHAMITE,f.m.(7%<:W.)
Voye^ Pa u l ia n is t e .
ABRAHAMITES, f. m. pl. moines catholiques
qui fouffrirent le martyre pour le culte des images
fous Théophile, au neuvième fiecle. ( G )
- * ABRAMBOÉ, ABRAMBAN , ville & pays fur
la côte d’Or d’Afrique 6c la rivière de Volte. Long.
t8. lut. y.
ABRASION, f. f. lignifie, en Médecine, l’irritation
que produilent fur la membrane interne de l’eltomac
& des intellins les médicamens violens, comme les
purgatifs auxquels ori a donné le nom de drajliques.
V o y e i D r a s t iq u e .
La violence avec laquelle ces remedes agiffent fur
le velouté de Teftoma-c & du canal inteftinal, produit
des effets fi fâcheux, que la vie des malades ell
en danger', lorfque l’on n’y remédie pas promptement
par des remedes adouciffans 6c capables d’é-
môuffer ou embarraffer les pointes de ces efpeces de
médicamens. ( N') ,
* ABRAXAS ou ABRASAX , terme myllique de
l’ancienne Philofophie & de la Théologie de quelques
hérétiques , en particulier des Bafilidiens. Quelques
modernes- ont cru fur la foi de Tertullien 6c de
laint Jérôme,que Bafilide appelloit le Dieu fuprème
ou le Dieu tout-puiffant du nom $ abraxas, marquant,
ajolitent-ils, par ce mot les trois cents foixante
6i cinq proceffions divines qu’il inventait; car félon
1a valeur numérale des lettres de ce nom, A vaut i .
j8,a: pyioo‘; «, i. <r, îoo. a,' r.if, 6a: ce qui'faiten
tout 365. Mais outre que S. Jérômedit ailleurs qu’^-
braxas etoit,peut-être le nom de Mithra ou du foleil,
qui étoitle Dieu des Perfes, 6c qui dans fa révolution
annuelle fournit le nombre de 365 jours, le fen-
timent de ces peres efl détruit par celui de S. Irënée,
qui aflure, i° . que les Bafilidiens ne. donnoient point
de nom au Dieu fuprème. -Le. Père de toutes chofes ,
difoient-ils, efi inejffablç &fans ’nom : ils nel’appel-
loient donc pas abraxas ; que ce nom faifant le
nombre de 36 5 , les Bafilidiens appelloient de la forte
le premier de leurs c c c l x y cieux, ouïe prince 6c
le premier.des.ee cl x v anges qui y réfidoient. Ter-
tul'l. de prafcrïpt. hoeret. cap. xlvj. Saint Jérome, in
amor. tom. Vï.pag. 100. fîéaufob. Ht fi. du Manich.
yom. II. pag. Sz.
' Ce mot énigmatique a. fort exercé ies favans:
mais comme les anciens n’en ont donné aucune explication
fatisfaifante, nous en rapporterons différentes
imaginées par les modernes ; le leéleur jugera
de leur folidité.
Godfrid Wendelin, homme fort verfé dans l’antiquité
eccléfiaftique, a propofé fon opinion fur cette
matière dans une lettre écrite à Jean Chiflet au mois
de Septembre 1615. Il y prétend qu’abrafax ell com-
pofé des lettres initiales de plufieurs mots ; que chaque
lettre exprime un mot ; les quatre premières,
quatre mots Hébreux ; les trois dernieres, trois mots*
Grecs, de la maniéré fuivante ;
A fignifie A b , le pere.
B Ben, le fils.
R Rouach, l’efprit.'
A Acadofch, le faintj
S Soteria, le falut.
A Ap o , par.
X Xulou, le bois.'
Voilà abrafax bien orthodoxe 6c bien honoré, puif-
qu’on y trouve diftin&ement exprimées les trois per-
lonnes divines, 6c le falut acquis par la croix du Rédempteur.
Il ell ailé de réfuter cette idée de Wendelin
par deux raifons : la première, qu’il n’ell pas naturel
de former un même mot de quatre mots Hébreux
6c de trois mots Grecs. Cette objeélion n’eft:
pas à la vérité fuffifante ; il y a d’autres exemples de
ces mots bâtards : d’ailleurs les Bafilidiens auroient
pu défigner par-là l’union des deux peuples des Hébreux
6c des Grecs dans la même églife 6c dans la
même foi. La fécondé raifon paroît plus forte : on
dit que ces hérétiques croyant que Simon le Cyré-
néen fut crucifié à la place de Jefils-Chrift; 6c fur
cette rêverie, refufant de croire en celui qui a. été
crucifié, ils ne pouvoient dire que le falut a été acquis
par la croix. Leràfinement 6c la fubtilité qui régnent
dans cette opinion de Wendelin, contribuent à la
détruire.
Le P. Hardoüin a. profité de la conje&ure précédente.
Il veut que les trois premières lettres du mot
abrafax défignent le .Pere, le Fils -, 6c le fàint-Efprit ;
mais il croit que ces quatre dernieres A. S. A. X .
lignifient «VrfO'oe-tsç <rof,w àyiéâ , mots Grecs qui
veulent dire fauvant les hommes par le faint bois. En
fuivartt la même méthode , on a donné un féns Fort
pieux au mot abracadabra , dopt on a fait un remède
contre la fievre. On y a trouvé, le Pere ,'le Fils le
faint-Efprit efauvant les hommes pàrltfaint arbre. Le
Pere , le Fils, le faint-Efprit, le Seigneur efl unique.
Voye^ Abracadabra.
M- Bafnage dans fon Hifloire des Juifs, tome IIT.
part. II. pag. y 00. a propofé une autre hypothèfe;
« Abraxas, dit-il, tire Ion origine des Egyptiens ,
» puifque Ton voit un grand nombre d’amuletes fur
» lefquels ell im Harpocr.ate alîis fur fort lotus, 6c le
>> foiiet à la main avec le mot d’abrafax ». Jufquë-là
cette conjeéhire de M. Bafnage ell non-feulement
vraiffemblable ; elle eft vraie & évidemment prouvée
par le mot abracadabra ^ qui ell formé fur celui dia-
brafax, 6c qui répété plufieurs fois, 6c écrit fût- du
parchemin ën forme de pyramide renverféè, paffoit
pour un remede contre la fievre. La^preuve que-cette
liiperllition venoit des Pay ens, c’en que.le poète Serenus
qui fut précepteur du jeune Gordien, & qui ell
le plus ancien auteur qui mous ait parlé de çë ’prétendu
remede, ne peiit avoir faitprofelïïôn du Chri-
llianifine : mais ce qui confirme encore plus folide-
ment le fentiment de M. Bafnage, c’ëft lemot abpa-
CAZ en grec qu’on lit fort dillinfrement fur l’un des
deux Talifmans qui ont été trouvés dans le x v n .
fiecle, & dont le cardinal Barpnius.nous a donné la
figure dans le tome II. de fes .Annales , fous l’année
de Jefus-Chrill n o . l’autre eft dans' le cabinet de
Sainte-Génevieve ; envoie i l’infçription y
ÀÊPÂCa s . aaûnai. aaimonqn. aesiài. àinameic.'
4>TAASATE. OTABIAN. riATAEINAN. AriO. TIANTOC.
k a k o î. AAIMONOK ; c’eft-à-dire Abraxas Adonar, ou
■ Seigneur des démons, bonnes Puiffances , préferve£ Ulpie
Pauline de tout méchant démon ; formule qui reffertt
fort le Paganifme. Mais ce qu’ajoute M. Bafnage
n’eft pas aufli j ufte : « Abraxas, continue-t-il, eft un
» mot barbare qui ne fignifie rien , 6C dans lequel il
» ne faut chercher que des nombres. Les Bàfilidiens
» s’enfervoient pour exprimer le Dieu Souverain qui
» a créé trois cents foixante-cinq cieux, 6c partage
» le cours du foleil en trois cents foixahte-cinq jours».
On a vu ci-deffus qu’Abraxas n’eft point le nom que •
les Bafilidiens donnoient au Dieu fuprème ; & nous
allons montrer que ce terme n’eft pas un mot barbare
, 6c qui ne fignifie rien.
Les recherches de M. de Beaufobre nous en fourniront
la preuve. «Je crois , dit ce favant, qu’abra-
» xas ou abrafax eft compofé de deux mots Grecs.
» Le premier eft àCpoç qui a diverfes lignifications ;
» mais entr’autres, celle de beau, de magnifique. C ’eft
» une épithete ou un attribut du Dieu appelle Jao,
» comme on le voit dans cet oracle d’Apollon de
» Claros rapporté par Macrobe. Saturnal, lib. I. iy.
YLmptcni p k v t A iS'tv , A/a <JV tîctpoç ctpzo/jtvoto ,
HiXtov é'I ipttv , fj.iTcapa>pcc tf^eiCpoy 1 cto.
» C’eft-à-dire, Pluton préfide fur Vhyver, Jupiter fur
» le printems , le Soleil fur l'été , & le beau. Joafur Vatt-
» tome. On traduit ordinairement mollis Iao, ce qui
» ne veut pas dire une divinité molle 6c foible, mais
» une divinité qui fournit aux hommes toutes les dé-
» lices de la v ie , & qui préfide fur l’automhe, faifon
» des vins 6c des fruits.. . . a’Cpoc fignifie auflî beau ,
*> majeflueux, fuperbe; de-là vient YÀCp'tQa.ivuv d’Euri-
-» pide, pour dire une démarche fuperbe , majeflueu-
» f e . . . . Dans les vers que je viens d’alléguer , Iao
» eft Bacchus : mais Bacchus eft le Soleil, comme
» Macrobe l’a fait v o ir .. . . Quoi qu’il en fo it , àCpès
-» eft une épithete du Soleil. Le fécond mot Grec dont
» abrafax eft compofé , eft ou celui de Sao , XA£i,
» qui eft fouvent employé dans Homere, 6c qui veut
» direfauveron guérir, ou celui de S a ,2.A, quifigni-
» fie falut ,fanté. Ainfi abrafax voudroit dire à la let-
» tre le beau , le magnifique Sauveur > celui qui guérit
» les maux , & qui en préferve ». Hifi. du Manichéifme ,
tome II. page SS.
M. de Beaufobre détaille enfüitè fort au long les
preuves qui établiffent qu’abrafax ou- ce magnifique
Sauveur n’eft autre que le Soleil. C ’eft pourquoi
nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage de cet auteur.
Cet article eft en grande partie tiré des Mémoires
de M. Formey , Hifioriographe de VAcadémie royale de
brufi. (r,-y ■ . ■ W Ê M
ABRÉGÉ, f. m» épitome , fommaire , précis , raccourci.
Un abrégé eft un difeours dans lequel on réduit
en moins de paroles, la fubftance de ce qui eft
dit ailleurs plus au long & plus en détail.
* «Les critiques, dit M. Baillet, 6c généralement
« tous les ftudieux qui font ordinairement les plus
•» grands ennemis des abrégés , prétendent que là
» coûtume de les faire ne s’eft introduite que long-
*> tems après ces fiecles heureux où fleuriffoient les
» Belles-Lettres 6c les Sciences parmi les Grecs 6c
» les Romains. C ’eft à leur avis un des premiers fruits
» de l’ignorance 6c de la fainéarttifê , où là barbarie
» a fait tomber les fiecles qui ont fuivi la décadent
■9> ce de l’empire. Les gens de lettres 6c les favans de
» ces fiecles, difent-ils , ne cherchoiént plus qu’à
» abréger leurs peines & leurs études, fur-tout dans
» la lefture des hilloriens, des philofophes, 6c des
» jurifconfultes, foit que ce fut le loifir ,foit que ce
>> fut le courage qui leur manquât ».
Les abrégés peuvent, félon le même auteur j fé
réduire à fix elpeces différentes : i° , les épitomes où
Tome I,
’on à réduit les auteurs en gardant règulieremérit
leurs propres termes 6c les exprefïïons de leurs originaux
, mais en tâchant de renfermer tout leur fens
en peu de mots ; 1°. les abrégés proprement dits, que
les abré viateurs ont faits à leur mode, 6c dans le fty le
qui leur étoit particulier ; 3 ° . les cèntons ou rhapfouies,
qui font des compilations de divers morceaux ; 4°*
les lieux communs ou clajfés fous lefquelles on â rangé
les matières relatives à un même titre ; 50. les recueils
faits par certains lefreurs pour leur utilité particulière
, 6c accompagnés de remarques ; 6° les extraits
qui ne Contiennent que des lambeaux tranf-4
crits tout entiers dans les auteurs originaux, la plû-
part du tems fans fuite 6c fans liaifon les uns avec
les autres.
« Toutes ces maniérés d’abreger les auteurs, con-
» tinue-t-il, pouvoient avoir quelque utilité pour
>> ceux qui avoient pris la peine de les faire, 6c peiit-
» être n’étoient-elfes point entièrement inutiles à
» ceux qui avoient lu les originaux. Mais ce petit
» avantage n’a rien de comparable à la pefte que la
» plupart de Ces abrégés ont caüfée à leurs auteurs ,
» 6c n’a point dédommagé la république des Lettres».
En effet, en quel genre ces abrégés n’ont-ils pas
fait difparoître une infinité d’originaux ? Des auteUrd
ont crû que quelqties-üns des livres faints de l’ancien
Teftament n’étoient que des abrégés des livres de
G ad, d’Iddo, de Nathan, des mémoires de Salomon ,
de la chronique des rois de Juda, &c. Les jurifconfultes
fe plaignent qu’on a perdu par cet artifice plus
de deux mille volumes des premiers écrivains dani
leur genre, tels que Papinien, les trois Scevoles, Ldé-
béon , Ulpien , Modefiin , 6c plufieurs autres dont lei
noms font connus. On a laifl'é. périr de même uli
grand nombre des ouvrages des peres Grecs depuis
Origene ou S. Irenée, même jiifqu’âii fchifme , terni
auquel on a vû toutes ces chaînes d’auteurs anonymes
fur divers livres de l’Ecriture. Les extraits que
Conjlamin Porphyrogenete fit faire des excellens hif*
tonens Grecs 6c Latins fur l’hiftoire , la politique ,
la morale, quoique d’ailleurs très-loitables , ont oc-
cafionné la perte de l'hifioire univerfelle de Nicolas do
Damas, d’une bonne partie des livres de Polybe ,
de Diodore de Sicile , de Denys d'Halicarnaffe , & c .
On ne doute plus que Juftin ne nous ait fait perdre
le Trogue Pompée entier pat l’abrégé'qu’il en a fait,
6c ainfi dans prefque tous les autres genres de lit"
térature. .
Il faut pourtant dire en faveur dès abrèges, qu’ils
font Commodes pour certaines perfonnes qui n’ont
ni le loifir de confulter les originaux, ni les facilités
de fe les procurer , ni le talent de les approfondir ,
ou d’y démêler ce qu’un compilateur habile & exaflr
leur préfente tout digéré. D ’aillëufs , comme l’a rej
marqué Saumaife", les plus excellens ouvragés des
Grecs 6c des Romains auroient infailliblement 6c entièrement
péri dans les fiecles de barbarie , fans l’in->
duftrie de Ces faifeurs àéabrégés qui nous Ont' ait moins
fauvé quelques planches du naufragé : ils n’empêchent
point qu’on ne Confulte les originaux quand ils
exiftent. Baillet, Jügemt des Savans , tome I. page
1-40. & fuir. (G )
Ils font utiles*: à ceux qui ont déjà vû les cho-*
fes au long. •
20. Quand ils font faits de façon qû’ijs donnent las
connoiffance entière d elà chofe dont ils parlent, 6C
qu’ils font ce qu’eft unportrait-en mignâfùfe'par rapport
à un portrait en grand. On peut donner une idée!
générale d’une grande hiftoire, ou de quelqu’aütre'
matière ; mais on ne doit point entamer un' detail
qu’on ne peut pas éclaircir , & dont on-ne donne
qu’une idée cOmufe qui n’apprend rien, 6c qui rte réveille.
aucune idée déjà âcquife. Je vais éclaircir ma
r penfée par ces exemples : Si je dis que Rome fut d’a>»
^ Eij