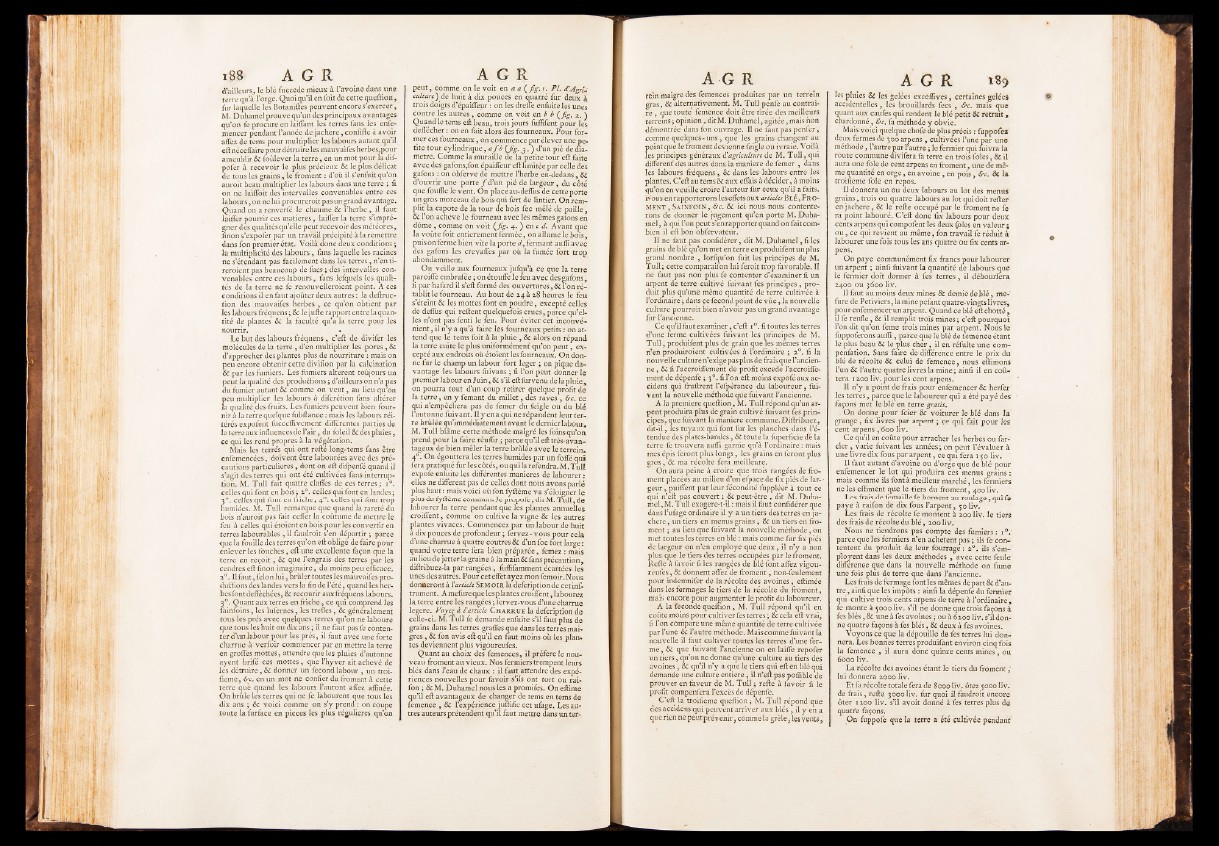
d’ailleurSj le blé fuccede mieux à l’avoine dans une
terre qu’à Forge. Quoiqu’il en l'oit de cette queftion,
fur laquelle les Botaniftes peuvent encore s’exercer,
M. Duhamel prouve qu’un dçs principaux avantages
qu’on fe procure en lailTant les terres fans les enfe-
mencer pendant l’année de jachere, confifte à avoir
allez de tems pour multiplier les labours autant qu’il
eft néceffaire pour détruire les mauvaifes herbes,pour
ameublir 6c foûlever la terre, en un mot pour la dif-
pofer à recevoir le plus précieux 6c le plus délicat
de tous les grains, le froment : d’où il s’enfuit qu’on
auroit beau multiplier les labours dans une terre ; fi
on ne laiffoit des intervalles convenables entre ces
labours, on ne lui procurerait pas un grand avantage.
Quand on a renverfé le chaume 6c l’herbe , il faut
laifler pourrir ces matières, laifler la terre s’imprégner
des qualités qu’elle peut recevoir des météores,
linon s’expofer par un travail précipité à la remettre
dans fon premier état. Voilà'donc deux conditions ;
la multiplicité des labours, fans laquelle les racines
ne s’étendant pas facilement dans les terres, n’en tireraient
pas beaucoup de fucs ; des intervalles convenables
entre ces labours, fans lefquels les qualités
de la terre ne fe renouvelleraient point. A ces
conditions il en faut ajouter deux autres : la deftrac-
tion des mauvaifes herbes-, ce qu’on obtient par
les labours fréquens ; & le jufte rapport entre la quantité
de plantes 6c la faculté qu’a la terre, pour les
nourrir. •
Le but des labours fréquens , c’eft de divifer les
molécules de la terre , d’en multiplier les pores, 6c
d’approcher des plantes plus de nourriture : mais on
peu encore obtenir cette divifion par la calcination
6c par les fumiers. Les fumiers altèrent toûjours un
peut la qualité des productions ; d’ailleurs on n’a pas
du fumier autant 6c comme on veu t, au lieu qu’on
peu multiplier les labours à difcrétion fans altérer
la qualité /les fruits. Les fumiers peuvent bien fournir
à la terre quelque fubftance : mais les labours réitérés
expofent fucceflivement différentes parties de
la terre aux influences de l’air , du foleil & des pluies,
ce qui les rend propres à la végétation.
Mais les terrés qui ont refté long-tems fans être
enfemencées, doivent être labourées avec des précautions
particulières, dont on eft difpenfé quand il
s’agit des terres qui ont été cultivées fans interruption.
M. Tull fait quatre claffes de ces terres; i° .
celles qui font en bois ; z°. celles qui font en landes ;
3°. celles qui font en friche; 40. celles qui font trop
humides. M. Tull remarque que quand la rareté du
bois n’auroit pas fait ceffer la coutume de mettre le
feu à celles qui étoient en bois pour les convertir en
terres labourables , il faudrait s’en départir ; parce
que la fouille des terres qu’on eft obligé de faire pour
enlever les fôuches , eft une excellente façon que la
terre en reçoit, 6c que l’engrais des terres par les
cendres eft finon imaginaire, du moins peu efficace.
2.0. Il faut, felo n lu i, brûler toutes les mauvaifes productions
des landes vers la fin de l’été, quand les herbes
font defféchées, 6c recourir aux fréquens labours.
30. Quant aux terres en friche, ce qui comprend les
lainfoins, les lufernes, les trefles, 6c généralement
tous les prés avec quelques terres qu’on ne laboure
que tous les huit ou dix ans ; il ne faut pas fe contenter
d’un labour pour les prés, il faut avec une forte
charrue à verfoir commencer par en mettre la terre
en groffes mottes, attendre que les pluies d’autonne
ayent brifé ces mottes , que l’hyver ait achevé de
les détruire, 6c donner un fécond labour , un troifieme
, &c. en un mot ne confier du froment à cette
terre que quand les labours l’auront a fiez affinée.
On brille les terres qui ne fe labourent que tous les
dix ans ; 6c voici comme on s’y prend : on coupe
toute la furface en pièces les plus régulières qu’on
[ peut, comme on le voit en a a ( fig. /. PL ÆAgrU
culture') de huit à dix pouces en quarré fur deux à
trois doigts d’épaiffeur : on les dreffe enfuite les unes
contre les autres, comme on voit en b b ( fig. z. )
Quand le tems eft beau, trois jours fuffifent pour les
deffécher : on en fait alors des fourneaux. Pour former
ces fourneaux, on commence par élever une petite
tour cylindrique, a fb (fig. 3 . ) d’un pié de diamètre.
Comme la muraille de la petite tour eft faite
avec des gafons,fon épaiffeur eft limitée par celle des
gafons : on obferve de mettre l’herbe en-dedans, 6c
d’ouvrir une porte ƒ d’un pié de largeur, du côté
que fouffle le vent. On place au-deffus de cette porte
un gros morceau de bois qui fert de lintier. On remplit
la capote de la tour de bois fec mêlé de paille,
& l’on achevé le fourneau avec les mêmes galons en
dôme , comme on voit (fig. 4. ) en e d. Avant que
la voûte foit entièrement fermée, on allume le bois,
puis on ferme bien vite la porte </, fermant aiïfli avec
des gafons les crevaffes par où la fumée fort trop
abondamment.
On veille aux fourneaux jufqu’à ce que la terre
paroiffe embrafée ; on étouffe le feu avec des gafons,
fi par hafard il s’eft formé des ouvertures, & l’on rétablit
le fourneau. Au bout de 24 à 28 heures le feu
s’éteint 6c les mottes font en poudre, excepté celles
de deffus qui reftent quelquefois crues, parce qu’elles
n’ont pas fenti le feu. Pour éviter cet inconvénient
, il n’y a qu’à faire les fourneaux petits : on attend
que le tems foit à la pluie , 6c alors on répand
là terre cuite le plus uniformément qu’on p eut, excepté
aux endroits oîi étoient lesfourneaux. On donne
fur le champ un labour fort leger ; on pique davantage
les labours fui va ns ; fi l’on peut donner le
premier labour en Juin, 6c s’il eft fur venu de la pluie ,
on pourra tout d’un coup retirer quelque profit de
la terre, en y femant du millet, des raves , &c. ce
qui n’empêchera pas de femer du feigle ou du blé
l’autonne fuivant. Il y en a qui ne répandent leur terre
brûlée qu’immédiatement avant le dernier labour.
M. Tull blâme cette méthode malgré les foins qu’on
prend pour la faire réuflir ; parce qu’il eft très-avantageux
de bien mêler la terre brûlee avec le terrein.
40. On égouttera les terres humides par un foffé qui
fera pratiqué fur les côtés, ou qui la refendra. M. Tull
expofe enfuite les différentes maniérés de labourer :
elles ne different pas de celles dont nous avons parlé
plus haut : mais voici où fon fyftème v a s’éloigner le
plus du fyftème commun. Je propofe, dit M. T u ll, de
labourer la terre pendant que les plantes annuelles
croiffent, comme on cultive la vigne 6c les autres
plantes vivaces. Commencez par un labour de huit
à dix pouces de profondeur ; fervez - vous pour cela
d’une charrue à quatre coutres 6c d’un foc fort large:
quand votre terre fera bien préparée, femez : mais
aulieu de jetter la graine à la main& fans précaution ,
diftribuez-la par rangées, fuffifamment écartées les
unes des autres. Pour cet effet ayez mon femoir. Nous
donneront à l’article Se m o ir la deferiptionde cetinf.
trament. A mefure que les plantes croiffent, labourez
la terre entre les rangées ; fervez-vous d’une charrue
legere. Foye{ à Varticle C h a r r u e la defeription de
celle-ci. M. Tull fe demande enfuite s’il faut plus de
grains dans les terres graffes que dans les terres maigres
, 6c fon avis eft qu’il en faut moins où les plantes
deviennent plus vigoureufes.
Quant au choix des femences, il préféré le nouveau
froment au vieux. Nos fermiers trempent leurs
blés dans l’eau de chaux : il faut attendre des expériences
nouvelles pour favoir s’ils ont tort ou rai-
fon ; 6c M. Duhamel nous les a promifes. On eftime
qu’il eft avantageux de changer de tems en tems de
femence , 6c l’expérience juftifie cet ufage. Les autres
auteurs prétendent .qu’il faut mettre dans un terrein
maigre des femences produites par un terrein
gras, & alternativement. M. Tull penfe au contraire
, que toute femence doit être tirée des meilleurs
terrems ; opinion, dit M. Duhamel, agitée, mais non
démontrée dans fon ouvrage. Il ne faut pas penfer,
comme quelques - uns, que les grains changent au
point que le froment devienne feigle ou ivraie. Voilà
les principes généraux d’agriculture de M. T u ll, qui
different' des autres dans, la maniera de femer , dans
les labours fréquens, 6c dans les labours entre les
plantes. C’eft au tems & aux effais à décider, à moins
qu’on en veuille croire l’auteur fur ceux qu’il a faits.
Nous en rapporterons les effets aux articles B LÉ, Fr o-
ment , Sainfoin , &c. 6c ici nous nous contenterons
de donner le jugement qu’en porte M. Duhamel
, à qui l’on peut s’enrapporter quand on fait combien
il eft bon obfervateur.
Il ne faut pas confidérer, dit M. Duhamel, fi les
grains de blé qu’on met en terre en produifentunplus
grand nombre , lorfqu’on fuit les principes de M.
Tull; cette comparaifon lui ferait trop favorable. Il
ne faut pas non plus fe contenter d’examiner fi un
arpent de terre cultivé fuivant fies principes , produit
plus qu’une même quantité de terre cultivée à
l’ordinaire ; dans ce fécond point de v û e , la nouvelle
culture pourrait bien n’avoir pas un grand avantage
fur l’ancienne.
Ce qiv il faut examiner, c’eft i° . fi toutes les terres
d’une ferme cultivées fuivant les principes de M.
T u ll, produifent plus de grain que les mêmes terres
n’en produiraient cultivées à l’ordinaire ; 20. fi la
nouvelle culture n’exige pas plus de frais que l’ancienne
, 6c fi l’accroiffement de profit excede l’accroiffe-
ment de dépenfe ; 30. fi l’on eft moins expoféaux ac-
cidens qui fruftrent l’efpérance du laboureur , fuivant
la nouvelle méthode qiie fuivant l’ancienne.
A la première queftion, M. Tull répond qu’un arpent
produira plus de grain cultivé fuivant les principes
, que fuivant la maniera commune. Dillribuez,
dit-il, les tuyaux qui font fur les planches dans l’étendue
des plates-bandes, 6c toute la fuperficie dê la .
terre fe trouvera aufli garnie qu’à l’ordinaire : mais
mes épis feront plus longs, les grains en feront plus
gros, & ma récolte fera meilleure.
On aura peine à croire que trois rangées de froment
placées au milieu d’un efpace de fix pies de l a r geur
, puiffent par leur fécondité fuppléer à tout ce
qui n’eft pas couvert ; 6c peut-être , dit M. Duhamel,
M. Tull exagere-t-ij. : mais il faut confidérer que
dans Fufage ordinaire il y a un tiers des terres en jachère
, un tiers en menus grains , 6c un tiers en froment
; au lieu que fuivant la nouvelle méthode, on
met toutes les terres en blé : mais comme fur fix piés
de largeur on n’en employé que deux, il n’y a non
plus que le tiers des terres occupées par le froment.
Refte à favoir fi les rangées de blé font affez vigoureufes
, 6c donnent affez de froment, hon-feulement
pour indemnifer de la récolte des avoines, eftimée
dans les fermages le tiers de la récolte du froment,
mais encore pour augmenter le profit du laboureur.
A la fécondé queftion, M. Tull répond qu’il en
coûte moins pour cultiver fes terres ; 6c cela eft vrai,
fi l’on compare une même quantité de terre cultivée
par l’une 6c l’autre méthode. Mais comme fuivant la
nouvelle il faut cultiver toutes les terres d’une ferme
, 6c que fuivant l’ancienne on en laiffe repofer
un tiers, qu’on ne donne qu’une culture au tiers des
avoines, 6c qu’il n’y a que le tiers qui eft én blé qui
demande une culture entière, il n’elt pas polîible de
prouver en faveur de M. Tull ; refte à favoir fi le
profit compenfera l’excès de dépenfe.
C’eft la troifieme queftion ; M. Tull répond que
des accidens qui peuvent arriver aux blés , il y en a
que rien ne peut prévenir, comme la grêle, les yents,
les pluies & les gelées excéflives, certaines gelées
accidentelles, les brouillards fecs , &c. mais que
quant aux caufes qui rendent le blé petit & retrait,
chardonné, &c. fa méthode y obvie.
Mais voici quelque chofe de plus précis : fuppofez
deux fermes de 300 arpens,, cultivées l’une par une
méthode, l’autre par l’autre ; le fermier qui fuivra la
route commune divifera fa terre en trois foies, 6c il
aura une foie de cent arpens en froment, une de même
quantité en orge, en avoine, en pois, &c. 6c la
troifieme foie en repos.
Il donnera un ou deux labours au lot des menus
grains, trois ou quatre labours au lot qui doit refter
en jachere, 6c le refte occupé par le froment ne fe
ra point labouré. C ’eft donc fix labours pour deux
cents arpens qui compofent les deux {pies en valeur ;
o u , ce qui revient au même, fon travail fe réduit à
labourer une fois tous les ans quatre ou fix cents arpens.
On paye communément fix francs pour labourer
un arpent ; ainfi fuivant la quantité de labours que
le fermier doit donner à fes terres, il débourfera
2400 ou 3600 liv.
Il faut au moins deux mines & demié de blé, mefure
de Petiviers, la minepefant quatre-vingts livres,
pour enfemencer un arpent. Quand ce blé eft chotté ,
il fe renfle, 6c il remplit trois mines ; c’eft pourquoi
l’on dit qu’on feme trois mines par arpent. Nous le
fuppoferons aufli, parce que le blé de lemence étant
le plus beau 6c le plus cher, il en réfulte une com-
penfation. Sans faire de différence entre le prix du
blé de récolte 6c celui de femence, nous eftimons
l’un 6c l’autre quatre livres la mine; ainfi il en coûtera
1200 liv. pour les cent arpens.
Il n’y a point de frais pour enfemencer 6c herfer
les terres, parce que le laboureur qui a été payé des
façons met le blé en terre gratis.
. On donne pour feier & voiturer le blé dans la
grange, fix livres par arpent ; ce qui fait pour les
cent arpens ,600 liv.
Ce qu’il en coûte pour arracher les herbes ou farde
r , varie fuivant les années ; on peut l’évaluer à
une livre dix fous par arpent, ce qui fera 150 liv. '
Il faut autant d’avoine ou d’orge que de blé pour
enfemencer le lot qui produira ces menus grains :
mais comme ils font à meilleur marché, les fermiers
ne les eftimènt que le tiers du froment, 400 liv.
Les frais de femaille fe bornent au roulage, qui fe
paye à raifon de dix fous l’arpent, 50 liv.
Les frais de récolte fe montent à 200 liv. le tiers
des frais de récolte du b lé, 200 liv.
Nous ne tiendrons pas compte des fumiers : i ° ;
parce que les fermiers n’en achètent pas ; ils fe contentent
du produit de leur fourrage : 20. ils s’em-
ployent dans les deux méthodes , avec cette feule
différence que dans la nouvelle méthode on fume
une fois plus de terre que dans l’ancienne.
Les frais de fermage font les mêmes départ 6c d’autre
, ainfi que les impôts : ainfi la dépenfe du fermier
qui cultive trois cents arpens de terre à l’ordinaire ,
fe monte à 5000 liv. s’il ne donne que trois façons à
fes blés, 6c une à fes avoines ; ou à 6200 liv. s’il donne
quatre façons à fes blés, 6c deux à fes avoines.
Voyons ce que la dépouille de fes terres lui donnera.
Les bonnes terres produifant environ cinq fois
la femence , il aura donc quinze cents mines, ou
6000 liv.
La récolte des avoines étant le tiers du froment,’
lui donnera 2000 liv.
Et fa récolte totale fera de 8000 liv. ôtez 5000 liv.'
de frais, refte 3000 liv. fur quoi il faudrait encore
ôter 1200 liv. s’il ayoit donné à fes terres plus de
quatr'e façons.
On fuppofe que la terre a été cultivée pendant'