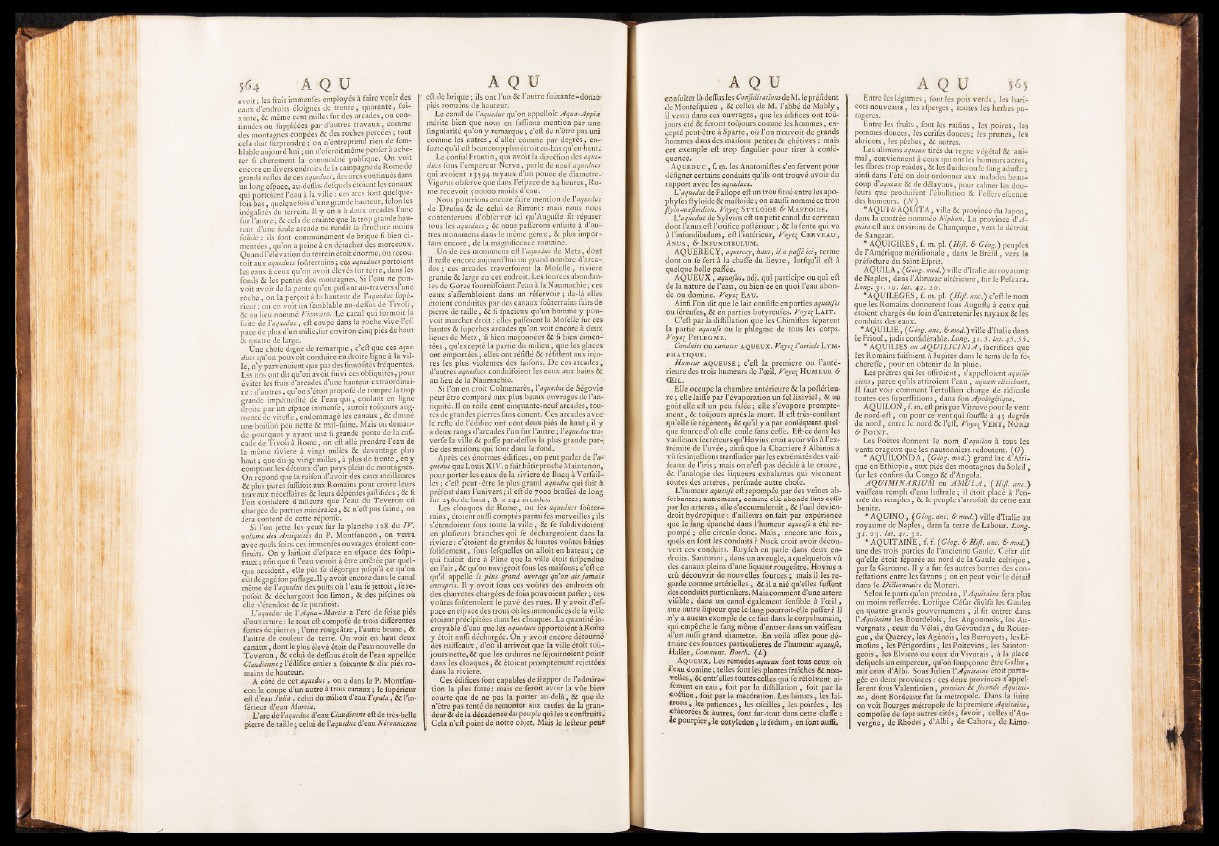
t p l p
564 A Q U
avoit ; les frais immenfes employés à faire v enir des
eaux d’endroits éloignés de tr en te , quarante, foi-
xante, & même cent milles fur des arcades, ou continuées
ou fuppléées par d’autres tra v a u x , comme
des montagnes coupées & des roches percées »tout
cela doit furprendre : on n’entreprend rien de fem-
blable aujourd’hui ; on n’oferoit même penfer a acheter
li chèrement la commodité publique. O n v o i t
encore en divers endroits de la campagne de Rome dé
grands relies de ces aqueducs, des arcs continues dans
un long efpace, au-deffus defquels etoicnt les canaux
qui portoient l’eau à la v ille : ces arcs font quelquefois
bas quelquefois d’une grande hauteur, félon les
inégalités du terrein. Il y en a à deux arcades 1 une
fur l’autre ; & cela de crainte que la trop grande hauteur
d’une feule arcade ne rendît la flrutture moins
folide ; ils font communément de brique fi bien c imentées
, qu’on a peine à en détacher des m orceaux.
Quand l’élévation du terrein étoit énorme, on recou-
roit aux aqueducs foûterrains ; ces aqueducs portoient
les eaux à ceux qu’on avo it élevés fur te rre , dans les
fonds & les pentes des montagnes. Si l’eau ne pou-
v o i t avo ir de la pente qu’en paffant au-travers d une
ro c h e , on la perçoit à la hauteur de Y aqueduc fupe-
rieur: on en v o it un femblable au-deffus de T iv o l i ,
■ & au lieu nommé Vicovaro. Le canal qui formoit la
fuite de Y aqueduc, e fl coupe dans la roche v iv e 1 efpace
de plus d’un m ille,fur environ cinq piés de haut
& quatre de large.
ducs Une chofe digne de remarque, c’e fl que ces aque
qu’on pouvo it conduire en droite ligne à la v ille
, n’y parvenoient que par des finuofites frequentes.
Lss uns ont dit qu’on avoit fuiv i ces obliquités, pour
é viter les frais d’arcades d’une hauteur extraordinaire
: d’autres, qu’on s’étoit propofé de rompre la trop
grande impétuofité de l ’eau q u i, coulant en ligne
droite par un efpace immenfe, auroit toujours augmenté
de v îte ffe , endommagé les c an a u x , & donne
une boi'ffon peu nette & mal-faine. Mais on demande
pourquoi y ayant une fi grande pente de la caf-
cade de T iv o li à R om e , on e fl allé prendre l’eau de
la même rivière à v ingt milles & davantage plus
haut ; que dis-je v ingt milles, à plus de tren te , en y
comptant les détours d’un pays plein de montagnes.
O n répond que la raifon d’ avoir des eaux meilleures
& plus pures fuffifoit aux Romains pour croire leurs
tra v au x néceffaires & leurs dépénfes juflifiées ; & fi
l ’on confidere d’ailleurs que l’eau du T e v e ro n e fl
chargée de parties m inérales, & n’e fl pas fa in e , on
fera content de cette réponfè.
volSuim le’o dne sj eAtnteti qluesit éyse u x fur la planche 12.8 du IV, du P. Montfaucon, on v erra
a v e c quels foins ces immenfes ouvrages étoient con-
ilruits. O n y laiffoit d’efpace en efpace des foûpi-
raux ; afin que fi l’eau venoit à être arrêtée par quelque
accid ent, elle pût fe dégorger jufqu’à ce qu’on
eût dégagé fon pafTage. Il y avo it encore dans le canal
même de Y aqueduc des puits où l ’eau fe je t to i t , fe re-
pofoit & déchargedit fon limon, & des pifcines où
elle s’ étendoit & fe purifioit.
L ’aqueduc de Y Aqua- Marcia a l’arc de feize piés
d’ouverture : le tout e fl compofé de trois différentes
fortes de pierres ; l’une rou geâ tre , l’autre brune, &
l ’autre de couleur de terre. On v o i t en haut deux
c an a u x , dont le plus é le v é étoit de l’eau nouvelle du
T e v e r o n , & celui de deffous étoit de l’eau appellée Claudienne; l’édifice entier a foixante & dix piés romains
de hauteur.
A côté de cet aqueduc, on a dans le P. Montfaucon
la coupe d’un autre à trois canaux; le fupérieur
e f l d’eau Julia, celui du milieu d’eau Tepula, Ôc l’inférieur
d’eau Marcia.
L ’arc de Y aqueduc d’eau Claudienne efl de très-belle
pierre de taille ; c elui de Y aqueduc d’eau Néronniennc
A Q U
e fl de brique ; ils ont l’un & l’autre fo ix an te - douze»
■ piés romains de hauteur.
L e canal de Yaqueduc qu’on appelloit Aqua-Appia
mérite bien que nous en fafïions mention par une
fingularité qu’on y remarque ; c’e fl de n’être pas uni
comme les au tre s , d’aller comme par d eg rés , en-
forte qu’il e fl beaucoup plus étroit en-bas qu’en-haut.’
L e conful Frontin, qui avo it la direction des aqueducs
fous l’empereur N e rv a , parle de neu f aqueducs
qui avo ien t 13594 tu yau x d’un pouce de diamètre.
Vigerus obfe rve que dans l’efpace de 24 heures, R o me
rece vo it 500000 muids d’eau.
Nous pourrions encore faire mention de Y aqueduc
de Drufus & de celui de Rimini : mais nous nous
contenterons d’obfe rve r ic i qu’Augufle fit réparer
tous les aqueducs ; & nous pa ie ron s enfuite à d’autres
monumens dans le même g en re , & plus impor-
tans en co re , de la magnificence romaine.
Un de ces monumens e fl l’aqueduc de M e tz , dont
il refie encore aujourd’hui un grand nombre d’arca-,
des ; ces arcades traverfoient la M o fe lle , riviere
grande & large en cet endroit. L es fources abondantes
de Gorze fourniffoient l’eau à la Naumachie; ces
eaux s’affembloient dans un réfervoir ; de-là elles
étoient conduites par des canaux foûterrains faits de
pierre de taille , & fi fpacieux qu’un homme y pouv
o it marcher droit : elles paffoient la Mofelle fur ces
hautes & fuperbes arcades qu’on voit encore à deux
lieues de M e tz , fi bien maçonnées & fi bien cimentées
, qu’excepté la partie du m ilieu , que les glaces
ont emportées, elles ont réfiflé & réfiftent aux injures
les plus violentes des faifons. D e ces arcades,'
d’autres aqueducs conduifoient les eaux aux bains &
au lieu de la Naumachie.
Si l’on en croit Colmenarès, Y aqueduc de Sé gov ie
peut être comparé aux plus beaux ouvrages de l’antiquité.
Il en refie cent cinquante-neuf arcades, toutes
de grandes pierres fans ciment. C e s arcades av e c
le refie de l’édifice ont cent deux piés de haut ; il y
a deux rangs d’arcades l’un fur l ’autre ; Y aqueduc tra-
v er fe la v ille & paffe par-deffus la plus grande par-,
tie des maifons qui font dans le fond.
Après ces énormes édifices, on peut parler de Yac-
queduc que Louis X IV . a fait bâtir proche Maintenon,
pour porter les eaux de la riviere de Bucq à Verfail-
les ; c’e fi peut - être le plus grand aqueduc qui foit à
préfent dans l ’univers ; il e fl de 7000 braffes de long
fur 2560de h au t, & a 242 arcades.
Lès cloaques de R om e , ou fes aqueducs foûterrains
, étoient auffi comptés parmi fes merveilles ; ils
' s’étendoient fous toute la v i l l e , & fe fubdivifoient
en plufîeurs branches qui fe déchargeoient dans la
riviere : c ’étoient de grandes & hautes voûtes bâties
‘ fôlidement, fous lefquelles on alloit en bateau ; ce
qui faifoit dire à Pline que la v ille étoit fufpenduè
en l’a i r , &c qu’on navigeoit fous les maifons ; c’e fl ce
qu’il appelle le plus grand ouvrage qu'on ait jamais
entrepris. Il y avo it fous ces voûtes des endroits où
des charretes chargées de foin pouvoient paffer ; ces
voûtes foûtenoient le pa vé des rues. Il y avo it d’e fpace
en efp ace des trous où les immondices de la v ille
étoient précipitées dans les cloaques. L a quantité incroyable
d’eau qu e lé s aqueducs àpportoient à R ome
y étoit auffi déchargée. O n y avo it encore détourné
dés ruiffeaux, d’où il arrivoit que la v ille étoit toû-
jours nette, & que les ordures ne féjournoient point
dans les c loaques, & étoient promptement rejettééSL
dans la riv iere.
’ Gés édifices font capables de frapper de l ’admiration
la plus forte : mais ce feroit avoir la vûe bien
courte que dé ne pas là porter au-delà, & que de
n’ être pas tenté de remonter aux caufes de la grandeur
& d e la décadenc-e du peuple qui les à conftruits.
1 C e la n’e fl point de notre objet, Mais le loueur peu*
■ y ;
A Q U
eonfulter là-deffus les Conjidéraùons de M. lepréfident
de Montefquieu , & celles de M. l’abbé de Mably,
il verra dans ces ouvrages, que les édifices ont toû-
jours été & feront toûjours comme les hommes, excepté
peut-être à Sparte, où l’on trouvoit de grands
hommes dans des maifons petites & chétives : mais
çet exemple efl trop fingulier pour tirer à confé-
quence.
A q u e d u c , f, m. les Anatomifles s’en fervent pour
défigner certains conduits qu’ils ont trou v é a v o ir du
rapport av e c les aqueducs. L’aqueduc de Fallope e fl un trou fitué entre les apo-
phyfes flyloïde & mafloïde ; on a auffi nommé ce trou fiylo-maftdidien. Voye% S t y l OÏde & MASTOÏDE.
L’aqueduc de Sy lv ius efl un petit canal du cerveau
dont l’anus e fl l’orifice poflérieur ; & la fente qui v a
à l’infundibulum , e fl l’intérieur, Voye^ C e r v e a u ,
A nu s , & In f u n d ib u lum .
. AQUERECY, aquereçy, haut, il a paffé ici, terme
dont on fe fert à la chaffe du lievre, lorfqu’il efl à
quelque belle paffée.
AQUEUX, aquofus, adj. qui participe ou qui efl
de la nature de l’e au , ou bien ce en quoi l’eau abonde
ou domine. Voye£ Ea u .
Ainfi l’on dit que le lait confifle en parties aqueufes
ouféreufes, & en parties butyreufes. VQy*{ L a it .
C’efl par la diflillation que les Chimifles féparent
la partie aqueufe ou le phlegme de tous les corps. Voyei P h l e g m e . Conduits o u canaux AQU EUX, Voye^Varticle L Y M PHA
TIQ UE . Humeur a q u e u s e ; c’e fl la première o u l’antérieure
des trois humeurs de l’oe iî. Voye£ Hum e u r £
(E i l .
. Elle occupe la chambre antérieure & la poflérieur
te ; elle laiffe par l’évaporation un fel lixiviel, & au
goût elle efl un peu falée ; elle s’évapore promptement,
& toujours après la mort. Il efl très-confiant
qu’elle fe régénéré, & qu’il y a par confisquent quelque
fpurced’où elle coule fans ceffe. Efl-c.e dans les
y aiffeaux fecréteurs qu’Hovius croit avoir vus à l’extrémité
de l’uvée, ainfi que la Charriere ? Alb.inus a
yû fesinje&ipns tranffuder parles extrémités des vaif-
feaux de l’iris ; mais on n’efl pas décidé à le croire,
& l’analogie des liqueurs exhalantes qui viennent
toutes des artetes, perfuade autre chofe.
. L’humeur aqueufe efl repompée par des veines ab-
forbantes; autrement, comme elle abonde fans ceffe
par les artères, elle s'accumulerait, & l’oeil devien-
droit hydropique : d’ailleurs on fait par expérience
que le fang épanché dans l’humeur aqueufe a été repompé
; elle circule donc. Mais, encore une fois ,
quels en font les conduits ? Nuck croit avoir découvert
ces conduits, Ruyfch en parle dans deux endroits.
Santorini, dans un aveugle, a quelquefois vû
des canaux pleins d’une liqueur rougeâtre. Hoyius a
crû découvrir de nouvelles fources ; mais il les regarde
comme artérielles, & il a nié qu’elles fuffent
des conduits particuliers. Mais comment d’une.artere
vifible, dans un canal également fenfible à l’oeil ,
Une .autre liqueur que le fang pourroit-elle paffer ? Il
u’y .a aucun exemple de ce fait dans le corpshumain,
qui empêche île fang même d’entrer dans un vaiffeau
d’un auffi grand diamètre. En voilà affez pour détruire
ces fources particulières de l’humeur aqueufe. Haller, Comment. Boerh. (IS)
Aqueux. Les remedes.a^«c«àr font tous ceux où
i’eau domine ; telles font les plantes fraîches & nou-
ve.Ues, ôtentr’elles toutescelles quife réfol vent ai-
fément en eau, foit par la diflillation , foit par :1a
«oâion, foit par la macération. Les ’laitues, les .lai-
trons, les patiences, les ofeilles, les poirées, les
.chicorées .& autres, font fur-tout dans cette olaffe :
ie pourpier, le cotylédon, le fedum, en font.aufïï.
A Q U '565
Entre lès légume s , font les pois verds , les haricots
n o u v e au x , les afperges, toutes les herbes potagères.
Entre les fruits , font les raifins , les poires, les
pommes douces, les cerifes douces ; les prunes, les
abricots, les pêches, & autres.
Les alimens aqueux tirés du regne végétal & animal
, conviennent à ceux qui ont les humeurs acres,
les fibres trop roides, & les fluides ou le fang adulte ;
ainfi dans l’été on doit ordonner aux malades beaucoup
d'aqueux & de délayans, pour calmer les douleurs
que produifent l’ébullition & l’effervefcencé
des humeurs. (N )
*AQUI &AQUITA, ville & province du Japon,
dans la contrée nommée Niphon. La province d 'A -
quita efl aux environs de Chançuque, vers le détroit
de Sangaar.
* AQUIGIRES, f. m. pl. (Hiß. & Géog.) peuples
de l’Amérique méridionale , dans le Bréfil, vers la
préfecture du Saint-Efprit.
AQUILA, (Géog. mod.') ville d’Italie au royaume
de Naples, dans l’Abruzze ultérieure, fur le Pefcara.
Long. 3 1 . /o. lat. 42. 20.
*AQUILEGES, f. m. pl. (Hiß. anc.) c’efl le nom
que les Romains donnèrent fous Augufle à ceux qui
etoient chargés du foin d’entretenir les tuyaux & les
conduits des eaux.
*AQUILIE , (Géog. anc. &mod.~) ville d’Italie dans
le Frioul, jadis confidérable. Long. 3 ». 5 . lat.q5 . 6 5 l * AQUILIES ou A Q U IL IC IN 1A , facrifices que
les Romains faifoient à Jupiter dans le tems de la fé»
chereffe, pour en obtenir de la pluie.
Les prêtres qui les offroient, s’appelloient aquili-
ciens, parce qu’ils attiroient l’eau, aquam eliciebarit.
Il faut voir comment Tertullien charge .de ridicule
toutes ces fuperflitions, dans fon Apologétique.
AQUILON, f. m. efl pris par Vitruve pour le vent
de nord-efl, ou pour ce vent qui fouffle à 45 degrés
du nord, éntre le nord & l’efl. Voyeq_ V e n t , N o rd ,
& P o in t .
Les Poètes donnent le nom d’aquilon à tous les
vents orageux que les nautonniers redoutent. (O)
* AQUILONDA, (Géog. mod.} grand lac d’Afrique
en Ethiopie, aux piés des montagnes du Soleil
fur les confins du Congo & d’Angola.
A Q U IM IN A R IU M ou A M U L A , (H iß . anc.}
vaiffeau rempli d’eau luftrale ; il étoit placé à l’eri-
trée des temples, & le peuple s’arrofoi’t de cette eau
benite.
* AQUINO, (Géog. anc. & mod.} ville d’Italie au
royaume de Naples, dans la terre de Labour. Long.
3z. 23; lat. 4/. 32.
* AQUITAINE, f. f. (Géog. & Hiß, anc. & mod.}
Une des trois parties de l’ancienne Gaule. Céfar dit
qu’elle étoit féparée au nord de la Gaule celtique ,
par la Garonne. Il y a fur fes autres bornes des con-
teflations entre les favans ; on en peut voir le détail
dans le Dictionnaire de Moreri.
Selon le parti cju’on prendra, Y Aquitaine fera plus
ou moins refferree. Lorfque Céfar divifa les Gaules
en quatre grands gouvernemens , il fit entrer dans
Y Aquitaine les Bourdélois, les Angoumois, les Auvergnats
, ceux du Vêlai, du Gévaudan, du Roüer-
gue, du Quercy, les Agénois , les Berruyets, les Li-
mofins, ;les Périgordins, les.Poitevins, les Sainton-
geois, les Elviens ou ceux du Vivarais , à la place
defquels un empereur, qu’on foupçonne être Galba ,
-mit ceux d’Albi. Sous Julien Y Aquitaine étoit partagée
en deux provinces î ces deux provinces s’appelleront
fous Valentinien, première & fécondé Aquitain
e , dont Bordeaux fut la-métropole. Dans la fuite
on voit Bourges métropole de la première Aquitaine^
-compofée de fept autres-cités ; favoir, celles d’Auvergne,
de Rhodes, d’Albi, de Cahors, de,Limo