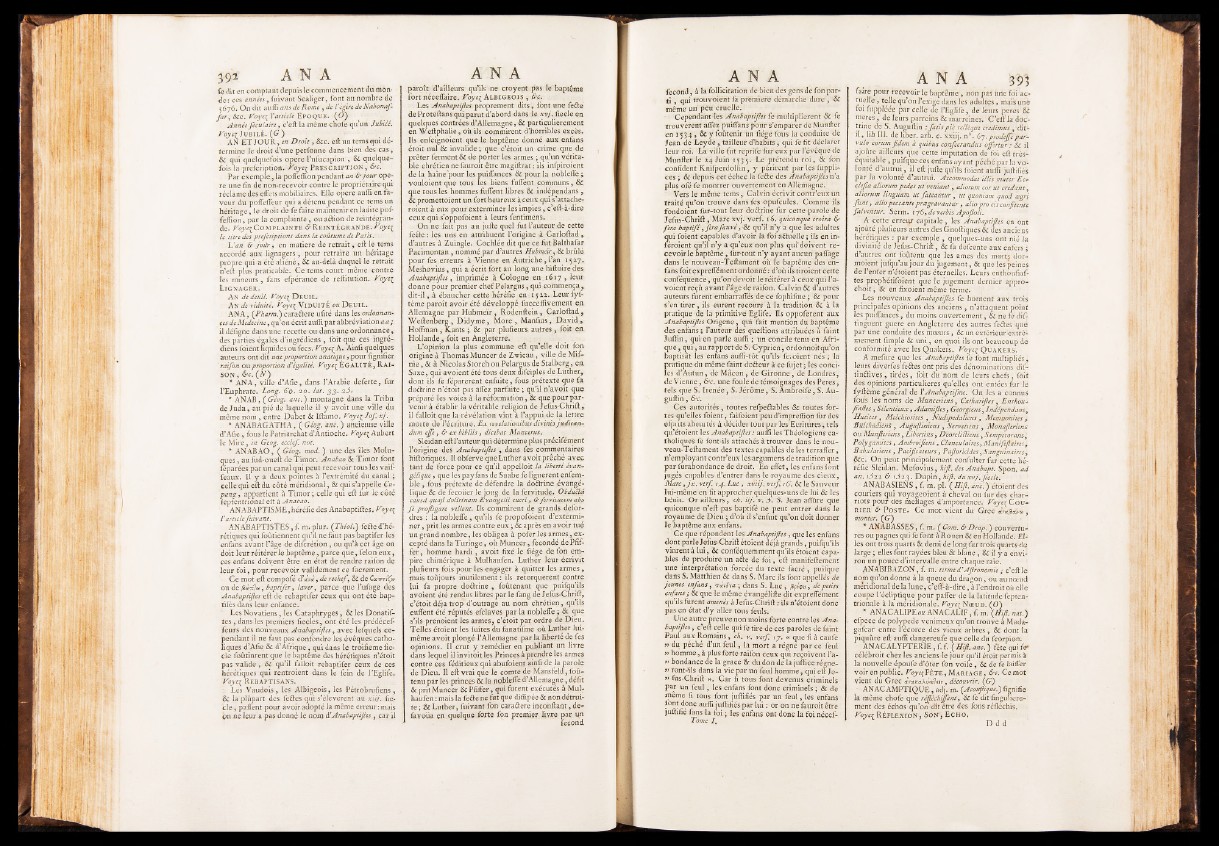
fe dit en comptant depuis le commencement du monde:
ces années, fuivant Scaliger, font au nombre de
5676. On dit aufli ans de Rome , de l'élire deNabonaJ-
far, &c. Voye^Y article EPOQUE. (O)
Année féeulaire, c’eft la même chofe qu’un Jubilé.
Voye^ Jubilé. (G )
AN ET JOUR, en Droit, &c. eft un tems qui détermine
le droit d’une perfonne dans bien des cas,
& qui quelquefois opéré l’ufucapion , & quelquefois
la prefcription. Voye^ Prescription , & c.
Par exemple, la pofl'eflion pendant an b jour opéré
une fin de non-recevoir contre le propriétaire qui
réclame des effets mobiliaires. Elle opéré aufli en Faveur
du poffeffeur qui a détenu pendant ce tems un
héritage, le droit de fe faire maintenir en ladite pof-
feflîon, par la complainte, oua&ionde reintégran-
de. Foye[ Complainte & Reintégrande. Vpyc£
le titre des prefcriptions dans la coutume de Paris.. .
L ’an & joûr y en matière de retrait, eft le tems
accordé aux lignagers, pour retraire un héritage
propre qui a été aliéné, & au-delà duquel le retrait
n’eft plus praticable. Ce tems court même contre
les mineurs, fans efpérance de reftitution. Voye£
Lignager.
An de deuil. Voye£ DEUIL.
An de viduité. Voye{ V iduitÉ ou Deuil.
AN A , (Pharm.) caraûere ufité dans \ps ordonnances
de Médecine, qu’on écrit aufli par abbréviation a a;
il défigne dans une recette ou dans une ordonnance,
des parties égales d’ingrédiens , foit que ces ingré-
diéns foient liquides ou fecs. Voye^k. Ainfi quelques
auteurs ont dit une proportion anatique, pour lignifier
raifon ou proportion d'égalité. V?ye£ ÉGALITÉ, RAISON
, &c. (AT) v
* AN A, ville d’Afie, dans l ’Arabie deferte, fur
l’Euphrate. Long. Go. 20. lat. 33. 2J.
* ANAB, ( Géog. anc.') montagne dans la Tribu
de Xuda, au pié de laquelle il y avoit une ville du
même nom , entre Dabet & Iftamo. Voye^Jof. x j.
* ANABAGATHA, ( Géog. anc. ) ancienne ville
d’Afie, fous le Patriarchat d’Antioche. Voye£ Aubert
le Mire, in Geog. ecclef. not.
* ANABAO, (Géog. mod. ) une des îles Molu-
ques, au fud-oueu de Timor.Anabao & Timor font
féparées par un canal qui peut recevoir tous les vaif-
feaux. Il y a deux pointes à l’extrémité du.canal.;
celle qui eft du côté méridional, & qui’s’appèlle Cu-
pang y appartient à Timor ; celle qui eft fur le côté
feptentrional eft à Anabao.
ANABAPTISMEjhéréfie des Anabaptiftes. Voye1
l'article fuivant.
ANABAPTISTES , f. m. plur. (Théol.) fette d’hérétiques
qui foûtiennent qu’il ne faut pas baptifer les
enfans avant l’âge de diferétion, ou qu’à cet âge on
doit leur réitérer le baptême, parce que, félon eux,
ces enfans doivent être en état de rendre raifon de
leur fo i, pour recevoir validement ce facrement.
Ce mot eft compofé d’aïa, de rechef, & de Cct'un-lÇa
ou de pidlm, baptifer y laver y parce que l’ufage des
Anabaptifies eft de rebaptifer ceux qui ont été bap-
tifés dans leur enfance.
Les Novatiens, les Cataphryges, & les Donatif-
te s , dans les premiers fiecles, ont été les prédécef-
feurs des nouveaux Anabaptiftes, avec lefquels cependant
il ne faut pas confondre les évêques catholiques
d’Afie. & d’Afrique, qui dans le troifieme fie-
cle foûtinrent que le baptême des hérétiques n’étoit
pas valide, & qu’il falloit rebaptifer ceux de ces
hérétiques qui rentroient dans le fein de l ’Eglife.
Foye{ RebaptïSANS.
: Les Vaudois , les Albigeois, les Pétrobrufiens ,
& la plupart des feétes qui s’élevèrent au xiij. fie-
c le , paffent pour avoir, adopté la même erreur: mais
on ne leur a pas donné le nom & Anabaptifies, car il
paroît d’ailleurs qu’ils ne croyent pas le baptême
fort néceffaire. Voye£ Albigeois ; &c. ,
Les Anabaptifies. proprement dits , font une fefte
de Proteftans qui parut d’abord dans le xvj. fiecle en
quelques contrées d’Allemagne, & particulièrement
en Weftphalie, où ils'.commirent d’horribles excès.
Ils enfeignoient que le baptême donné aux enfans
étoit nul & invalide ; que c’étoit un crime que de
prêter ferment & de porter les armes ; qu’un véritable
chrétien ne fauroit être magiftrat : ils infpiroient
de la haine *pour les puiffances & pour la nobleffe ;
vouloient que tous les biens fuffent communs, &
que tous les hommes fuffent libres & indépendans ,
&c promettoient un fort heureux à ceux qui s’attache-
roient à eux pour exterminer les impies;, c’eft-à-dire
ceux qui s’oppofoient à leurs fentimênS;.
On ne fait pas au jufte quel fut l’auteur de cette
fe&e : les uns en attribuent l’origine à Carloftad
d’autres à Zuingle. Cochlée dit que ce fut Balthafar
Pacimontan, nommé par d’autres Hubmeir, & brûlé
pour fes erreurs à Vienne en Autriche, l’an 1527.
Meshovius, qui a écrit fort au long une hiftoire des
Anabaptifies, imprimée à Cologne en .1617 , leur
donne pour premier chef Pelargus . , qui commença,
dit-il ; à ébaucher cette héréfie e n i 5 22. Leur fyf-
tème paroît avoir été développé fuc.ceHivernent en
Allemagne par Hubmeïr , Rodenftein, Carloftad,
Weftenberg, Didyme, More , Manlius, D a v id ,
Hoffman, Kants ; & par plufieurs autres, foit en
Hollande, foit en Angleterre. .
L’opinion la plus commune eft qu’elle doit fon
origine à Thomas Muncer de Zwicau, ville.de Mif-
nie, & à Nicolas Storch ou Pelargus de Stalberg, en
Saxe, qui avoient été tous deux difciples de Luther,
dont ijs fe féparerent enfuite, fous.prétexte que fa
doéfrine n’étoit pas affez parfaite ; qu’il n’avoit que
préparé les voies à la réformation, & que pour parvenir
à établir la véritable religion de Jefus-Chrift,
il falloit que la révélation vînt à l’appui,de la lettre
morte de,l’écriture. E x revelationibus divinisjudican-
dum effe , & ex bibliis , dicebat Muncerus.
. SIeidan eft l’auteur qui détermine plus précifément
l’origine des Anabaptifies , dans fës commentaires
hiftoriques. Il obferve que Luther avoit prêché avec
tant de force pour ce qu’il, appelloit la liberté évangélique
y que les payfans de Suabe fe liguèrent enfem-
ble , Lotis prétexte de défendre la doftrine évangélique
& de fecoiier le joug de la fervitude. Obduclâ
causa quafi doefrinam Evangelii tueri , & fervitutem ab$
fe profiigare vellent. Ils commirent de grands defor-
dres : la nobleffe , qu’ils fe propofoient d’exterminer
, prit les armes contre eux ; & après en avoir tué
un grand nombre, les obligea à pofer les armes, excepté
dans la Turinge, où Muncer, fécondé de Pfif-
fe r , homme hardi, avoit fixé le fiége de: fon empire
chimérique à Mulhaufen. Luther leur écrivit
plufieurs fois pour les engager à quitter les armes ,
mais toûjours inutilement : ils rétorquèrent contre
lui fa propre do&rine , foûtenant que puifqu’ils
avoient été rendus libres par le fang de Jefus-Chrift,
c’étoit déjà trop d’outrage au nom chrétien, qu’ils
euffent été réputés efclaves par la nobleffe ; & que
s’ils prenoient les armes, c’étoit par ordre de Dieu.
Telles étoient les fuites dufanatifme où Luther lui-
même avoit plongé l’Allemagne par la liberté de fes
opinions. Il crut y remédier en publiant un livre
dans lequel il invitoit les Princes à prendre les armes
contre ces féditieux qui abufoient ainfi de la parole
de Dieu. Il eft vrai que le comte de Mansfeld, foû-
tenu par les princes & la nobleffe d’Allemagne, défit
& prit Muncer & Pfiffer, qui furent exécutés à Mulhaufen
: mais la feâe ne fut que diflipée & non détruite
; & Luther, fuivant fon cara&ere inconftant, de-
favoiia en quelque forte fon premier livre par qn
- fécond
fécond, à la Pollicitation de bien des gens de fon parti
, qui trouyoîent fa première démarche dure’, ’ &
même un peu cruelle.
Cependànt'les Anabaptifies fe multiplièrent & fe
trouvèrent affez puiffans pour s’emparer dé Munfter
en 1534, & y foûtenir fin fiége fous la conduite de
Jean de Le yde, tailleur d’habits ; qui fe fit déclarer
leur roi. La ville fut reprife fur eux par l’évêquè de
Munfter le 24 Juin 1535. Le prétendu ro i, & fon
confident Knifperdollin, y périrent par les Supplices
; & depuis cet échec la fefte des Anabaptifies n’a
plus ofé fe montrer ouvertement en Allemagne.
Vers le même tems, Calvin écrivit cOntr’eux un
traité qu’on trouve dans fes opufculés. Comme ils
fondoient fur-tout leur doélrine fur cette parole de
Jefus-Chrift, Marc xvjv Verf. 16. quiconque croira &
fera baptifé, ferafauvé, & qu’il n’y a que les adultes
qui foient capables d’avoir la foi aâuelle ; ils en in-
féroient qu’il n’y a qu’eux non plus qui1 doivent recevoir
le baptêmë , fur-toüt n’y ayant aucun paffage
dans le nouveau-Teftament où le baptême des enfans
foit expreffément ordonné : d’où ils tiroient cette
conféquence, qu’on devoit le réitérer à ceux qui l’a-
voient reçu avant l’âge de raifon. Calvin & d’autres
auteurs furent embarraffés de ce fophifme ; & pour
s’en tirer, ils eurent recôiirs à la tradition & à la
pratique de la primitive Eglife. Ils oppoferent aux
Anabaptifies O rigene, qui fait mention dû baptême
des enfans ; l’auteur des queftions attribuées à faint
Juftin, qui en parle aufli ; un-concile tenu en Afrique
, qui j àu rapport de S. Cyprien, ordonnoitqu’on
baptisât les enfans aufli-tôt qu’ils- fe; oient nés ; la
pratique du même faint do&eur à ce fujet; les conciles
d’Autun, de Mâcon, de Gironne, de Londres,
de Vienne, &c. une foule de témoignages des Peres,'
tels que S. Irenée, S. Jérôme, S. Ambroife, S. Au-
guftin, &c.
Ces autorités, toutes refpeélables & toutes fortes
qu’elles foient, faifoient peu d’impreflion fur des
efprits aheurtés à décider tout par les Ecritures; tels
qu’étoient les Anabaptifies : 'aufli les Théologiens catholiques
fe font-ils attachés à trouver dans le nouveau
Teftament des textes capables de les terraffer,
n’employant contr’eux les argumens de tradition que
par lurabondance de droit. En effet, les enfansfont
jugés capables-,d’entrer dans le royaume des cieux,
Marc y j x . verf. 14. Luc, xviij. verfi 1 G . & le Sâüveur
lui-même en fit approcher quelques-uns de lui & les
bénit. Or ailleurs , ch. iij. v. 5 . S. Jean allure que
quiconque n’eft pas baptifé ne peut entrer dans- le
royaume de Dieu ; d’où il s’enfuit qu’on doit donner
le baptême aux enfans.
Ce que répondént les Anabaptifies y que les enfans
dont parle Jefus-Chrift étoient déjà grands, puifqu’ils
vinrent à lui, & conféquemment qu’ils étoient capables
de produire un aéte de fo i, eft manifeftemenî
une interprétation forcée du texte facré , puifque
dans S. Matthieu & dans S. Marc ils font appellés de
jeunes enfans, •7ràiSita ; dans S. Luc ; /2pî<pn, de petits
enfans ; & que le même évangélifte dit expreffément
qu’ils furent amenés à Jefus-Chrift : iis n’étoient donc
pas en état d’y aller tous feuls^
Une autre preuve non moins forte contre les Anabaptifies
, c’eft celle qui fe tire de ces paroles de faint
Paul aux Romains, ch. v. verf. iy. « que fi à caufe
» du péché d’un feu l, la mort a régné par cé feul
» homme, à plus forte-raifon ceux qui reçoivent l’a-
» bondance de la grâce & du don de la juftice régne-
» ront-ils dans la vie par un feul homme, qui elt Je-
» fus-Chrift ». Car fi tous font devenus criminels
par un feul, les enfans font donc criminels ; & de
même fi tous font jiiftifiés par un feul, les enfans
font donc aufli juftifiés par lui : or on ne fauroit être
juftifié fans la foi ; les enfans ont donc la foi nécef-
Tome I,
faire pour recevoir le baptême, non pas fiffé foi actuelle',
telle qu’on l’exige dans les adultes, maisunè
foi fuppléée par celle de l’Eglife, de leurs peres &t
meres , de leurs parreins & marreines. C ’eft'la doctrine
de S. Auguftin ‘.finis pic reclique credimus , dit-
il, lib III. de liber, arb. c. xxiij. n°. 67. prodeffe par-
vulo éorum fidem à quibtis cOnfecrandus ojfcrtur : & il
ajoute ailleurs que cette imputation de foi eft très-
équitable, puifque ces enfans ayant péché par la vo lonte
d àùtrui, il eft jufte qu’ils foient aufli juftifiés
par la volonté d’autrui. ActotnmodarilUs mater Ec+
défia aliorum pedes ut veniant, aliorum cor ut credant,
aliorum linguatn. ut fiateafitur y ut quoniam quod cegri
funt y alio peccante proegravantur, alio.pro eis confitente
falventur. Serm. 176, de verbis Apofloli.
A cette erreqr capitale, les Anabaptifies en ont
ajouté plufieurs autres des Gnoftiques & des anciens
hérétiques : par exemple , quelques-uns ont nié la
divinité de Jefus-Chrift, & fa defeente aux enfers ;
d’autres ont foûtenu que les âmes des morts dor-
moient jufqu’au jour du jugement, & que les peines
de l’enfer n’étoient pas éternelles. Leurs enthoufiaf-
fes prophétifoient que le jugement, dernier appro-
choit, & en fîxoient même terme.
Les nouveaux Anabaptifies fe bornent aux trois
principales opinions des anciens , n’attaquent point
les puiffances, du moins ouvertement, &c ne fe dif-
tinguent guere en Angleterre des autres feétes que
par une conduite des moeurs, & un extérieur extrêmement
fimple & uni, en quoi ils ont beaucoup de
conformité avec les Quakers. Voÿe^ Quakers.
A mefure que les Anabaptiftes fe font multipliés,
leurs diyerfes feftes ont pris des dénominations dif-
tinftives., tirées, foit du nom de leurs chefs, fort
des opinions particulières qu’elles ont entées fur lë
fyftème général de YAnabaptifme. On les a connut
fous les noms de Munceriens, Catharifies , Enthou-
fidßes y Silentieux, Adamifies, Georgiens, Indépendans,
Huâtes , Melchiorites , Nudipedaliens , Mepiuonites y
Bulchqdiens , Auguftiniens , Serveiièns -, Môhafieriens
Ow Munfieriens, Libertins y Deorelicliens, Stmperoransÿ
Polygamites , Ambrofiens , Clanculaires, Mamfefiaires,
Babulariens , Pacificateurs , P aftoricides, Sanguinaires y
&c. On peut principalement confulter fur cette Üé-
refie SIeidan. Mefovius, hifl. des Anabapt. Spon. ad
an. 1S22 & 1623. Dupin, hifl. du xvj. fiecle.
ANAB ASIENS , f. m. pl. ( Hifi. âne.f^étoient des
coùriers qui voyageoient à cheval ou fur des char-
riots pour des meffages d’importance; Vofie^ C ourier
& Poste. Ce mot vient du Grec dvetßadm,
monter. (G j
* ANABASSES, f. m. ( Coni. & Drap, j couvertures
ou pagnes qui fe font à Rouen & en Hollande. EL
les ont trois quarts & demi de long fur trois quarts-de
large ; elles font rayées bleu & blanc, & il y a environ
un pouce d’intervalle entre chaque raie.
^NABIBAZON, f. m. terme d'Afironomie ’ c’ eft le
nom qu’on donne à la queue du dragon, ou au noeud
méridional de la lune, c’eff-à-dire, à l’endroit où elle
coupe l ’écliptique pour paffer de la latitude fepten-
ffionalè à la méridionale. ^ôyc{N(EUD. (O)
* ANACALIPEo« ANACALIF, f. m. {Hifl. nat.)
efpece de polypede venimeux qu’on trouve a Mada-
gafear entre l’écorce des vieux arbres , & dont la
piquure eft aufli dangereufe que celle du feorpion.
( ANACALYPTERIE, f. f. ( Hifi,anc. ) fête qui fe*
célébroit chez les anciens le jour qu’il étoit permis à
la nouvelle époufe d’ôter fon vo ile , & de fe laiffer
voir en public. ^ôyeçFÊT-E, Mariage, &c. Ce mot
Vient du Grec dmzaXv>aluv, découvrir. (G)
ANACAMPTIQUE , adj. m. ('Acoiefiique.) fignifie
la même chofe que réfiéchiffant, & fe dit finguliere-
ment des échos-qu’on dit être des fons réfléchis.
Poye£ Réflexion, Son> Echo.
D d d