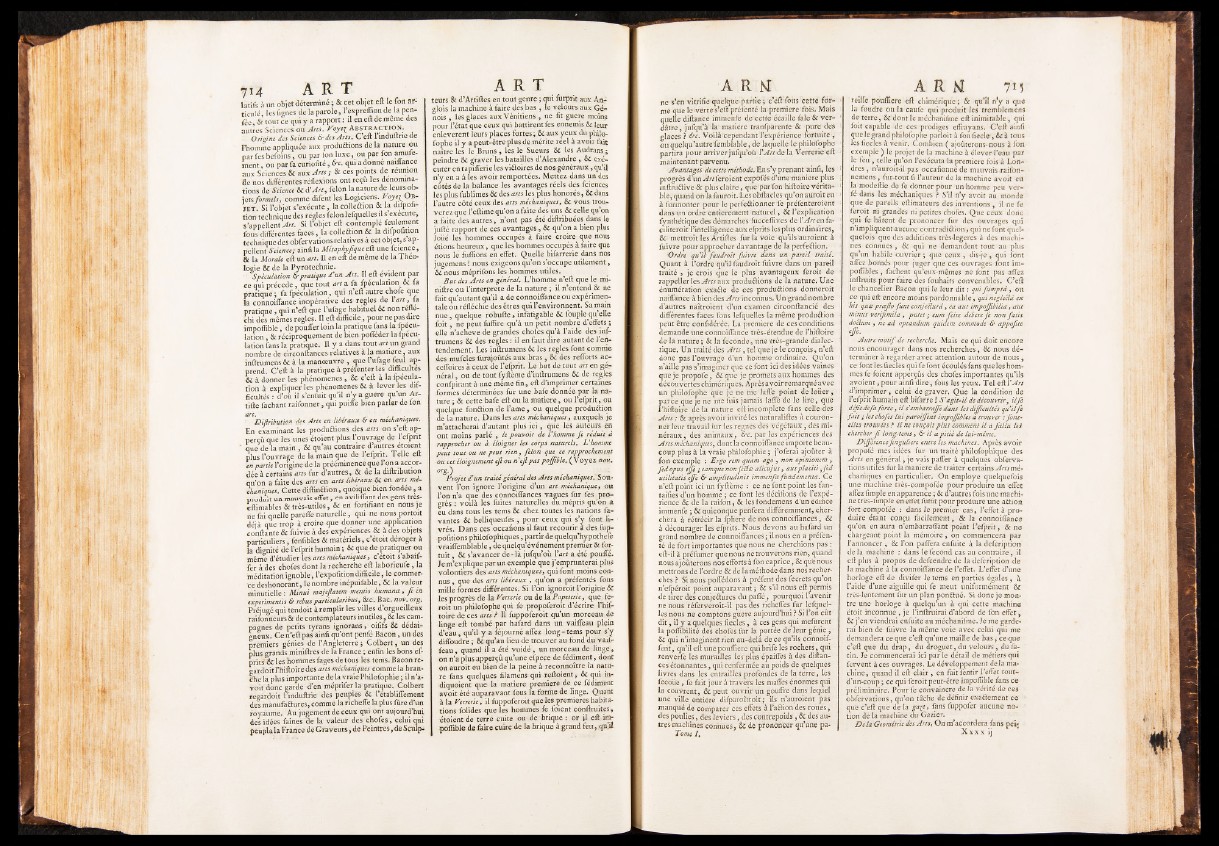
714 A R T
latifs à un objet déterminé ; & cet objet eft le Ton articulé,
les lignes de la parole, l’expreffion dé jà pen-
f é e & tout ce qui y a rapport : il en eft de meme des
autres Sciences ou Arts. V?ye{ A b s t r a c t io n .
Origine des Sciences & des Arts. C eft 1 mduftne de
l’homme appliquée aux productions delà nature ou
par fes befoins, ou par Ion luxe, ou par fon amule-
ment, ou par fa curiofité, &c. qui a donne namance
aux Sciences & aux Arts; & ces points de reunion
fle nos différentes réflexions ont reçu les dénominations
de Science & d'Art, félon la nature de leurs objets
formels, comme difent les Logiciens. Voye\O b j
e t . Si l’objet s’exécute, la collection & la dilpoli-
tion technique des réglés félon lefquelles il s’exécute,
s’appellent Art. Si l’objet eft contemple feulement
fous différentes faces, la collection & la difpofition
technique des obfervations relatives à cet objet, s appellent
Science; ainfi la Métaphyfque eft une fcience,
& la Morale eft un art. Il en eft de même de la Théologie
& de la Pyrotechnie. , .
Spéculation 6* pratique d'un Art. Il eft évident par
ce qui précédé, que tout art a fa fpéculation & fa
pratique ; fa fpéculation, qui n’eft autre chofe que
la connoiffance inopérative des réglés de IV/ , fa
pratique, qui n’eft que l’ufage habituel 8c non réfléchi
des mêmes réglés. Il eft difficile, pour ne pas dire
impoffible, de pouffer loin la pratique fans la fpecu-
lation, & réciproquement de bien poffeder la lpecu-
lation fans la pratique. Il y a dans tout art un grand
nombre de circonftances relatives à la matière, aux
inftrumens & à la manoeuvre , que l’ufage feul apprend.
C ’eft à la pratique à préfenter les difficultés
6c à donner les phénomènes , 6c c’eft à la fpecula-
tion à expliquer les phenomenes 6c à lever les difficultés
: d’où il s’enfuit qu’il n’y a guere qu’un Ar-
tifte fachant raifonner, qui puiffe bien parler de fon
àrt. ,' ,
Dijlribution des Arts en liberaux & en mèchaniques.
En examinant les productions des arts on s eft ap-
percû que les unes étoient plus l’ouvrage de l’efpnt
‘ que de la main , 6c qu’au contraire d’autres étoient
plus l’ouvrage de la main que de 1 efprit. Telle eft
en partie l’origine de la prééminence que l’on a accor-
dée à certains arts fur d’autres, 6c de la diftribution
qu’on a faite des arts en arts libéraux 6c en arts mécaniques.
Cette diftinCtion, quoique bien fondée, a
produit un mauvais effet, en aviliffant des gens tres-
eftimables 8c très-utiles, 6c en fortifiant en nous je
ne fai quelle pareffe naturelle, qui ne nous portoit
déjà que trop à croire que donner une application
confiante 6c fuivie à des expériences 6c à des objets
particuliers, fenfibles 8c matériels, c’étoit déroger à
la dignité de l’efprit humain ; 6c que de pratiquer ou
même d’étudier les arts mèchaniques, c’étoit s’abaif-
fer à des chofes dont la recherche eft laborieufe, la
méditation ignoble, l ’expofition difficile, le commerce
deshonorant, le nombre inépuifable, 6c la valeur
minutielle : Minui majeflatem mentis humante, f i in
experimentis & rebus particularibus, 8cc. Bac. nov. org.
Préjugé qui tendoit à remplir les villes d’orgueilleux
ïaifonnèurs 81 de contemplateurs inutiles, 6c les campagnes
de petits tyrans ignorans, oififs 6c dédaigneux.
Ce n’eft pas ainfi qu’ont penfé Bacon, un des
premiers génies de l’Angleterre ; Colbert, un des
plus grands miniftres de la France ; enfin les bons ef-
prits’ 6c les hommes fages de tous les tems. Bacon re-
gàrdoit l’hiftoire des arts mèchaniques comme la branche
la plus importante delà vraie Philofophie ; iln ’a-
voit donc garde d’en méprifer la pratique. Colbert
regardoit l’ irtduftrie des peuples 6c l’établiffement
des manufactures, comme la richeffe la plus fûre d’un
royaume. Au jugement de ceux qui ont aujourd’hui
des idées faines de la valeur des chofes, celui qui
peupla la France de Graveurs, de Peintres, de Scuîpteurs
8c d’Artiftes en tout genre ; qui furprit aux An-
glois la machine à faire des bas., le velours aux Génois
, les glaces aux Vénitiens , ne fit guere moins
pour l’état que ceux qui battirent fes ennemis 6c leur
enlevèrent leurs places fortes ; 6c aux yeux du philo-
fophe il y a peut-être plus de mérite réel à avoir fait
naître les le Bruns , les le Sueurs 6c les Audrans ;
peindre 6c graver les batailles d’Alexandre, 6c exécuter
en tapifferie les victoires de nos généraux, qu’il
n’y en a à les avoir remportées. Mettez dans un des
côtés de la balance les avantages réels des fciences
les plus fublimes 6c des arts les plus honorés, 6c dans
l’autre côté ceux des arts mèchaniques, 8c vous trouverez
que l’eftime qu’on a faite des uns 6c celle qu’on
a faite des autres, n’ont pas été diftribuées dans le
jufté rapport de ces avantages, 6c qu’on a bien plus
loiié les hommes occupés à faire croire que nous
étions heureux, que les hommes occupés à faire que
nous le fuflions en effet. Quelle bifarrerie dans nos
jugemens ! nous exigeons qu’on s’occupe utilement,
6c nous méprifons les hommes utiles.
But des Arts en général. L ’homme n’eft que le mi-
niftre ou l’interprete de la nature ; il n’entend 8t ne
fait qu’autant qu’il a de connoiffance ou expérimentale
ou réfléchie des êtres qui l’environnent. Sa main
nue, quelque robufte, infatigable 6c fouple qu’elle
fo i t , ne peut fuffire qu’à un petit nombre d’effets ;
elle n’acheve de grandes chofes qu’à l’aide des inftrumens
6c des réglés : il en faut dire autant de l’entendement.
Les inftrumens 6c les réglés font comme
des mufcles furajôûtés aux bras, 8c des refforts ac-
ceffoires à ceux de l’efprit. Le but de tout art en gér
néral, ou de tout fyftème d’inftrumens 6c de réglés
confpirant à une même fin, eft d’imprimer certaines
formes déterminées fur une bafe donnée par la nar
ture ; 8t cette bafe eft ou la matière, ou l’efprit, ou
quelque fonction de l’ame, ou quelque production
de la nature. Dans les arts mèchaniques, auxquels je
m’attacherai d’autant plus i c i , que les auteurs en
ont moins parlé , le pouvoir de l'homme fe réduit à
rapprocher ou à éloigner les corps naturels. L'homme
peut tout ou ne peut rien, félon que ce rapprochement
ou cet éloigntment ejl ou n'efl pas poffible. (Vo ye z nov,.
org.')
Projet d'un traité général des Arts mèchaniques/. Souvent
l’on ignore l’origine d’un art méchanique3 ou
l’on n’a que des connoiffances vagues fur fes progrès
: voilà les fuites naturelles du mépris qu’on a
eu dans tous les tems 6c chez toutes les nations fa-
vantes 6c belliqueufês , pour ceux qui s’y font,livrés.
Dans ces oceafions il faut recourir à des fup-
pofitions philofophiques, partir de quelqu’hypothefe
vraiffemblable, de quelqu’événement premier & fortuit
, 6c s’avancer de - là jufqu’où Y art a été pouffé-
Je m’explique par un exemple que j’emprunterai plus
volontiers des arts mèchaniques, qui font moins connus
, que des arts libéraux , qu’on a préfentés fous
mille formes différentes. Si l’on ignoroit l’origine 8c
les progrès de la Verrerie ou de la Papeterie, que. feroit
un philofophe qui fe propoferoit d’écrire l’hif-
toire de ces arts ? Il fuppoferoit qu’un morceau de
linge eft tombé par hafard dans un vaiffeau plein
d’eau, qu’il y a féjourné affez long-tems pour s’y
diffoudre ; 6c qu’au lieu de trouver au fond du vaifi-
feau, quand il a été vuidé, un morceau de linge,
on n’a plus apperçû qu’une efpece de fédiment, dont
on auroit eu bien de la peine à reconnoître la nature
fans quelques filamens qui reftoient, 6c qui iiv
diquoient que la matière première de ce fédiment
avoit été auparavant fous la forme de linge. Quant
à la Verrerie, il fuppoferoit que lés.premières habitations
folides que les hommes fe foienf coifllruites,
•étoientde terre cuite ou-.de brique: or jl eft.im.-
poflible de faire cuire de la brique à grand fèu, qu’il
ne s’éfl vitrifie quelque bîU’tie ; c’ëft foils cette forme
que le'Verre s^eft préfenté la première fois. Mais
quelle diftance immenfe de cette écaille fale & verdâtre,
jufqù’à la matière tranfparenfe 8c pure des
glaces ? &c. Voilà‘cependant l’expérience fortuite ',
ou quelqu’aütre fëhlblable, de laquelle le philofophe
partira pour arriver jufqu’où Y Are de laVerrerie eft
maintenant parvenu.
Avantagés de cette méthode. En s'y prenant ainfi, les
progrès d’un Art feroient eXpôfés d’une maniéré plus
inftriiCtive 8c plus claire, queparffon hiftoire véritable,
quand on là fauroit.'Les obftacles qu’on auroit eu
à furmonter pour le perfectionner fe préfenteroient
dans un ordre entièrement naturel, ÔC l’explication
fynthétique des démarches fücceflives de Y Art en fa-
ciliteroit l’intelligence auxefprits les plus ordinaires,
6c- mettroit les A'rtiftes fur la voie qu’ils aurôient à
fuivre pour approcher davantage de la perfection.
Ordre qu'il faudroit fuivre dans un pareil traité.
Quant à l’ordre qu’il faudroit fuivre dans un pareil
traité , je crois que le plus avantageux feroit de
rappeller les Arts'àux productions de la nature. Une
énumération exaCte de ces productions donneroit
naiffance à bien des Ans inconnus. Un grand nombre
d’autres nàxtroient d’un examen circonftancié des
différentes faces fous lefquelles la même production
peut être confidérée. La première de ces conditions
demande une connoiffance très-étendue de l’hiftoire
de la nature; 8c la féconde, une très-grande dialectique.
Un traité des Arts, tel que je le conçois , n’eft
donc pas l’ouvrage d’un homme ordinaire. Qu’on
n’âille pas s’imaginer que cé font ici des idées vaines
que je propofe, 6c que je promets aux hommes des
découvertes chimériques. Après avoir remarqué avec
un philofophe que je ne me laffe point delotier ,
parce que je ne me fuis jamais laffé de le lire, que
l ’hiftoire de la nature eft incomplète fans celle des
Arts : 8c après avoir invité les naturaliftes à couronner
leur travail fur les régnés des végétaux, des minéraux
, des animaux, &c. par les expériences des
Arts mèchaniques, dont la connoiffance importe beaucoup
plus à la vraie philofophie ; j’oferai ajoûter à
fon exemple : Ergo rem quant ago, non opinionem,
fed opus ejjc ; eamque non feclte alicujus , aut placiti , fed
utilitatis effe & amplitudinis immenfe fundamenta. Ce
n’eft point ici un fyftème : ce ne font point les fan-
taifies d’un homme ; ce font les dédiions de l’expérience
6c de la raifon, 8c les fondemens d’un édifice
immenfe ; 6c quiconque penfera différemment, cherchera
à rétrécir la fphere dé nos connoiffancés, 6c
à décourager les efprits. NoùS devons au hafard un
grand nombre de connoiffances ; il nous en a préfenté
de fort importantes que nous ne cherchions pas :
eft-il à préfüffier que nous në trouverons rien, quand
noùs ajoâtetons nos efforts à fon caprice, 6c qufe nous
mettrons de l’ordre 6c de laméthode dans nos recherches
? Si nous poffédons à préfent des fecrets qu’on
n’efpéroit point auparavant ; 6c s’il nous eft permis
de tirer des conjeélures du paffé, pourquoi l’avenir
ne nous réferveroit-il pas des richeffes fur lefquelles
nous ne comptons guere aujourd’hui ? Si l’on eût
dit, il y a quelques fiecles, à ces gens qui mèfurent
la poflîbilité des chofes fur la portée de leur génie ,
6c qui n’imaginent rien au-delà de ce qu’ils connoif-
fent, qu’il eft une poufliere qui brife les rochers, qui
renverfe les murailles les plus épaiffes à des diftan-
ces étonnantes, qui renfermée au poids de quelques
livres dans les entrailles profondes de la terre, les
fecoüë, fe fait jour à travers les maffes énormes qui
la couvrent, 6c peut ouvrir un gouffre dàns lequel
une ville entière difparôïfroit ; ils n’auroient pas
manqué de comparer ces effets à l’aftion des roues,
des poulies, des leviers, des contrepoids, ôc des autres
machines connues, 6c de prononcer qu’une pa-
Tomt ƒ,
teille pouflîefe eft chimérique ; & qu’il n’y a que
la foudre ou la caufe qui produit les tremblemens
de terre, ôc’dont le méchanifme eft inimitable, qui
foit capable de ces prodiges effrayahs. C ’eft ainfi
que le grand philofophe parloit à fonfiecle, 6c à tous
les fiecles à venir. Combien ( ajouterons-nous à fort
exemple ) le projet de la machine à élever l’eau pat
le feu1, telle qu’on l’exécuta la première fois à Londres
, n’auroit-il pas oceafionné de mauvais raifon-
nemens, fur-tout fi l’auteur de la machine avoit eu
la modeftie de fe donner pour un homme peu ver-
■ fé dans les mèchaniques ? S’il n’y avoit au monde
que de pareils eftimateurs des inventions , il ne fe
feroit ni grandes ni petites chofes. Que ceux donc
qui fe hâtent de prononcer fur des ouvrages qui
n’impliquent aucune contradiélion, qui ne font quelquefois
que dëS additions très-legeres à des machines
connues, 6c qui ne demandent tout au plus
qu’un habile Ouvrier ; que ceux , dis-je , qui font
affez bornés pour juger que cés ouvrages font im-
poflïbles , fâchent qu’eux-mêmes ne font pas affez
iinftruits pour faire des fouhaits convenables. C ’eft
le chancelier Bacon qui le leur dit : qui fumptâ, ou
ce qui eft encore moins pardonnable, qui hegleclâ ex
his quoe ptoeflo funt conjeUurâ, ea aut impojjibilia, aut
minus verifimila , putet ; eum fcire debere fe non fu is
doclum , ne ad optdndum quidem commode & appofite
effe.
Autre motif de recherche. Mais ce qui doit encore
nous encourager dans nos recherches, 6c nous déterminer
à regarder avec attention autour de nous ,
ce font lés fiecles qui fe font écoulés fans que les hommes
fe foient apperçûs des chofes importantes qu’ils
a voient, pour ainfi dire, fous lès yeux. Tel eft Y Art
d’imprimer, celui de graver. Que la condition de
l’efprit humain eft bifarre 1 S'agit-il de découvrir, ilft
défie de fa force , i l s'embarraffe dans les difficultés qu'ilfe
fait ; les chofes lui paroiffient itnpoffibles à trouver : font-
elles trouvées ? il ne conçoit plus comment i l a fallu leS
chercher J î long-tems , & i l a pitié de lui-même.
Différence finguliere entre les machines. Après avoir
propofé mes idées fur un traité philofophique des
Arts en général ; je vais paffer à quelques obfervations
utiles fur la maniéré de traiter certains Arts mi-
chaniques en particulier. On employé quelquefois
une machine très-compofée pour produire un effet
affez fimple en apparence ; 8c d’autres fois une machine
très-fimple en effet fuffit pour produire une aftion
fort compofée : dans le premier cas, l’effet à produire
étant conçu facilement, 8c la connoiffance
qu’on en aura n’embarraffant point l ’elprit, 8c ne
chargeant point la mémoire, on commencera par
l’annoncer , 6c l’on paffera enfuite à la defcription
de la machine : dans le fécond cas au contraire, il
eft plus à propos de defcendre de la defcription de
la machine à la connoiffance de l’effet. L’effet d’une
horloge eft de divifer le tems en parties égales , à
l’aide d’une aiguille qui fe meut uniformément 6c
très-lentement fur un plan ponétué. Si donc je montre
une horloge à quelqu’un à qui cette machina
étoit inconnue , je l’inftruirai d’abord de fon effet,
6c j’en viendrai enfuite au méchanifme. Je me garderai
bien de fuivre la même voie avec celui qui me
demandera ce que c’eft qu’une maille de bas, ce que
c’eft que du drap, du droguet, du velours, du fa-
tin. Je commencerai ici parle détail de métiers qui
fervent à ces ouvrages. Le développement delà machine,
quand il eft clair , en fait fentir l ’effet tout-
d’un-coup ; ce qui feroit peut-être imp o ffib le fans ce
préliminaire. Pour fe convaincre de la vérité de ces
o b f e r v a t io n s , qu’on tâche de définir exactement ce
que c’eft que de la ga^e, fans fuppofer aucune notion
delà machine du Gazier.
De la Géométrie des Arts, On m’accordera fans pei-
X x x x ij