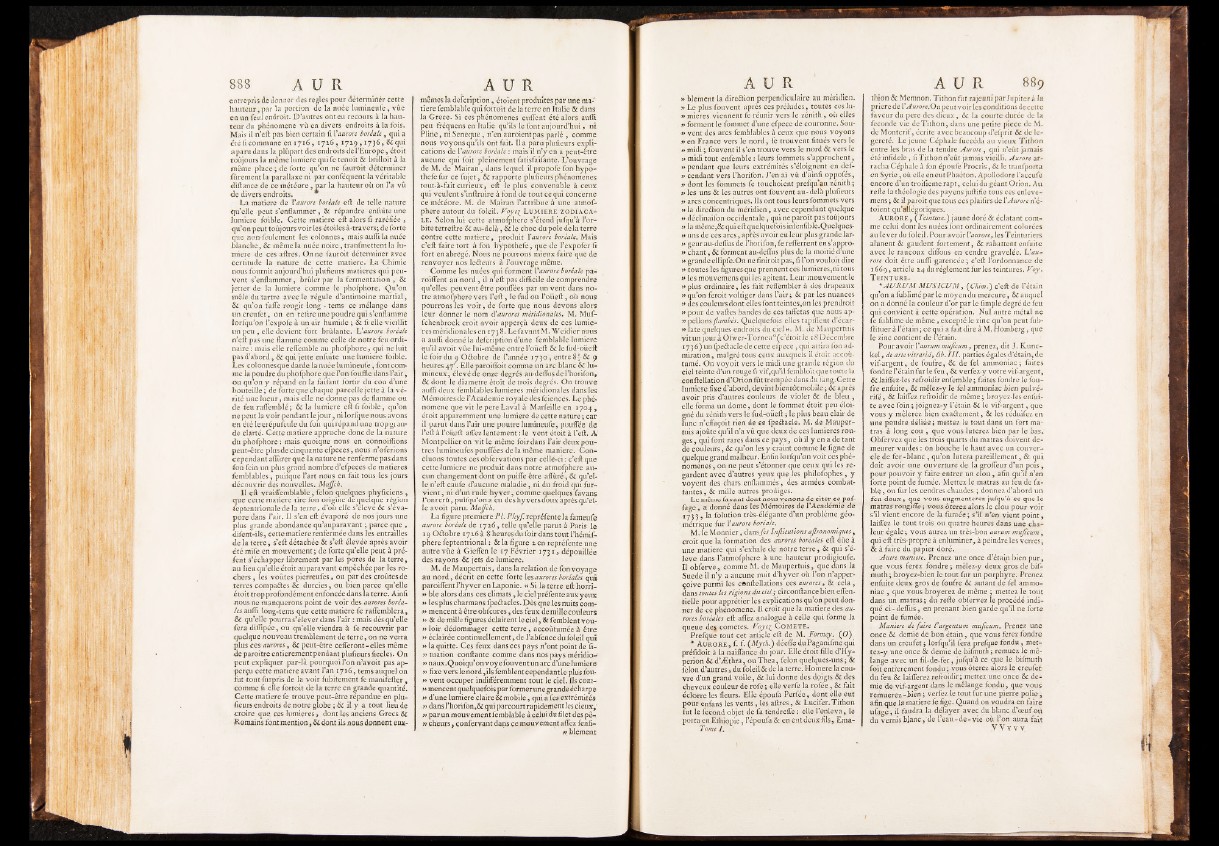
entrepris de donner des réglés pour détermiflér cette
hauteur,par la portion de la nuée lumineufe, vue
en un feul endroit. D ’auttes ont eu recours à la hauteur
du phénomène vu en divers endroits à la fois.
Mais il n’eft pas bien certain fi l'aurore boréale , qui a
étéficommune en 17 16 , 1726, 172 9 ,173 6 , & qu i
a paru dans la plupart des endroits de l’Europe-, étoit
toujours la même lumière qui fe tenoit & brrlloit à la
même place ; de forte qu’on ne fauroit déterminer
fûrement la parallaxe ni par confisquent la véritable
diftance de ce météore, par la hauteur où on l’a vu
de divers endroits* *
La matière de Vaurore boréale eft de telle nature
qu’elle peut s’enflammer , & répandre enfuite une
lumière foible. Cette matière eft alors fi raréfiée ,
qu’on peut toujours voir les étoiles à-travers; de forte
que non-feulement les colonnes, mais auffi la nuée
blanche, & même la nuée noire, tranfmettent la lti-
miere de ces aftres. On ne fauroit déterminer avec
Certitude la nature de cette matière. La Chimie
nous fournit aujourd’hui plufieurs matières qui peuvent
s’enflammer, brûler par la fermentation , &
jetter de la lumière comme le phofphore. Qu’on
mêle du tartre avec le régule d’antimoine martial,
& qu’on Jaffe rougir long - tems ce mélange dans
un creufet, on en retire une poudre qui s’enflamme
lorfqu’on l’expofe à un air humide ; & fi elle vieillit
un peu , elle devient fort brûlante. L'aurore boréale
n’eft pas une flamme comme celle de notre feu ordinaire
: mais elle reffemble au phofphore, qui ne luit
pas d’abord, & qui jette enfuite une lumière foible.
Les colonnes que darde la nuée lumineufe, font comme
la poudre du phofphore que l’on fouffle dans l’air,
ou qu’on y répand en la faifant fortir du cou d’une
bouteille ; de forte que chaque parcelle jette à la vérité
une lueur, mais elle ne donne pas de flamme ou
de feu raffemblé ; & la lumière eft fi foible, qu’on
ne peut la voir pendant le jour, ni lorfque nous avons
en été le crépufcule du foir qui répand une trop grande
clarté. Cette matière approche donc de la nature
du phofphore : mais quoique nous en connoiflions
peut-être plus de cinquante efpeces, nous n’oferions
cependant affiner que la nature ne renferme pas dans
fon fein un plus grand nombre d’efpeces de matières
femblables, puilque l’art nous en fait tous les jours
découvrir des nouvelles. Muffch.
Il eft vraiffemblable, félon quelques phyficiens ,
que cette matière tire fon origine de quelque région
feptentrionale de la terre , d’où elle s’élève & s’évapore
dans l’air. Il s’en eft évaporé de nos jours une
plus grande abondance qu’auparavant ; parce que ,
difent-ils, cette matière renfermée dans les entrailles
de la terre, s’eft détachée & s’eft élevée après avoir
été mife en mouvement ; de forte qu’elle peut à pré-
fent s’échapper librement par les pores de la terre,
au lieu qu’elle étoit auparavant empêchée par les rochers
, les voûtes pierreufes, ou par des croûtes de
terres compares & durcies, ou bien parce qu’elle
étoit trop profondément enfoncée dans la terre. Ainfi
nous ne manquerons point de voir des aurores boréales
aufli long-tems que cette matière fe raffemblera,
& qu’elle pourra s’élever dans l’air : mais dès qu’elle
fera difîïpée, ou qu’elle viendra à fe recouvrir par
quelque nouveau tremblement de terre, on ne verra
plus ces aurores, & peut-être cefferont-elles même
deparoître entièrement pendant plufieurs fiedes. On
peut expliquer par-là pourquoi l’on n’avoit pas ap-
perçu cette matière avant l’an 1716, tems auquel on
fut toutfurpris.de la voir fubitement fe manifefter,
comme fi elle fortoit de la terre en grande quantité.
Cette matière fe trouve peut-être répandue en plufieurs
endroits de notre globe ; & il y a tout lieu de
croire que. ces lumières, dont les anciens Grecs &
Romains font mention, & dont ils nous donnent euxmêmes
la defeription, étoient produites par une matière
femblable qui fortoit de la terre en Italie & dans
la Grece. Si ces phénomènes euflent été alors aufli
peu fréquens en Italie qu’ils le font aujourd’hui, ni
Pline, m Seneque, n’en aüroient pas parlé , comme
nous voyons qu’ils ont fait. Il a paru plufieurs explications
de l’aurore boréale : mais il n’y en a peut-être
aucune qui foit pleinement fatisfaifante. L’ouvrage
de M. de Mairan, dans lequel il propofe fon hypo-
thefe fur ce fujet, & rapporte plufieurs phénomènes
tout-à-fait curieux, eft le plus convenable à ceux
qui veulent s’inftruire à fond de tout ce qui concerne
ce météore. M. de Mairan l’attribue à une atmof-
phere autour du foleil. Voye^ L u m iè r e z o d ia c a l
e . Selon lui cette atmofphere s’étend jufqu’à l’orbite
terreftre & au-delà, & le choc du pôle delà terre
contre cette matière, produit F aurore boréale. Mais
c’eft faire tort à fon hypothelè, que de l’expofer fi
fort en abrégé. Nous ne pouvons mieux faire que de
renvoyer nos lefteurs à l’ouvrage même.
Comme les nuées qui forment Y-aurore boréale pa-
roiflënt au nord , il n’eft pas difficile de comprendre
qu’elles peuvent être pouflees par un vent dans notre
atmofphere vers l’e ft , le fud ou l’oiieft, où nous
pourrons les voir , de forte que nous devons alors
leur donner le nom d'aurores méridionales. M. Muf-
fehenbroek croit avoir apperçû deux de ces lumières
méridionales en 1738. LefavantM.Weidief nous
a auffi donné la defeription d’une femblable lumière
qu’il avoit vûe lui-même entre l’oiieft & le fud-oüeft
le foir du 9 Oftobre de l’année 1730, entre 8£- & 9
heures 47 . Elle paroiffoit comme un arc blanc & lumineux,
élevé de onze degrés au-deffus de l’horifon,
& dont le diamètre étoit de trois degrés. On trouve
auffi deux femblables lumières méridionales dans les
Mémoires de l’Academie royale des fciences. Le phénomène
que vit lé pere Laval à Marfeille en 1704 ,
étoit apparemment une lumière de cette nature ; car
il parut dans l’air une poutre lumineufe, pouflee de
l’eft à l’oiieft affez lentement : le vent étoit à l’eft. A
Montpellier on vit le même foir dans Pair deux poutres
lumineufes pouflees de la même maniéré. Concluons
toutes ces obfervations par celle-ci : c’eft que
cette lumière ne produit dans notre atmofphere aucun
changement dont on puiffe être afluré, & qu’elle
n’eft caufe d’aucune maladie, ni du froid qui fur-
vient, ni d’un rude hyver, comme quelques favans
l’ont crû, puifqu’on a eu des hy vers doux après qu’elle
avoit paru. Mujfch.
La figure première PI. Phyf. repréfente la fameufe
aurore boréale de 1726, telle qu’elle parut à Paris le
19 O&obre 1726 à 8 heures du foir dans tout l’hémif-
phere feptentrional : & la figure 2 en repréfente une
autre vûe à GiefTen le 17 Février 17 3 1 , dépouillée
des rayons & jets de lumière.
M. de Maupertuis, dans la relation de fon voyage
au nord, décrit en cette forte les aurores boréales qui
paroiffent l’hy ver en Laponie. « Si la terre eft horri-
» ble alors dans ces climats, le ciel préfente auxyeux
» les plus charmans fpe&acles. Dès que les nuits com-
» mencent à êtreobfcures, des feux de mille couleurs
» & de mille figures éclairent le ciel, & femblent vou-
» loir, dédommager cette terre, accoûtumée à être
» éclairée continuellement, de l’abfence du foleil qui
» la quitte. Ces feux dans ces pays n’ont point de fi-
» tuation confiante comme dans nos pays méridio-'
» naux. Quoiqu’on voyefouvent un arc d’une lumière
» fixe vers le nord, ils femblent cependant le plus fou-
» vent occuper indifféremment tout le ciel. Us com-
» mencent quelquefois par former une grandeécharpe
» d’une lumière claire & mobile, qui a fes extrémités
->» dans l’horifon,ôtqui parcourt rapidement les cieux,'
» par un mouvement femblable à celui du filet des pê-
» cheurs, çonfervant dans ce mouvement affez fenfi-
» blement
» blement la direttion perpendiculaire au méridien.
» Le plus fouvent après ces préludes, toutes ces Iu-
» mieres viennent fe réunir vers le zénith, où elles
» forment le fommet d’une efpece de couronne. Sou-
» vent des arcs femblables à ceux que nous voyons
» en France vers le nord, fe trouvent fitués vers le
» midi ; fouvent il s’en trouve vers le nord & vers le
» midi tout enfemble : leurs fommets s’approchent,
» pendant que leurs extrémités s’éloignent en def-
» Cendant vers l’horifon. J’en ai vû d’ainfi oppofés,
» dont les fommets fe touchoient prefqu’au zénith ;
» les uns & les autres ont fouvent au-delà plufieurs
» arcs concentriques. Ils ont tous leurs fommets vers
» la direélion du méridien, avec cependant quelque
» déclinaifouoccidentale, qui ne paroît pas toûjours
» la même,& qui eft quelquefois infenfible.Quelques-
» uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande lar-
» geur au-deffus de l’horifon, fe refferrent en s’appro-
» chant, & forment au-deffus plus de la moitié d’une
» grande ellipfe.On ne finiroit pas, fi l’on vouloit dire
» toutes les figures que prennent ces lumières,ni tous
» les mouvemens qui les agitent. Leur mouvement le
» plus ordinaire, les fait reffembler à des drapeaux
» qu’on feroit voltiger dans l’air ; & par les nuances
» des couleurs dont elles font teintes,on les prendroit
» pour de vaftes bandes de ces taffetas que nous ap-
» pelions flambés. Quelquefois elles tapiffent d’écar-
» late quelques endroits du ciel». M. de Maupertuis
vit un jour à Ofwer-Tornea°(c’étoitIe 18 Décembre
1736) un fpeétacle de cette efpece, qui attira fon admiration
, malgré tous ceux auxquels il étoit accoû-
tumé. On voyoit vers le midi une grande région du
ciel teinte d’un rouge fi vif,qu’il fembloit que toute la
conftellation d’Orion fût trempée dans du lang.Cette
lumière fixe d’abord, devint bientôt mobile ; &c après
avoir pris d’autres couleurs de violet & de bleu ,
elle forma un dôme, dont le fommet étoit peu éloigné
du zénith vers le fud-oüeft ; le plus beau clair de
lune n’effaçoit rien de ce fpe&acle. M. de Maupertuis
ajoûte qu’il n’a vû que deux de ces lumières rouges
, qui font rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs, & qu’on les y craint comme le figne de
quelque grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phé-
nomenes, on ne peut s’étonner que ceux qui les regardent
avec d’autres yeux que les philofophes, y
voyent des chars enflammés, des armées combattantes
, & mille autres prodiges.
Le même favant dont nous venons de citer ce paf-
fage, a donné dans les Mémoires de l’Académie de
1733 , la folution très-élégante d’un problème géo-
• métrique fur Y aurore boréale.
M. le Monnier, dansfes Injlitutions agronomiques,
croit que la formation des aurores boréales eft dûe à
une matière qui s’exhale de notre terre, & qui s’élève
dans l’atmofphere à une hauteur prodigieufe.
Il obferve, comme M. de Maupertuis, que dans la
Suede il n’y a aucune nuit d’hyver où l’on n’apper-
çoive parmi lés cOnftellations ces aurores, & cela,
dans toutes Us régions du ciel; circonftance bien effen-
tielle pour apprétier les explications qu’on peut donner
de cè phénomène. Il croit que la matière desau-
rores boréales eft affez analogue à celle qui forme la
queue dej cometes. ^°ycl C o m e t e .
Prefque tout cet article eft de M. Formey. (O)
* A u r o r e , f. f. (M y th .) déeffeduPaganifme qui
préfidoit à la naiffance du jour. Elle étoit fille d’Hy-
perion & d’Æthra, ou Thea, félon quelques-uns ; &
félon d’autres, du foleil & de la terre. Homere la couvre
d’un grand voile, & lui donne des doigts & des
cheveux couleur de rofe ; elle verfe la rofée, & fait
éclorre les fleurs. Elle époufa Perfée, dont elle eut
pour enfans les v ents, les aftres, & Lucifer. Tithon
fut le fécond objet de fa tëndreffe : elle l ’enleva, le
porta en Ethiopie, l’époufa & en eut deux fils, Ema-
Tome I.
thion & Memnon. Tithon fut rajeuni par Jupiter à la
priere de YAurore.On peutvoirles conditions de cette
faveur du pere des dieux, & la courte durée de la
fécondé vie de Tithon, dans une petite piece de M.
de Montcrif, écrite avec beaucoup d’efprit & de le-
gereté. Le jeune Céphale fuccéda au vieux Tithon
entre les bras de la tendre Aurore, qui n’eût jamais
été infidèle, fi Tithon n’eût jamais vieilli. Aurore arracha
Céphale à fon époufe Procris, & le tranfporta
en Syrie, où elle en eut Phaéton. Apollodore l’accufe
encore d’un troifieme rapt, celui du géant Orion. Au
refte la théologie des payens juftifie tous ces enleve-
mens ; & il paroît que tous ces plaifirs de Y Aurore n é-
toient qu’allégoriques.
A u r o r e , ( Teinture.) jaune doré & éclatant comme
celui dont les nuées font ordinairement colorées
au lever du foleil. Pour avoir Y aurore, les Teinturiers
alunent & gaudent fortement, & rabattent enfuite
avec le raucoux diffous en cendre gravelée. L’aurore
doit être aufli garencée; c’eft l’ordonnance de
1669, article 24 du réglement fur les teintures. Voy.
T e in t u r e .
*AURUM M USICUM, (Chim.) c’eft de l’étain
qu’on a fublimé par le moyen du mefeure, & auquel
on a donné la couleur d’or par le fimple degré de feu
qui convient à cette opération. Nul autre métal ne
le fublime de même, excepté le zinc qu’on peut fub-
ftituer à l’étain ; ce qui a fait dire à M. Homberg, que
le zinc contient de l’étain.
Pour avoir Yaurum mujicum, prenez, dit J. Kunc-
kel, de arte vitrariâ, lib. I II. parties égales d’étain, de
vif-argent, de foufre, &C de fel ammoniac; faites
fondre l’étain fur le feu, &c verfez-y votre vif-argent,
& laiflez-les refroidir enfemble ; faites fondre le foufre
enfuite, & mêlez-y le fel ammoniac bien pulvé-
rifé, & laiflez refroidir de même ; broyez-les enfuite
avec foin ; joignez-y l’étain & le vif-argent, que
vous y mêlerez bien exaftement, & les reduifez en
une poudre déliée; mettez le tout dans un fort ma-
tra$ à long cou , que vous luterez bien par le bas.
Obfërvez que les trois quarts du matras doivent demeurer
vuides : on bouche le haut avec un couvercle
de fer-blanc, qu’on lutera pareillement, & qui
doit avoir une ouverture de la grofleur d’un pois,
pour pouvoir y faire entrer un clou, afin qu’il n’en
forte point de fumée. Mettez le matras au feu de fable
, ou fur les cendres chaudes ; donnez d’abord un
feu doux., que vous augmenterez jufqu’à ce que le
matras rougifle ; vous ôterez alors le ciou pour voir
s’il vient encore de la fumée ; s’il n’en vient point,
laiflez le tout trois ou quatre heures dans une cha*
leur.égale; vous aurez un très-bon aurum mujîcum,
qui eft très-propre à enluminer, à peindre les verres;
& à faire du papier doré.
Autre maniéré. Prenez une once d’étam bien pur,
que vous ferez fondre ; mêlez-y deux gros de bif-
muth ; broyez-bien le tout fur un porphyre. Prenez
enfuite deux gros de foufre & autant de fel ammoniac
, que vous broyerez de même ; mettez le tout
dans un matras ; du refte obfervez le procédé indiqué
ci - defliis, en prenant bien garde qu’il ne forte
point de fumée.
Maniéré de faire Vdrgentum mujicum. Prenez une
once & demie de bon étain, que vous ferez fondre
dans un creufet ; lorfqu’il fera prefque fondu, met-
tez-y une once & demie de bifmuth; remuez le mélange
avec un fil-de-fer, jufqu’à ce que le bifmuth
foit entièrement fondu ; vous ôterez alors le creufet
du feu & laiflerez refroidir; mettez une once & demie
de vif-argent dans le mélange fondu, que vous
remuerez - bien ; verfez le tout fur une pierre polie ,
afin que la matière fe fige. Quand on voudra en faire
ufage, il faudra la délayer avec du blanc d’oeuf ou
du vernis blanc, de l’eau-de-vie où l’on aura fait
y Vvvv,