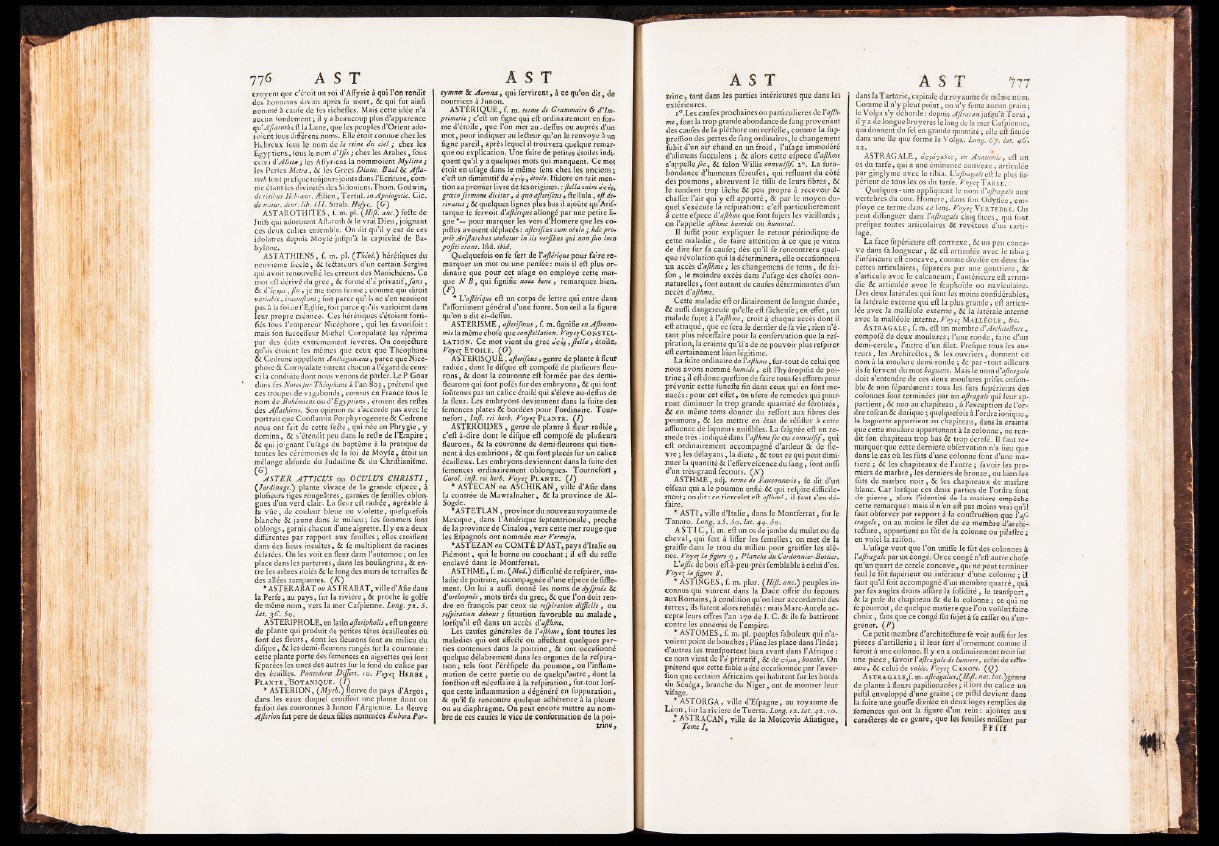
croyent que c’éfoit un roi d’Affyrie à qui l’on rendit
des honneurs divins après fa mort, & qui fut ainfi
nommé à caufe de les richeffes. Mais cette idée n’a
aucun fondement ; il y a beaucoup plus d’apparence
qu'Aftarotked la Lune, que les peuples d’Orient ado-
roient fous différens noms. Elle étoit connue chez les
Hébreux fous le nom de la reine du ciel ; chez les
Egyptiens, fous le nom d'ifts ; chez les Arabes, fous
celui d'Alitta ; les Aflyriens la nommoient Mylitta;
les Perles Metra, 6c les Grecs Diane. Baal 6c Aßa-
roth font prefque toujours joints dans l’Ecriture, comme
étant les divinités des Sidoniens.Thom. Godwin,
de titibus J/cb/ceor. Æ lien, Tertul. in Apologetic. Cic.
de natur. de'or. lib. t II. Strab. Hefyc. (G)
ASTAROTHITES, 1'. m. pl. {Hiß. anc.) fefle de
Juifs qui adoroient Aftaroth & le vrai Dieu, joignant
ces deux cultes enièmbîe. On dit qu’il y eut de ces
idolâtres depuis Moyl'e jufqu’à la captivité de Ba-
ASTATHIENS, f. m. pl. ( Théol.) hérétiques du
neuvième fiecle, 6c feftateurs d’un certain Sergius
qui avoit renouvellé les erreurs des Manichéens. Ce
mot eft dérivé du grec, & formé dV’ privatif ,fan s ,
& d'içnpu yfio, je me tiens ferme ; comme qui diroit
variable, inconfiant; foit parce qu’ds ne s’en tenoient
pas à la foi de l’Eglife, foit parce qu’ils varioient dans
leur propre créance. Ces hérétiques s’étoient fortifiés
lous l’empereur Nicéphore, qui les favorifoit :
mais fon fuccefl'eur Michel Curopalate les réprima
par des édits, extrêmement leveres. On conjeélure
qu’ils étoicnt les mêmes que ceux que Théophane
& Cedrene appellent Anthiganiens > parce que Nice-
phore & Curopalate tinrent chacun à l’égard de ceux-
ci la conduite dont nous venons de parler. Le P Goar
dans fes NotesJur Théophane à l’an 803 , prétend que
ces troupes de vagabonds, connus en France fous le
nom de Bohémiens ou à'Egyptiens, étoient des relies
des AJlathiens. Son opinion ne s’accorde pas avec le
portrait que Conftanrin Porphyrogenete & Cedrene
nous ont fait de cette fe£le, qui née en Phrygie, y
domina, 6c s’étendit peu dans le relie de l’Empire ;
& qui joignant l’ufage du baptême à la pratique de
toutes les cérémonies de la loi de Moyfe, étoit un
mélange abfurde du Judaïlme 6c du Chriftianilme.
m
A ST ER A T T 1CU.S ou OCULUS CH R I S T I ,
( Jardinage.) plante vivace de la grande efpece, à
plufieurs tiges rougeâtres, garnies de feuilles oblon-
gues d’un verd clair. La fleur ell radiée, agréable à
la vû e, de couleur bleue ou violette, quelquefois
blanche & jaune dans le milieu ; les fommers font
oblongs, garnis chacun d’une aigrette. Il y en a deux
differentes par rapport aux feuilles ; elles croiflent
dans des lieux incultes, & fe multiplient de racines
éclatées. On les voit en fleur dans l’automne ; on les
place dans les parterres, dans les boulingrins, & entre
les arbres il'olés & le long des murs de terraffes 6c
des allées rampantes, ( if )
* ASTERABAT ou ASTR ABAT, ville d’Afie dans
la Perfe, au pays, fur la riviere, & proche le golfe
de même nom, vers la mer Cafpienne. Long. y z . S .
lat. 3 6. 5o.
ASTER1PHOLE, en latin afteripholis, eft un genre
de plante qui produit de petites têtes écailleufes où
font des fleurs , dont les fleurons font au milieu du
d ifque, 6c les demi-fleurons rangés fur la couronne :
cette plante porte des femences en aigrettes qui font
féparées les unes des autres fur le fond du calice par
des écailles. Pontederoe Dijfert. 10. Voyeç H e r b e ,
P l a n t e , B o t a n iq u e . (T )
* ASTERION, {Mythi) fleuve du pays d’Argos,
dans les eaux duquel croifloit une plante dont on
faifoit de? couronnes à Junon l’Argienne. Le fleuve
Àfterion fut pere de deux filles nommées Eubora P oreymnet
& Acrona, qui fervirent, à ce qu*on dit, de
nourrices à Junon.
ASTÉRIQUE, f. m. terme de Grammaire & d'imprimerie
; c’eft un figne qui eft ordinairement en for*
me d’étoile, que l’on met au-deffus ou auprès d’un
mot, pour indiquer au leéleur qu’on le renvoyé à un
figne pareil, après lequel il trouvera quelque remar*
que ou explication. Une fuite de petites étoiles indiquent
qu’il y a quelques mots qui manquent. Ce mot
etoit en ufage dans le même fens chez les anciens;
c’eft un diminutif de «V«V > étoile. Ifidore en tait mention
au premier livre de lès origines. : ftelldenim «V»p,
grceco fermone dicitur, à quo ajlerifcus, ftetlula, ejl dériva
tus • 6c quelques lignes plus bas il ajoute qu’Arif-
tarque fe fervoit d'afterique allongé par une petite ligne
*•— pour marquer les vers d’Homere que les co-
piftes avoient déplacés : ajlerifcus cum obelo ; hâcproprié
Arijlarchus utebatur in iis verjîbus qui non fuo loco
pojiti erant. Ifid. ibid.
Quelquefois on fe fert de Yafterique pour faire remarquer
un mot ou une penfée: mais il eft plus ordinaire
que pour cet ufage on employé cette marque
N B y qui lignifie nota bene > remarquez bien.
f a m m
* Uajlérique eft un corps de lettre qui entre dans
l’aflortiment général d’une fonte. Son oeil a la figure
qu’on a dit ci-deffus.
ASTÉRISME, ajlerifmus, f. m. lignifie en Agronomie
la même chofe que conjlellation. Voye^ C ons t e l -
l a t io n . Ce mot vient du grec «V»j> ,ftclla , étoile.
Voye^ E t o i l e . (O )
ASTÉRISQUE, ajlerifcus, genre de plante à fleuf
radiée, dont le difque eft compofé de plufieurs fleurons
, & dont la couronne eft formée par des demi-
fleurons qui font pofés fur des embryons, 6c qui font
foûtenus par un calice étoilé qui s’élève au-deffus de
la fleur. Les embryons deviennent dans la fuite des
femences plates 6c bordées pour l’ordinaire. Tour-
nefort, Injl. rei hcrb. Voye[ PLAN T E . (/)
ASTEROÏDES , genre de plante à fleur radiée ,
c’eft-à-dire dont le difque eft compofé de plufieurs
fleurons, 6c la couronne de demi-fleurons qui tiennent
à des embrions, & qui font placés fur un calice
écailleux. Les embryons deviennent dans la fuite des
femences ordinairement oblongues. Tournefort,
Corol. injl. rei htrb. Voyc{ P LANTE. (/)
* ASTECAN ou ASCHIK.AN, ville d’Afie dans
la contrée de Mawralnaher, & la province de Al-
Sogde.
*ASTETLAN, province du nouveau royaume de
Mexique, dans l’Amérique feptentrionale, proche
de la province de Cinaloa, vers cette mer rouge que
les Efpagnols ont nommée mar Vermejo.
*ASTEZAN ou COMTÉ D ’AST, pays d’Italie an
Piémont, qui le borne au couchant ; il eft du refte
enclavé dans le Montferrat.
ASTHME , f. m. {Med.') difficulté de refpirer, maladie
de poitrine, accompagnée d’une efpece de fiffie-
ment. On lui a aufli donné les noms de dyfpnée 6c
d'orthopnée, mots tirés du grec, & que l’on doit rendre
en françois par ceux de refpiration difficile , ou
refpiration debout ; fituation favorable au malade ,
lorfqu’il eft dans un accès d'afthme.
Les caùfes générales de V ajlhme, font toutes les
maladies qui ont affeôé ou affeâent quelques parties
contenues dans la poitrine, & ont. occafionné
quelque délabrement dans les organes de la refpiration
; tels font l’éréfipele du poumon, ou l’inflammation
de cette partie ou de quelqu’autre, dont la
fonction eft néceffaire à la refpiration, fur-tout lorf-
que cette inflammation a dégénéré en fuppuration,
& qu’il fe rencontre quelque adhérence à la pleure
ou au diaphragme. On peut encore mettre au nombre
de ces caules le v ice de conformation de la poitrine,
trille, tant dans les parties intérieure? que dans lé?
extérieures.
i°.Les caufes prochaines ou particulières de l'afth-
me, font la trop grande abondance de fang provenant
des caufes de la pléthore univerfelle, comme la fup-
preflion des pertes de fang ordinaires, le changement
îubit d’un air chaud en un froid, l’ufage immodéré
d’alimens fucculens ; 6c alors cette efpece d'ajlhme
s’appellefe c9 6c félon "Willis convuljif z°. La fura-
bondance d’humeurs féreufes, qui refluant du côté
des poumons, abreuvent le tiffu de leurs fibres, &
le rendent trop lâche 6c peu propre à recevoir 6c
chaffer l’air qui y eft apporté, & par le moyen duquel
s’exécute la refpiration : c’eft particulièrement
a cette efpece d'ajlhme que font fujets les vieillards ;
on l’appelle ajlhme humide ou humoral.
Il fuffit pour expliquer le retour périodique de
cette maladie, de faire attention à ce que je viens
de dire fur fa caufe; dès qu’il fe rencontrera quelque
révolution qui la déterminera, elle occafionnera
un accès d'ajlhme ; les changemens de tems, de fai-
fon , le moindre excès dans l’ufage des chofes nom-
naturelles , font autant de caufes déterminantes d’un
accès d'afthme.
Cette maladie eft ordinairement de longue durée,
& aufli dangereufe qu’elle eft fâcheufe ; en effet, un
malade fujet à Y ajlhme y croit à chaque accès dont il eft attaqué, que ce fera Je dernier de fa vie ; rien h’é-
tant plus néceffaire pour la confervation que la refpiration,
la crainte qu’il.’a de ne pouvoir plus refpirer
eft certainement bien légitime.
• La fuite ordinaire de Vajlhme, fur-tout de celui que
nous avons nommé humide , eft l’hydropifie de poitrine
; il eft donc queftion de faire tous fes efforts pour
prévenir cette funefte fin dans ceux qui en font menacés
: pour cet effet, on ufera de reniedes qui pourront
diminuer la trop grande quantité de ferofités,
& en même tems donner du reffort aux fibres des
poumons, & les méttre en état de réfifter à cette
affluence de liqueurs nuifibles. La faignée eft un re-
mede très-indiqué dans l'ajlhmefec ou convuljif, qui
eft ordinairement accompagné d’ardeur & de fièvre
; les délayans, la diete, & tout ce qui peut diminuer
la quantité & l’effervefcence du fang, font aufli
d’un très-grand fecours. {N)
ASTHMÉ, adj. terme de Fauconnerie, fe dit d’uri
oifeau qui a le poumon enflé 6c qui refpire difficilement
; on dit : ce tiercelet eft afthméy il faut s’en défaire.
* ASTI, v ille d’ ftalie, dans le Montferrat, fur le
iTanaro. Long. zS. 5 o. lat. 4 4 .60:. .
A S T I C , f. m. eft un os de jambe de mulet ou de
cheval, qui fert à liffer les femelles ; on met de la
graiffe dans le trou du milieu pour graiflèr les alênes.
Vye^ la figure () , Planche du Cordonnier-Bottier.
Vajlic de bois eft à-peu-près femblable à celui d’os.
Ÿoye^ la figure 8.
* ASTINGES, f. m. plur. {Hifii anc.) peuples inconnus
qui vinrent dans la Dace offrir du fecours
aux Romains, à condition qu’on leur accorderoit des
terres ; ils furent alors refulés : mais Marc-Aurele accepta
leurs offres l’an 17d.de J» C. & ils fe battirent
contre les ennemis de l’empire.
* ASTOMES, f. m. pl. peuples fabuleux qui n’a-
voient point de bouches ; Pline les place dans l’Inde ;
d’autres les tranfportent bien avant dans l’Afrique :
ce nom vient de IV p rivatif, & de ç-Ô/m ; bouche. On
prétend que cette fable a été occafionnée par l’a ver-
non que certains Africains qui habitent fur ies bords
du Senéga, branche du Niger, ont de montrer leur
vifage.
_ * ASTORGA, ville d’Ëfpagne, au royaume de
Leon, fur la riviere àaTuerta. Long, iz.lat. 42.. 10. * ASTR AC AN, ville de la Mofcoyie Afiatiaue,
Tome /,
dans la Tartarie, capitale du royaume de même nomi
Comme il n’y pleut point, on n’y feme aucun grain ;
le.Volga s’y aeborde : depuis AJlracan jüfqu’à T e rx i,
il y a de longue bruyères le long de la mer Cafpienne;
qui donnent du fel en grande quantité ; elle eft fituée
dans une île que forme le Volga. Long. Cf. lat. 46*
z z .
ASTRAGALE, àç-pàyaXoç, en Anatomie, eft un
os du ta r fe , qui a uhè éniinencé c o n v e x e , articulée
par ginglyme av e c le tibia. L'aftragale eft le plus fu-
périeur de tous les os du tarfe. Poye[ T a r se . ’
Quelques-uns appliquent le nom d'aftragale aux
vertebres du cou* Hômere, dans fon Odyffée, employé
ce terme dans ce fens. Voye{ V e r t e b r e . On
peut diftinguer dans Y aftragale cinq faces, qui font
prefque toutes articulaires 6c revêtues d’un carti*
!age.
La face fupérieure eft convexe, 6c uti peu concav
e dans fa longueur, 6c eft articulée avec le tibia ;
l’inférieure eft concave, comme divifée en deux facettes
articulaires, féparées par une gouttière, &
s’articule avec le calcanéum; l’antérieure eft arrondie
& articulée avec le feaphoïde ou naviculairei
Des deux latérales qui font les moins confidérables;
la latérale externe qui eft la plus grande ; eft articulée
^vec la malléole externe, & la latérale interne
avec la malléole interne. Voye^ Ma l l é o l e , &c.
A s t r a g a l e , f. m. eft un membre d’Architecture,
compofé de deux moulures ; l’une ronde, faite d’un
demi-cercle, l’autre d’un filet. Prefque tous les auteurs,
les Architeéles, & les ouvriers, donnent ce
nom à la moulure demi-ronde ; 6c par-tout ailleurs
ils fe fervent du mot baguette. Mais le nom d’aftragale
doit s’entendre de ces deux moulures prifes enfem-
ble & non féparément : tous les fûts fupérieurs des
colonnes font terminées par un aftragale qui leur appartient,
& non au chapiteau, à l’exception de l’ordre
tofean 6c dorique ; quelquefois à l’ordre ionique ,
la baguette appartient au chapiteau , dans la crainte
que cette moulure appartenant à la colonne, ne rendît
fon chapiteau trop bas 6c trop écrafé. Il faut remarquer
que cette derniere obfervation n’a lieu que
dans le cas où les fûts d’une colonne font d’une matière
; 6c les chapiteaux de l’autre ; fa voir les premiers
de marbre, les derniers de bronze, ou bien les
fûts de marbre noir, & les chapiteaux de marbre
blanc. Car lorfque ces deux parties de l’ordre font
de pierre , alors l’identité de la matière empêche
cette remarqué : mais il n’en eft pas moins vrai qu’il
faut obferver par rapport à la conftruélion que IV/-
tragale, ou au moins le filet de ce membre d ’archi-
teâure, appartient au fut de la colonne ou pilaftre;
en voici.la raifon.
L ’ufage veut que l’on unifie le fût des colonnes à
Yaftragale par un congé. Or ce congé n’eft autre chofe
qu’un quart de cercle concave, qui ne peut terminer
feul le fût fupérieur ou inférieur d’une colonne ; il
faut qu’il foit accompagné d’un membre quarré, qui
par fes angles droits affûre la folidité, le tranfport,
& la pofe du chapiteau 6c de la colonne ; ce qui ne
fe pourroit, de quelque matière que l’on voulut faire
choix, fans que ce congé fût fujet à fe caffer ou s’engrener.
{P)
Ce petit membre d’architetture fe voit aufli fur le s
pièces d’artillerie ; il leur fert d’ornement comme il
feroit à une colonne. Il y en a ordinairement trois fur
une piecë, fa voir Y aftragale de lumière, celui de ceth-
turey 6c celui de volée. Voyeç C an o n . (Q ) . . _
A s t r a g a l e , f. m» aftrdgalus, {Hifti nat.bot.)genrd
de plante à fleurs papilionacées ; il fort du calice uti
piftil enveloppé d’une graine ; ce piftil devient dan9
la fuite une gouffe divifee en deux loges remplies de
femences qui ont la figure d’un rein : ajoutez aux*
caraéleres de ce genre, que les feuilles naiffent par
F F f f f