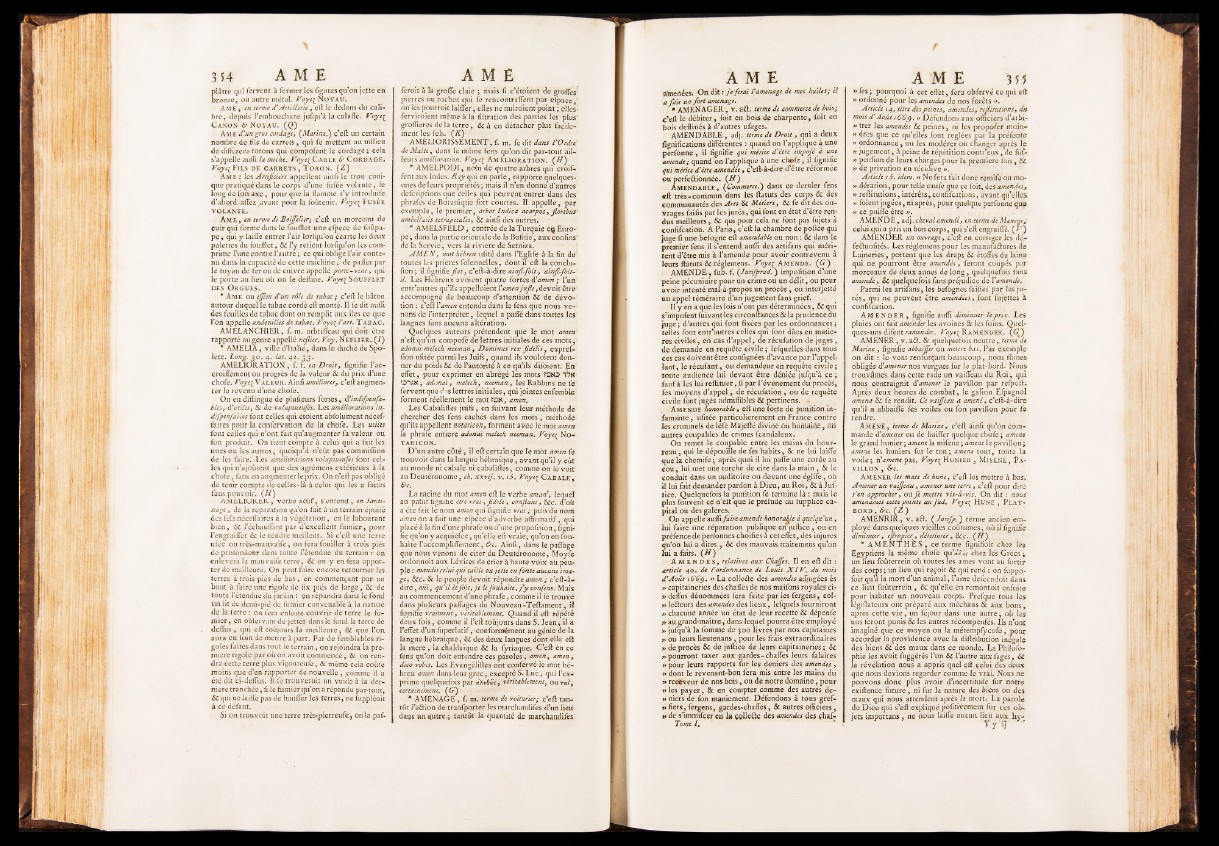
plâtre qui fervent à fermer les figures qu’on jette en
bronze, ou autre métal. Foye[ Noyau.
Ame, en terme d’Artillerie, eft le dedans du calibre
, depuis l’embouchure jufqu’à la culaffe. Foye{
C anon & Noyau. (Q)
Ame d’un gros cordage, (Marine,j c’eft un certain
nombre de fils de carrets, qui fe mettent au milieu
de différens torons qui compofent le cordage ; cela
s’appelle aufli la mechc. Voye^ C able & C ordage.
Voyei Fils de carrets, T oron. (Z)
Ame : les Artificiers appellent ainfi le trou conique
pratiqué dans le corps d’une fufée volante, le
long de fon axe, pour que la flamme s’y introduire
d’abord affez avant pour la foûtenir. Voye^ Fusée
VOLANTE.
Ame , en terme de BoiJfelicr; c’eft un morceau de
cuir qui forme dans le foufflet une efpece de foûpa-
p e , qui y laifle entrer l’air lorfqu’on écarte les deux
palettes du foufflet, & l’y retient lorfqu’on les comprime
l’une contre l’autre ; ce qui oblige l’air contenu
dans la capacité de cette machine, de palier par
le tuyau de fer ou de cuivre appellé porte-vent, qui
le porte au lieu où on le deftine. Foye[ Soufflet
des Orgues.
* Ame ou effieu d'un rôle de tabac; c’eft le bâton
autour duquel le tabac cordé eft monté. Il fe dit aufli
des feuilles de tabac dont on remplit aux îles ce que
l’on appelle andotùlles de tabac. Foye^l’art. T abac.
AMELANCHIER, f. m. arbriffeau qui doit être
rapporté au genre appellé tiefiier. Foy. Neflier. (/)
* AMELIA, ville d’Italie, dans le duché de Spo-
lete. Long. 30. 4. lut. 42. 33.
AMÉLIORATION, f. f. en Droit, lignifie l’ac-
croiffement ou progrès de la valeur & du prix d’une
chofe. Foye[ Valeur. Ainfi améliorer, c ’eft augmenter
le revenu d’une chofe.
On en diftingue de plufieurs fortes, déindifpenfa-
bles, d’utiles, 8c de voluptueufes. Les améliorations in-
difpenfables font celles qui étoient abfolument nécef-
faires pour la. confier vation de la chofe. Les utiles
font celles qui n’ont fait qu’augmenter fa valeur ou
fon produit. On tient compte à celui qui a fait les
unes ou les autres, quoiqu’il n’eût pas commiflion
de les faire. Les améliorations voluptueufes font celles
qui n’ajoutent que des agrémens extérieurs à la
choie, fans en augmenter le prix. On n’eft pas obligé
de tenir compte de cellès-là à celui qui les a faites
fans pouvoir. (U j
AMÉLIORER, verbe attif, s’entend , en Jardinage
, de la réparation qu’on fait à un terrain épuifé
des fels néceflaires à ia végétation, en le labourant
bien, Ôc l’échauffant par d’excellent fumier, pour
l’engraifler 8c le rendre meilleur. Si c’ eft une terre-
ufée ou très-mauvaife, on fera fouiller à trois piés
de profondeur dans toute l’étendue du terrain : on
enlevera la mauvaife terre, & on y en fera apporter
de meilleure. On peut faire encore retourner les
terres à trois piés de bas , en commençant par un
bout à faire une rigole de fix piés de large, 8c de
toute l’étendue du jardin : çn répandra dans le fond
un lit de demi-pié de fumier convenable à la nature
de la terre : on fera en fuite couvrir de terre le fumier,
en obfervant de jetter dans le fond la terre de
defliis, qui eft toujours la meilleure, & que l’on
aura eu foin de mettre à part. Par de femblables rigoles
faites dans tout le terrain, on rejoindra la première
rigole par où on avoit commencé, & on rendra
cette terré plus vigpureufe, & même cela coûte
moins que d’en rapporter de nouvelle ', comme il a
été dit ci-defîiis. Il fe troùveroit un vuide à la dernière
tranchée, fi le fumier qu’on a répa ndu par-tout,
8c qui ne laifle pas de hauffer les terres, ne fuppléoit
à ce défaut.
Si on trouvoit une terre très-pierreufe, onia pafferoit
à la grofle claie ; mais fi c’ëtoiént de greffes
pierres ou roches qui fe rencontraflerit par efpace,'
on les pourroit laifler, elles ne nuiroient point ; elles^
ferviroient même à la filtration des parties les plus'
grofîieres delà terre, & à en détacher plus facilement
les fels. (A )
AMÈLIORISSEMENT, f. m. fe dit dans VOrdre
de Malte, dans le même fens qu’on dit par-tout ailleurs
amélioration. Foye{ AMÉLIORATION. (//)
* AMELPODI, noîn de quatre arbres qui croif-
fentaux Indes. Ray qui en parle, rapporte quelques-
unes de leurs propriétés; mais il n’en donne d’autres
defcriptions que celles qui peuvent entrer dans des
phrafes de Botanique fort courtes. Il appelle, par
exemple, le premier, arbor Indica acarpos, fioribus'
umbtîlaùs tetrapetalis, 8c ainfi des autres.
* AMELSFÈLD, contrée de la Turquie eg Euro-'
pe, dans la partie orientale de la Bofnie, aux confins'
de la Servie, vers la riviere de Setniza.
AM EN , mot hébreu ufité dans l’Eglife à la fin de
toutes les prières folennelles, dont il eft la conclu-
fion; il fignifie fiat, c’eft-à-dire ainfi f oit, ainfi-foit-
il. Les Hébreux a voient quatre fortes à! amen; l’un'
entr’autres qu’ils appelloient l’amen jufie, devoit être
accompagné de beaucoup d’attention & de dévo-'
tion : c’eft l’amen entendu dans le fens que nous venons
de l’interpréter, lequel a paffé dans toutes les
langues fans aucune altération.
Quelques auteurs prétendent que le mot amen
n’eft qu’un compofé de lettres initiales de ces mots ,
adonaï melech neeman , Dominas rex fidelis , expref-
fion ufitée parmi les Juifs, quand ils vouloient donner
du poids 8c de l’autorite à ce qu’ils difoient. En
effet, pour exprimer en abrégé les mots TQRD iS x
\D*1AN, adonaï, melech, neeman, les Rabbins ne fe
fervent que d :s lettres initiales, qui jointes enfemble
forment réellement le mot HÛN, amen.
Les Cabaliftes juifs, en fuivant leur méthode de
chercher des fens cachés dans les mots, méthode;
qu’ils appellent notaricon, forment avec le mot amen
la phrafe entière adonaï melech neeman. Foyeç No-'
TARICON.
D ’un autre côté, il eft certain que le mot amen fe
trouvoit dans la langue hébraïque, avant qu’il y eût
au monde ni cabale ni cabaliftes, comme on le voit
au Deutéronome, ch. xxvij. v. iS. Foye^ Cabale,
&c.
La racine du mot amen eft le verbe amarf, lequel
au pafiif fignifie être vrai, fidele, confiant, Scc. d’où
a été fait le nom amen qui fignifie vrai; puis du nom
amen on a fait une efpece d’adverbe affirmatif, qui
placé à la fin d’une phrafe ou d’une propofition-, fignifie
qu’on y acquiefce, qu’elle eft vraie, qu’on en fou-
haite l ’accompliffement, &c. Ainfi, dans le pafîage
que nous venons de citer du Deutéronome, Moyfe
ordonnoit aux Lévites de crier à haute voix au peuple
: maudit celui qui taille ou jette en fonte aucune image,
Scc. & le peuple devoit répondre amen ; c’eft-à-
dire , oui, qu’i l lefoit,je lefouhaite, j ’y confens. Mais
au commencement d’une phrafe, comme il fe trouve
dans plufieurs paflages du Nouveau -Teftament, il
fignifie vraiment, véritablement. Quand il eft répété
deux fois, comme il l’eft toûjours dans S. Jean, il a
l’effet d’un fuperlatif, conformément au génie de la
langue hébraïque, 8c des deux langues dont elle eft
la mere , la chaldaïque 8c la fyriaque. C ’eft en ce
fens qu’on doit entendre ces paroles, amen, amen,
dico vobis. Les Evangéliftes ont confervé le mot hébreu
amen dans leur grec, excepté S. Luc, qui l’exprime
quelquefois par àxnQus, véritablement, ou rai,
certainement. (G j
* AMENAGE , f. m. terme de voiturier; c’eft tantôt
l’attion de tranfporter les marchandifes d’un lieu
dans un autre ; tantôt la quantité de marchandifes
Qtaeriées. On dit : je 1 ferai l ’amenage de mes huiles; il
a fait an fort amenage.
* AMENAGER, v . att. terme de commerce de bois;
c ’eft le débiter, foit en bois de charpente, foit en
bois deftinés à d’autres ufages.
AMENDABLE, adj. terme de Droit, qui a deux
lignifications différentes : quand on l’applique à une
perfonne, il fignifie qui mérite d’être impofé à une
amende; quand on l’applique à une chcfe, il fignifie
qui mérite d’être amendée , c’eft-à-dire d’etre reformée
ou perfectionnée. (H j ,
Amendable, {Commerce.) dans ce dernier fens
«ft très-commun dans les ftatuts des corps 8c des
communautés des Arts 8c Métiers, 8c fe dit des ouvrages
faifis par les jurés, qui font en état d’être rendus
meilleurs, 8c qui pour cela ne font pas fujets à
confifeation. A Paris, c’eft la chambre de police qui
juge fi une befogne eft amendable ou non : 8c dans le
premier fens il s’entend aufli des artifans qui méritent
d’être mis à l’amende pour avoir contrevenu à
leurs ftatuts 8c réglemens. Foye^ Amende. (G )
AMENDE, fub. f. (Jurifprud. ) impofition d’une
peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour
avoir intenté mal-à-propos un procès , ou interjetté
un appel téméraire d’un jugement fans grief.
Il y en a que les lois n’ont pas déterminées, 8c qui
s’impofent fuivant les circonftances & la prudence du
juge ; d’autres qui font fixées par les ordonnances ;
telles font entr’autres celles qui font dûes en matières
civiles, en cas d’appel, de réeufation de juges,
de demande en requête civile ; lefquelles dans tous
ces cas doivent être confignées d’avance par l’appel-
lant, le reculant, ou demandeur en requête civile;
toute audience lui devant être déniée jufqu’à ce ;
fauf à les lui reftituer, fi par l ’évenement du procès,
fes moyens d’appel, de réeufation, ou de requête
civile lont jugés admiflibles 8c pertinens. ;
Amende honorable , eft une fortte de punition infamante
, ufitée particulièrement en France contre
les criminels de lefe Majefté divine ou humaine, ou
autres coupables de crimes fcandaleux.
On remet le coupable entre les mains du bourreau
, qui le dépouille de fes habits, & ne lui laifle
que la chemife ; après quoi il lui paffe une corde au
cou, lui met une torche de cire dans la main, & le
conduit dans un auditoire ou devant une églife, où
il lui fait demander pardon à D ieu, au R oi, & à Juf-
tice. Quelquefois la punition fe termine là : mais le
plus fouvent ce n’eft que le prélude du fupplice capital
ou des galères.
On appelle aufli faire amende honorable à quelqu’un,
lui faire une réparation publique enjuftice, ou en
préfence de perfonnes choifies à cet effet, des injures
qu’on lui a dites , 8c des mauvais traitemens qu’on
lui a faits. (H )
A m e n d e s , relatives aux Chaffes. II en eft dit :
article 40. de j ’ordonnance de Louis X I F . du mois
d'Août i6~Ccf. « La collette des amendes adjugées ès
» capitaineries des chaffes de nos maifons royales ci-
» defliis dénommées fera faite par les fergens, col-
» leâeurs fes amendes des lieux, lefquels fourniront
» chacune année un état de leur recette & dépenlè
» au grand-maître, dans lequel pourra être employé
» jufqu’à la fommp de 300 livres par nos capitaines
» ou leurs lieutenans, pour les frais extraordinaires
» de procès & de juftice de leurs capitaineries ; 8c
»pourront taxer aux gardes-chaffes leurs falaires
» pour leurs rapports fur les deniers des amendes ,
» dont le revenant-bon fera mis entre les mains du
» receveur de nos bois, ou de notre domaine, pour
» les payer, & en compter comme des autres de-
» niers de fon maniement. Défendons à tous gref-
»> fiers, fergens, gardes-chaffes, & autres officiers,
» de s’immifeer en la collette des amendes des çhaf-
Tome /,
»fes; pourquoi à cet effet, fera obfervé ce qui eft
» ordonné pour les amtndes de nos forêts ».
Article 14. titre des peines, amendes, refiitutions, du
mois d’Août i66$, « Défendons aux officiers d’arbi-
» trer les amendes 8c peines, ni les propofer moin-
» dres que ce qu’elles font réglées par la préfente
» ordonnance, ou les modérer ou changer après le
» jugement, à peine de répétition contr’eux, de fuf*
» penfion de leurs charges pour la première fois, 8c
» de privation en récidive ». ‘‘
Article iô. idem. « Ne fera fait donc remife ou rtio-
» deration, pour telle caufe que ce foit, des amendes,
» reftitutions, intérêts, confifcations, avant qu’elles
» foient jugées, ni après, pour quelque perfonne que
»,ce puifle être ».
AMENDÉ, adj. .chevalamendé, en terme de Manegej
celui qui a pris un bon corps, qui s’eft engraiffé. { F j
AMENDER un ouvrage, c’eft en corriger, les dé,-
fettuofités. Les réglemens pour les manufattures de
Laineries, portent que les draps 8c étoffes de, laine
qui ne pourront être amendés, feront coupés par
morceaux de deux aunes de long, quelquefois fans
amende, 8c quelquefois fans préjudice de l’amende.
Parmi les artifans, les befognes faifies par les jurés
, qui ne peuvent être amendées, /ont fujettes à
confifeation.
A m e n d e r , fignifie aufli diminuer le prix. Les
pluies ont fait amender les avoines & les foins. Quelques
uns difent ramender. Foye^ R AMENDER. ( G j
AMENER , v . att. 8t quelquefois neutre, terme de
Marine , fignifie abbaijfer ou mettre bas. Par exemple
on dit : lè vent renforçant beaucoup, nous fûmes
obligés Ramener nos vergues fur le plat-bord. Nous
trouvâmes dans cette rade un vaifleau du R oi, qui
nous contraignit Ramener le pavillon par refpett;
Après deux heures de combat, le galion Efpagnol
amena 8c fe rendit. Ce vaijfeau a amené, c’eft-à-dire
qu’il a abbaiffé fes voiles ou fon pavillon pour fe
rendre.
Amène, terme de Marine, c’eft ainfi qu’on commande
d’amener ou de baiffer quelque chofe ; amène
le grand hunier ; amene la mifene ; amtne le pavillon ;
amene les huniers fur le ton; amene tout, toüte la
voile ; n’amene pas. Foyeç Hunier , MisenÊ , Pavillon
, &c.
Amener les mats de hune, c’eft les mettre à bas."
Amener un vaiffeau, amener une terre, c’eft pour dire
s'en approcher, ou fe mettre vis-à-vis. On dit : nous
amenâmes cette pointe au fud. Foye£ Hunè , Plat-
B O R D , &C. ( Z )
AMÉNRIR, v . att. ( Jurifp. ) terme ancien employé
dans quelques vieilles cpûtumes, où il fignifie
diminuer, efiropier , détériorer, 8cc. (H j
* A M E N T H È S , ce terme fignifioit chez les
Egyptiens la même chofe qu’et<T«ç chez lés Grecs
un lieu foûterrein où toutes les âmes vont au fortir
des corps ; un lieu qui reçoit 8c qui rend : on fuppô-
foit qu’à la mort d’un animal, l’ame defeendoit dans
ce lieu foûterrein , 8c qu’elle en remontoit enfuite
pour habiter un nouveau corps. Prefque tous les
légiflateurs ont préparé aux méchans 8c aux bons^
après cette v i e , un féjour dans une autre, où les
uns feront punis 8c les autres récompenfés. Ils n’ont
imaginé que ce moyen ou la métempfÿcofe, pour
accorder la providence avec la diftribution inégale
des biens 8c des maux dans ce monde. La Philofo-
phie les avoit fuggérés l’un 8c l’autre aux fages, 8c
la révélation nous a appris quel eft celui des deux
que nous devions regarder comme le vrai. Nous ne
pouvons donc plus avoir d’incertitude fur notre
exiftence future , ni fur la nature des biens ou des
maux qui nous attendent après la mort. La parole
de Dieu qui s’eft expliqué pofitivement fur ces objets
importans, ne nous laifle aucun lieu aux hy