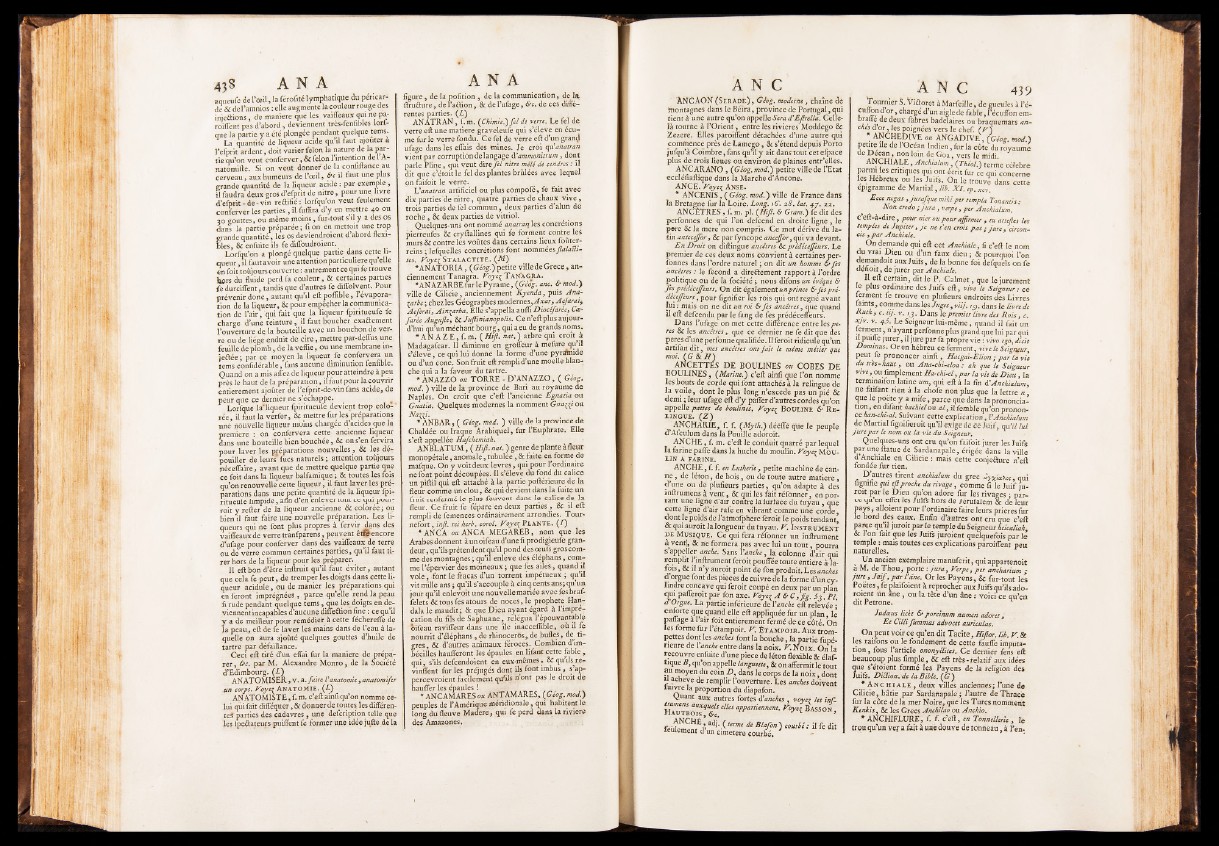
aqueufe de l’oeil, la férofité lymphatique du péricarde
& del’amnios : elle augmente la couleur rouge des
injettions, de maniéré que les vaiffeaux qui ne pa-
roiffent pas d’abord , deviennent très-fenfibles lori-
que la partie, y a été plongée pendant quelque tems.
La quantité de liqueur acide qu’il faut ajouter à
l’efprit ardent, doit varier félon la nature de la partie
qu’-on veut conferver ,& félon l’intention del A -
natomifte. Si on veut donner de la confiftance au
cerveau, aux humeurs de l’oeil, il faut une plus
grande quantité de la liqueur acidé : par exemple ,
il faudra deux gros d’efprit de nitre, pour une. livre
d’efprit-de-vin reftifié: lorfqu’ôn veut feulement
conferver les parties, i l fuffira d’y en mettre 40 ou
ao gouttes, ou même moins, fur-tout s il y a des os
daïis la partie préparée ; 11 on en mettoit une trop
grande quantité, les os deviendraient d’abord flexibles
, & enfuite ils fe diflbudroient.
Lorfqu’pn a plongé quelque partie dans cett.e liqueur
,i l faut avoir uneattention particulière qu’elle
en foit toujours couverte s autrement ce qui fe trouve
hors du fluide perd fa couleur, & certaines parties
fe durciffent, tandis que d’autres fe diffplvent, Pour
prévenir donc, autant qu’il cil polîlble, 1 évaporation
de la liqueur, & pour empeçher la communication
de l’air, qui fait que la liqueur fpiritueufe fe
charge d’une teinture, il faut boucher exafiement
l’ouverture dq la bouteille avec un bouchon de verre
ou de liège enduit de cire, mettre par-defliis une
feuille de plomb, de laveflie, ou une membrane injectée
y par ce moyen la liqueur fe confervera un
tems confidérable, fans aucune diminution fenfible.
Quand on a mis allez de liqueur pour atteindre à peu
près le haut delà préparation, ilfaut pour la couvrir
entièrement ajouter de l’efprit:de-vin fans acide, de
peur que ce dernier ne s’échappe. .
Lorfque la*liqueur fpiritueufe devient trop colo- ’
rée, il faut la verfer, & mettre fur les préparations
une nouvelle liqueur moins chargée d’acides que la '
première : on confervera cette ancienne liqueur
dans une bouteille bien bouchée, & on s’en fervira
pour laveries préparations nouvelles, & les dépouiller
de leurTfuCS naturels ; attention toujours
néceffaire, avant que de mettre quelque partie que
ce foit dans la liqueur balfamique ; & toutes les fois
qu’on renouvelle cette liqueur, il faut laveries préparations
dans une petite quantité de la liqueur fpiritueufe
limpide, afin d’en enlever tout ce qui pourrait
y relier de la liqueur ancienne & colorée; qq
bienll faut faire une nouvelle, préparation. Les liqueurs
qui ne font plus propres à fervir dans des
vaiffeaux de verre tranfparens, peuvent êt® encore
d’ufage pour conferver dans des vaiffeaux de terre
ou de verre commun certaines parties, qu’il faut tirer
hors de ia liqueur pour les préparer.
Il eft bon d’être mftruit qu’il faut éviter , autant
que cela fe petit, de tremper les doigts dans cette liqueur
acidulé, ou de manier les préparations qui
en feront imprégnées ,. parce qu’elle rend la peau
f i rude pendant quelque tems, que les. doigts en deviennent
incapables d’aucune dineÉtion fine : ce qu’il
y a de meilleur pour remédier à cette fechereffe de
la peau, eft de fe laver les mains dans de l’eau à laquelle
on aura ajoûté quelques goutte,s d’huile de
tartre par défaillance.
Geci eft tiré d’un effai fur la maniéré de préparer
, &c. par M. Alexandre Monro, de ia Société
d’Edimbourg. (X)
ANATOMISER , V. faire l'anatomie , anatomifer
un corps. Voyc{ Anatomie. (X) .
ANATOMISTE, f. m. c’eû ainfi qu’on nomme celui
qui fait difféquer, & donner de toutes les différentes
parties des cadavres , une defeription telle que
les fpeflateurs puiffent fe former une idée jufte delà
figure, de la pofition, de la communication, de la
ftru&ure, de l’aûion, & de l’ufage, &c. de ces différentes
parties. (X)
ANATRAN, f. m. (Chimie.') fe l dé verre. Le fel de
verre eft une matière graveleufe qui s’élève en écume
fur le verre fondu. Ce fel de verre eft d’un grand
ufage dans les effais des mines. Je croi qu'anatran
vient par corruption de langage d'ammonitrurn, dont
parle Pline, qui veut dire 7el nitre mêlé de cendres : il
dit que c’étoit le fel des plantes bridées avec lequel
on faifoit le verre» > \
Uanatran artificiel ou plus cômpofe, fè fait avec
dix parties de nitre, quatre parties de chaux v iv e ,
trois parties de fel commun, deux parties d’alun dé
roche, & deux parties de vitriol.
Quelques-uns ont nommé anatran les concrétions
pierreufes & cryftallines qui fe forment contre leà
murs & contre les voûtes dans certains lieux fouter-
reins ; lefquelles concrétions font nommées flalacli-
tes. Voye[ STALACTITE. (Af)
*ANATORIA, (Géog.) petite ville de Grece, anciennement
Tanagra. Foyei T an*â GRA.
*ANAZÀRBEfurle Yyrame, (Géog. anc. &mod.)
ville de Cilic ie, anciennement Kyenda, puis Ana-
[arbe ; chez les Géographes modernes, Axar, Acfarai,
Acferai, Ain^arba. Elle s’appella auffi Diocéfarèe, Coe-
farée Auguftt, & Jußinianopolis. Ce n’eft plus aujourd’hui
qu’un méchant bourg, qui a eu de grands noms*
* A N A Z E , f. m. ( Hift. ndt. ) arbre qui croît à
Madagafcar. Il diminue en grofféur à mefure qu’il
s’élève, ce qui lui donne la forme d’une pyrdïnide
ou d’un cône. Son fruit eft rempli d’une moelle blanche
qui a la faveur du tartre.
* ANAZZO ou TORRE - D’AN AZZO, ( Géog,
mod. ) ville de la- province de Rari au royaume de
Naples. On croit que c’èft l’ancienne Egnatia o\\
Gnatia. Quelques modernes la nomment G n a ^ ou
Naqyi. • ••
* ANBAR, ( Géog. mod. ) ville de la province de
Chaldée oulraque Arabiquel, fur l’Euphrate» Elle
s’eft appellée Hafchemiah.
ANBLATUM, (Hiß. nat. ) genre de plante à fleur
monopétale, anomale, tubulee, & faite en forme de
mafque. On y voit deux levres, qui pour l’ordinaire
ne font point découpées. 11 s’élève du fond du calice
un piftil qui eft attaché à la partie poftérieure de la
fleur comme un clou, & qui devient dans la fuite un
fruit renfermé le plus fouvent dans le Calice de la
fleur. Ce fruit fe fépdre en deux parties , & il eft
rempli de femences ordinairement arrondies. Tour-
nefort, infi. rei herb, corol. Voye[ Pl a n t e . (/)
* ANCA ou ANCA MEGAREB, nom que les
Arabes donnent àunoifeaud’unefi prodigieufe grandeur
, qu’ils prétendent qu’il pond des oeufs gros comme
des montagnes ; qu’il enleve des éléphans, comme
l’épervier des moineaux ; que fes ailes, quand il
vo le , font le fracas d’un torrent impétueux ; qu’il
vit mille ans ; qu’il s’accouple à cinq cents ans; qu’un
jour qu’il enlevoit une nouvelle mariée avec fes braf-
felets & tous fes atours de noces, le prophète Han-
dala le.maudit; & que Dieu ayant égard à l’imprécation
du fils de Saghuane, relégua l’épouvantable
Sifeau ravifleur dans une île inacceflible, où il fe
nourrit d’éléphans, de rhinocerôs, de bufles, de tigres,
& d’autres animaux féroces. Combien d’im-
bécilles haufleront les épaules en lifant cette fable ,
qui, s’ils defeendoient en eux-mêmes, & qu’ils re-
vinflent fur les préjugés dont ils font imbus, s’ap-
percevroient facilement qifils nont pas le droit de
hauffer les épaules 1 J
* ANC AM ARES ou ANTAMARES, (Geog. mod.)
peuples de l’Amérique méridionale, qui habitent le
long du fleuve Madere, qui fe perd dans la rivière
des Amazones»
ÂNCAON (Serade) , Géog. moderne, chaîne de
ïnontagnes dans le B éïra, province de Portugal, qui
tient à une autre qu’on appelle Sera d’Èfirella. Celle-
là tourne à l’Orient, entre les rivières Moddego &
ÎZezere. Elles paroiflent détachées d’une autre qui
commence près de Lamego, & s’étend depuis Porto
jufqu’à Coïmbre, fans qu’il y ait danS'tout cet efpace
plus de trois lieues ou environ de plaines entr’elles*
ANCARANO, (Géog. mod.) petite ville de l’Etat
eccléfiaftiqùe dans la Marche d’Ancône»
ANCE. Poyei A n s e .
* ANCENIS, ( Géog. mod.) ville de France dans
la Bretagne fur la Loire. Long. iG. a.8. lat. 4 /. 22.
ANCÊTRES, f. m. pl. (Hiß. & Gram.) fe dit des
perfonnes de qui l’on defeend en droite ligne, le
p»re & la mere non compris. Ce mot dérive du latin
antecejfor , & par fyncope ancejfor, qui va devant»
En Droit on diftingue ancêtres & prédèceffeurs. Le
premier de ces deux noms convient à certaines per-
l'onnes dans l’ordre naturel ; on dit un homme & fes
ancêtres : le fécond a directement rapport à l’ordre
politique ou de la fociété ; nous difons un évêque &
fes prédèceffeurs. On dit également un prince & fes pré-
deceffeurs, pour lignifier Tes rois qui ont régné avant
lui : mais on ne dit un roi & fes ancêtres, que quand
il eft defeendu parle fang de les prédéceueurs.
Dans l’ufage on met cette différence entre les pe-
res & les ancêtres , que ce dernier ne fe dit que des
peres d’unè perfonne qualifiée. Il ferait ridicule qu’un
artifan d it, mes ancêtres ont fait le même métier que
moi. (G & H )
ANCETTES DE BOULINES oa COBES DE
BOULINES, (Marine.) c’eft ainfi que l ’on nomme
les bouts de corde qui font attachés à la relingue de
la vo ile , dont le plus long n’excede pas un pié &
demi ; le u r ufage eft d’y palier d’autres cordes qu’on
appelle pattes de boulines. Koye£ Bo u l in e & R e -
riNGUE» ( Z )
? ANCHARIE, f. f, (Myth.) déefle que le peuple
d’Afculum dans la Pouille adorait.
ANCHE, f. m. c’eft le conduit quarré par lequel ;
la farine paffe dans la huche du moulin, f^oye^ M o u l
in A FARINE.
• 7 -----" —“ J “ V "V W , »7»» U», iu u iv a u u » l l i a i i c i c ,
d’une ou de plufieurs parties, qu’on adapte à des
inftrumens à vent, & qui les fait réfonner, en portant
une ligne d’air contre la furface du tuyau, que
cette ligne d’air rafe en vibrant comme une corde,
dont le poids de l’atmolphere ferait le poids tendant,
& qui aurait la longueur du tuyau. V. Instrument
de Musique. Ce qui fera réfonner un infiniment
à vent), & ne formera pas avec lui un tout, pourra
s appeller anche. Sans Y anche, la colonne d’air qui
remplit l’inftrument feroit poulTée toute entieré à-la-
fois, & il n’y aurait point de fon produit. Les anches
d orgue font des pièces de cuivre de la forme d’un cy-
lindre concave qui feroit coupé en deux par un plan
qui pafleroit par fon axe. Vùye{ A & C }fig. 5$.Pl .
d Orgue. La partie inférieure de Y anche eft relevée •
enter te que quand elle eft appliquée fur un p lan, le
pauage à l’air foit entièrement fermé de ce côté. On
les forme fur l’étampoir. V. Étam po ir . Aux trompettes
dont les anches font la bouche, la partie fupé-
rieure de Y anche entre dans la noix. V. N o ix . On la
recouvre enfuite d’une pièce de léton flexible & élaf-
tique B t qu’on appelle languette, & on affermit le tout
au moyen du coin D , dans le corps de la noix, dont
11 achevé de remplir l’ouverture. Les anches doivent
iuivre la proportion du diapafon.
Quant aux autres fortes à1 anches , voyez les inf-
eU“ aPPartltnnent’ jæ N Basson ,
leulement d un cimetere dc‘o Bulrabfém. ) H il Ce dit
’Tournier S. Viftoret à Marfeille, de gueules à l’é-
u m " f 0r ’ char?é d’un aiAle de fable, Téeuffon em-
J,dedeu* f?“ res hâdelairés Ou braquemars an-
chts d o r , les poignées vers le chef. ( P )
* ANCHED1VE ou ANGADIVE, CGéop. mod.'\
petite de de l’Océan Indien, fur la côte du royaume
de D ecan, non loin de Goa, vers le midi.
ANCHIALE , Anckialiim, (Jhéol.) terme célébré
pärmi les critiques qui ont écrit fur ce qui concerne
les Hebreux ou les Juifs. On le trouve dans cette
eptgramme de Martial, üb. X I . ep. xcv.
Eccc negas , jurafiitt mihi per tcmpla. Tortantis :
Non credo ;jura , verpe , per Anchialùm.
_ ---------- * tx* c-rui» pas ; .jure , circoncis
, par Anchiale,
On demande qui eft cet Anchiale, fi c’eft le nom
du vrai Dieu ou d’un faux dieu ; & pourquoi l’on
demandoit aux Juifs, de la bonne foi defquels on fe
defioit, de jurer par Anchiale,
Il eft certain, dit le P. Calmet, que le jurement
le plus ordinaire des Juifs eft, Vive le Seigneur: ce
ferment fe trouve en plufieurs endroits des Livres
mmts, comme dans les Juges, viij. kj . dans le livre de
liuth , c. iij. v. / j . Dans le premier livre des Rois, 0.
xjv. v. 43. Le Seigneur lui-même, quand il fait un
lermenr, n’ayant perfonne plus grand que lui par qui
îlpmffe jurer, il jure par fa propre vie : vivo egà, dicit
Dommus. Or en hébreu ce ferment, vive le Seigneur,
peu tfe prononcer ainfi, Hacgdi-Elion ; par la vit
du très-haut, ou Ana-chi-eloa : ah que le Seigneur
vive, ou Amplement Ha-chi-el, par la vie de D ieu, la
terminaifon latine um, qui eft à la fin d’Anchialùm,
ne faifant rien à la chofe non plus que la lettre n
que le poète y a mife, parce que dans la prononciation,
en difant hachielou a l, il femble qu’on prononce
han-chi-al. Suivant cette explication, Y Anchialùm
de Martial lignifierait qu’il exige de ce Juif, qu’,*/ lui
jure par le nom ou la vie du Seigneur.
Quelques-uns ont cru qu’on faifoit jurer les Juifs
par une ftatue de Sardanapale, érigée dans la v ille
d’Anchiale en Cilicie : mais cette conjecture n’eft
fondée fur rien.
D ’autres tirent anchialùm du grec dyxiaXoç, qui
lignifie qui ejlproche du rivage, comme fi le Juif jurait
par le Dieu qu’on adore fur les rivages ; parce
qu’en effet les Juifs hors de Jérufalem & de leur
pays, alloient pour l ’ordinaire faire leurs prières fur
le bord des eaux. Enfin d’autres ont cru que c’eft
parce qu’il jurait par le temple du Seigneur heicaliah,
& l’on fait que les Juifs juraient quelquefois par le
temple : mais toutes ces explications paroiflent peu
naturelles.
Un ancien exemplaire manuferit, qui appartenoit
à M. de Thou, porte : jura, Verpe, per ancharium ;
jure , Juif , par Vâne. Or les Payens, & fur-tout les
Poètes, fe plaifoient à reprocher aux Juifs qu’ils adoraient
ün âne, ou la tête d’un âne : voici ce qu’en
dit Petrone. n
Judxzus liett & porcinum numen adoret,
E t Cilli fummas advocet auriculas.
On peut voir ce qu’en dit Tacite, Hiftor. lib. V . &
les raifons ou le fondement de cette faufle imputation
, fous l’article ononyclites. Ce dernier fens eft
beaucoup plus fimple, & eft très-relatif aux idées
que s’étoient formé les Payens de la religion des
Juifs. Diclion.'de la Bible. (G )
* A n c h i a l e , deux villes anciennes; l’unë de
Cilicie, bâtie par Sardanapale; l’autre deThracè
fur la côte de la mer Noire, que les Turcs nomment
Kenkis, & les Grecs Anchilaoou Anchio.
* ANCHIFLURE, f. f. c’eft, en Tonnellerie , le
trou qu’un vey a fait à une douve de tonneau, à l’en