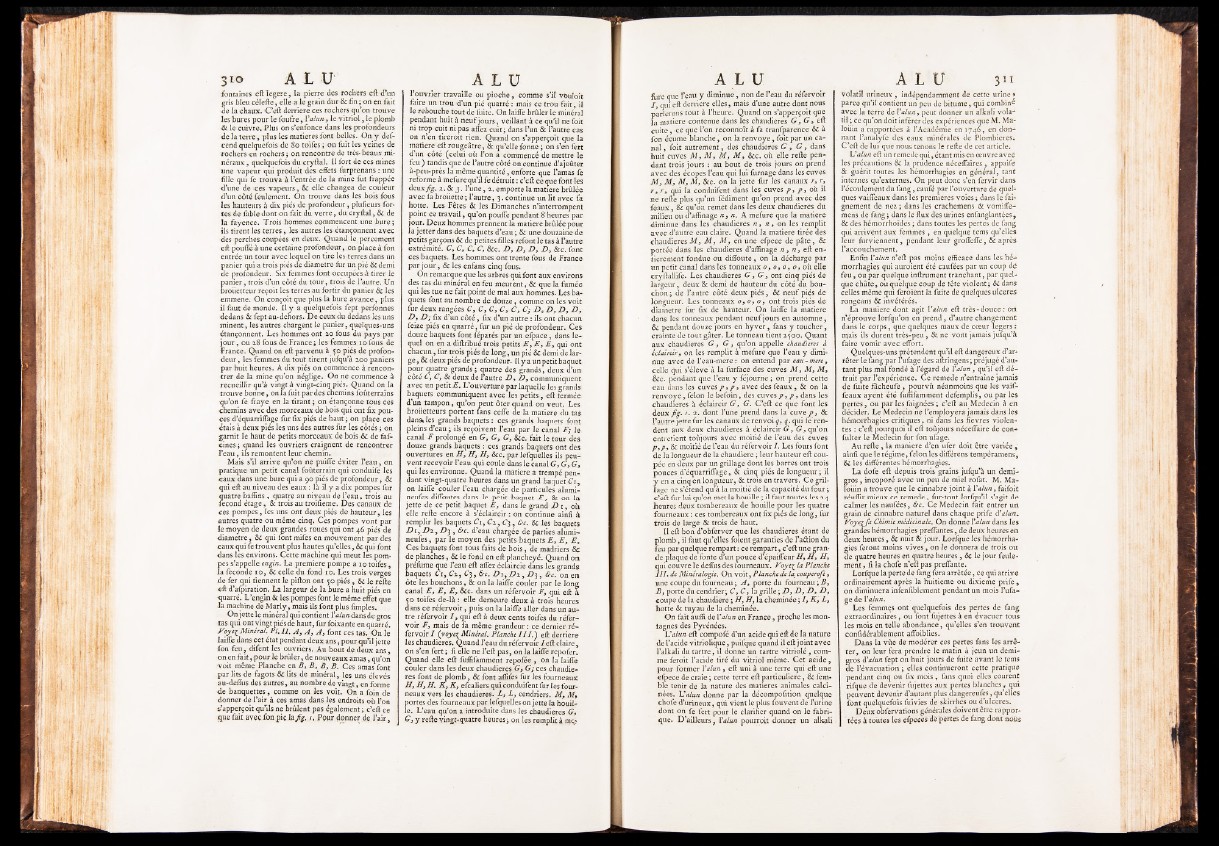
310 A L U'
fontaines eft legere, la pierre des rochers eft d’un
gris bleu célefte, elle a le grain dur & fin ; on en fait
de la chaux. C ’eft derrière ces rochers qu’on trouve
les bures pour le foufre , Yaourt , le vitriol , 1e plomb
& le cuivre. Plus on s’enfonce dans les profondeurs
de la terre, plus les matières font belles. •On y def-
cend quelquefois de 80 toifes ; on fuit les yeines de
rochers-en rochers ; on rencontre de très-beaux minéraux,
quelquefois du cryftal. Il fort de ces mines
une vapeur qui produit des effets forprenans : une
fille qui fe trouva à l’entrée de la mine fut frappée
d ’une de ces vapeurs, & elle changea de couleur
d’un coté feulement. On trouve dans les bois fous
les hauteurs à dix piés de profondeur, plufieurs fortes
de fable dont on fait du v erre, du cryftal, & de
la fayence. Trois hommes commencent une bure;
ils tirent les terres, les autres les étançonnent avec
des perches coupées en deux. Quand le percement
eft pouffé à une certaine profondeur, on place à fon
entrée un tour avec lequel on tire les terres dans un
panier qui a trois piés de diàmetre fur un pié & demi
de profondeur. Six femmes font occupées à tirer le
panier, trois d’un côté du tour, trois de l ’autre. Un
broiietteur reçoit les terres au fortir du panier & les
emmene. On conçoit que plus la bure avance, plus
il faut de monde. Il y a quelquefois fept perfonnes
dedans & fept au-denors. De ceux du dedans les uns
minent, les autres chargent le panier, quelques-uns
étançonnent. Les hommes ont 20 fous du pays par
jou r , ou 18 fous de France ; les femmes 10 fous de
France. Quand on eft parvenu à 50 piés de profondeur
, les femmes du tout tirent jufqu’à 200 paniers
par huit heures. A dix piés on commence à rencontrer
de la mine qu’on néglige. On ne commence à
recueillir qu’à vingt à vingt-cinq piés. Quand on la
trouve bonne, on la fuit par des chemins foûterrains
•qu’on fe fraye en la tirant ; on étançonne tous ces
chemins avec des morceaux de bois qui ont fix pouces
d’équarriffage fur fix piés de haut ; on place ces
étais à deux piés les uns des autres fur les côtés ; on
garnit le haut de petits morceaux de bois & de faf-
cines ; quand les ouvriers craignent de rencontrer
l’eau, ils remontent leur chemin.
Mais s’il arrive qu’on ne puiffe éviter l’eau, on
pratique un petit canal foûterrain qui conduife les
eaux dans une bure qui a 90 piés de profondeur, &
qui eft au niveau des eaux : là il y a dix pompes fur
quatre bafiins , quatre au niveau de l’eau, trois au
■ fécond étage, & trois au troifieme. Des canaux de
ces pompes, les uns ont deux piés de hauteur, les
autres quatre ou même cinq. Ces pompes vont par
le moyen de deux grandes roues qui ont 46 piés de
diamètre, & qui font mifes en mouvement par des
eaux qui fe trouvent plus hautes qu’elles, & qui font
dans les environs. Cette machine qui meut les pompes
s’appelle engin. La première pompe a 10 toifes,
la fécondé 10, & celle du fond 10. Les trois verges
de fer qui tiennent le pifton ont 50 piés , & le refte
eft d’afpiration. La largeur de la bure a huit piés en
cjuarré. L ’engin & les pompes font le même effet que
la machine de Marly, mais ils font plus fimples.
On jette le minéral qui contient Y alun dans de gros
tas qui ont vingt piés de haut, fur foixante en quarré.
Voye{ Minéral. Pl. II. A , A , A , font ces tas. On le
laiffe dans cet état pendant deux ans, pour qu’il jette
fon feu , difent les ouvriers. Au bout de deux ans
on en fait, pour le brûler, de nouveaux amas, qu’on
-voit même Planche en B , B , Bt B. Ces amas font
par lits de fagots & lits de minéral, les uns élevés
au-deffus des autres, au nombre de vingt, en forme
de banquettes, comme on les voit. On a foin de
donner de l’air à ces amas dans les endroits où l’on
s’apperçoit qu’ils ne brûlent pas également ; c’eft ce
gue fait ayec fon piç la fig, 1, Pour donner de l’air,
A L U
l’ouvrier travaille ou pioche, comme s’il vbnloit
faire un trou d’un pié quarré : mais ce trou fait, il
le rebouche tout de fuite. On laiffe brûler le minéral
pendant huit à neuf jours, veillant à ce qu’il ne foit
ni trop cuit ni pas affez cuit ; dans l’un & l’autre cas
on n’en tireroit rien. Quand on s’apperçoit que la
matière eft rougeâtre, & qu’elle fonne ; on s’en fert
d’un côté (celui où l’on a commencé de mettre le
feu ) tandis que de l’autre côté on continue d’ajoûter
à-peu-près la même quantité, enforte que l’amas fe
reforme à mefure qu’il fe détruit : c’eft ce que font les
d eu x^ . 2 .& J . l’une, 2. emporte la matière brûlée
avec fa broiiette ; l’autre, 3. continue un lit avec fa
hotte. Les Fêtes & les Dimanches n’interrompent
point ce travail, qu’on pouffe pendant 8 heures par
jour. D eux hommes prennent la matière brûlée pour
la jetter dans des baquets d’eau ; & une douzaine de
petits garçons & de petites filles refont le tas à l’autre
extrémité. C, C, C, C, & c . D , D , D , Z>, &c. font
ces baquets. Les hommes ont trente fous de France
par jour, & les enfans cinq fous.
On remarque que les arbres qui font aux environs
des tas du minéral en feu meurent, & que la fumée
qui les tue ne fait point de mal aux hommes. Les baquets
font au nombre de douze, comme on les voit
fur deux rangées C, C , C, C, C , Cy D , D , D , D ,
D» fix d’un côté, fix d’un autre : ils ont chacun
feize piés en quarré, fur un pié de profondeur. Ces
douze baquets font féparés par un efpace, dans lequel
on en a diftribue trois petits E t E , E , qui ont
chacun, fur trois piés de long, un pié & demi de large
, & deux piés de profondeur. Il y a un petit baquet
pour quatre grands ; quatre des grands, deux d’un
côté C, C, & deux de l’autre D> D t communiquent
avec un petit.#. L’ouverture par laquelle les grands
baquets communiquent avec les petits, eft fermée
d un tampon, qu’on peut ôter quand on veut. Les
broiietteurs portent fans ceffe de la matière du tas
dan* les grands baquets : ces grands baquets font
pleins d’eau; ils reçoivent l’eau par le canal F; le
canal F prolongé en G, G, G, & c . fait le tour des
douze grands baquets : ces grands baquets ont des
ouvertures en H , H, H, & c . par lefquelles ils peuvent
recevoir l’eau qui coule dans le canal G, G , G,
qui les environne. Quand la matière a trempé pendant
vingt-quatre heures dans un grand baquet C i,
on laiffe couler l’eau chargée de particules alumi-
neufes diffoutes dans le petit baquet E , & on la
jette de ce petit baquet E , dans le grand D i , où
elle refte encore à s’éclaircir : on continue ainfi à
remplir les baquets C i, C i , U3, &c. & les baquets
D 1, Dx,D-$ , &c. d’eau chargée de parties alumi-
neufes, par le moyen des petits baquets E , E , E ,
Ces baquets font tous faits de bois, de madriers &
de planches, & le fond en eft plancheyé. Quand on
préfume que l’eau eft affez éclaircie dans les grands
baquets C i, Cz , C3, &c. D i , D x , #>3, &c. on en
ôte les bouchons, & on la laiffe couler par le long
canal E , E , E , &c. dans un réfervoir F , qui eft à
50 toifes de-là : elle demeure deux à trois heures
dans ce réfervoir, puis on la laiffe aller dans un autre
réfervoir I , qui eft à deux cents toifes du réfervoir
F, mais de fa même grandeur : ce dernier réfervoir
ƒ (voyt{ Minéral. Planche I I I . ) eft derrière
les chaudières. Quand l’eau du réfervoir /eft claire,
on s’en fert ; fi elle ne l’eft pas, on la laiffe repofer.
Quand elle eft fuffifamment repofée , on la laiffe
couler dans les deux chaudières G, G; ces chaudières
font de plomb, & font aflifes fur les fourneaux
H, H , H. K } K , efcaliers qui conduifentfur les fourneaux
vers les chaudières. Ly L , cendriers. M, Mt
portes des fourneaux par lefquelles pn jette la houille.
L ’eau qu’on a introduite dans les chaudières G,
G, y refte vingt-quatre heures ; on les remplit à me«
A L U
fiire que l’eau y diminue, non de l’eau du réfervoir
I , qui eft derrière elles, mais d’une autre dont nous
parlerons tout à l’heure. Quand on s’apperçoit que
la matière contenue dans les chaudières G , G , eft
cuite, ce que l’on reconnoît à fa tranfparence & à
fon écume blanche, on la renvoyé, foit par un can
a l, foit autrement , des chaudières G , G , dans
huit cuves M , M , M , M , &c. où elle refte pendant
trois jours : au bout de trois jours on prend
avec des écopes l’eau qui lui fumage dans les cuves
M y M , M, M, &c. on la jette fur les canaux r, r,
r , r , qui la conduifent dans les cuves /», p , où il
ne refte plus qu’ un fédiment qu’on prend avec des
féaux, & qu’on remet dans les deux chaudières du
milieu ou d’affinage72, n. A mefure que la matière
diminue dans les chaudières n , n , on les remplit
avec d’autre eau claire. Quand la matière tirée des
chaudières M , M f M , en une efpece de pâte, &
portée dans les chaudières d’affinage n , n , eft entièrement
fondue ou diffoute, on la décharge par
un petit canal dans les tonneaux 0 ,0 , 0 ,0 , où elle
cryftallife. Les chaudières G , G , ont cinq piés de
largeur, deux & demi de hauteur du côté du bouchon
; de l’autre côté deux piés, & neuf piés de
longueur. Les tonneaux o, a , o , ont trois piés de
diamètre fur fix de hauteur. On laiffe la matière
dans les tonneaux pendant neuf jours en automne,
& pendant douze jours en hy v er , fans y toucher,
crainte de tout gâter. Le tonneau tient 2500. Quant
aux chaudières G , G , qu’on appelle chaudières à
éclaircir, on les remplit à mefure que l’eau y diminue
avec de l’eau-mere: on entend par eau-mere,
celle qui s’élève à la furface des cuves M , M, M,
& c . pendant que l’eau y féjourne ; on prend cette
eau dans les cuves p » p y avec des féaux, & on la
renvoyé, félon le befoin, des cuves p } p> dans les
chaudières à éclaircir G , G. C ’eft ce que font les
deux f ig .i . 2. dont l’une prend dans la cuve p } &
l’autre jette fur les canaux de renvoi q9 q, qui fe'rendent
aux deux chaudières à éclaircir G , G , qu’on
entretient toûjours avec moitié de l’eau des cuves
p y Pt & moitié de l’eau du réfervoir I . Les fours font
de la longueur de la chaudière ; leur hauteur eft coupée
en deux par un grillagé dont les barres ont trois
pouces d’équarriffage, & cinq piés de longueur ; il
y en a cinq en longueur, & trois en travers. Ce grillade
ne s’étend qu’à la moitié de la capacité du four ;
c ’eft fur lui qu’on met la houille ; il faut toutes les 24
heures deux tombereaux de houille pour les quatre
fourneaux : ces tombereaux ont fix piés de long, fur
trois de large & trois de haut.
Il eft bon d’obferver que les chaudières étant de
plomb, il faut qu’elles foient garanties de l’aftion du
feu par quelque rempart : ce rempart, c’eft une grande
plaque de fonte d’un pouce d’épaiffeur H, H , H,
qui couvre le deffus des fourneaux. Voye^ la Planche
I II. de Minéralogie. On voit, Planche de la couperofe ,
une cotipe du fourneau ; A f porte du fourneau ; B,
B i porte du cendrier; C, C , la grille ; D y D , D , D ,
coupe de la chaudière ; H, H, la cheminée ; I , K } L,
hotte & tuyau de la cheminée.
On fait aulîi de Y alun en France, proche les montagnes
des Pyrénées.
U alun eft compofé d’un acide qui eft de la nature
de l’acide vitriolique, puifque quand il eft joint avec
l’alkali du tartre, il donne un tartre vitriolé , comme
feroit l’acide tiré du vitriol même. Cet acide,
pour former Y alun, eft uni à une terre qui eft une
efpece de craie ; cette terre eft particulière, & fem-
ble tenir de la nature des matières animales calcinées.
L’alun donne par la décompofition quelque
chofe d’urineux, qui vient le plus fouvent de l’urine
dont on fe fert pour le clarifier quand on le fabrique.
D ’ailleurs, Y alun pourrait donner un alkali
A L U B11
Volatil urineux , indépendamment de cette urine »
parce qu’il contient un peu de bitume, qui combine
avec la terre de Y aluni peut donner un alkali vola“
til ; ce qu’on doit inférer des expériences que M. Ma-
loiiin a rapportées à l’Académie en 1746, en donnant
l’analyfe des eaux minérales de Plombières*
C ’eft de lui que nous tenons le refte de cet article.
U alun eft un remede qui, étant mis en oeuvre avec
les précautions Sc la prudence néceffaires , appaifé
& guérit toutes les hémorrhagies en général, tant
internes qu’externes. On peut donc s’en fervir dans
l’écoulement du fang, caufé par l’ouverture de quel*
ques vaiffeaux dans les premières voies ; dans le fai-
gnement de nez ; dans les crachemens & vomiffe-
mens de fang ; dans lé flux des urines enfanglantées,
& des hémorrhoïdes ; dans toutes les pertes de fang
qui arrivent aux femmes , en quelque tems qu’elles
leur furviennent, pendant leur groffeffe, & après
l’aç.couchement.
Enfin Y alun n’eft pas moins efficace dans les hémorrhagies
qui auroient été caufées par un coup de
feu , ou par quelque infiniment tranchant, par quelque
chûte, ou quelque coup de tête violent; & dans
celles même qui feroient la fuite de quelques ulcérés
rongeans & invétérés.
La maniéré dont agit l'alun eft très-douce: ori
n’éprouve lorfqu’on en prend, d’autre changement
dans le corps, que quelques maux de coeur légers :
mais ils durent très-peu, & ne vont jamais jufqu’à
faire vomir avec effort.
Quelques-uns prétendent qu’il eft dangereux d’ar-*
fêter le fang par l’ufage des aftringens; préjugé d’autant
plus mal fondé à l’égard de Y alun, qu’il eft détruit
par l’expérience. Ce remede n’entraîne jamais
de fuite fâchéufe , pourvû néanmoins que les vaiffeaux
ayent été fuffifamment defëmplis, ou par les
pertes, ou par les faignées ; c’eft au Médecin à en
décider. Le Médecin ne l’employera jamais dans les
hémorrhagies Critiques, ni dans les fievres violentes
: c’eft pourquoi il eft toûjours néceffaire de eon-
fulter le Médecin fur fon ufage.
Au refte, la maniéré d’en ufer doit être variée ,
ainfi que le régime, félon les différens tempéramens,
& les différentes hémorrhagies.
La dofe eft depuis trois grains jufqu’à un demi-
gros , incoporé avec un peu de miel rofat. M. Ma-
loi'iin a trouve que le cinnabre joint à Y alun, faifoit
réuflir mieux ce remede, fur-tout lorfqu’il s’agit de
calmer les naufées, &c. Ce Médecin fait entrer un
grain de cinnabre naturel dans chaque prife Y alun.
Voye.^ fa Chimie médicinale. On donne Y alun dans les
grandes hémorrhagies preffantes, de deux heures en
deux heures, & nuit & jour. Lorfque les hémorrhagies
feront moins vives , on le donnera de trois ou
de quatre heures en quatre heures, Sc le jour feulement,
fi la chofe n’eft pas preffante.
Lorfque la perte de fang fera arrêtée, ce qui arrive
ordinairement après la huitième ou dixième prife ,
on diminuera infenfiblement pendant un mois l’ufage
de Y alun.
Les femmçs ont quelquefois des pertes de fang
extraordinaires, ou font fujettes à en évacuer tous
les mois en telle abondance, qu’elles s’en trouvent
confidérablement affoiblies.
Dans la vûe de modérer ces pertes fans les arrêter,
on leur fera prendre le matin à jeun un demi-
gros Y alun fept ou huit jours de fuite avant le tems
de l’évacuation ; elles continueront cette pratique
pendant cinq ou fix mois , fans quoi elles courent
rifque de devenir fujettes aux pertes blanches, qui
peuvent devenir d’autant plus dangereufes, qu’elles
font quelquefois fuivies de skirrhes ou d’ulceres.
Deux obfervations générales doivent être rapportées
à toutes les efpeces dë pertes de fang dont nous