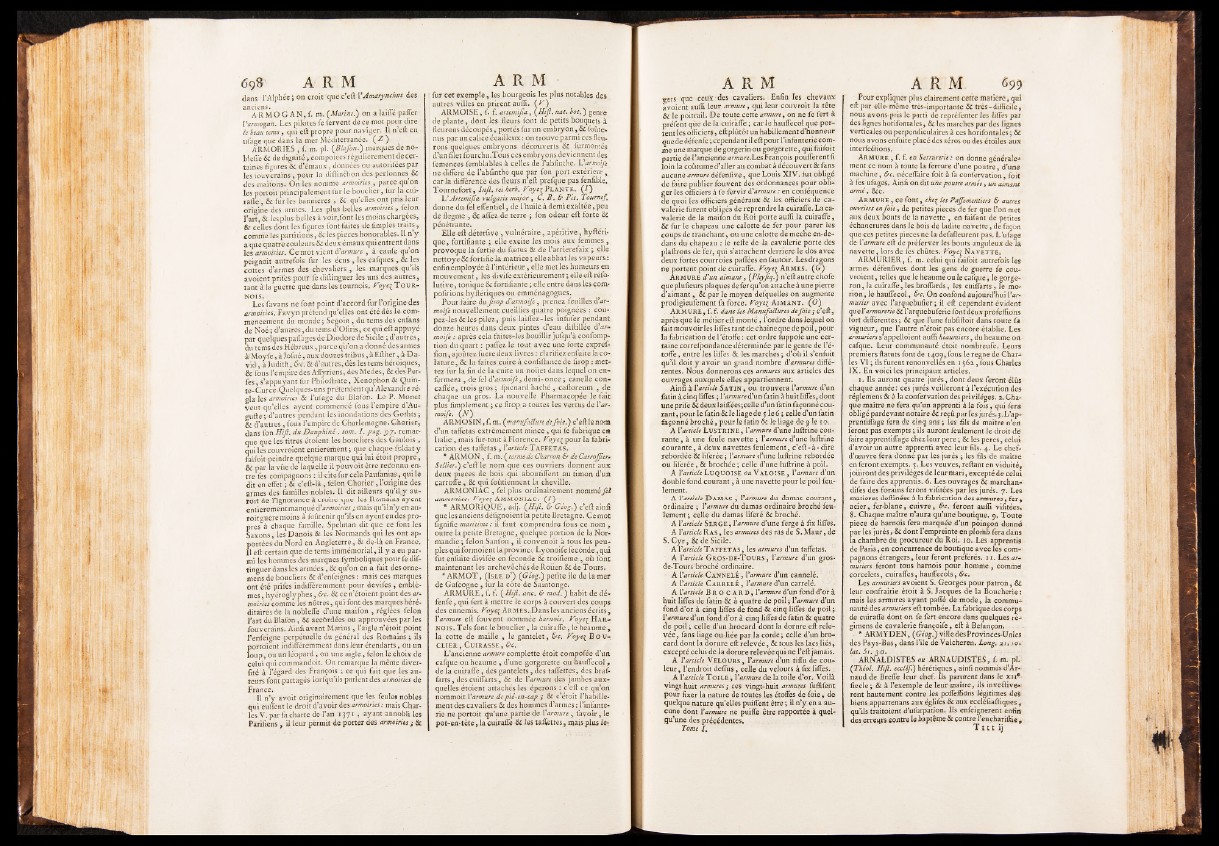
i g p ! f i i l | i |
698 A R M
dans l’Alphée ; on croit 'que c’eft YAmarynchus des
anciens. - . , _
A R M O G A N , f .n i . (Marine.) on a laifle palier
Varmogan. Les pilotes le fervent de ce mot pour dire
le beau tems, qui eft propre pour naviger. Il n’eft en
ufage que dans la mer Méditerranée. ( Z )
ARMORIES , f. m. pl. (Blafon.) marques de no-
bleffe & de dignité > compolées regulierement de certaines
figures & d’émaux, données ou autorifées par
les louverains, pour la diftinftion des perlonnes^ &
des maiions. On les nomme armoiries ■, parce qu on
les portoit principalement lur le bouclier, lur la cuiraffe'',
& fur les bannières , &c qu’elles ont pris leur
origine des armes. Les plus belles armoiries | félon
l’art, & lesplus belles à voir,font les moins chargées,
gf celles dont les figures font faites de fimples traits,
comme’les partitions, 8des pièces honorables. Il n’y
a que quatre couleurs & deux émaux qui entrent dans
lés armoiries. Ce mot vient àéarmure , à caufe qu’on
peighoit autrefois fur les écus , les cafques , & les
cottes d’armes des chevaliers , les marques qu’ils
avoient prifes pour fe diflinguer les uns des autres,
tant à'ia guerre que dans les tournois. Voye^ TOURNOI
SV --- ... '
Les favans ne font point d’accordfur l’origine des
armoiries. Fa vyn prétend qu’elles ont été dès le commencement
du monde; Segoin , du tems des enfans
de Noé ; d’autres, du tems d’Ofiris, ce qui eft appuyé
par quelquespaftages de Diodore de Sicile ; d’autres,
du tems des Hébreux, parce qu’on a donné des armes
à'Moyfe, à J-ofué, aux douzes tribus, à Efther, à D a vid
, à Judith y&c: & d-autres, dès les tems héroïques,
& fous l’empire des Affyriens, des Medes, & des Per-
fes, s’appuyant fur Philoftrate, Xenophon & Quin-
te-Curce.Quelques-uns prétendent qu’Alexandre régla
le s armoiries & l’ufage du Blafon. Le P. Monet
Veut qu’elles ayent commence fous l’empire d’Au-
gufte-; d’autres pendant les inondations des Gothts ;
ÔC d’autres, fous l ’empire de Charlemagne. Ghorier,
dans fon tiifi. du Dauphine ., tom. I. pag. o,y. remarque
que les titres étoient les boucliers des Gaulois ,
qui les couvroient entièrement ; que chaque foidat y
Stifoit peindre quelque marque qui lui étoit propre,
& par la vûede laquelle il pouvoit être redonnu entre
fes compagnons : il cite fur cela Paufanias, qui le
dit en effet ; & c’eft4 à , félon Chorier , l’origine des
armes des familles nobles. Il dit ailleurs qû’ih y au-
roit de l’ignorance à croire que les Romains ayent
entièrement manqué üarmoiries ; mais qu’il n’y en au-
roit guere moins à foûtenir qu’ils en ayent eu des propres
à chaque famille. Spelman dit que ce font les
Saxons ,• les Danois & les Normands qui les ont apportées
du Nord en Angleterre, & de-là en France.
Il eft certain que de tems immémorial, il y a eu parmi
les hommes des marques fymboliques pour fe distinguer
dans les armées, & qu’on en a fait desorne-
mens de boucliers & d’enfeignes : mais ces marques
ont été prifes indifféremment pour devifes , emblèmes,
hyéroglyphes, &c. & cen’étoient point des armoiries
comme les nôtres, qui font des marques héréditaires
de la nobleffé d’une maifon , réglées félon
l’art du Blafon, 8c accôrdées ou approuvées par les
fouverains. Ainft avant Marius , l’aigle n’étoit point
l’enfeigne perpétuelle du général des Romains ; ils
portoient indifféremment dans leur étendarts, ou un
loup, ou un léopard, ou une aigle, félon le choix de
celui qui commandoit. On remarque la même diver-
fxté à l’égard des François ; ce qui fait que .les auteurs
font partagés lorfqu’ils parlent des armoiries de
France. --'f
Il n’y avoit originairement que les feules nobles
qui euffent le droit d’avoir des armoiries : mais Charles
V . par fa charte de l’ an 1 3 7 1 , ayant annobli les
Parifiens , il leur permit de porter des armoiries ; 8c
A R M
fur cet exemple, les bourgeois les plus notables des
autres villes en prirent aufli. ( f 1' )
ARMOISE, f. f. artemifia, (H i f i .n a t . b o t .) genre
de plante, dont les fleurs font de petits bouquets à
fleurons découpés, portés fur un embryon, 8c foûte*
nus par un calice écailleux : on trouve parmi ces fleu-
rons quelques embryons découverts 8c furmontés
d’un filet four chu.Tous ces embryons deviennent des
femences femblables à celles de l’abfinthe. Varmoife
ne différé de l’abfinthe que par fon port extérieur ,
car la différence des fleurs n’eft prefque pas fenfible.
Tournefort, I n ß . rei herb. Voye^ Pl a n t e , ( ƒ )
L ’Artemifia vulgaris major , C . B . & B i t . T ourne/.
donne du fel effentiel, de l ’huile à demi exaltée, peu
de flegme , 8c affez-de terre ; fon odeur eft forte 8c
pénétrante»
Elle eft déterfive, vulnéraire, apéritive, hyftéri-
que, fortifiante ; elle excite les mois aux femmes ,
provoque la fortie du foetus 8c de l’arrierefaix’; elle
nettoye 8c fortifie la matrice ; elle abbat les vapeurs-:
enfin employée à l’intérieur, elle met les humeurs en
mouvement, les divife extérieurement; elle eft réfo*
lutive, tonique 8c fortifiante ; elle entre clans les com«
pofnions hyftériques ou emménagogues.
Pour faire du firop d'armoife, prenez feuilles d’<*r-
moife nouvellement .cueillies quatre poignées : cou-
pez-les 8c les pilez, puis laiffez-les infufer pendant
douze heures dans deux pintes d’eau diftillée d’ar-
moife : après cela faites-les bouillir jufqu’à confomp-
tion du quart : paffez le tout avec une forte expref-
fion, ajoutez fucre deux livres : clarifiez enfuite la co-
lature, 8c la faites cuire à confiftance de firop : mettez
fur la fin de la cuite un noiiet dans lequel on enfermera
, de fel d'armoife, demi-once ; canelle con-
caffée, trois gros ; fpienard haché , caftoreum , de
chaque -un gros. La nouvelle Pharmacopée le fait
plus fimplement ; ce firop. a toutes les vertus de Yar-
moife. (N )
ARMOSIN, f. m. (manufacture de fo ie .) c’eft le nom
d’un taffetas extrêmement mince, qui fe fabrique en
Italie, mais fur-tout à Florence. V oy e£ pour la fabrication
des taffetas , Y article T a f f e t a s .
* ARMON, f. m . (termede Charron & deCarrojfier-
S e llie r .) c’eft'le nom que ces ouvriers donnent aux
deux pièces de bois qui aboutiffent au timon d’un
carroffe, 8c qui foûtiennent la cheville.
ARMONIAC , fel plus ordinairement nommé f e l
ammoniac. V o y e [ AMMONIAC. ( I )
* ARMORIQUE, adj. (H iß . & G é o g .) c’eft ainft
que les anciens défignoient la petite Bretagne. Ce mot
fignifie maritime : il faut comprendre fous ce nom ,
outre la petite Bretagne, quelque portion de la Normandie
; félon Sanfon , il convenoit à tous les peuples
qui formoient la province Lyonoife fécondé, qui
fut enfuite divifée en fécondé 8c troifieme , oit font
maintenant les archevêchés de Rouen 8c de Tours.
* ARMOT, (Isl e d’) (G é o g .) petite île de la mer
de Gafcogne , fur la côte de Saintonge.
ARMURE, f. f. ( H iß . a nc. & mod. ) habit de dé-
fenfe, qui fert à mettre le corps à couvert des coups
des ennemis.-Voye% ARMEsJDans les anciens écrits,
Y armure eft fouvent n om m é e harnais. Voye^ Ha r -
n o i s . Tels font le bouclier, la cuiraffe, le heaume ,
la cotte de maille , le gantelet, & c . V oy eç B o u -
c l ie r , C u ir a s s e , & c.
L’ancienne armure complette étoit compoféè d’un
cafque ou heaume , d’une gorgerette ou hauflecol,
de la cuiraffe, des gantelets, des taffettes, des braf-
farts, des cuiflarts, 8c de Y armure des jambes auxquelles
étoient attachés les éperons : c’eft ce qu’on
nommoit Y armure de p ié-en-cap ÿ 8c c’étoit l’habillement
des cavaliers 8c des hommes d’armes : l’infanterie
ne portoit qu’une partie de Y armure , favoir, le
pot-en-tête, la cuiraffe 8c les taffettes, mais plus le:
A R M
gers que ceux • des cavaliers» Enfin les chevaux
avoient aufli leur armure, qui leur couvroit la tête
8c le poitrail. De toute, cette armure, on ne fe fert à
préfent que de la cuiraffe ; car le hauffecol que portent
les officier^, eft plutôt un habillement d’honneur
que de défenfe ; cependant il eft pour l’infanterie comme
une marque degorgerin ou gorgerette, qui faifoit
partie de l ’ancienne armureX.es François pouffèrent fi
loin la coutume d’aller au combat à découvert 8c fans
aucune armure défenfive, que Louis X IV. fut obligé
de faire publier fouvent des ordonnances pour obliger
les officiers à fe fervir d'armure : en conféquence
de quoi les officiers généraux 8c les officiers de ca*-
valerie furent obligés de reprendre la cuiraffe. La cavalerie
de la maifon du Roi porte aufli .la cuiraffe,
8c fur le chapeau une calotte de fer pour parer les
coups de tranchant, ou une calotte de meche en-dedans
du chapeau : le refte de la cavalerie porte des
plaftrons de fer, qui s’attachent derrière le dos avec
deux fortes courroies paffées en fautoir. Les dragons
ne portent point de cuiraffe. Boye{ A r m e s . (G)
A rm u r e d’un aimant, (Phyfiq.) n’eft autre chofe
que plufieurs plaques de fer qu’on attache à une pierre
d’aimant, 8c par le moyen defquelles on augmente
prodigieufement fa force; Voye[ A im a n t . (D)
A r m u r e , f. f. dans les Manufactures de foie; c’eft,
après que le métier eft monté, l’ordre dans lequel on
fait mouvoir les liftes tant de chaîne que de poil, pour
la fabrication de l’étoffe : cet ordre füppofe une certaine
correfpondance déterminée par le genre de l’étoffe
, entre les lifles 8c les marches ; d’où il s’enfuit
qu’il doit y avoir un grand nombre, d’armures différentes.
Nous donnerons ces armures aux articles des
ouvrages auxquels elles appartiennent.
Ainfi à Y article Sa t in , ou trouvera Y armure d’un
fatin à cinq lifles ; l 'armure d’un fatin à huit liffes, dont
une prife 8c deux laiffées;celle d’un fatin façonné courant
, pour le fatin 8c le liage de 5 le 6 ; celle d’un fatin
façonné broché, poiir le fatin & le liage de 9 le 10.
A Y article L u s t r in e , Y armure d’une luftrine courante
, à une feule navette ; Y armure d’une luftrine
cou ran te, à deux navettes feulement, c’e f t -à - dire
rebordée 8c liferée ; Y armure d’une luftrine rebordée
o u life rée , & brochée ; celle d’une luftrine à poil‘ify>
A Y article L u q u o i sE ou V a l o is e , Y armure d’un
double fond courant, à une navette pour le poil feulement.
A l'article D a m a s , Yarmure du damas couran t,
Ordinaire ; Y armure du damas ordinaire broché feulement
; celle du damas liferé 8c broché.
A Y article Se r g e , Y armure d’une ferge à fix liffes.
A Y article R AS, les armures des ras de S. Maur, de
S. C y r , 8c de Sicile.
A Y article T a f f e t a s , les armures d’un taffetas.
A Y article G r o s -de-T o u r s , Y armure d’un gros-
de-Tours broché ordinaire.
A Y article C ANNElÉ, Y armure d’ün cannelé.
A Y article C a r r e l é , Y armure d’un carrelé.
A Y article B r o c a r d , Y armure d’un fond d’or à
huit liffes de fatin 8c à quatre de poil; Y armure d’un
fond d’o r à cinq liffes de fond & cinq liffes de poil ;
Y armure d’un fond d’or à cinq liffes de fatin 8c quatre
de poil ; celle d’un brocard dont la dorure eft relevée
, fans liage ou-liée par la corde ; celle d’un brocard
dont la dorure eft relevée, 8c tous les lacs liés,
excepté celui de la dorure relevée qui ne l’eft jamais.
A Y article V e lo u r s , Y armure d’un tiffu de couleur
, l’endroit deffus, celle du velours à fix liffes.
A Yarticle T o i l e ; l'armure de la toile d’or. Vo ilà
vingt-huit armures ; ces vingt-huit armures fuffifent
pour fixer la nature de toutes les étoffes de fo ie , de
quelque nature qu’elles puiffent être ; il n’y en a aucune
dont Y armure ne puiffe être rapportée à quelqu’une
des précédentes.
Tome ƒ,
A R M
Pour éxpliquér plus clairement cette matière, qui
eft par elle-même très-importante 8c très-difficile*
nous avons-pris le parti de repréfenter les liffes par
des lignes horifontales, 8c les marches par des lignes
verticales ou perpendiculaires à ces horifontales ; 8c
nous avons enfuite placé des zéros ou des étoiles aux
interférions.
A r rïu re , f. fl en Serrurerie: on donne générale-»
ment ce nom à toute la ferrure d’une poutre, d’une
machine, &c. néceffaire foit à fa confervation foit
à fes ufages-. Ainfi on dit une poutre armée , un aimant
armé, 8cc.
A rm u r e , ce font, che£ les Pajfememiers & autres
ouvriers en foie, de petites pièces de fer que l’on met
aux deux bouts de la navette , en faifant de petites
échancrures dans le bois de ladite naVette, de façon
que ces petites pieces ne la defafleurent pas. L ’ufagé
de Y armure eft de préferver les bouts anguleux de là
navette,. lors de fes chutes. Voye^ N a v e t t e .
ARMURIER, f. m. celui qui faifoit autrefois les
armes défenfives dont les gens de guerre fe côii-
vroient, telles que le heaume ou le calque, le gorge*
ron, la cuiraffe, les broffards, les cüiffarts * le mo-
rion, le hauffecol, &c. On confond aujourd’hui Yar*
mûrier avec l’arquebufier ; il eft cependant évident
que Yarmurerie & l’arqüebuferie font deux profeffiöns
fort différentes ; & que l’une fubfiftoit dans toute fà
vigueur , que l’autre n’étoit pas encore établie. Les
armuriers s’appelloient aufli heaumiers, du heaume ott-
cafque. Leur comm.unauté étoit nombteufe. Leurs
premiers ftatuts font de 1409, fous le regne de Char-*
les V I ; ils furent renouvellés en 1 $ 6 i, fous Charles
IX. En voici les principaux articles.
1. Ils auront quatre jurés, dont deux feront élûs
chaque année : ces jurés veilleront à l’exécution des
réglemens 8c è la confetvation des privilèges, z.Chaque
maître ne fera qu’un apprenti à la fois, qui ferà
obligé pardevant notaire & reçû par lès jurés.3 .L’ap*-
prentiffage fera de cinq ans ; les fils de maître n’en
feront pas exempts ; ils auront feulement le droit de
faire apprentiffage chez leur pere ; & les peres, celui
d’avoir ùn autre apprenti avec. leur fils. 4. Le chef-
d’oeuvre fera donné par les jurés ; les fils de maître
en feront exempts. 5. Les veuves, reftant en viduité,
jouiront des privilèges de leur mari, excepté de celui
de faire des apprentis* 6. Les ouvrages & marchandées
des forains feront vifitées par les jurés. 7. Les
matières deftinées à la fabrication des armures, fer*
acier, fer-blanc, cuivre, &c. feront aufli vifitées.
8. Chaque maître n’aura qu’une boutique. 9. Toute
piece de harnôis fera marquée d’un poinçon donné
par les jurés, & dont l’empreinte en plomb fera dans
la chambre du procureur du Roi. 10. Les apprentis
de Paris, en concurrence de boutique avec les compagnons
étrangers, leur feront préférés. 11. Les armuriers
feront tous harnois pour homme, comme
corcelets, cuiraffes, hauffecols, &c.
Les armuriers avoient S. Georges pour patron, &
leur confrairie étoit à S. Jacques de la Boucherie:
mais les armures ayant paffé de mode, la communauté
des armuriers eft tombée. La fabrique des corps
de cuiraffe dont on fe. fert encore dans quelques ré-
gimens de cavalerie françoife, eft à Bdançon.
* ARMYDEN, (Géog.) ville des Provinces-Unies
des Pays-Bas, dans l’île de Valcheren. Long, z i » /ov
lat. Si. ß ö .
ARNALDISTES ou ÀRNAUDIStES, C tu. pb
(Théol. Hiß. eccléf) hérétiques, ainfi nommés d’Arnaud
de Breffe leur chef. Ils parurent dans le xn *
fiecle ; & à l’exemple de leur maître, ils inve&ive*
rent hautement contre les poffeifiôns légitimes des
biens appartenans aux églifes & aux eccléfiaftiques ,
qu’ils traitoient d’ufurpation. Ils enfeignerent enfiii
des erreqrs contre le baptême 8c contre l’euchariftie 9