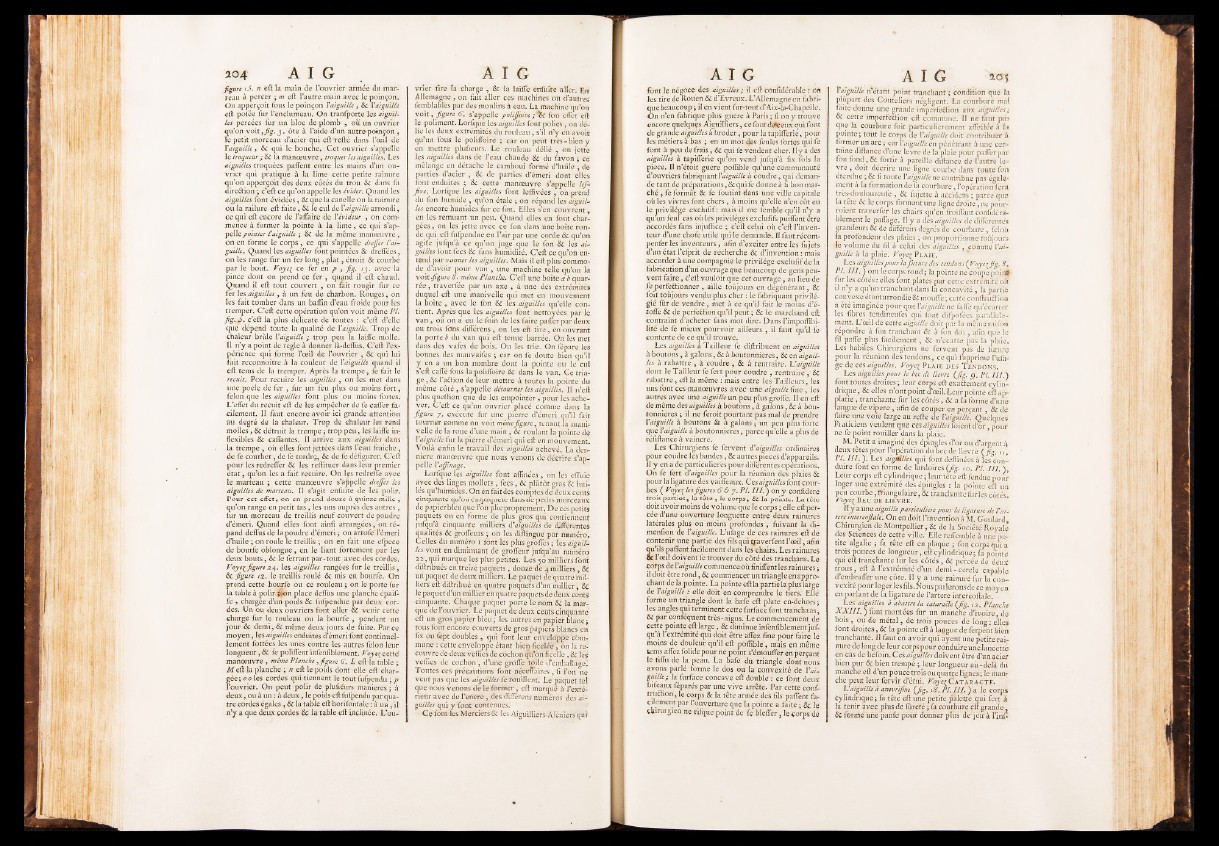
figure /5. n eft la main de l’ouvrier armée du marteau
à percer ; m eft l’autre main avec le poinçon.
On apperçoit fous le poinçon l’aiguille, & l’aiguille
eft pofée fur l’enclumeau. On tranfporte les aiguilles
percées fur un bloc de plomb , où un ouvrier
qu’on voit ,fig. j . ôte à l’aide d’un autre* poinçon ,
le petit morceau d’acier qui eft *refté dans l’oeil de
F aiguille, & qui le bouche« Cet ouvrier s’appelle
le troqueur ; &c fa manoeuvre, troquer les aiguilles. Les
aiguilles troquées paffent entre les mains d’un ouvrier
qui pratique à la lime cette petite rainure
qu’on apperçoit des deux côtés du trou & dans fa
direction ; c’eft ce qu’on appelle les évider. Quand les
aiguilles font é vidées, & que la canelle ou la rainure
ou la railure eft faite, & le cul de Y aiguille arrondi,
ce qui eft encore de l’affaire de l'èvideur , on commence
à former la pointe à la lime, ce qui s’appelle
pointer l'aiguille ; & de la même manoeuvre,
on en forme le corps , ce qui s’appelle drejfer l'ai-
guille. Quand les aiguilles font pointées & dreffées,
on les range fur un fer long, plat, étroit & courbé
par le bout. Voye{ ce fer en p , fig. 13. avec la
pince dont on prend ce f e r , qiuind il eft chaud.
Quand il eft tout couvert , on fait rougir fur ce
fer les aiguilles , à un feu de charbon. Rouges, on
les fait tomber dans un baflin d’eau froide pour les
tremper. C’eft Cette opération qu’on voit même PI.
fig.fi. c’eft la plus délicate de toutes : c’eft d’elle
que dépend toute la qualité de l’aiguille. Trop de
chaleur brûle l’aiguille ; trop peu la laiffe molle.
Il n’y a point de réglé à donner là-deffus. C’eft l’expérience
qui forme l’oeil de l’ouvrier , & qui lui
fait reconnoître à la couleur de 1 ' aiguille quand il
eft tems de la tremper. Après la trempe, fe fait le
recuit. Pour recuire les aiguilles , on les met dans
une poele de fer , fur un feu plus ou moins fort,
félon que les aiguilles font plus ou moins fortes.
L ’effet du recuit eft de les empêcher de fe cafter facilement.
Il faut encore avoir ici grande attention
au degré de la chaleur. Trop de chaleur les rend
molles , & détruit la trempe ; trop peu, les laiffe inflexibles
& caftantes. Il arrive aux aiguilles dans
la trempe , où elles font jettées dans l’eau fraîche,
de fe courber, de fe tordrç, & de fe défigurer. C’eft
pour les redreffer & les reftituer dans leur premier
é ta t, qu’on les a fait recuire. On les redreffe avec
le marteau ; cette manoeuvre s’appelle drejfer les
aiguilles de marteau. Il s’agit enfuite de les polir.
Pour cet effet, on en prend douze à quinze mille ,
qu’on range en petit tas, les uns auprès des autres ,
liir un morceau de treillis neuf couvert de poudre
d’émeri. Quand elles font ainfi arrangées, on répand
deffus de la poudre d’émeri ; on arrofe l’émeri
d’huile ; on roule le treillis ; on en fait une efpece
de bourfe oblongue, en le liant fortement par les
deux bouts, & le ferrant par-tout avec des cordes.
yoye^ figure 24. les aiguilles rangées fur le treillis,
& figure 12. le treillis roulé & mis en bourfe. On
prend cette bourfe ou ce rouleau ; on le porte fur
la table à polir $on place deffus une planche épaif-
fe , chargée d’un poids & fufpendue par deux cordes.
Un ou deux ouvriers font aller & venir cette
charge fur le rouleau ou la bourfe , pendant un
jour & demi, & même deux jours de liiite. Par ce
moyen, les aiguilles enduites d’émeri font continuellement
fottées les unes contre les autres félon leur
longueur, & fe poliffent infenfiblement. Voye1 cette?
manoeuvre , même Planche, figure 6. L eft la table :
M eft la planche ; n eft le poids dont elle eft chargée
; o o les cordes qui tiennent le tout fufpendu ; p
l’ouvrier. On peut polir de plufiëurs maniérés ; à'
deux, ou à un : à deux, le poids eft fufpendu par quatre
cordes égales, & la table eft horifontale : à un, il
n’y a que deux cordes & la table eft inclinée, L’ouvrièr
tire la charge , & la laiffe enfuite aller. Ert
Allemagne, on fait aller ces machines oit d’autres
femblablès par des moulins à eau. La machine qu’on
v o it , figure Cf. s’appelle poliffoire fon effet eft
le poliment. Lorfque les aiguilles font polies, on délie
les deux extrémités du rouleau, s’il n’y en avoit
qu’un fous le poliflbire ; car on peilt très-bien y
en mettre plufiëurs. Le rouleau délié , on jette
les aiguilles dans de l’eau chaude & du favon ; ce
mélange en détache le camboui formé d’huile • de
parties d’acier , & de parties d’émeri dont elles
lont enduites ; & cette manoeuvre s’appelle lej's
five. Lorfque les aiguilles font leflivées , on prend
du fon humide , qu’on étale ; on répand les aiguilles
encore humides fur ce fon. Elles s’en couvrent,
en les remuant Un peu. Quand elles en font chargées
, on les jette avec ce fon dans une boîte ronde
qui eft fufpendue en l’air par une corde & qu’on
agite jufqu’à ce qu’on juge que le fon & les aiguilles
font fecs & fans humidité. C’eft ce qu’on entend
parvanner les aiguilles. Mais il eft plus commode
d’avoir pour van , une machine telle qu’on la
voit figure 8. même Planche. C ’eft une boîte a b qüar-
r é e , traverfée par un axe , à une des extrémités
duquel eft une manivelle qui met en mouvement
la boîte ,. avec le fon & les aiguilles qu’elle contient.
Après que les aiguilles font nettoyées par le
van , où on a eu le foin de les faire palier par deux
ou trois fons différens , on les eh tire, en ouvrant
la porte b du van qui eft tenue barrée. On les met
dans des vafes de bois. On les trie. On fépare les
bonnes des maüvàifes ; car on fe doute bien qu’il
y en a un bon nombre dont la pointe ou le. cul
s’eft caffé fous la poliflbire & dans le van. Ce triage
, & l’aftion de leur mettre à toutes la pointe du
même côté , s’appelle détourner les aiguilles. Il n’eft
plus queftion que .de les empointer, pour les achever.
C ’eft: ce qu’un ouvrier placé comme dans la
figure y. exécute fur une pierre d’émeri qu’il fait
tourner comme on voit même figure, tenant la manivelle
de la roue d’une main , & roulant la pointe de
Faiguille fur la pierre d’émeri qui eft: en mouvement.
Voilà enfin le travail des aiguillés achevé. La dernière
manoeuvre que nous venons de décrire s’appelle
Y affinage.
Lorfque les aiguilles font affinées , on les éffuiê
avec des linges mollets , fecs, & plutôt gras & huilés
qu’hiimides. On èn fait des comptes de deux Cents
cinquante qu’on èmpaquete dans de petits morceaux
de papier bleu que l’bn plie proprement. De ces petits
paquets on en forme de plus gros qui contiennent
jufqu’à cinquante milliers d'aiguillés de différentes
qualités & groffeurs ; on les diftingue par numéro.
Celles du numéro 1 fônt lés plus großes ; les alguiU-
les vont en diminuant de groffeur jufqü’àü numéro
21 , qui marque les plus petites. Les 50 milliers font
diftribués en treize paquets, douze de 4 milliers, &c
un paquet de deux milliers. Le paquet de quatre milliers
eft diftribué en quatre paquets d’un millier, &c
le paquet d’un millier en quatre paquets de deux cents
cinquante. Chaque paquet porte le nom èç la marque
de l’ouvrier. Le paquet de deux cents cinquante
eft un gros papier bleu ; les autres en pàpiéf blanc;
tous font encore Couverts de gros papiers blancs en
fix ou fept doubles , qui font leur enveloppe ’çbhi-
mune : cette enveloppe étant bien ficelée , on iâ recouvre
de deux veflies de c’öchön qti’ön ficelle, & les
veflies de cochon', d’üiiè groffe toile d’emballage!
Toutes ces précautions font nécenaires, fi l’on ne
veut pas que les aigüilles fe fouillent. Le paquet tel
que nous venons de le former, eft marqué à l’exté-
rieftr avec de l’encre, des différens numéros des aiguilles
qui y font contenues.
• C e font-les Merciers & les Aiguilliers-Alèniersquî
font le négoce des aiguilles ; il eft cohfidérable i Oh
les tire de Rouen & d’Evreux. L’Allemagne en fabri-
que beaucoup ; il en vient fur-tout d'Aix-la-Chapelle.
On n’en fabrique plus guere à Paris ; fi on y trouve
encore quelques Aiguilliers, ce font ddlfceux qui font
de grande aiguilles à broder, pour la tapifferie, pour
les métiers à bas ; en un mot des feules fortçs qui fè
font à peu de frais, & qui fe vendent cher. Il y a des
aiguilles à tapifferie qu’on vend jufqu’à fix fols la
piece. Il n’étoit guere poflible qu’une communauté
d’ouvriers fabriquant Y aiguille à coudre, qui demande
tant de préparations, & qui fe donne à fi bon marché
, fe formât & fe foutînt dans une ville capitale
oii les vivres font chers , à moins qu’elle n’en eût eu
le privilège exclufif : mais il me femble qu’il n’y a
qu’un feul cas où les privilèges exclufifs puiffent être
accordés fans injuftice ; c’eft celui où c’eft l’inventeur
d’une chofe utile qui le demande. Ilfautrécom-
penfer les inventeurs, afin d’exciter entre les fujets
d’un état l’efprit de recherche & d’invention ; mais
accorder à une compagnie le privilège exclufif de la
fabrication d’un ouvrage que beaucoup de gens peuvent
faire, c’eft vouloir que cet ouvrage, au lieu de
fe perfectionner , aille toûjours en dégénérant, &
foit toûjoürs vendu plus cher : le fabriquant privilégié
fûr de vendre, met à ce qu’il fait le moins d’étoffe
& de perfection qu’il peut ; & le marchand eft
contraint d’acheter fans mot dire. Dans l’impofllbi-
lité de fe mieux pourvoir ailleurs , il faut qu’il fe
contente de ce qu’il trouve.
Les aiguilles à Tailleur fe distribuent en aiguilles
à boutons, à galons, & à boutonnières, & en aiguilles
à rabattre , à coudre , & à rentraire. Vaiguille
dont le Tailleur fe fert pour coudre , rentraire, &
rabattre, eft la même : mais entre les Tailleurs, lès
uns font ces manoeuvres avec une aiguille fine , les
autres avec une aiguille un peu plus groffe. II en eft
de même des aiguilles à boutons, à galons, &c à boutonnières
; il ne feroit pourtant pas mal de prendre
Xaiguille à boutons & à galons , un peu plus forte
que Y aiguille à boutonnières, parce qu’elle a plus de
réfiftanCC à vaincre.
Les Chirurgiens fe fervent d’aiguilles ordinaires
pour coudre les bandes * & autres pièces d’appareils.
Il y en a de particulières pour différentes opérations.
On fe fert d'aiguilles pour la réunion des plaies &
pour la ligature des vaiffeaux. Ces aiguilles font courbes
( Voye{ les figures 6 & y, PI. III. ) on y confîderé
trois parties, la tê te , le corps, & la pointe. La, tête
doit avoir moins de volume que le corps ; elle eft percée
d’une ouverture longuette entre deux rainures
latérales plus ou moins profondes , fuivant la di-
menfion de Y aiguille. L’ufage de ces rainures eft dé
contenir une partie des fils qui graverfent l’oeil, afin
qu’ils paffent facilement dans les chairs. Les rainures
& l’oeil doivent fe trouver du côté des tranchans. Le
corps de Y aiguille commence où finiffent les rainures ;
il doit être rond, & commencer un triangle en approchant
de la pointe. La pointe eft la partie la plus large
de Y aiguille : elle doit en comprendre le tiers. Elle
forme un triangle dont la bafe eft plate en-dehors ;
les angles qui terminent cette furface font tranchans,
& par conlequent très-aigus. Le commencement dé
cette pointe eft large, & diminue infenfiblement ju£
qu’à l’extremite qui doit êtrè àffez fine pour faire lé
moins de douleur qu’il eft poflible, mais en même
tems affez folide pour ne point s’émouffer en perçant
le tiffu de la peau. La bafe du triangle dont nous
avons parlé forme le dos ou la convexité de Yai-
giùlle} la furface concave eft doublé : ce font deux
bifeaux féparés par une vive arrête. Par cette corifi
trù&ion, le corps & la tête armée des fils paffent facilement
par l’ouverture que la pointe a faite ; & lé
chirurgien ne rifque point de fç bleffer, le corps de
î aiguille n’étaht point tranchant ; condition que la
plupart des Couteliers négligent. La courbure mal
faite donne line grande imperfection aux aiguilles ;
& cette imperfection eft commune. Il ne faut pds
que la courbure foit particulièrement affeCtééà la
pointe ; toiit le corps dé Y aiguille doit contribuer à
former un arc ; car Y aiguille en pénétrant à une certaine
diftance d’une levre de la plaie pour paffer par
fôn fond, & fortir à pareille diftance de l autre le-
vre , doit décrire une ligne courbe dans toute fort
etendue ; & fi toute Y aiguille ne contribue pas égale*
ment a la formation de fa courbure, ^opération fera
très-doulqureufe , & fujette à aCcidens ; parce que
la tête ôc le corps formant une ligne droite, ne pour*
roient traverfer les chairs qu’en froiffant confidéra-
blement le paffage. II y a des aiguilles de différentes
grandeurs & de différens degrés de courbure , feloh
la profondeur des plaies ; on proportionne toujours
le volume du fil à celui des aiguilles , comme Y aiguille
à la plaie. Voye^ Plaie.
Les aiguilles pour la future des tendons {Voye^fig. 8.
PL III. ) ont le corps rond ; la pointe ne coupe poiifô
fur les côtés : elles font plates par cette extrémité oîi
il n’y a qu’un tranchant dans la concavité , la partiô
convexe étant arrondie & moufle ; cette conftruâion
a été imaginée pour que Y aiguille ne faffe qu’écarter
les fibres tendineufes qui font difpofées parallèlement.
L’oeil de cette aiguille doit parla mêmeraifon
répondre à fon tranchant &: à fon dós , afin que lé
fil paffe plus facilement, &: n’écarte pas la plaie.
Les habiles Chirurgiens ne fervent pas de future
pour la réunion des tendons, ce qui fupprime l’ufage
de aiguilles. Voyc^ Plaie des Tendons.
Les aiguilles pour le bec de lievre (fig. g . PL I I I .)
font toutes droites; leur corps eft exactement cylindrique
, & elles n’ont point d’oeil. Leur pointe eft ap*
platie, tranchante fur les côtés, & a la forme d’une
langue de vipere, afin de couper en perçant, & dé
faire une voie large au refte de Y aiguille. Quelques
Praticiens veulent que ces aiguilles foient d’o r , pour*
ne fe point rouiller dans la plaie.
M. Petit a imaginé des épingles d’or ou d’argent 'à
deux têtes pour l’opération du bec de lievre ( fig /1,
PL III. ). Les aiguilles qui font deftinées à les conduire
font en forme de lardoires (fig. 10. PL III. ),
Leur corps eft cylindrique ; leur tête èft fendue pour
loger une extrémité des épingles : la pointe èft un
peu courbe, triangulaire, & tranchante furies côtés.
Poyei Bec de lievre.
Il y a une aiguille particuliere pour la ligature de l'afi
teré intercojlale. On en doit l’invention à M. Goulard
Chirurgien de Montpellier, & de la Société Royale
des Sciences de cette ville. Elle reffemble à une petite
algalie ; fa te te eft en plaque ; fon corps qui a
trois pouces de longueur, eft cylindrique ; fa pointe'
qui eft tranchante fur les côtés , & percée de deux
trous, eft à l’extrémité d’un demi - cercle capable
d’embraffer une côte. Il y a une rainure fur la convexité
pour logerdesfils. Noué parleronsde ce moyen
en parlant de la ligature de l’artere intercoftale.
'Laf aiguilles à abattre la cataracte (fig. 12, Planché
X X I I I . ) font montées fur un manche d’ivoirè , de
bois , ou de métal, de trois pouces de long: elles
font droites ,& la pointe eft à langue de ferpént bien
tranchante. Il faut en avoir qui ayent une petite rainure
de long de leur corps pour conduire une lancette
en cas de béfoin. Ces aiguilles doivent être d’un acier
bien pur & bien trempé ; leur longueur aii-delà du
manche eft d’un poucè trois ou quatre lign es; le manche
peut leur fervir d’étui. Foyei C a t a r a c t e . '
Vaiguille à anevrifihe (fig. 18. PL III. ) a le corps
Cylindrique ; fa tête eft une petite palege qui fert à
la tenir avec plus de fureté ; fa courbure eft grande ,
ÔC formé iinê pahfe pour donner plus dé’ jeirà Fini«