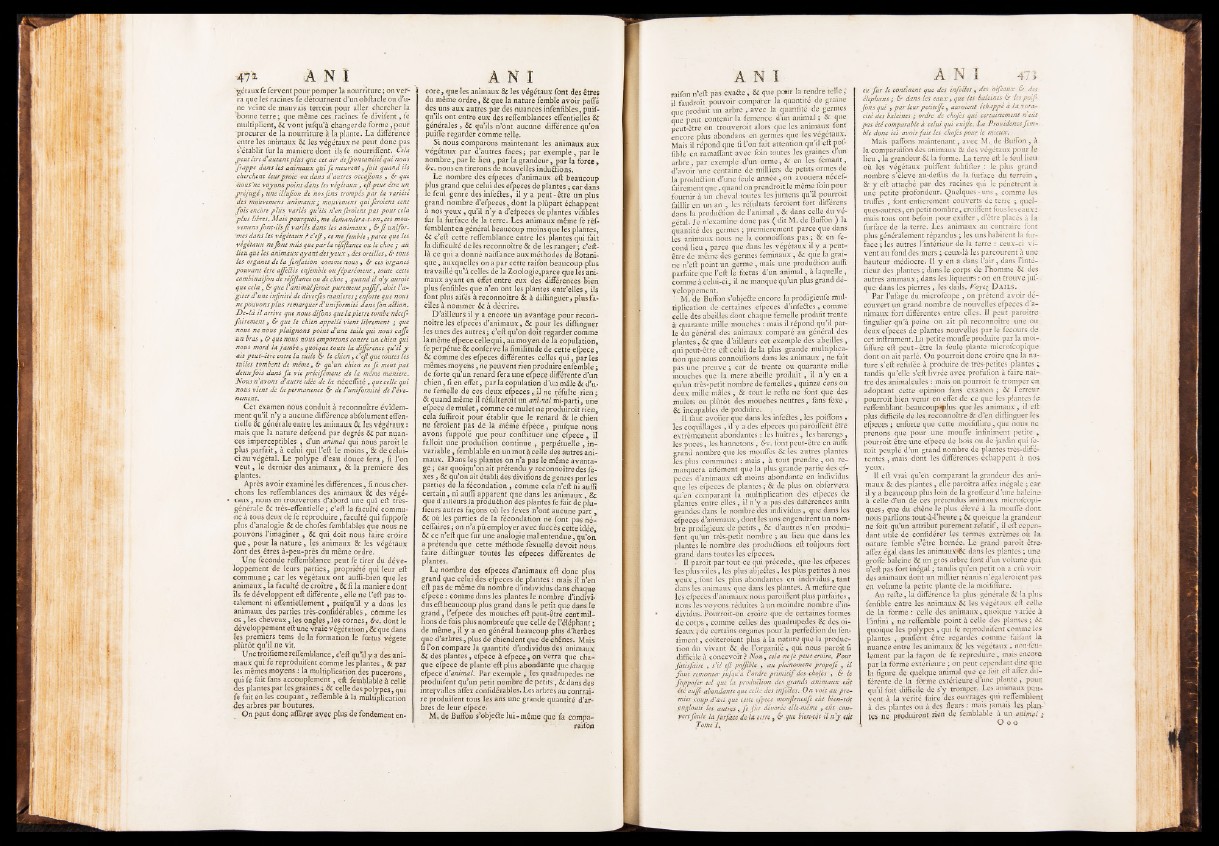
l'étaux fe fervent pour pomper la nourriture ; on vef- 1
ra que les racines fe détournent d’un obftacle ou d’une
ve'irré de mauvais terrein pour aller chercher la
"bonne terre; que même ces,racines fe divifent, fe
multiplient, 8c vont jufqu’à changer de forme ,pour :
'procurer de la nourriture-à la plante. La différéncè ;
entre les animaux iSc les végétaux ne peut, donc pas
s’établir fur la maniéré dont ils fe riourriffent. Cela ■
peut être tCautant plus que cet air defp'ontaneïtê qui nous
frappe dans l'es animaux qui fe meuvent, foit quand ils
cherchent leur proie ou dans d'autres occafons , & que
nous ne voyons point-dans les végétaux , eft peut-être un
préjugé y une illufion de nos fens trompés par la variété
des m'ouvemehs animaux ; mouvemens qui feroient cent
fo is encore plus variés qu'ils rien feroient pas pour cela
plus libres. Mais pourqudiy hie dcmandera-t-ony ces mouvemens
font-ilsfi variés dans les animaux y & f i unifor-
"mes dans les végétaux ? c'ejl, ce nie femble y parce que les
végétaux neJbnt mus que parla réfifiance ou le choc ; ait
Heu que tes animaux ayant des yeux y des oreilleSy & tous
les organes de la fenfaiion comme nous , & ces organes
-pouvant être affectés enfemble ou féparément, toute cette
combinaifon de réjijlahce ou de choc , quand il ri y aurait
que cela, & que l'animalferoït purementpaffif, doit l'agiter
d'une infinité de diverfes maniérés; enforte que noùi
ne pouvons plus remarquer d'uniformité dansfon action.
De-la, il arrive que nous difons que la pierre tombe nécef-
■ fairement, & que le chien appellé vient librement ; que
■ nous ne nous plaignons point dune tuile qui nous caffé
un bras y & que nous nous emportons contra un chien qui ,
nous mord la jambe y quoique toute la différence qu'il y
-ait peut-être entre la tuile & le chien , c'ejl que toutes les
tuiles tombent de même, & qriun chien ne Je meut pas
deux fois dans fa vie précifément de la même maniéré.
’Nousnavons d'autre idée de la néceffité , que celle qui
riotis vient de làpermanence & de l'imiformité de tévénement.
Cèt examen nous conduit à reconnoître évidemment
qu’il n’y a aucune différence abfolument effen-
tielle 8c générale entre les animaux 8c les végétaux :
mais que la nature defeend par degrés 8c par nuances
imperceptibles , d’un animal qui nous paroît le
plus parfait , à celui qui l’eft le moins, & de celui-'
c i au végétal. Le polype d’eau douce fera, fi l’on
v e u t , le dernier des animaux, & la première des
plantes.
Après avoir examiné les différences, fi nous cherchons
les reffemblances des animaux & des végétaux
, nous en trouverons d’abord une qui eft très-
jgénérale 8c très-effentielle ; c’eft la faculté commune
à tous deux de fe reproduire, faculté qui fuppofe
plus.d’analogie 8c de chofes femblables que nous ne
pouvons l’imaginer , & qui doit nous faire croire
que , pour la nature, les animaux & les végétaux
iont des êtres à-peu-près du même ordre.
Une fécondé reffemblance peut fe tirer du développement
de leurs parties, propriété qui leur.eft
commune ; car les végétaux ont aufîi-bien que les
animaux, la faculté de croître, & fi la maniéré dont
ils fe développent eft différente, elle ne l’eft pas totalement
ni effentiellement, puifqu’il y a dans les
animaux des parties très-confidérables, comme les
o s , les cheveux, les ongles, les cornes, &c. dont le
développement eft une vraie végétation, 8c que dans
les premiers tems de la formation le foetus végété
plutôt qu’il ne vit.
Une troifieme reffemblance, c’eft qu’il y a des animaux
qui fe reproduifent comme les plantes , & par
les mêmes moyens : la multiplication des pucerons,
qui fe fait fans accouplement, eft femblable à celle
des plantes par les graines.; & celle des polypes, qui
fe fait en les coupant, reffemble à la multiplication
des arbres par boutures.
On péut donc aflurer avec plus de fondement encorè,
que les animaux 8c les végétaux font des êtres
du même ordre, 8c que la nature femble avoir paffé
des uns aux autres par des nuances infenfibles, puif-
qu’ils ont entre eux des reffemblances effentiélles 8t
générales , 8c qu’ils n’ont aucune différence qu’on
puiffe regarder comme telle.
Si nous comparons maintenant les animaux aux
végétaux par d’autres faces ; par exemple, par lé
nombre, par le lieü , par la grandeur,, par la force,
&c. nous en tirerons de nouvelles induirions.
Le nombre des efpeces d’animaux èft beaucoup
plus grand que celui des efpeces de plantes ; car dans
le feul genre desinfeftes, il y a peut-être un plus
grand nombre d’efpeces, dont la plupart échappent
a nos y e u x , qu’il h y a d’efpeces de plantes vifibles
fur la furface de la terre. Les animaux même fe rëf-
femblent en général beaucoup moins que les plahtes,
8c c’eft cette reffemblance entre lés plantes qui fait
la difficulté de les reconnoître & de les ranger ; c’eft-
là ce qui a donné naiffance aux méthodes de Botanique
, auxquelles on a par cette raifon beaucoup plus
travaillé qu à celles de la Zoologie,parce que les animaux
ayant en effet entre eux des différences bien
plus fenfibles que n’én ont les plantes éntr’elles, ils
font plus aifés à reconnoître & à diftinguer, plus faciles
à nommer 8c à décrire»
D ’ailleurs il y à encore un avantage pour recoii-
noître les efpeces d’animaux, 8c pour les diftinguer
■ les unes des autres ; c’eft qu’on doit regarder comme
la même efpece celle qui , au moyen de la copulation,
fe perpétue & conferve la fimilitude de cette efpece ,
8c comme des efpeces différentes celles qui, parles
mêmes moyens, rie pëiivérit rien produire enfemble ;
de forte qu’un renard fera une efpece.différente d’un
chien, fi eh effet, par la copulation d’Uii mâle & d’une
femelle de ces deux efpeces,-„ilne réfultë rien;
& quand même il réfulteroit un animal mi-parti, iirie
efpece de mulet, comme ce mulet ne produiroit rièn,
cela fuffiroit pour établir que le reriard & le chien
ne feroient pas de la même efpece, piiifque nous
avons fuppofé que pour conftituer une efpece , il
falloit une production continue , perpétuelle , invariable
, femblable en un mot à celle des autres animaux.
Dans les plantes on n’a pas le même avantage
; car quoiqu’on ait prétendu y reconnoître des fe-
xes y 8c qu’On ait établi des di virions de genres par les
parties de la fécondation , comme cela ri’eft ni aüflï
certain, ni auffi apparent que dans les animaux, 8c
que d’ailleurs la production dès plantes fe fait de plusieurs
autres façons oîi les fëxes n’ont aucune part ,
8c où les parties de la fécondation nè font pas né-
ceffaires ; on n’a pû employer avec füccès cette idée,
8c ce n’eft que fur une analogie mal entendue, qu’on
a prétendu que cette méthode fexuelîe devoit nous
faire diftinguer toutes les efpeces différentes de
plantes.
Le rtômbre des efpeces. d’animaux eft donc plus
grand que celui des efpeces de plantes : mais il n’en
eft pas de même du nombre d’individus dans chaque
efpece : comme dans les plantes le nombre d’individus
eft beaucoup plus grand dans le petit que dans le
grand, l’efpece des mouches eft peut-être cent millions
de fois plus nombreufe que celle de l’éléphant ;
de même, il y a en général beaucoup plus d’herbes
que d’arbres, plus de chiendent que de chênes. Mais
ri l’on compare la quantité d’individus des animaux
& des plantes, efpece à efpece, on verra que chaque
efpece de plante eft plus abondante que chaque
efpece ri animal. Par exemple , les quadrupèdes ne
produifent qu’un petit nombre de petits, & dans dès
intervalles affez confidérables. Les arbres au contraire
produifent tous les ans une grande quantité d’arbres
de leur efpece.
M. de Buffon s’objeéte lui-même que fa compa-
raifon
ïaifon n’eft pas èx aû e, & que p a ir la rendre telle ;
il faudroit pouvoir comparer la quantité de graine
que produit un arbre , avec, la quantité de germes
que peut contenir la femence d’un animal ; & que
peut-être on trouveroit alors que les animaux font
encore plus abondans en germes que les végétaux.
Mais il répond que fi l’on tait attention qu’il eft pof-
fible en ramaffant avec foin toutes les graines d un
arbre , par exemple d’un orme, & en les femarit,
d’avoir une centaine de milliers de petits, ormes de
la production d’une feule année, on avouera necef-
feirement que, quand on prendrait le même foin pour
fournir à un cheval toutes les jumens qu’il pourrait
faillir en un an , les rcfultats feroient fort différons
dans la production de l’animal, & dans, celle du végétal.
Je n’examine donc pas (dit M. de Buffon ) la
quantité des germes ; premièrement parce que dans
les animaux nous ne .la eonnoiffons pas ; & en fécond
lieu, parce que dans les végétaux il y a peut-
être de même des germes feminaux, 8c que la graine
n’eft point un germe , mais une production auffi
parfaite que l’eft le foetus d’un animal, à laquelle ,
comme à celuirci, il ne manque 'qu’un plus grand développement.
' M. de Buffon s’objeCte encore la prodigieufe multiplication
de certaines efpeces d’infeCtes , comme
celle des abeilles dont chaque femelle produit trente
à quarante mille mouches : mais il répond^qu’il parle
du général des animaux comparé au général des
plantes, 8c que d’ailleurs cet exemple des abeilles
qui peut-être eft celui de la plus grande multiplication
que nous eonnoiffions dans les animaux , ne fait
pas une preuve ; car de trente ou quarante mille
mouches que la mere abeille produit , il n’y en a
qu’un très^petit nombre de femelles , quinze cens ou
deux mille mâles , & tout le refte ne font que des
mulets ou plûtôt des mouches neutres, fans fexe ,
8c incapables de produire. ^ .
- Il faut avoiier que dans les infeCtes, les poifforis >
les coquillages -, il y a des efpeces qui paroiffent être
extrèmeirient abondantes : les huîtres, les harengs ,
les puces, les hannetons, &c. font peut-être en auffi
grand nombre que les moufles & les autres plantes-
les plus communes : mais , à tout prendre , on remarquera
aifément que la plus grande partie des ef-:
peces d’animaux eft moins abondante en individus
que les efpeces de plantes ; & de plus on obfervera
qu’en comparant la multiplication des efpeces de
plantes entre elles , il n’y a pas des différences auffi
grandes dans le nombre des individus, que dans les
efpeces d’animaux, dont les Uns engendrent Un nombre
prodigieux de petits y 8c d’autres n’en produifent
qu’un très-petit nombre ; au lieu que dans les
plahtes le nombre des produirions eft toûjôurs fort
grand dans toutes les efpeces»
. Il paroît par tout ce qui précédé , que -les efpeces
les plus viles, les plus abjeûes, les.pliis petites à nos
yeux , font les plus abondantes en individus tant
dans les animaux que dans les plantes.. A mefure que
les efpeces d’animaux nous paroiffent plus parfaites,
nous les voyons, réduites à un moindre nombre d’individus.
Pourroit-ton croire qrie de certaines formes
de corps, comme celles des quadrupèdes & des oi-
feauxfdè certains organes pour la perfeôion du fen-
timent, coûteroient plus à la nature que la production
du vivant 8c de l’organifé. -, qui nous paroît fi
difficile à concevoir? Non, cela-neJe peut croire. Pour
fatisfaire , s'il eft pojjîble , aù phénomène propofé , il
faut remonter jufqrià l'ordre primitif des çhojes ', & le
fuppofer tel que la production des grands animaux eut
été auffi abondante que celle des infectes. On voit au premier
coup d'oeil que cette efpece monjlrueiife eût bien-tôt
englouti les autres .Je fut dévorée elle-même , eût cou-r
yert feule la Jurfitce de la terre, & que bien-tçt il n'y eût
J ’orne‘1 ,
êu fur le continent que des infectes , des oifeaux & des
êlephans ; & dans les eaux, que les baleines & les poif-
fons qui , par leur pedtxffe , auroient échappé a la voracité
des baleines ; ordre de chofes qui certainement ri eût
pas été comparable cl celui qui exifie. La Providence femble
donc ici avoir fait les c'hojes pour le mieux.
Mais paffons maintenant, avec M.. de Buffon , à
la comparaifon des animaux & des végétaux pour le
lieu , la grandeur 8c la forme. La terre eft le feul lieu
où les végétaux puiffent fubfifter : le plus grand
nombre s’eleve au-deffus de la furface du terrein ,
& y eft attaché par des racines qui le pénètrent à
une petite profondeur. Quelques-uns , comme les
truffes , font entièrement couverts de terre ; quel-
ques-autres, en petit nombre, croiffent fous les eaux:
mais tous ont befoin pour exifter, d’être placés à la
furface de la terre. Les animaux au contraire font
plus généralement répandus ; les uns habitent la fur-
face ; les autres l ’intérieur de la terre : ceux-ci vivent
au fond des mers ; ceux-là les parcourent à une
hauteur médiocre. Il y en a dans l’air , dans l’intérieur
des plantes ; dans le corps de l’homme 8c des
autres animaux; dans les liqueurs : on en trouve juf-
que dans les pierres, les dails. Voye^ D a i l s .
Par 1 ufage du microfcope , on prétend avoir découvert
un grand nombre de nouvelles.efpeces d’animaux
fort différentes entre elles. Il peut paroître
fingulier qu’à peine on ait pû reconnoître une ou.
deux efpeces de plantes nouvelles par le fecours de
cet infiniment. La petite moufle produite par la moi-,
fiffure eft peut-être la feule plante microfcopique
dont on ait parlé. On pourroit donc croire que la na-.
turc s’eft refufée à produire de très-petites plantes ;
tandis qu’elle s’eft livrée avec profufion à faire naî-.
tre des animalcules : mais on pourroit fe tromper en
adoptant cette opinion fans examen ; 8c l’erreur
pourroit bien venir en effet de ce que les plantes fe
reffemblant beaucoup <f>lus que les animaux, il eft
plus difficile de les, reconnoître & d’en diftinguer les
efpeces ; enforte que cette moififlure, que nous ne
prenons. que pour une moufle infiniment petite ,
pourroit être une efpece de bois ou de jardin qui fe-
noit peuplé d’un grand nombre de plantes très-différentes
,' mais dont les différences échappent à nos
yeux.
£ jjl eft vrai qu’en comparant la grandeur des animaux
& des plantes , elle paroîtra affez inégale ; car
il y a beaucoup plus loin de la groffeur d’une baleine
à celle d’un dë ces prétendus animaux microfcopi-
ques, que du chêne le plus élevé à la moufle dont
nous parlions tout-à-l’heure ; & quoique la grandeur
ne foit qu’un attribut purement relatif, il eft cependant
utile de confidérer les termes extrêmes où la
nature femble s’être bornée. Le grand paroît être-
affez égal dans les animaux*& dans les plantes ; une
groffe baleine 8c un gros arbre font d’un volume qui
n’eft pas fort inégal ; tandis qu’en petit on a crû voir
des animaux dont un millier réunis n’égaleroient pas
en volume la petite plante de la moififlure.
Au refte, la différence la plus générale 8c la plus
fenfible entre les animaux 8c les végétaux eft celle
, de la forme : celle des animaux , quoique variée à
f’irifini -, ne reffemble point à celle des plantes ; 8c
quoique les polypes , qui fe reproduifent comme les
plantes , puiffent être regardés comme faifant la
nuance entre les animaux 8c les végétaux, non-leu-
lemént par la façon de fe reproduire, mais encore
par la forme extérieure ; on peut cependant dire que
la figure de quelque animal que ce foit èft affez différente
de la forme extérieur^ d’une planté , pour
qu’il foit difficile de s’y tromper. Les animaux peuvent
à la vérité faire des ouvrages qui reffemblent
à des plantes où à des fleurs : mais jamais les plan-'
tes ne produiront rien de femblable à un animal ;
, ......... “ ** O o o