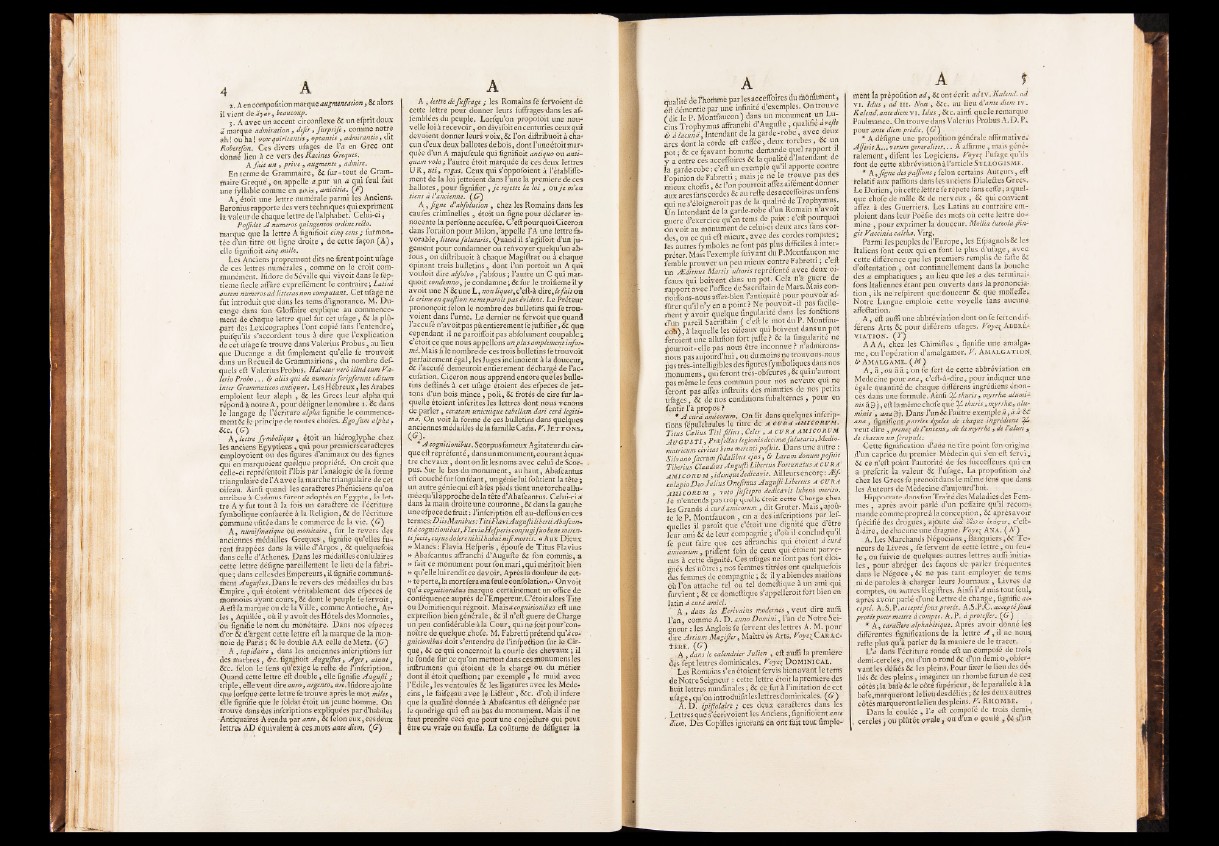
4 A
2. A en corrtpofition marque augmentation, & alors
il vient de ayav , beaucoup. _
3. A avec un accent circonflexe Sc un eiprit doux
5 marque admiration > dejîr, furprife, comme notre
ah ! ou hà ! vox quiritantis, optantis , admirantis, dit
Robertfon. Ces divers ufages de Va en Grec ont
donné lieu à ce vers des Racines Greques.
A fait un , prive , augmente, admire.
En terme de Grammaire, & fur-tout de Grammaire
Greque', on appelle a pur un a qm feul fait
une fyllable comme en tptxiet, amicitia. ÇP)
A , étoit une lettre numérale parmi les Anciens.
Baronius rapporte des vers techniques qui expriment
la valeurde chaque lettre de l’alphabet. Celui-ci,
Pojjidet A numéros quingentos ordine reclo.
marque que la lettre A fignifïoit cinq cens ; furmon-
tée d’un titre ou ligne droite , de cette façon (A ) ,
elle fignifïoit cinq mille.
Les Anciens proprement dits ne firent point ufage
de ces lettres numérales , comme on le croit communément.
Ifidore de Séville qui vivoit dans le fep-
tieme fiecle aflïire expreflement le contraire \Laûm
autem numéros ad litteras non computant. Cet ufage ne
fut introduit que dans les tems d’ignorance. M. Du-
cange dans fon Gloffaire explique au commencement
de chaque lettre quel fut cet u fage, Sc la plupart
des Lexicographes l’ont copié fans l’entendre*,
puifqu’ils s’accordent tous à dire que l’explication
de cet ufage fe trouve dans Valerius Probus, au lieu
que Ducange a dit Amplement qu’elle fe trouvoit
dans un Recueil de Grammairiens, du nombre desquels
eft Valerius Probus. Habetur vero illud cum V 2-
lerio Probo. . . & aliis qui de numerisferipferunt editum
inter Grammaticos antiquos. Les Hebreux, les Arabes
emploient leur aleph , Sc les Grecs leur alpha qui
répond à notre A , pour défigner le nombre 1. Sc dans
.le langage de l’écriture alpha fignifie le commencement
& le principe de toutes chofes. Ego fum alpha >
& c . (G) .
A , lettre fymbolique , étôit un hiéroglyphe chez
le s anciens Egyptiens , qui pour premiers carafteres
employoient ou des figüres d’animaux ou des Signes
qui en marquoient quelque propriété. On croit que
celle-ci repréfentoit l’Ibis par l’analogie de la forme
triangulaire de l’A avec la marche triangulaire de cet
oifeau. Ainfi quand les carafteres Phéniciens qu’on
attribue à Cadmus furent adoptés en E gypte, la lettre
A y fut. tout à la fois un caraûere de l’écriture
fymbolique confacrée à la Religion, & dé l’écriture
commune ufitée dans le commerce de la vie. (G)
A , numifmatique ou i/iànétaire , fur le revers des
anciennes médailles Greques, fignifie qu’elles fuirent
frappées dans là v ille d’Argos , & quelquefois
dans celle d’Athenês. Dans les médailles conlulàires
cette lettre défigne pareillement le lieu de la fabrique
; dans celles des Empereurs, il fignifie communément
Augujlus.Dans le revers des médailles du bas
Empire , qui étoient véritablement des efpeces de
monnoies ayant cours, St dont le peuple fe l’ervoit,
A efr la marque ou de la Ville, comme Antioche, Arles
, Aquilée, où il y avoit des Hôtels des Monnoies,
ou fignifie le nom du monétaire. Dans nos efpeces
d’or & d’argent cette lettre eft la marque dè la mon-
-uoie de Paris ; Sc le double AA celle de Metz. (G)
; A , lapidaire , dans les anciennes inferiptions fur
des marbres, fignjfiôit Augufius, Ager, aiunt,
& c . félon le fens qu’exige le refte de l’infeription.
Quand cette lettre eft double, elle fignifie Augujli ;
triple, elle veut dire auro , argento, are. Ifidore ajoute
qu.e lorfque cette lettre fe trouve après le mot miles,
elle fignifie que le foldat étoit un jeune homme. On
trouve dans des inferiptions expliquées par d’habiles
Antiquaires A rendu par ante, & félon eux, ces deux
lettres AD équivalent à. cesonots ante diem, (G)
A
A , Utite de fujffrage ; les Romains fe fefVoieht de
cette lettre pour donner leurs fuffrages-dans les afi
femblées du peuple. Lorfqu’on propofoit une nouvelle
loi à recevoir, on divifoiten centuries ceux qui
dévoient donner leurs voix, Sc l’on diftribuoit à chacun
d’eux deux ballotes de bois, dont l’une étoit mar-»
quée d’un A majufcule qui fignifïoit antiquo ou anti-
quam volo; l’autre étoit marquée dé ces deux lettres
U R , uii, rogas. Ceux qui s’oppofoient à l’établifTe-
ment de la loi jettoient dans Time la première de ces
ballotes, pour lignifier, je rejette la loi , ou je m'en
tiens à l'ancienne. (G)
A 9 figue d'abfolution , chez les Romains dans les
caufes criminelles , étoit un ligne pour déclarer innocente
la perfonneaccufée. C ’eft pourquoi Cicéron
dans l’orailon pour Milon,'appelle l’A une lettre favorable,
littera falutaris. Quand il s’agilfoit d’un jugement
pour condamner ou renvoyer quelqu’un ab^
lous, on diftribuoit à chaque Magiftrat ou à chaque
opinant trois bulletins , dont l’un portoit un A qui
vouloit dire abfolvo, j’abfous ; l’autre un C qui mar-
quoit condemno, je condamne ; Sc fur le troifiéme il y
avoit une N & une L , non liquet, c’eft-à dire, le fait ou
le crime enquejlion nemeparoît pas évident. Le Préteur
prononçoit félon le nombre des bulletins qui fetrou-
voient dans l’urne. Le dernier ne fer voit que quand
l’accufé n’avoitpas pu entièrement fe juftifier, Sc que
cependant il neparoifloitpas abfolument coupable;
c’étoit ce que nous appelions un plus amplement informé.
Mais fi le nombre de ces trois bulletins fe trouvoit
parfaitement égal, les Juges inclinoient à la douceur,
St i’accufé demeurait entièrement déchargé de l’ac-
eufation. Cicéron nous apprend encore que les bulletins
deftinés à cet ufage etoient des efpeces de jet-
tons d’un bois mince, poli, Sc frotés de cire fur laquelle
étoient inferites les lettres dont nous venons
de parler, ceratam unicuique tabellam dari cerd légitima.
On voit la forme de ces bulletins dans quelques
anciennes médailles de la famille Cafia. V. Jettons#
i G> . . . ■
A cogmtionïbus. Scorpus fameux Agitâtéur du cirque
eft repréfenté, dans un monument, courant à quatre
chevaux, dont on lit les noms avec celui de Scorpus.
Sur le bas du monument, au haut, Abafcantus
eft couché fur fon féant, un génie lui foûtient la tête;
un autre génie qui eft à fes pieds tient une torche allu-'
mée qu’il approche de la tête d’Abafcantus. Celui-ci ai
dans la main droite une couronne, & dans la gauche
uneefpecede fruit : l’infeription eft au-defTous en ces
termesiDiisManibus: TitiFlaviAuguJli libertiAbafcan-
ti à cognitionibus, FlaviaHefperis conjugifuo bene meren-
tifecit3cujusdolerenïhilhabuinifimortis. «Aux Dieux
» Mânes : Flavia Hefperis, époufe de Titus Flavius
» Abafcantus affranchi d’Augufte Sc fon commis, a
» fait ce monument pour fon mari, qui méritoit bien
» qu’elle lui rendît ce devoir. Après la douleur decet-
» te perte, la mort fera ma feule confolation.» On voit
qu’à cognitionibus marque certainement un office de
conféquence auprès de l’Empereur. C’étoit alors Tite
ou Domitienquirégnoit. Mais à cognitionibus eft une
expreffion bien générale, Sc il n’eft guere de Charge
un peu confidérable à la Cour, qui ne foit pour'con-
noître de quelque ehofe. M. Fabretti prétend qu’à cognitionibus
doit s’entendre de l’infpeélion fur le Cirque,
Sc ce qui concernoit la courte des chevaux ; il
fe fonde fur ce qu’on mettoit dans ces mônumensles
inftrumens qui étoient de la charge ou du métier
dont il étoit queftion; par exemple , le muid avec
l’Edile, les ventoufes Sc les ligatures avec les Meder
cins, le fâifceau avec le Lifreur, & c . d’où, il inféré
que la qualité donnée à Abafcantus eft défignée par
le quadrige qui eft au bas du monument. Mais il ne
faut prendre ceci que pour une conje&ure qui peut
être ou vraie ou fauflè. La couturée de défigner la
Aiaiîté àèrhommfe tiarlesacceflbu-es aufflbmiment,
<üft démentie par une infinité d’exemples. On trouve
?dit le P. Montfaueon ) dans Un monument un Lutins
Trophymus affranchi d’Augufte , qualifie avefle
ù M È È m Intendant de la garde-robe, avec deux
arcs dont la corde eft caffée , deux torches , & un
pot ; Sc ce fçavant homme demande quel rapport il
y a entre ces acceffoires & la qualité d Intendant de
ta carde-robe : c’eft un exemple qu’il apporte contre
l’opinion de Fabretti ; mais je ne le trouve pas des
mieux choifis, & l’on pourroit affezaifément donner
aux arcs fans cordes & au refte dés àcceffotres unfens
qui ne s’élôigneroit pas de la'qualité de Trophymus.
Un Intendant de la garde-robe d’un Romain n avoit
èuere d’exercice qu*en tems de paix : c’eft pourquoi
on voit au monument de celui-ci deux arcs fans cor-
des, ou ce qui eft mieux, avec des cordes rompîtes ;
lés autres fymboleS ne font pas plus difficiles à interpréter.
Mais l’exemple fuivant du P.Montfaucon me
femble prouver un peu mieux contre Fabretti ; c eft
un Ædituus Munis Otait repréfenté avec deux 01-
féaux qui boivent dans un pot. Cela n’a guere de
rappott avec l’office de Sacriftain de Mats. Maiscon-
noifforts-nails affez-bien l’antiquité pour pouvoir affûter
qu’il n’y en a point ? Né pouvoit - il pas facile-
ment y avoir quelque fingtilarité dans les fonctions
d’un pafeil Sacriftain ( C’eft le mot du P. Montfau-
coto), à' laquelle les ôifeaux qui boivent dans un pot
feraient une allufion fort jufte ? & la fingularite ne
pourrait- elle pas nous être inconnue ? n’admirons-
rtôlts pâs aujourd’hui, ou du moins ne trouvons-nous
pas très-intelligibles des figures fymboliques dans nos
mottuirtens, qui fetont très-dbfcUres, & qui n’auront
pas même lè fens commun pour nos neveux qui ne
feront pas aflêz inftruits des minuties de nos petits
ùfàges, & de 110s conditions fubaltërnes , pour en
fentir l’à propos ? . .
* A cura drnicorum. On lit dans quelques mfcrip-
tiôns fépülchrales le titre de a c ü r a a m i c o r u m .
Titus Calius Tiii filius, Celer, A C U R A a m i c o r u m
A ü ÔUSTI, Pr&feclus legionis décima falutaris, Medio-
matrieurn civitas bene mer end pofuit. Dans une autre :
Silvânô facrumfodalibtis ejus, & Ldrum donumpofuit
Tiberius C la u d iu sAugujliLibertusFortunatusA c u r a '
a m i c o r u M, idemquededicavit. Ailleurs encore : Æf-
culapioDeo Julius O nefimus Augujli Libertus A C U R A
À M i C O R V M , voto füfttpto dedicavit lubenS merito.
Je n’enténds pas trop quelle étoit cette Charge chez
les Grands à cura amicorum, dit Grüter. Mais, ajoute
le P. Montfaueon , on a des inferiptions par lef-
quelles il paraît que c’étoit Une dignité que d’être
leur ami & de leur compagnie ; d’ôù il eoncludqu il
fé peut faire que èes affranchis qui etoient a cürâ
amicorum 9 prifleflt foin de Ceux qui étoient parvenus
à cette dignité. Ces ufages ne font pas fort éloignés
des nofrèS; fiers femmes titrées ont quelquefois-
des femmes de compagnie ; & il y a bien des maifons
où ï’ôn attache tel ôli tel domeftique à un ami qui
fûrviènt ; St ce domeftique s'appellerait foft bien en
latin à cura amici. '
‘ A» dans les Ëctivaïhs modernes, veut dire aufli
l ’an, comirie A. D. anno Domini, l’an de Notre Seigneur
: les Anglois fe fervent des lettres A. M. pour
dire Artium Magifer, Maître es Arts. Voye{ C ARAd-
f ÈRE. (G ) .
, A , dans le calendrier Julien , eft auffi la première
âès fèpt lettres dominicales. Voye{ D ominical.
T Les Romains s’en étoient fervis bien avant le tems
de Notre Séigriair : cette lettre étoit la première des
huit lettres nundinaleS ; Sc ce fut à l’imitation de cet
ufage .q ü ’on introduifit lés lettrés dominicales; (G )
A. D. épijlolairè ; cès deux cara&eres dans les
Lettres que s’écriyoîent les Anciens, fignifioient ante
A y
mèftt la prépofition ad, & on t écrit adiv. Kalend. ad
v i. Idus , ad m . Non , & c . au lieu d'ante diem iv .
Kalend. ante diemvi. Idus., & c . airifi que le remarque
Paulmance. On trouve dans Valerius Probiis A. D. P.
pour ante diempridie. (G )
* A défigne une propofition générale affirmative.’
Afferit A... Ver uni generaliter... A affirme , mais généralement
, difent les Logiciens. Voye{ l’ufage qu’ils
font de cette abbréviâtion à l’article Syllogisme.
* A ifigtie despajjîonsj félon certains Auteurs, eft
Relatif aux pallions dans les anfciens Dialefres Grecs.
Le Dorien, bù cette lettre fe répété fans ceffe ^ a quelque
chofe de mâle St dé nerveux , 6c qui convient
allez à des Guerriers. Les Latins au contraire emploient
dans leur Poëfie des mots où cette lettre domine
, pour exprimer la douceur. Mollia luteola fin-
git Vaccinia caltha. Virg.
Parmi les peuplés de l’Europe, les EfpâgnolsSc les
Italiens font ceux qui en font le plus d’ulage, avec
cette différence que les premiers remplis de fafte Sc
d’oftentatioh ont continiiellement dans la bouché
des a emphatiques ; au lieu que les a des terminai-
fons Italiennes étant peu ouverts dans la prononciation
, ils ne refpirent que: douceur & que mollefîe.
Notre Langue.emploie cette voyelle fans aucune
affe&atiori.. _ ' _ .
A , eft auffi Une abbréviation dont On fe fertendif-
férens Arts & pour différens ufages. J ^ c^ Abbré-
yiàtion. (T ) i A A Aj chez. les Chimiftes , fignifie une amalgame,
ou l’opération d’amalgamer. E. Amalgation.
& Amalgame. (iW)
A , a , ou â â ; on fe fert de cette abbréviation en
Medecine pour ana, c*eft-à-dire, pour indiquer une
égale quantité de chaque différens ingrédiens énon-
ces dans une formule. Ainfi I f thuris, myrrha alumi-
nis â 9 j , eft la même cho'fe qlte I f thuris.) myrrha, alu-
minis \ anaBj. Dans l’unôc l’autre exempleà,àà Sc
ana, fignifient’parties égales de chaque ingrédient Of.
veut dire , prene^ de l'encens $ de la myrrhe , de F alun +
de chacun un fcrupuléi ..
Cette lignification d’ààà ne tire point fon-origine
.d’un caprice du premier Médecin qui s’en eft fe tv i,
Sc ce n’eft point l’autorité de fes fuccefleurs qui en
a preferit la valeur Sc 'l’ufage. La propofition «V«
chez les Grecs fe prenoitdans le même fenfi que dans,
les Auteurs de Medecine d’aujourd’hui.
Hippocrate dans fon T raité .dés Maladies des F cm-
mes , après avoir parlé d’un peftaire qù’il recom-i
mande comme propre à la conception, Sc après avoir
fpécifié des drogues, ajoute àva cCoXov tKaç-ov, c’eft-
à-dire, de chacune une dragnie< Voye^ AN A. ( N')
A. Les Marchands Négocians., Banquiers, Sc Te^
neürs de Livres, fe fervent de eetté lettre, ou feu-'
l e , ou fuivie de quelques-autres lettres auffi initia-,
le s , pour abréger des façons de parler fréquentes-
dans le Négoce , Sc ne pas tant employer de temS;
ni de paroles à charger leurs Journaux , Livres de
comptes, ou autres Regiftres. Ainfi Y A mis tout feul,,
après avoir parlé d’une Lettre de change, fignifie accepté.
A. S. P .accepté fous protêt. A.S.P.C. accepté fous
protêt pour mettre à compte. A. P. à protefler; (G )
* A , caractère alphabétique. Après avoir donné les-
différentes fignifications de la lettre A ,41 ne nou^
refte plus qu’à parler de la maniéré de le tracer. ,
Va dans l’écriture ronde eft un cômpofé de trois
demi-eerelèS , ou d’un o rond Sc d’un demi o , pbfer-*;
vantles déliés Sc les pleins. Pour fixer le lieu des dé->
liés Sc des pleins, imaginez un rhombe furun de ces.
côtés ; la bafe Sc le côte fupérieur, & le parallèle a la
bafe,marqueront le lieu des déliés ; & les deux autres
côtés marqueront le lieu des pleini. W; Rhombe. ,
Dans la coulée , l'a eft compofé de trois demi-.
, cerclés ? où plûtôt évale j où d’un 0 coulé » ^ d’un