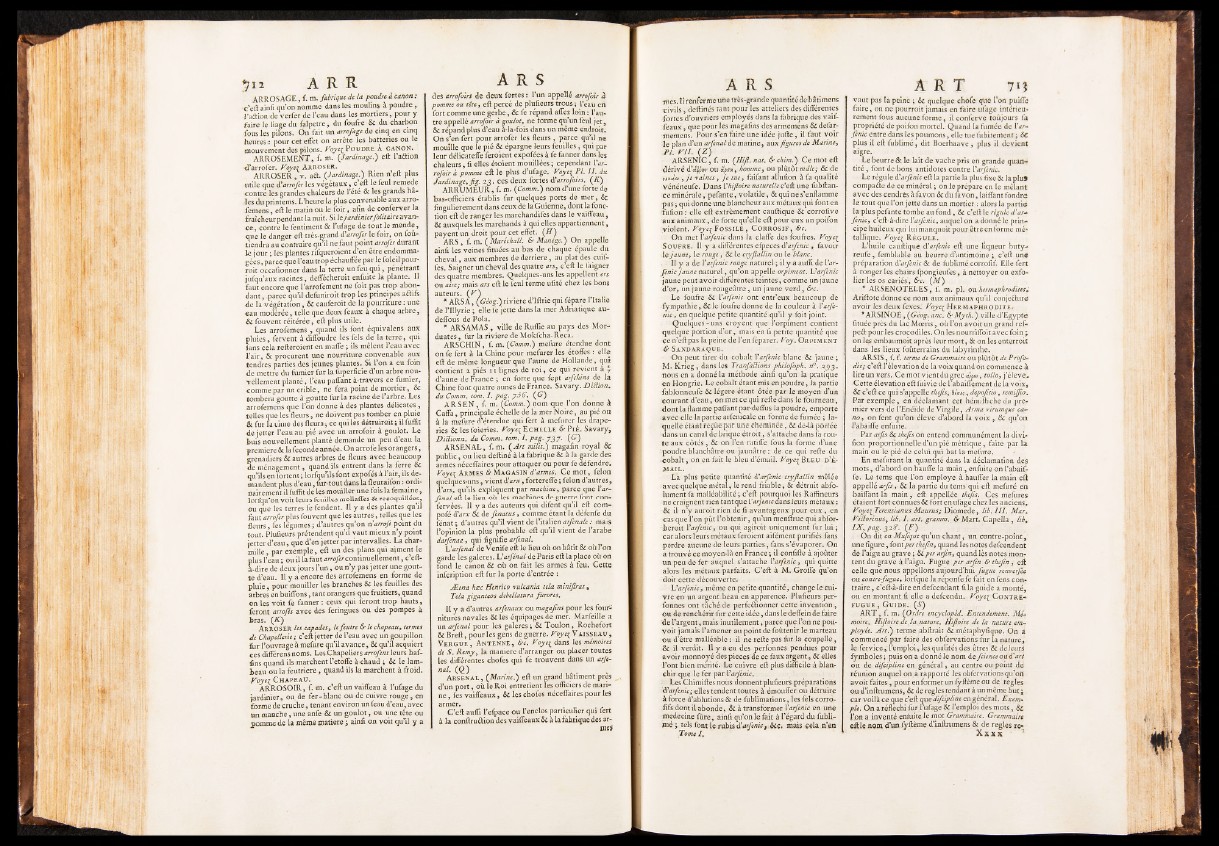
jii. A R R ARROSAGE, f. m. fabrique de U foudre i teuton :
■ c’eft ainfi tju’on nomme dans les .moulins à poudre,
l ’aftion de verier de l’eau dans les mortiers, pour y
faire le liage du falpetre, du foufre S c du charbon
fous les pilons. On fait un tmofage de cinq en cinq
heures t pour cet effet on arrête les batteries ou le
mouvement des pilons. Voye^ Po u d r e À c a n o n .
ARROSEMENT, f. m. ( Jardinage.) eft l’aflion
xTarrofer. Vqye^ A r r o se r .
ARROSER , v . aft. (Jardinage.) Rien n elt plus
utile que d'arrofer les végétaux, c’ eft le feul remede
contre les grandes chaleurs de l’été & les grands haie
s du printems. L’heure la plus convenable aux arrofemens
, eft le matin ou le foir, afin de conferver la
fraîcheur pendant la nuit. Si 1 ejardinierfolitaire avanc
e , contre le fentiment & l’ufage de tout le monde,
que le danger eft très-grand d'arrofer le foir, on foû-
tiendra au contraire qu’il ne faut point arrofer durant
le jour ; les plantes rifqueroient d’en etre endommagées
, parce que l’eau trop echauffee par le foleil pour-
roit occafionner dans la terre un feu qui, pénétrant
jufqu’aux racines, deffécheroit enfuite la plante. II
faut encore que l ’arrofement ne foit pas trop abondant,
.parce qu’il defuniroit trop les principes afrifs
■ de la végétation, 6c cauferoit de la pourriture : une
eau modérée, telle que deux féaux à chaque arbre,
6>c fouvent réitérée, eft plus utile.
Les arrofemens , quand ils font équivalens aux
pluies, fervent à diffoudre les fels de la terre, qui
làns cela refteroient en maffe ; ils melent l’eau avec
l’air, & procurent une nourriture convenable aux
tendres parties des jeunes plantes. Si l’on a eu foin
de mettre du fumier fur lafuperficie d’un arbre nouvellement
planté, l’eaupaffant a-travers ce fumier,
comme par un crible, ne fera point de mortier, 6c
tombera goutte à goutte fur la racine de 1 arbre. Les
arrofemens que l’on donne à des plantes délicates,
telles que les fleurs, ne doivent pas tomber en pluie
& fur la cime des fleurs, ce qui les détruiroit ; il fuffit
de jetter l’eau au pié avec un arrofoir à goulot. Le
buis nouvellement planté demande un peu d’eau la
première & la fécondé annee. On arrofe les orangers,
grenadiers 6c autres arbres de fleurs avec beaucoup
de ménagement, quand ils entrent dans la^ ferre 6c
qu’ils en fortent ; lorfqu’ils font expofés à l’air, ils demandent
plus d’eau, fur-tout dans la fleuraifon : ordinairement
il fufiit de les mouiller une fois la femaine,
lorfqu’on voit leurs feuilles mollaffes & recoquillées,
ou que les terres fe fendent. Il y a des plantes qu’il
faut arrofer plus fouvent que les autres, telles que les
fleurs, les légumes ; d’autres qu’on n 'arrofe point du
tout. Plufieurs prétendent qu’il vaut mieux n’y point
jetter d’eau, que d’en jetter par intervalles. La charmille
, .par exemple, eft un des plans qui aiment le
plus l’eau ; ou il la faut arrofer continuellement, c’eft-
à-dire de deux jours l’un, ou n’y pas jetter une goutte
d’eau. Il y a encore des arrofemens en forme de
pluie, pour mouiller les branches 6c les feuilles des
arbres en buiffons, tant orangers que fruitiers, quand
on les voit fe fanner : ceux qui feront trop hauts,
feront arrofés avec des feringues ou des pompes à
bras. (R)
A r r o se r les capades, le feutre & le chapeau, termes
de Chapellerie ; c’eft jetter de l’eau avec un goupillon
ïur l’ouvrage à mefure qu’il avance, 6c qu’il acquiert
c e s différens noms. Les Chapeliers arrofent leurs baf-
fins quand ils marchent l’etoffe à chaud ; 6c le lambeau
ou la feutriere, quand ils la marchent à froid.
Voye^ C h a p e a u .
ARROSOIR, f. m. c’eft un vaiffeau à l’ufage du
jardinier, ou.de fer-blanc ou de cuivre rouge, en
forme de cruche, tenant environ un feau d’eau, avec
un manche, une anfe & un goulot, ou une tête ou
pomme de la même matière ; ainfi on voit qu’il y a
A R S des arrofoirs de deux fortes : l’un appelle arrofoir à
pomme ou tête, eft percé de plufieurs trous ; l’eau en
fort comme une gerbe, & fe répand affez loin : l’autre
appellé arrofoir à goulot, ne forme qu’un feul jet,
& répand plus d’eau à-la-fois dans un même endroit.
On s’en fert pour arrofer les fleurs , parce qu’il ne
mouille que le pié & épargne leurs feuilles, qui par
leur délicateffe feroient expofées à fe fanner dans les
chaleurs, fi elles étoient mouillées ; cependant IV-
rofoir à pomme eft le plus d’ufage. Voye^ PI. II. du
Jardinage, fig. 23. ces deux fortes à’arrofoirs. (A )
ARRUMEUR, f. m. (Comm.) nom d’une forte de
bas-officiers établis fur quelques ports de mer, &
fingulierement dans ceux de laGuienne, dont la fonction
eft de ranger les marchandifes dans le vaiflëau,
6c auxquels les marchands à qui elles appartiennent,
payent un droit pour cet effet. (H )
ARS , f. m. ( Marcchall. & Manège.) On appelle
ainfi les veines fituées au bas de chaque épaule du
cheval, aux membres de derrière, au plat des cuif-
fes. Saigner un cheval des quatre ars, c’eft le faigner
des quatre membres. Quelques-uns les appellent ers
ou aire; mais ars eft le feul terme ufité chez les bons
auteurs. (^ )
* ARS A , (Géog.) riviere d’Iftrie qui fépare l’Italie
de l’IUyrie ; elle fe jette dans la mer Adriatique au-
deflbus de Pola.
* ARSAMAS, ville de Ruflie au pays des Mor-
duates, fur la riviere de Mokfcha-Reca.
ARSCHIN, f. m. (Comm.) mefure étendue dont
on fe fert à la Chine pour mefurer les étoffes : elle
eft de même longueur que l’aune de Hollande, qui
contient 2 piés 11 lignes de r o i, ce qui revient à j
d’aune de France ; en forte que fept arfehins de la
Chine font quatre aunes de France. Savary. Diction,
du Comm. tom. I. pag. y5 6 . (G) >
A R S E N , f. m. (Comm.) nom que l’on donne à
Caffa, principale échelle de la mer Noire, au pié ou
à la mefure d’étendue qui fert à mefurer les draperies
6c les foieries. Voye^ E c h e l l e & P i é . Savary,
Dictionn. du Comm. tom. 1. pag. 73 7 . (G)
ARSENAL, f. m. ( Art milit.) magafin royal &
public, ou lieu deftiné à la fabrique & à la garde des
armes néceffaires pour attaquer ou pour fe défendre.
Voye^ A rm e s & Ma g a s in d'armes. Ce mot, félon
quelques-uns, vient d'arx, fortereffe ; félon d’autres,
d'ars, qu’ils expliquent par machine, parce que IV -
fenal eft le lieu où les machines de guerre font con-
fervées. Il y a des auteurs qui difent qu’il eft com-
pofé d'arx 6c de fenatus, comme étant la défenfe du
fénat ; d’autres qu’il vient de l’italien arfenale : mais
l’opinion la plus probable eft qu’il vient de l’arabe
darfenaa , qui fignifie arfenal.
Varfenal de Venife eft le lieu où on bâtit & où l’on
garde les galeres. Varfenal de Paris eft la place où on
Fond le canon & où on fait les armes à feu. Cette
infeription eft fur la porte d’entrée :
Ætna hac Henrico vulcania tela minijlrat,
Tela giganteos debellatura furores.
Il y a d’autres arfenaux ou magajîns pour les fournitures
navales 6c les équipages de mer. Marfeille a
un arfenal pour les galeres; 6c Toulon, Rochefort
6c Breft, pour les gens de guerre. Voye^ V a is s e a u ,
V e r g u e , A n t e n n e , &c. Voye{ dans les mémoires
de S. Remy, la maniéré d’arranger ou placer toutes
les différentes chofes qui fe trouvent dans un arje-
nal. (Q ) A ,
A r s e n a l , (Marine.) eft un grand batiment près
d’un port, où le Roi entretient les officiers de marine
, fes vaiffeaux, & les chofes néceffaires pour les
1 armer. C’eft auffi l’efpace ou l’enclos particulier qui fert
à la conftruftion des vaiffeaux & à la fabrique des armes
A R S
mes. 11 renferme üiîe très-grande quantité debâtimens
civils deftinés tant pour les atteliers des différentes
fortes d’ouvriers employés dans la fabrique des vaiffeaux
, que pour les magafins des armemens 6c defar-
memens. Pour s’en faire une idée jufte, il faut voir
le plan d’un arfenal de marine, aux figures de Marine,
PI. VU. ( Z )
ARSENIC, f. m. (Hifi. nat. & chim.) Ce mot eft
dérivé d’ajopm- ou dpe», homme, ou plutôt mâle; & de
VMcloe , je vaincs, je tue, faifant allufion à fa qualité
vénéneufe. Dans Yhiftoire naturelle c’eft une fubftan-
ce minérale, pefante, volatile, & qui nè s’ enflamme
pas ; qui donne une blancheur aux métaux qui font en
'fufion : elle eft extrêmement cauftique 6c corrofive
aux animaux, de forte qu’elle eft pour eux un poifon
yiolent. Voye[ F o s s i l e , C o r r o s i f , &c.
On met l'arfenic dans la claffe des foufres. Voyeç
S o u f r e . Il y a différentes efpeces d'arfenic, favoir
\e jaune, le rouge, 6c le cryftaïlin ou le blanc.
Il y a de YarJ'enic rouge naturel ; il y a auffi de IV -
fenic jaune naturel, qu’on appelle orpiment. Varfenic
jaune peut avoir différentes teintes, comme un jaune
d’or, un jaune rougeâtre, un jaune verd, &c.
Le foufre 6c Yarfenic ont entr’eux beaucoup de
fympathie, & le'foufre donne de la couleur à Y arfenic,
en quelque petite quantité qu’il y foit joint.
Quelques-uns croyent que l’orpiment contient
quelque portion d’o r , mais en fi petite quantité que
ce n’eft pas la peine de l’en fëparer. Voy. O r p im e n t
& San d à r a q u e v ■'
On peut tirer du cobalt Yarfenicblanc & jaune ;
M. K r ieg , dans les Tranfactions philofoph. n°. 293.
nous en a donné la méthode ainfi qu’on la pratique
en Hongrie. Le cobalt étant mis en poudre,.la partie
fablonneufe 6c légère étant ôtée par le moyen d’un
courant d’eau, on met ce qui refte dans le fourneau,
dont la flamme paflant par-deffus la poudre, emporte
avec elle la partie arfenicale en forme de fumée ; laquelle
étant reçue par une cheminée, 6c de-là portée
• dans un canal de brique étroit, s’attache dans fa route
aux côtés, 6c on l’en ratifie fous -la'; forme d’une
■ poudre blanchâtre ou jaunâtre : de ce qui refte du
•cobalt, on en fait le bleu d’émail. Voye£ Bl e u d ’ ém
a i l .
Là plus petite quantité <Yarfenic cryftaïlin mêlée
avec quelque métal , le rend friable, & détruit abfo-
lument fa malléabilité ; c’eft pourquoi les Raffineurs
ne craignent rien tant que Yarfenic dans leurs métaux :
& il n’y aurôit rien de fi avantageux pour eu x, en
cas que l’on pût l’obtenir, qu’un menftrue qui abfor-
beroit Yarfenic, ou qui agiroit uniquement fur lui ;
car alors leurs métaux feroient aifément purifiés fans
perdre aucune de leurs parties, fans s’évaporer. On
a trouvé ce moyen-là en France ; il confifte à ajouter
un peu de fer auquel s’attache Yarfenic, qui quitte
alors les métaux parfaits. C ’eft à M. Groffe qu’on
doit cette découverte.1
Varfenic, même en petite quantité , change le cuivre
en un argent, beau en apparence. Plufieurs per-
fonnes ont taché- de perfectionner cette invention,
ou de renchérir fur cette idée, dans le deffein de faire
de l’argent, mais inutilement, parce que l’on ne pou-
voit jamais l’amener au point de foûtenir le marteau
ou d’être malléable : il ne refte pas fur la coupelle.,
& il verdit. Il y a eu des perfonnes pendues pour
avoir monnoyé des pièces de ce faux argent, 6c elles
l’ont bien mérité. Le cuivre eft plus difficile à blanchir
que le fer par Farfenic.
- Les Chimiftes noiis. donnent plufieurs préparations
<Yarfenic; elles tendent toutes à émouffer ou détruire
à force d’ablutions & de fublimations, les fels corrô-
iifs dont il abonde, & à transformer Yarfenic en une
medecine fûre, ainfi qu’on le fait à l’égard du fublir
m é ; tels font le rubis d'arfenic t 6cc, mais cela n’en
Tome /,
A R T 71?
vaut pas là peiné ; 6c quelque chofe que l’on puiffe
faire, on ne pourroit jamais en faire ufage intérieurement
fous aucune forme, il conferve toujours fa
propriété de poifon mortel. Quand la fumée de IV -
fenic entre dans les poumons, elle tue fubitement ; 6c
plus il eft fublimé, dit Boerhaave, plus il devient
aigre.
Le beurre & le lait de vache pris en grande quantité
, font de bons antidotes contre Yarfenic.
Le régule d'arfenic eft la partie la plus fixe & la plut
compafre de ce minéral ; on le prépare en le mêlant
avec des cendrés à favon & du favon, laiffant fondre
le tout que l’on jette dans un mortier : alors la partie
la plus pefante tombe au fond, 6c c’eft le régule d'ar-»
fenic, c’cft-à-dire Yarfenic, auquel pn a donné le principe
huileux qui lui manquoit pour être en forme mé‘
•tallique. Voye^ R é g u l e ,
L’huile cauftique d'arfenic eft une liqueur buty-
reufe, femblable au beurre d’antimoine ; c’eft une
préparation d'arfenic & de fublimé corrofif. Elle fert
à ronger les chairs fpongieufes * à nettoyer ou exfolier
les os cariés, &c. (M )
* ARSENOTELES, f. m. pl. ou hermaphroditesl
Ariftote donne ce nom aux animaux qu’il conjecture
avoir les deux fexes.' Voye^ H e r m a p h r o d it e ,
*ARSINOÉ, (Géog. anc. & Myth.) ville d’Egypte
fituée près du lac Moeris, où l’on avoit un grand ref-
peCt pour les crocodiles. On les nourriffoit avec foin ;
on les embaumoit après leur mort, & on les enterroit
dans les lieux foûterrains du labyrinthe.
ARSIS, f. f. terme de Grammaire ou plùtôt de Pr'ofo-
die; c’eft l’élévation de la voix quand on commence à
lire un vers. Ce mot vient du grec «/cw, tollo, j’éleve.
•Cette élévation eft fuivie de l’abaiflement de la voix,
& c’eft ce qui s’appelle thejîs, bUiç, depojitio, remijjîo.
Par exemple, en déclamant cet hémiftiche du premier
vers de l’Enéide de Virgile, Arma virumque ca-
no, on fent qu’on-éleve d’abord la voix , 6c qu’on
l’abaiffe enfuite. .
Par arfis Sç thefis on entend communément la divi-
fion proportionnelle d’un pié métrique, faite par la
main ou le pié de .celui qui bat la mefure.
En mefurant la quantité dans la déclamation des
mots, d’abord on hauffe la main, enfuite on l’abaif-
fe. Le tems que l’on employé à hauffer la main eft
appellé arfis, 6c la partie du tems qui eft mefuré en
baiffant la main, eft appellee tliefis. Ces mefures
étaient fort connues & fort en ufage chez les anciens,
Voye1 Terentianus Maurus; Diomede, lib. I II. Mar.
Vïclorinus, lib. I. art. gramm. & Mart. Capella , lib,
IX , pag. 328. (F )
: On dit en Mufique qu’un chant, un contre-point,'
une figure, font per thefin, quand les notes defeendent
dé l’aigu au grave ; & per arfin, quand lès notes montent
du grave à l’aigu. Fugue per afin & th e f in eft
celle que nous appelions aujourd’hui fugue renverfée
ou contre-fugue, lorfque la réponfe fe fait en fens con;
traire, c’eft-à-dire en defeendant fi la guide a monté,
ou en montant fi elle a defeendu.. Voye{ C o n t r e -
fu g ü e , G u id e ., (é 1)
A R T , f. m. (Ordre encyclopèd. Entendement. Mé-
moire. Hiftpiri de.La,nature. Hifioire de la nature employée.
Art.) terme abftrait &:metaphyfique. On à
commencé par faire des obfervations liir la nature,
le fetvice , l’emploi , les qualités des êtres & deleurS
fymboles ; puis on a donné le nom de fcience ou d'art
ou de difcipline en général, au centre ou point de
réunion auquel on à rapporté lesobfervarionsqu’ori
avoit faites, pour en former un lyftème ou de réglés
pu d’inftrumens, & de réglés tendant à un même but ;
car voilà ce que c’eft que difcipline en général. Exemple.
On a réfléchi fur l’ufage 6c l’emploi des mots, 6c
l’on a inventé enfuite le mot Grammaire. Grammaire
eftle nom d’un fyftème d’inftrumens & de réglés re^
X x x x |