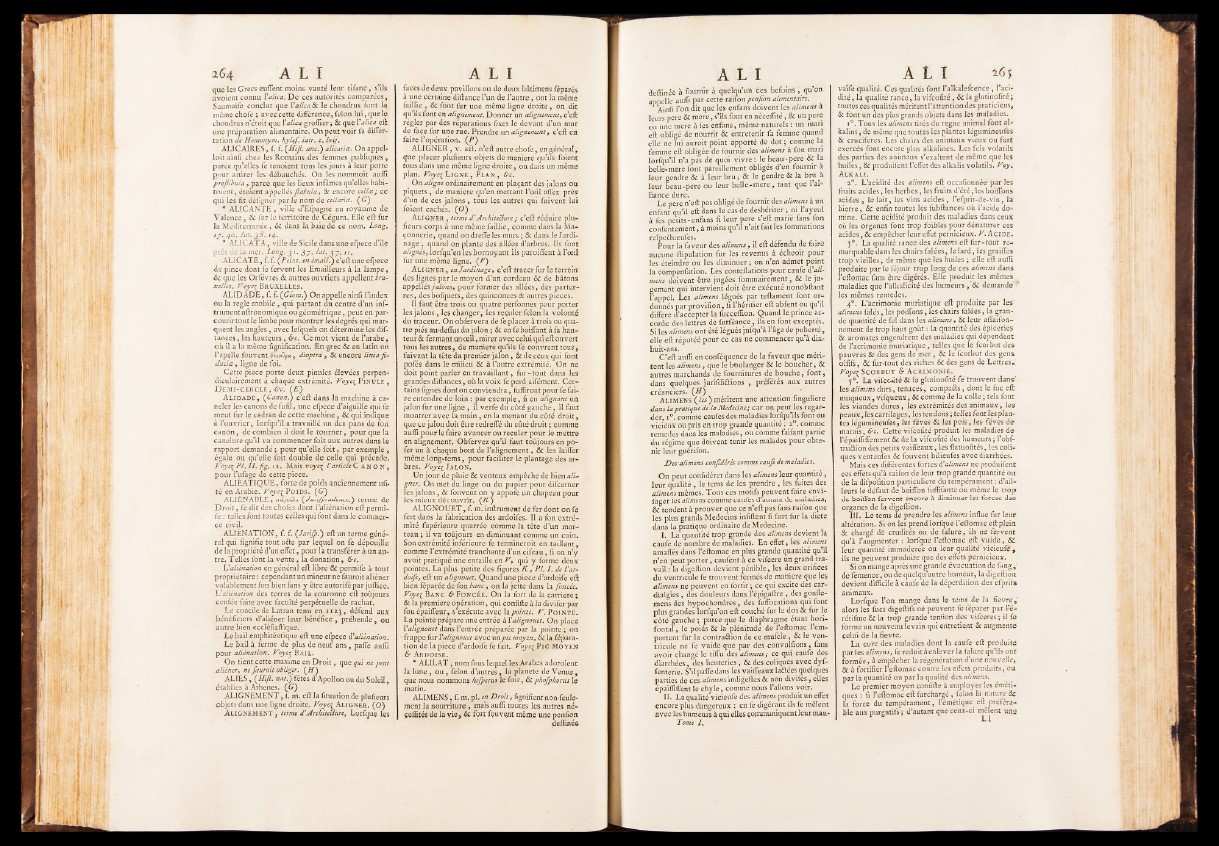
264 A L I
que les Grecs euffent moins vanté leur tifane, s’ils
a voient connu Valiez De ce?autorités comparées,
Saumaife conclut que Valica & le chonclrus font la
même chofe ; avec cette différence, félon lui, que le
chondrus n’étoit que Valica groffier ; & que Valica cfi
une préparation alimentaire. On peut voir fa differ-
tation de Hornonym. hylcf. iatr. c. Iv'tj.
ALICAIRES, f. f. (Hifi- anc.) alicarice. On appel-
loit ainfi chez les Romains des femmes publiques,
parce qu’elles fe tenoient tous les jours à leur porte
pour attirer les débauchés. On les nommoit aulfi
projlibula, parce que les lieux infâmes qu’elles habi-
toient, étoient appellés flabula, & encore celles; ce
qui les fit défigner par le nom de cellarice. (G)
* ALICANTE , ville d’Efpagne au royaume de
Valence, & fur le territoire de Cégura. Elle eft fur
la Méditerranée, & dans la baie de ce nom. Long,
sy. 40..lat. 38 .14 . '
* ALIC A T A , ville de Sicile dans une efpece d’île
près de la mer. Long. 31. $y. lat. 3 y. 11.
ALIC A T E , f. f. (Peint, en émail.’) c’eft une efpece
de pince dont fe fervent les Emailleurs à la lampe,
& que les Orfèvres & autres ouvriers appellent bru-
xelles. Foyei BRUXELLES.
ALIDADE, f. f. (Géom.) On appelle ainfi l’index
ou la réglé mobile , qui partant du centre d’un infiniment
aftronomique ou géométrique, peut en parcourir
tout le limbe pour montrer les degrés qui marquent
les angles, avec lefquels on détermine les distances
, les hauteurs, &c. Ce mot vient de l’arabe,
où il a la même lignification. En grec & en latin on
l ’apelle fouvent S'icJlpa., dioptra , & encore linea fiducies
, ligne de foi. •
Cette piece porte deux pinules élevées perpendiculairement
à chaque extrémité. Foye^ Pinule ,
D emi-cercle, & c. (E )
Alidade, (Canon.) c’eft dans la machine à ca-
neler les canons de fufil, une efpece d’aiguille qui fe
meut fur le cadran de cette machine, & qui indique
à l ’ouvrier, lorfqu’il a travaillé un des pans de fon
canon, de combien il doit le tourner, pour que la
canelure qu’il va commencer foit aux autres dans le
rapport demandé ; pour qu’elle foit, par exemple ,
égale ou qu’elle loit double de celle qui précédé.
Voyc^ PL. II. fig. iz . Mais voye^ Varticle C a n o n ,
pour l’ufage de cette piece.
ALIÉATIQUÈ, forte de poids anciennement ufi-
té en Arabie. Foye^ Poids. (G)
ALIÉNABLE, adjeél. (Jurifprudence.) terme de
D roit, fe dit des chofes dont l’aliénation eft permi-
fe : telles font toutes celles qui font dans le commerce
civil,
ALIÉNATION, f. f. (Jurifp.) eft un terme général
qui lignifie tout atte par lequel on fe dépouille
de la propriété d’un effet, pour la transférer à un autre.
Telles font la vente, la donation, &c.
Valiénation en général eft libre & permife à tout
propriétaire : cependant un mineur ne fauroit aliéner
valablement fon bien fans y être autorifé par juftice.
Ualiénation des terres de la coiironne eft toûjours
cenfée faite avec faculté perpétuelle de rachat.
Le concile de Latran tenu en 1 1 1 3 , défend aux
bénéficiers d’aliéner leur bénéfice, prébende, ou
autre bien eccléfiaftique.
Le bail emphitéotique eft une efpece d’aliénation.
Le bail à ferme de plus de neuf ans, paffe aulfi
pour aliénation. Foye^ Bail.
On tient cette maxime en D ro it, que qui ne peut
aliéner y ne fauroit obliger. (H )
ALIES, (Hifi. nat.jfêtes d’Apollon ou du Soleil,
établies à Athènes. (G)
ALIGNEMENT, 1’. m. eft la fituation de plufieurs
objets dans une ligne droite. Foye^ Aligner. (O)
A lignement , terme d’Architççturc, Lorfque les
A L I faces de deux pavillons ou de deux bâtimens féparés
à une certaine diftance l’un de l’autre, ont la même
faillie , & font fur une même ligne droite, on dit
qu’ils font en alignement. Donner un alignement, c’eft
regler par des réparations fixes le devant d’un mur
de face fur une rue. Prendre un alignement, c’eft en
faire l’opération. (P )
ALIGNER, v . aft. n’eft autre chofe, en général,
que placer plufieurs objets de maniéré qu’ils foient
tous dans une même ligne droite, ou dans un même
plan. F o y e { L ig n e , Pl a n , & c.
On aligne ordinairement en plaçant des jalons ou
piquets , de maniéré qu’en mettant l’oeil affez près
d’un de cës jalons, tous les autres qui fuivent lui
foient cachés. (O)
Aligner , terme d'Architecture ; c’eft réduire plufieurs
corps à une même faillie, comme dans la Maçonnerie,
quand on dreffe les murs ; & dans le Jardinage
> quand on plante des allées d’arbres. Ils font
alignés, lorfqu’en les bornoyant ils paroiffent à l’oeil
fur une même ligne.. (P)
A l ig n e r , en Jardinage, c’eft tracer fur le terrèin
des lignes par le moyen d’un cordeau & de bâtons
appellés jalons, pour former des allées, des parterres,
desbofquets, des quinconces àt autres pièces.
Il faut être trois ou quatre perfonnes pour porter
les jalons, les changer, les reculer félon la volonté
du traceur. On obfervera de fe placer à trois ou quatre
piés au-deffus du jalon ; & en fe baiffant à fa hauteur
& fermant un oeil, mirer avec celui qui eft ouvert
tous les autres, fte maniéré qu’ils fe couvrent tous ,
fuivant la tête du premier jalon, & de ceux qui font
pofés dans le milieu & à l’autre extrémité. On ne
doit point parler en travaillant, fur-tout dans les
grandes diftances, où la Voix fe perd aifément. Certains
lignes dont on conviendra, fuffiront pour fe faire
entendre de loin : par exemple, fi en alignant un
jalon fur une ligne , il verfe du côté gauche, il faut
montrer avec la main, en la menant du côté droit,
que ce jalon doit être redreffé du côté droit ; comme
aulfi pour le faire avancer ou reculer pour le mettre
en alignement. Obfervez qu’il faut toûjours en po-
fer un à chaque bout de l’alignement, & les Iaiffer
même long-tems, pour faciliter le plantage des arbres.
Foye^ Ja lon .
Un jour de pluie & venteux empêche de bien aligner.
On met du linge ou du papier pour difeerner
les jalons, & fouvent on y appofe un chapeau pour
les mieux découvrir. (K )
ALIGNOUET, f. m. infiniment de fer dont on fe
fert dans la fabrication des ardoifes. Il a fon extrémité
fupérieure quarrée comme la tête d’un marteau
; il va toûjours en diminuant comme un coin.
Son extrémité inférieure fe termineroit en taillant,
comme l’extrémité tranchante d’un cifeau, fi on n’y
avoit pratiqué une entaille en F , qui y forme deux
pointes. La plus petite des figures K , PI. I . de l'ar-
doife, eft un alignouet. Quand une piece d’ardoife eft
bien féparée de fon banc , on la jette dans la foncée.
Foye^ Banc & Foncé e. On la fort de la carrière ;
& la première opération, qui confifte à la di vifer par
fou épaiffeur, s’exécute avec la pointe. F. Po in t e .
La pointe prépare une entrée à Valignouet. On place
Valignouet dans l’entrée préparée par la pointe ; on
* frappe fur Valignouet avec un pic moyen, & la fépara-
tion de la piece d’ardoife fe fait. Foye^ P ic moyen
& Ardoise.
* ALILAT, nom fous lequel les Arabes adoroient
la lune , o u , félon d’autres, la planete de Venus ,
que nous nommons hefperus le foir, & phofpkorus le
matin.
ALIMENS, f. m. pl. en Droit, fignifient non-feulement
la nourriture , mais aulfi toutes les autres né-
çeflités de la y ie , & fprt fçuiYçnt même une penfion
deftinée
A L I deftinéè à fournir à quelqu’un èês befoins , qu’on
appelle aulfi par cetté raifon penfion alimentaire.
Ainfi l’on dit que les enfans doivent les alimens à
leurs pere & mère, s’ils font en nécelïïté, & un pere
ou une mère à fes enfans, même naturels : un mari
eft obligé de nourrir & entretenir fa femme quand
elle ne lui auroit point apporté de dot ; comme la
femme eft obligée de fournir des alimens à fon mari
lbrfqu’il n’a pas de quoi vivre : le beau-pere & la
belle-meré font pareillement obligés d’en fournir à
leur gendre & à leur bru ; & le gendre & la bru à
leur beau-pere ou leur belle-mere, tant que l’alliance
dure.
Le pere n’eft pas oblige de fournir des alimens à un
enfant qu’il eft dans le cas de deshériter ; ni l’ayeul
à' fes petits-enfans fi leur pere s’eft marié fans fon
confentement, à moins qu’il n’ait fait les fommations
refpeêlueufes. . »
: Pour la faveur des alimens, il eft défendu de fairë
aucune ftipulation fur les revenus à écheoir pour
lès éteindre ou les diminuer ; on n’en admet point
la cômpenfation. Les conteftations pour caufe d'ali-
mens doivent être jugées fommairemertt, & le jugement
qui intervient-doit être exécuté nonObftant
rappel. Les alimens légués par teftament font ordonnés
parprovifion, fi l’héritier eft abfent ou qu’il
diffère d’accepter la fuccelfion. Quand le prince accorde
des lettres de furféance, ils en font exceptés.
Si les alïrnens ont été légués jufqu’à l’âge de puberté,
elle eft réputéé pour ce cas ne commencer qu’à dix-
huit-ans.
C ’eft aulfi en conféquence de la faveur que meri- I
tent les alimens, que le boulanger & le boucher, &
autres marchands de fournitures de bouche font,
dans quelques jurifdiûions , préférés aux autres
créanciers. (H)
Alimens ( les ) méritent une attention finguliere
dans la pratique de la Medecine; car on peut les regarder,
10. comme caufes des maladies lorfqu’ils font ou
vicieux ou pris en trop grande quantité : z°. comme j
remedes dans les maladies, ou comme faifant partie :
du régime que doivent tenir les malades pour obtenir
leur guérifon.
Des alimens confédérés commt caufe de maladies.
On peut confidérer dans les alimens leur quantité *
leur qualité , le tems de les prendre , les fuites des
alimens mêmes. Tous ces motifs peuvent faire envi-
fâger les alimens comme caufes d’autant de maladies,
& tendent à prouver que ce n’eft pas fans raifon que
les plus grands Médecins infiftent fi fort fur la diete
dans la pratique ordinaire de Medecine.
I. La quantité trop grande des alimens devient la
caufe de nombre de maladies. En effet, les alimens
amaffés dans l’eftomac en plus grande quantité qu’il
n’en peut porter, caufent à ce vifeere un grand travail,:
la digeftion devient pénible, les deux orifices
du ventricule fe trouvent fermés de maniéré que les
alimens ne peuvent en fortir ; ce qui excite des car-
dialgies, des douleurs dans l’épigaftre , des gonfle-
mens des hypochondres, des fuffocations qui font
plus grandes lorfqu’on eft couché fur le dos & fur le
côté gauche ; parce que le diaphragme étant hori-
fontal, le poids & la plénitude de l’eftomac l’emportent
fur la contraftion de ce mufcle , & le ventricule
ne fe vuide que par des convulfions, fans
avoir changé le tiffu des alimens; ce qui caufe des
diarrhées, des lienteries, & des coliques avec dyf-
fenterie. S’il paffe dans les vaiffeaux laftées quelques
parties de ces alimens indigeftes & non divifes, elles
épailfiffent le chyle, comme nous l’allons voir.
IL La qualité vicieufe des alimens produit un effet
encore plus dangereux : en fe digérant ils fe mêlent
avec les humeurs à qui elles communiquent leur mau-
Tome /.
A L I 4 6$
Vaife qualité. Ces qualités font l’alkalefcénce, l’aci-*
dité, la qualité rance, Ja vifeolité, & la glutinofité;
toutes ces qualités méritent l’attention des praticiens,
& font Un des plus grands objets dans les maladies.
i° . Tous les alimens tirés du régné animal font al-
kalirts, de même que toutes les plantes légumineufes
& crucifères. Les chairs des animaux vieux ou fort
exercés font encore plus alkalines. Les fels volatils
des parties des animaux s’exaltent de même que les
huiles, & produifent l’effet des alkalis volatils. Foy^
Alkalï.
i °. L’acidité des alimens eft occafionnéé par les
fruits acides, les herbes, les fruits d’été, les boiffons
acides , le lait, les vins acides , l’efprit-de-vin, la
bierre, & enfin toutes les fubftances où l’acide domine.
Cette acidité produit dés maladies dans ceux
Où les organes font trop foibles pour dénaturer ces
acides, & empêcher leur effet pernicieux. F . Acides
30. La qualité rance des alimens eft fur-tout re-*
marquable dans les chairs falées, le lard, les graiffes
trop vieilles, de même que les huiles ; elle eft auflï
produite par le féjour trop long de ces alimens dans
l’eftomac fans être digérés. Elle produit les mêmes
maladies que l’alkalicité des humeurs ,*& demandé •
les mêmes remedes.
40. L’âcrimonie muriatique eft produite par les
alimens falés, les pOiffons, les chairs falées, la grande
quantité de fel dans les alimens, & leur affaifon-
nement de trop haut goût : la quantité des épiceries
& aromates engendrent des maladies qui dépendent
de l'acrimonie muriatique, 'telles que le feorbut des
pauvres & des gens de mer, & le feorbut des gens
oififis, & fur-tout des riches & des gens de Lettres.:
Foye{ Scorbut & Acrimonie.
5°. La vifcc-ité & la glutinofité fe trouvent dans"
les alimens durs, tenaces, compa&s, dont le fuc eft
muqueux, vifqueux, & comme de la colle ; tels font
les viandes dures, lés extrémités des animaux, les
peaux, les cartilages, les tendonsl, telles font les plantes
légumineufes, les fèves & les pois, les fèves de
marais, &i. Cette vifeofité produit- les maladies de
l’épaifliffement ô£ de la vifeofité des humeurs ; l’obf-
tru&ion des petits vaiffeaux, les flatuofités, les coliques
venteufes & fouvent bilieufes avec diarrhées.
Mais ces différentes fortes d’alimens ne produifent
ces effets qu’à raifon de leur trop grande quantité o u ,
de la difpofition particulière du tempérament : d’ailleurs
le défaut de boiffon fuffifante ou même le trop
de boiffon fervent encore à diminuer les forces des
organes de la digeftion.
III. Le tems dé preridre îès alimens influe fur leur1
altération. Si on les prend lorfque I’eftomac eft plein
& chargé dë crudités ou de falure, ils ne fervent
qu’à l’augmenter : lorfque l’eftomac eft vuide, &
leur quantité immodérée ou leur qualité'vicieuftf ,
ils ne peuvent produire que des effets pernicieux.
Si on mange après une grande évacuation de fang *
de femence, ou ae quelqivautre humeur, la digeftion
devient difficile à caufe de la déperdition des elprits
animaux.
Lorfque l’on mange dans le tëms de la fievre/
alors les fucs digeftifs ne peuvent fe féparer par l’é-
rétifme & la trop grande tenfion des vifcéres ; il fé
forme un nouveau levain qui entretient St augmente
celui de la fièvre.
La cure des maladies dont la caufe eft produite
; par les alimens, fe réduit à enlever la faliire qu’ils ont
formée, à empêcher la régénération d’une nouvelle*
& à fortifier l’eftomac contre les effets produits* Ou
par la quantité ou par la qualité des alimens-.
Le premier moyen confifte à employer les émétiques
î fi l’eftomac eft furchârgé, félon la nature &
la force du tempérament, l’émétique eft préférable
aux purgatifs ; d’autant que ceux-ci mêlent une