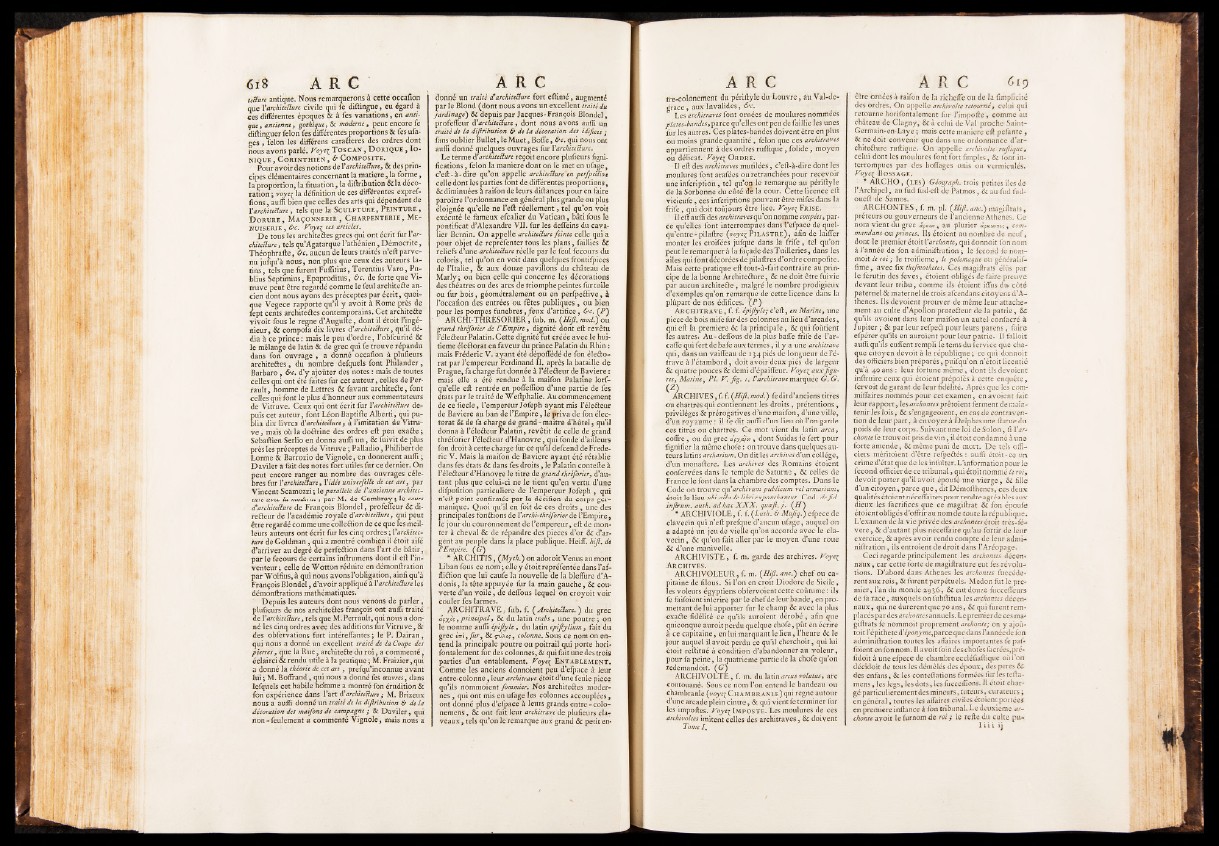
6i8 A R G
teciure antique. Nous remarquerons à cette occafion
que Y architecture civile qui le diftingue, eu égard à
ces différentes époques & à fes variations, en antique,
ancienne, gothique, 8c moderne , peut encore fe
diftinguer félon fes différentes proportions & fes ufa-
g e s , félon les différens caraâeres des ordres dont
nous avons parlé. Voyt{ T o s c a n , D o r iq u e , I o n
i q u e , C o r in t h i e n , & C o m p o s i t e .
Pour avoir des notions de l'architecture, & des principes
élémentaires concernant la matière, la forme,
la proportion, la fituation, la diftribution & la décoration
; voyes^ la définition de ces différentes expref-
fions, auffi bien que celles des arts qui dépendent de
Varchitecture, tels que la S c u l p t u r e , P e i n t u r e ,
D o r u r e , M a ç o n n e r i e , C h a r p e n t e r i e , M e n
u i s e r i e , Voyet^ ces articles. ^ ^
De tous les architeâes grecs qui ont écrit fur Varchitecture
, tels qu’Agatarque l ’athénien, Démocrite,
Théophrafte, &c. aucun de leurs traités n’eft parvenu
jufqu’à nous, non plus que ceux des auteurs latins
, tels que furent Fuffitius, Terentius Varo, Pu-
blius Septimius, Epaproditus, &c. de forte que Vi-
truve peut être regardé comme le feul architecte ancien
dont nous ayons des préceptes par écrit, quoique
Vegece rapporte qu’il y avoit à Rome près de
fept cents architectes contemporains. C et architecte
vivoit fous le régné d’Augufte, dont il étoit l’ingénieur,
8c compofa dix livres Xarchitecture, qu’il dédia
à ce prince : mais le pêu d’ordre, i’obfcurité &
le mélange de latin & de grec qui fe trouve répandu
dans fon ouvrage , a donné occafion à plufieurs
architectes, du nombre défquels font Philander,
Barbaro, &c. d’y ajouter des notes : mais de toutes
celles qui ont été faites fur cet auteur, celles de Per-
fault, homme de Lettres 8c favant architecte, font
celles qui font le plus d’honneur aux commentateurs
de Vitruve. Ceux qui ont écrit fur Varchitecture de-
' uis cet auteur, font Léon Baptifte Alberti, qui pu-
lia dix livres à’architecture, à l’imitation de Vitruve
, mais où la doctrine des ordres eft peu exaCte ;
Sebaftien Serlio en donna auffi un, 8c fuivit de plus
près les préceptes de Vitruve ; Palladio, Philibert de
Lorme & Barrozio de Vignole, en donnèrent auffi ;
Daviler a fait des notes fort utiles fur ce dernier. On
peut encore ranger au nombre des ouvrages célébrés
fur l’architecture, Vidée univerfelle de cet art, par
Vincent-Scamozzi; le parallèle de l'ancienne architecture
avec la moderne, par M. de Cambray ; le cours
£ architecture de François Blondel, profeffeur 8c directeur
de l’académie royale £ architecture, qui peut
être regardé comme une collection de ce que les meilleurs
auteurs ont écrit fur les cinq ordres ; Varchitecture
de Goldman, qui a montré combien il étoit aifé
d’arriver au degré de perfection dans l’art de bâtir,
par le fecours de certains inftrumens dont il eft l’inventeur
; celle de "Wbtton réduite en démonflration
par Wolfius, à qui nous avons l’obligation, ainfi qu’à
François Blondel, d’avoir appliqué à l'architecture les
démonftrations mathématiques.
Depuis les auteurs dont nous venons de parler,
plufieurs de nos architectes françois ont auffi traité
de Varchitecture, tels que M. Perrault, qui nous a donné
les cinq ordres avec des additions fur Vitruve, &
des obfervations fort intéreffantes ; le P. Dairan,
qui nous a donné un excellent traité de la Coupe des
pierres , que la Rue, architecte du roi, a commenté,
éclairci & rendu utile à la pratique ; M. Fraizier, qui
a donné la théorie de cet art, prefqu’inconnue avant
lui; M. Boffrand, qui nous a donné fes oeuvres, dans
lefquels cet habile homme a montré fon érudition &
fon expérience dans l’art d’architecture ; M. Brizeux
nous a auffi donné un traité de la distribution & de la
décoration des maifons de campagne ; & Daviler, qui
non - feulement a commenté Vignole, mais nous a
A R C
donné un traité d'architecture fort eftimé, augmenté
par le Blond (dont nous avons un excellent traité du
jardinage) 8c depuis par Jacques-François Blondel,
profeffeur d’architecture, dont nous avons auffi un
traité de la dißribution & de la décoration des édifices ;
fans oublier Bullet, le Muet, Boffe, &c. qui nous ont
auffi donné quelques ouvrages fur Varchitecture.
Le terme d’architecture reçoit encore plufieurs lignifications
, félon la maniéré dont on le met en ufage,
c’eft-à-dire qu’on appelle architecture 'en pcrfpeUive
celle dont les parties font de différentes proportions,
8c diminuées à raifon de leurs diflances pour en faire
paroître l’ordonnance en général plus grande ou plus
éloignée qu’elle ne l’eft réellement, tel qu’on voit
exécuté le fameux efcalier du V atican, bâti fous le
pontificat d’Alexandre VJI. fur les deffeins du cavalier
Bernin. On appelle architecture feinte celle qui a
pour objet de repréfenter tous les plans, faillies 8c
reliefs d’une architecture réelle par le feul fecours du
coloris, tel qu’on en voit dans quelques frontifpices
de l’Italie, & aux douze pavillons du château dè
Marly; ou bien celle qui concerne les décorations
des théâtres ou des arcs de triomphe peintes fur toile
ou fur bois, géométralement ou en perfpeâive, à
l’occafion des entrées ou fêtes publiques , ou bien
pour les pompes funèbres, feux d’artifice, &c. (P)
ARCHI-THRÉSORIER, fub. m. (Hiß. mod.') ou
grand thréforier de l'Empire, dignité dont eft revêtu
l’éleâeur Palatin. Cette dignité fut créée avec le huitième
éleâorat en faveur du prince Palatin du Rhin :
mais Frédéric V . ayant été dépoffédé de fon éleâo-
rat par l’empereur Ferdinand II. après la bataille de
Prague, fa charge fut donnée à l’éleâeur de Bavière :
mais elle a été rendue à la maifon Palatine lorf-
qu’elle eft rentrée en poffeffion d’une partie de fes
états par le traité de ‘Weftphalie. Au commencement
de ce fiecle, l’empereur Jofeph ayant mis l’éleâeur
de Bavière au ban de l’Empire, le jfriva de fon électorat
8c de fa charge de grand-maître d’hôtel, qu’il
donna à l’éleâeur Palatin, revêtit de celle de grand
thréforier l'éleâeur d’Hanovre, qui fonde d’ailleurs
fon droit à cette charge fur ce qu’il defeend de Frédéric
V. Mais la maifon de Bavière ayant été rétablie
dans fes états 8c dans fes droits, le Palatin contefte à
l’éleâeur d’Hanovre le titre de grand thréforier, d’autant
plus que celui-ci ne le tient qu’en vertu d’une
I difpofition particulière de l’empereur Jofeph , qui
n’eft point confirmée par la décifion du corps germanique.
Quoi qu’il en foit de ces droits , une des
principales fonâions de Varchi-thréforier de l’Empire,
le jour du couronnement de l’empereur, eft de monter
à cheval 8c de répandre des pièces d’or 8c d’argent
au peuple dans la place publique. HeifT. hiß. de
P Empire. (G)
* ARCHITIS, (Myth.) on adoroit Venus au mont
Liban fous ce nom ; elle y étoit repréfentée dans l’af-
fliâion que lui caufe la nouvelle de la bleflure d’A-
donis, la tête appuyée fur la main gauche, & couverte
d’un voile, de defibus lequel on croyoit voir
couler fes larmes.
ARCHITRAVE, fub. f. ( Architecture. ) du grec
a/j%oV, principal, 8c du latin trabs, une poutre ; on
le nomme auffi épiflyle, du latin epißylium, fait du
grec Iwiffur, 8c çvXoç, colonne. Sous ce nom on entend
la principale poutre ou poitrail qui porte hori-
fontalement fur des colonnes, 8c qui fait une des trois
parties d’un entablement. Voye£ En t a b l e m e n t .
Comme les anciens donnoient peu d’efpace à leur
entre-colonne, leur architrave étoit d’une feule piece
qu’ils nommoient fommier. Nos architeâes modernes
, qui ont mis en ufage les colonnes accouplées,
ont donné plus d’efpace à leurs grands entre - colo-
nemens, & ont fait leur architrave de plufieurs cla-
Véaux, tels qu’on le remarque aux grand 8c petit en-
A R C
tre-colonement du périftyle du Louvre, âù Vaï-de-
drace , aux Invalides, &c.
Les architraves font ornées de moulures nommées
plates-bandes, parce qu’elles Ont peu de faillie les unes
fur les autres. Ces plates-bandes doivent être en plus
ôu moins grande quantité, félon que ces architraves
appartiennent à des ordres ruftique, folide, moyen
ou délicat. Voye^ ORDRE.
Il eft des architraves mutilées, c’eft-à-dire dont lès
moulures font arafées ou retranchées pour recevoir
une infcriptiôh, tel qu’on le remarque au périftyle
de la Sorbonne du côté d l la cour. Cette licence eft
vicieufè, ces inferiptions pouvant être mifes dans la
frife, qui doit toûjours être lice. Voye^ Fr is e .
Il eft auffi dès architraves qu’on nomme coupées, parce
qu’elles font interrompues dansYefpace de quel-
qu’entre-pilaftre (voyeç P i l a s t r e ) , afin de laiffer
monter les croifées jufque dans la frife , tel qu’on
peut le remarquer à la façade des Tuilleries, dans les
ailes qui font décorées de pilaftres d’ordre compofite.
Mais cette pratique eft tout-à-fait contraire au principe
de la bonne A rchiteâure, 8c ne doit être fuivie
par aucun architeâe, malgré le nombre prodigieux
d’exemples qu’on remarque de cette licence dans la
plupart de nos édifices. (R)
A r c h i t r a v e , f. f. épiflyle; c’eft, en Marine, une
piece de bois mife fur des colonnes au lieu d’arcades,
qui eft la première 8c la principale, 8c qui foûtient
les autres-. Au - deffous de la plus baffe frife de l’ar-
cafle qui fert de bafe aux termes y il y a une architrave
qui, dans un vaiffeau de 1 34 piés de longueur de l’étrave
à l’étambord, doit avoir deux piés de largeur
& quatre pouces & demi d’épaiffeur. Voye^ aux figures,
Marine, PI. V. fig. 1. l'architrave marquée G. G.
(•Z)
ARCHIVES, f. f. (Hifl. mod.) fe dit d’anciens titres
ou chartrës qui contiennent les droits, prétentions,
privilèges & prérogatives d’une maifon, d’une ville,
d’un royaume : il le dit auffi d’un lieu où l’on garde
ces titres ou Chartres. Ce mot vient du latin area,
coffre , ou du grec âpx«iov, dont Suidas, fe fert pbur
lignifier la même chofe : on trouve dans quelques auteurs
latins archarium. On dit les archives d’un collège,
d’un monaftere. Les archives des Romains étoient
confervées dans l’e temple de Saturne , 8c celles de
France le font dans la chambre des comptes. Dans le
Code on trouve qu' archivant publicum vel armarium,
étoit le lieu ubi acta & libri exponebantur. Cod. de fid.
infbrum. autJu ad hcee X X X . quoefl.j. (H )
* ARCHIVIOLE, f. f. (Luth. & Mufîq.) efpece de
clavecin qui n’eft prefque d’aucun ufage, auquel on
a adapté un jeu de vielle qu’on accorde avec le clavecin
, 8c qu’on fait aller par le moyen d’une roue
8c d’une manivelle.
ARCHIVISTE, f. m. garde des archives. Voye^
A r c h iv e s .
ARCHI VOLEUR, f. m. (Hifl. anc.) chef ou capitaine
de filous. Si l’on en croit Diodore de Sicile,
les voleurs égyptiens obfervoient cette coutume : ils
fe faifoient inferiré par le chef de leur bande, en promettant
de lui apporter fur le champ 8c avec la plus
exaâe fidélité ce qu’ils auraient dérobé, afin que
quiconque aurait perdu quelque chofe, pût èn écrire
à ce capitaine, en lui marquant le lieu, l’heure & le
jour auquel il avoit perdu ce qu’il cherchoit, qui lui
étoit reftitué à condition d’abandonner au voleur,
pour fa peine, la quatrième partie de la chofe qu’on
fedemandoit. (G)
ARCHIVOLTE, f. m. du latin arcus volutus, arc
Oontouané. Sous ce nom l’on entend le bandeau ou
chambranle (voyei C h a m b r a n l e ) qui régné autour
d’une arcade plein cintre, & qui vient fe terminer fur
les impoftes. Voye[ Im p o s t e . Les moulures de ces
archivoltes imitent celles des architraves, 8c doivent
Tome I,
A R C 619
être ornées à raifon de la richefle ou de la fimplicité
des ordres. On appelle archivolte retourné, celui qui
retourne horifontalement fur l’im pofte, comme au
château de Clagny, 8c à celui de Val proche Saint-*
Germain-ert-Laye ; mais cette maniéré eft pefante ,
& né doit convenir que dans une ordonnance d’ar-
chiteâure ruftique. On appelle archivolte ruftique,
celui dont les moulures font fort fimples, 8c font interrompues
par des boffages unis ou vermiculés.
Voyc^ B o s s a g e .
* ARCHO , ( les) Géograph. trois petites îles de
l’Archipel, au fud fud-eft de Patmos, 8c au fud fud*
oueft de Sâmos.
• ARCHONTES, f. m. pi. (Hifl . anc.) magifttats,
préteurs ou gouverneurs de l’ancienne Athènes. Ce
nom vient du grec ctpzuv, au plurier «pKwmç, commandons
ou princes. Ils étoient au nombre de neuf,
dont le premier étoit Varchonte, qui donnoit fon nom
à l’année de fon adminiftration ; le fécond fe nora-
moit le roi ; le troifieme, le polemaque où généralif-
fime , avec fix thefmothetes. Cesmagiftrats élus par
le ferutin des feves, étoient obligés de faire preuve
devant leur tribu, comme ils étoient iffus div côté
paternel 8c maternel de trois afeendans citoyens d’A-
thenes. Ils dévoient prouver de même leur attachement
au culte d’Apollon proteâeur de la patrie, 8c
qu’ils avoient dans leur maifon un autel confacré à
Jupiter ; & par leur refpeâ pour leurs pârens, faire
efpérer qu’ils en auroient pour leur patrie. Il falloir
auffi qu’ils euffent rempli le tems du îervice que chaque
citoyen devoit à la république ; ce qui donnoit
des officiers bien préparés, puifqu’on n’étoit licentié
qu’à 40 ans : leur fortune même, dont ils dévoient
inftruire ceux qui étoient prépofés à cette enquête,
fervoit de garant de leur fidélité. Après que les com-1
miffaires nommés pour cet examen, en avoient fait
leur rapport, les archontes prètoient ferment demain-
tenir les lois, 8c s’engageoient, en cas de contravention
de leur part, à envoyer à Delphes une ftatue du
poids de leur corps. Suivant une loi de Solon, fi l’ar-
chonte fe trouvoit pris de v in , il étoit condamné à une
forte amende, 8c même puni de mort. De tels officiers
méritoient d’être refpeâés : auffi étoit - ce un
crime d’état que de les infulter. L’information pour le
fécond officier de ce tribunal, qui étoit nommé le roi,
devoit porter qu’il avoit époufé une v ierge, 8c fille
d’un citoyen, parce que, dit Démofthenes, ces deux
qualités étoient néceflaires pour rendre agréables aux
dieux les facrifices que ce magiftrat 8c fon époufe
étoient obligés d’offrir au nom de toute la république*
L’examen de la vie privée des archontes étoit très-fé-
vere, 8c d’autant plus néceflaire qu’au fortir de leur
exercice, 8c après avoir rendu compte de leur 'adminiftration
, ils entraient de droit dans l’Aréopage.
• Ceci regarde principalement les archontes décennaux,
car cette forte de magiftrature eut fes révolutions.
D ’abord dans Athènes les archontes fuccéde-
rent aux rois, 8c furent perpétuels. Medon fut le premier,
l’an du monde 2936, 8c eut douze fuccefleurs
de fa race, auxquels on iubftitua les archontes décennaux
, qui ne durèrent que 70 ans, 8c qui furent remplacés
par des archontes annuels. Le premier de ces ma*
giftrats fe nommoit proprement archonte; on y ajourait
l’épithete d'éponyme,parce que dans l’année de fon
adminiftration toutes les affaires importantes fe paf-
foient en fon nom. Il avoit foin des choies là crées, pré-
fidoit à une efpece de chambre eccléfiaftique où l’on
décidoit de tous les démêlés des époux, des per es 8c
des enfans, 8c les conteftations formées furies tefta-
mens, les legs, les dots, les fucceffions. Il étoit chargé
particulièrement des mineurs, tuteurs, curateurs ;
en général, toutes les affaires civiles étoient portées
en première inftance à fon tribunal. Le deuxieme archonte
avoit le furnom de roi ; le refte du culte pu-
1 1 i i ij