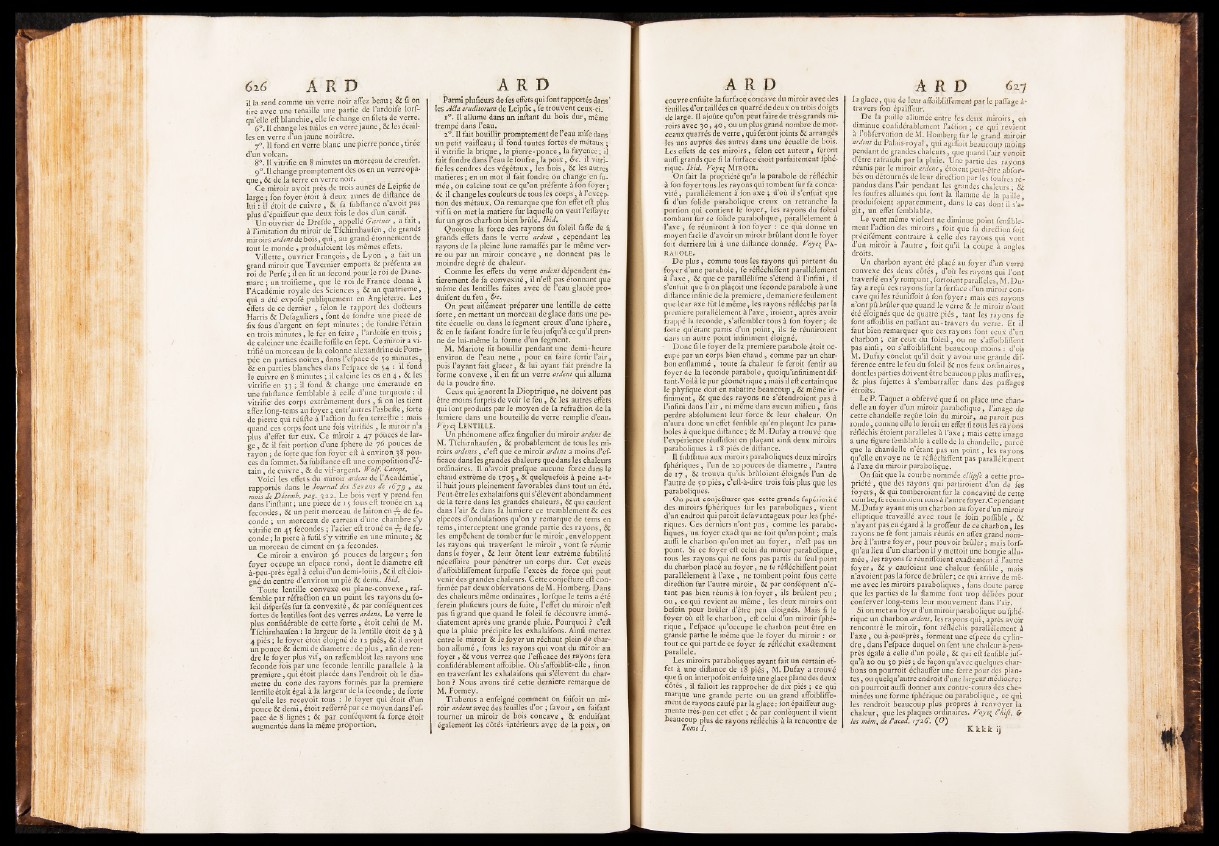
il la rend comme un verre noir allez beau ; & li on
tire avec une tenaille une partie de l’ardoife lorsqu'elle
eft blanchie, elle fe change en filets de verre.
6°. Il change les tuiles en verre jaune, & les écaillés
en verre d’un, jaune noirâtre. ^ _ 9 / 7°. Il fond en verre blanc une pierre ponce, tirée
d’un volcan. ,
8°. Il ,vitrifie en 8 minutes un morceau dé creufet.
9°. 11 change promptement des os en un verre opaque,
& de la terre en verre noir. ; . . . .
Ce miroir avoit près de trois aunes de Leipfic de
large *, fon foyer étoit à deux aunes de diftance de
lui : il étoit de cuivre , & fa fubftance h avoit pas
plus d’épaiffeur que deux fois le dos d’un canif. _
Un ouvrier de Drefde, appellé Gartner, a fa it ,
à l’imitation du miroir de Tfchirnhaüfen, de grands
miroirs ardens de bois, qui, au grand étonnement de
tout le monde , produifoient les mêmes effets. ^
Villette, ouvrier François, de Lyon , a fait un
grand miroir que Tavernier emporta 8c préfenta au
roi de Perfe ; il en fit un fécond pour le roi de Dane-
marc ; un troifieme, que lé roi de Francè donna à
l’Académie royale des Sciences ; 8c un quatrième, .
qui a été expofé publiquement en Angleterre. Les
effets de ce dernier , félon le rapport des doéteurs
Harris 8c Defaguliers , font de fondre une piece de
lix fous d’argent en fept minutes ; dé. fondre 1 etain
en trois minutes, le fer en feize, l’ ardoife en trois ;
de calciner une écaille foffile en fept. Ce miroir a vitrifié
un morceau de la colonne alexandrine de Pompée
en parties noires, dans l’efpace de 50 minutes,
& en parties blanches dans l’ efpace de 5 4 : il fond
le cuivre en 8 minutes ; il calcine iès os en 4 , & les
vitrifie en 33 ; il fond & change une émeraude en
une fubftance fenlblable à celle d’une tûrquoile : il
vitrifie' des corps extrêmement durs , f i t on les tient
affez Iong-tems au foyer ; entr’autres l’asbeftè, forte
de pierre qui réfifte à l’aétion du feu terreftre : mais
quand ces corps font une fois vitrifiés., le miroir .n’a
plus d’effet fur eux. Ce miroir a 47 poiicés de larg
e , & il fait portion d’une fphere de 76 pouces de
rayon ; de forte que fon foyer eft à environ 38 pouces
du fommèt. Sa fubftance eft une compofition d’étain
, de cuivre, & de vif-argent. Wolf. Catopt.
Voici les effet s du miroir ardent de l’Académie’’,
rapportés dans le Journal des Savans de 1679 , au
mois de Décemb.pag. 32.2. Le bois vert ÿ prend feu
dans l’inftant ; une piece de 15 fous eft trouée en 24
fécondés, & un petit morceau de laiton en -7% de fécondé
; un morceau de carreau d’une chambre s’y
vitrifie en 45 fécondés ; l’acier eft troué en de fécondé
; la piere à fufil s’y vitrifie en une minute; 8c
un morceau de ciment en 51 fécondés.
Ce miroir a environ 36 pouces de largeur; fon
foyer occupe un efpace rond, dont le diamètre eft
à-peu-près égal à celui d’un demi-loiiis, & il eft éloigné
du centre d’environ un pié 8c demi. Ibid.
Toute lentille convexè ou plane-convexe, raf-
femble par réfra&ion en un point les rayons du foleil
difperfés fur fa convexité, 8c par conféquentces
fortes de lentilles font des verres ardens. Le verre le
plus confidérable de cette forte , étoit celui de M.
Tfchirnhaüfen : la largeur de la lentille étoit de 3 à
4 piés ; le foyer étoit éloigné de 12 piés, 8c il avoit
un pouce & demi de diamètre : de plus , afin de rendre
le foyer plus v i f , on raffembloit les. rayons une
fécondé fois par une fécondé lentille parallèle à la
première, qui étoit placée dans l’endroit oîi le diamètre
du cône des rayons formés par la première
lëntille étoit égal à la largeur de la fécondé ; de forte
qu’elle les recevoit tous : le foyer qui étoit d’un
pouce 8c demi, étoit refferré par ce moyen dans l’efpace
de 8 lignés ; 8c .par conféquent fa force étoit
augmentée dans la même proportion.
Parmi plufieurs de fes effets qui font rapportés dans ‘
les Acta eruditorum de Leipfic, fe trouvent ceux-ci.
i° . Il allume dans un inftant du bois dur, même
trempé dans Peau.
zô. Il fait bouillir promptement de Peau mïfe dans
un petit vaiffeau ; il fond toutes fortes dé métaux ;
il vitrifie la brique, là pierre-poncé, la fayencè ; il
fait fondre dans Peau lè foufre, la poix, &c. il vitrifie
les cendres des végétaux, lés bois, & lés autres
matières; en un mot il fait fondre ou change en fumée,
ou calcine tout ce qu’on préfente à fon foyer ;
8c il change les couleurs de tous les edrps, à l’exception
des métaux. On remarque que fon effet eft plus
v i f fi on met la matière fur laquelle on veut l’effayer
fur un gros charbon bien brûle. Ibid.
Quoique la force des rayons dii foleil faffe dé li
grands effets dans le verre ardent , cependant les
rayons de la pleine lurte ramaffés par le même verre
ou par un miroir concave, ne donnent pas le
moindre degré de chaleur.
Comme les effets du verre ardent dépendent entièrement
de fa convexité, il n’éft pas étonnant que
même des lentilles faites avec de î’èâu glacée pro-
duifent du feu , &c.
On peut aifément préparer une lentille de cette
forte, en mettant urt morceau déglace dans une petite
éeuelle ou dans lefegment creux d’une fphere,
8c en le faifant fondre fur le féu jufqu’à ce qu’il prenne
de lui-même la forme d’un fegment.
M. Mariote fit bouillir pendant une demi-heure
environ de l’eau nette , pour en faire fortir l’air ,
puis Payant fait glacer, & lui ayant fait prendre la
forme convexe , il en fit un verre ardent qui alluma
• de la poudre fine.
Ceux qui ignorent la Dioptrique, ne doivent pas
être moins furpris de voir le feu , & les autres effets
qui font produits par le moyen de la réfraôion de la
^ lumière dans une bouteille de verre remplie d’eau.
y'oye{ L e n t il l e .
Un phénomène affez fingulier du miroir ardent de
M. Tfchirnhaüfen, 8c probablement de tous les miroirs
ardents, c’eft qué cè miroir ardent a moins d’efficace
dans les grandes chaleurs que dans lés chaleurs
ordinaires. Il n’avoif prefque aucune force dans le
chaud extrême de 1705 , & quelquefois à peine a-t-
il huit jours pleinement favorables dans tout ün été.
Peut-être les exhalaifons qui s’élèvent abondamment
de la terre dans les grandes chaleurs, & qui caufènt
dans Pair 8c dans la lumière ce tremblement & ces
efpeces d’ondulations qu’on y remarque de tems en
téms, interceptent une grande partie des rayons, 8c
. les empêchent de tomber fur le miroir, enveloppent
les rayons qui traverfent le miroir , vont fe réunir
dans le foyer, 8c leur ôtent leur extrême fubtilité
néceffaire pour pénétrer un corps dur. Cet excès
d’affoibliffement furpaffe l’excès de force qui peut
venir des grandes chaleurs. Cette conjecture eft confirmée
par deux obfervations de M. Homberg, Dans
des chaleurs même ordinaires, lorfque le tems a été
, ferein plufieurs jours de fuite, l’effet du miroir n’eft
pas fi grand que quand le foleil fe découvre immédiatement
après une grande pluié. Pourquoi ? c’eft
que la pluie précipite les éxhalaifons. Ainfi mettez
entre le miroir & le foyer un réchaut plein de charbon
allumé , fous les rayons qui vont du miroir au
foy e r , 8c vous verrez que l’efficace des rayons fera
confidérablement affoiblie. Où s’affoiblit-elle, linon
en traverfant les exhalaifons qui s’élèvent du charbon
? Nous avons tiré cette aerniere remarque de
M. Forméy.
Traberus a enfeigné comment on faifoit un miroir
ardent avec des feuilles d’or ; favoir, en faifant
tourner un miroir de bois concave , & enduifant
également les côtés intérieurs avec de la poix, on
couvre enfuite la furface concave du miroir avec des
feuilles d’or taillées en quarréide deux ou trois doigts
de large. Il ajoûte qu’on peut faire de très-grands miroirs
avec 30, 40, ou ün plus grand nombre de morceaux
quarrés de v erre, qui feront joints & arrangés
les uns auprès des autres dans une éeuelle de bois.
Les effets de ces miroirs , félon cet auteur, feront
auffi grands que fi la furface étoit parfaitement fphé-
rique. Ibid. Voyeç Mir o ir .
On fait la propriété qu’a la parabole de réfléchir
à fon foyer tous les rayons qui tombent fur fa concavité
, parallèlement à fon axe ; d’où il s’enfuit que
fi d’un folide parabolique creux on retranche la
portion qui contient le foyer , les rayons du foleil
tombant fur ce folide parabolique, parallèlement à
l’a x e , fe réuniront à fort foyer : ce qui donne un
• moyen facile d’avoir un miroir brûlant dont le foyer
foit derrière lui à une diftance donnée. Voye^ Pa r
a b o l e .
De plus , comme tous les rayons qui partent du
•foyerd’une parabole, fe réfléeniffent parallèlement
à l’ax e, & que ce parallélifme s’étend à l’infini, i l .
s’enf uit que li On plaçoit une fécondé parabole à une
diftance infinie de la première, de manière feulement
que leur axe fut le même, les rayons réfléchis par la
première parallèlement à l’axe, iroient, après avoir
frappé la féconde, s’affembler tous à fon foyer; de
forte qu’étant partis d’un point, ils fe réuniroient
dans un autre point infiniment éloigné.
Donc fi le foyer de la première parabole étoit occupé
par un corps bien chaud, comme par un charbon
enflammé , toute fa chaleur fe feroit fentir au
foyer de la fécondé parabole, quoiqu’infiniment dif-
tant. Voilà le pur géométrique ; mais il eft certain que
le phyfique doit en rabattre beaucoup, & même infiniment
, 8c que des rayons ne s’étendroient pas à
l’infini dans l’air , ni même dans aucun milieu, fans
perdre abfolument leur force & leur chaleur. On
•n’aura donc un effet fenfible qu’en plaçant les paraboles
à quelque diftance ; & M. Dufay a trouvé que
l’expérience réufliffoit en plaçant ainfi deux miroirs
paraboliques à 18 piés de diftance.
Il fubftitua aux miroirs paraboliques deux miroirs
fphériques, l’un de 20 pouces' de diamètre, l’autre
de 17 , 8c trouva qu’ils brûloient éloignés l’un de
l’autre de 50 piés, e’eft-à-dire trois fois plus que les
paraboliques.
On peut conjecturer que cette grande fupériorité
des miroirs fphériques lùr les paraboliques, vient
d’un endroit qui paroît defavantageux pour les fphériques.
Ces derniers n’ont pas, comme les paraboliques,
un foyer exaCt qui ne foit qu’un point ; mais
auffi le charbon qu’on met au foyer, n’eft pas un
point. Si ce foyer eft celui du miroir parabolique,
tous les rayons qui ne fons pas partis du feul point
du charbon placé au foy e r , ne fe réfléchiffent point
parallèlement à l’axe , ne tombent point fous cette
direction fur l’autre miroir, 8c par conséquent n’étant
pas bien réunis à fon foyer , ils brûlent peu ;
o u c e qui revient au même , les deux miroirs ont
befoin pour brûler d’être peu éloignés. Mais fi le
foyer où eft le charbon, eft celui d’un miroir fphé-
rique, l’efpace qu’occupe le charbon peut être en
grande partie le même que lé foyer du miroir : or
tout ce qui part de ce foyer fe réfléchit exactement
parallèle.
Les miroirs paraboliques ayant fait un certain effet
à une diftance de 18 piés , M. Dufay a trouvé
que fi on interpofoit enfuite une glace plane des deux
£ôtés , il falioit les rapprocher de dix piés ; ce qui
marque une grande perte ou un grand affoiblifie-
ment de rayons caufé par la glace : Ion épaiffeur augmente
très-peu cet effet ; 8c par conféquent il vient
beaucoup plus de rayons réfléchis à la rencontre de
Tome I,
la glace, que de leur affoibliffement par le paffage à»
travers fon épaiffeür.
De la paille allumée entre lés dèiix miroirs, en
diminue, confiderableiiient l’aChôn ; ce qui revient
à 1 obfervation de M. Homberg fur le grand miroir
ardent du Palais-royal, qui agiffoit beaucoup moin^
pendant de grandes chaleurs, que quand l’air venoit
d’être rafraîchi par la pluie. Une partie des rayons
réunis par le miroir ardent, étoient peut-être .abfor-
bés ou détournés de leur direction par les foufres répandus
dans l’air pendant les grandes chaleurs ; 6c
les foufres allumés qui font la flamme de la paillé
produifoient apparemment, dans le cas dont il s’agit
, un effet fémblable.
Le vent même violent ne diminue point fen fib le -
ment l’aCtion des miroirs , foit que fa direction foit
précifément contraire à celle des rayons qui vont
d’un miroir à l’autre, foit qu’il là coupe à angles
droits.
Un charbon ayant été placé au foyer d*urt verre
convexe des deux côtés, d’où les rayons qui l’ont
traverfé en s’y rompant, fortoient paralleles, M. Du*
fay.a reçu ces rayons fur la furface d’un miroir concave
qui les reunifloit à fon foyer : mais ces rayons
n ont pû brûler que quand le verre & le miroir n’ont
été éloignés qiie de quatre piés , tant les rayons fè
font affoiblis en paffant au-travers du verre. Et il
faut bien remarquer qué Ces rayons font ceux d’uti
charbon ; car ceux du. foleil, ou ne s’affoibliffertt
pas ainfi, ou s’affoibliffefit beaucoup moins : d’où
M. Dufay conclut qu’il doit y avoir une grande différence
entre le feu du foleil 8c nos feux ordinaires ,
dont les parties doivent être beaucoup plus maffives,
& plus fujettes à s’embarraffer dans des paffages
étroits.
Le P. Taquet a obfervé qué fi on place une chandelle
au foyer d’un miroir parabolique, l’image de
c e t t e chandelle reçue loin du miroir, ne parort pas
ronde, comme elle le feroit en effet fi tous les rayons
réfléchis étoient paralleles à l’axe; mais cette image
a une figure femblable à celle de la chandelle, parce
que la chandelle n’étant pas un point, les rayons
qu’elle envoyé ne fe réfléchiffent pas parallèlement
à l’axe du miroir parabolique.
On fait que la courbe nommée ellipfe a cette propriété
, que des rayons qui partiroient d’un, de fes
foyers, & qui tomberoient fur la concavité de cette
courbe, fe réuniroient tous à l’autre foyer.Cependant
M. Dufay ayant mis un charbon au foyer d’un miroir
elliptique travaillé avec tout le foin.poflïble, 8c
n’ayant pas eu égard à la groffeur de ce charbon, les
rayons ne fê font jamais réunis en affez grand nombre
à l’autre foyer, pour pouvoir brûler ; mais lorfi*
qu’au lieu d’un charbon il y mettoit une bougie allumée,
les rayons fe réuniffoient exaélemént à l’autre
foy er, & y caufoient une chaleur fenfible, mais
n’avoient pas la force de brûler ; ce qui arrive de même
avec les miroirs paraboliques, fans, doute parce
que les parties de la flamme font trop déliées pour
conferver long-tems leur mouvement dans l'air.
Si on met au foyer d’un miroir parabolique ou fphé»
rique un charbon ardent, les rayons qui, après avoir
rencontré le miroir, font réfléchis parallèlement à
l’axe , ou à-peu-près, forment une èfpece de cylindre
, dans l’efpace duquel ôn fent une chaleur à-peu-
près égale à celle d’un poêle, & qui eft fenfible jufqu’à
20 ou 30 piés ; de foçon qu’avec quelques charbons
onpourroit échauffer une ferte pour des plantes
, ou quelqu’autre endroit d’une largeur médiocre :
on pourroit auffi donner aux cohtre-coéurs des cheminées
une forme fphérique ou parabolique, ce qui
les rendroit beaucoup plus propres à renvoyer fa
chaleur, que les plaqués ordinaires. Voye^ T hiß, &
Us mèms de Tacad, tyzG, (O)
K k k k ij