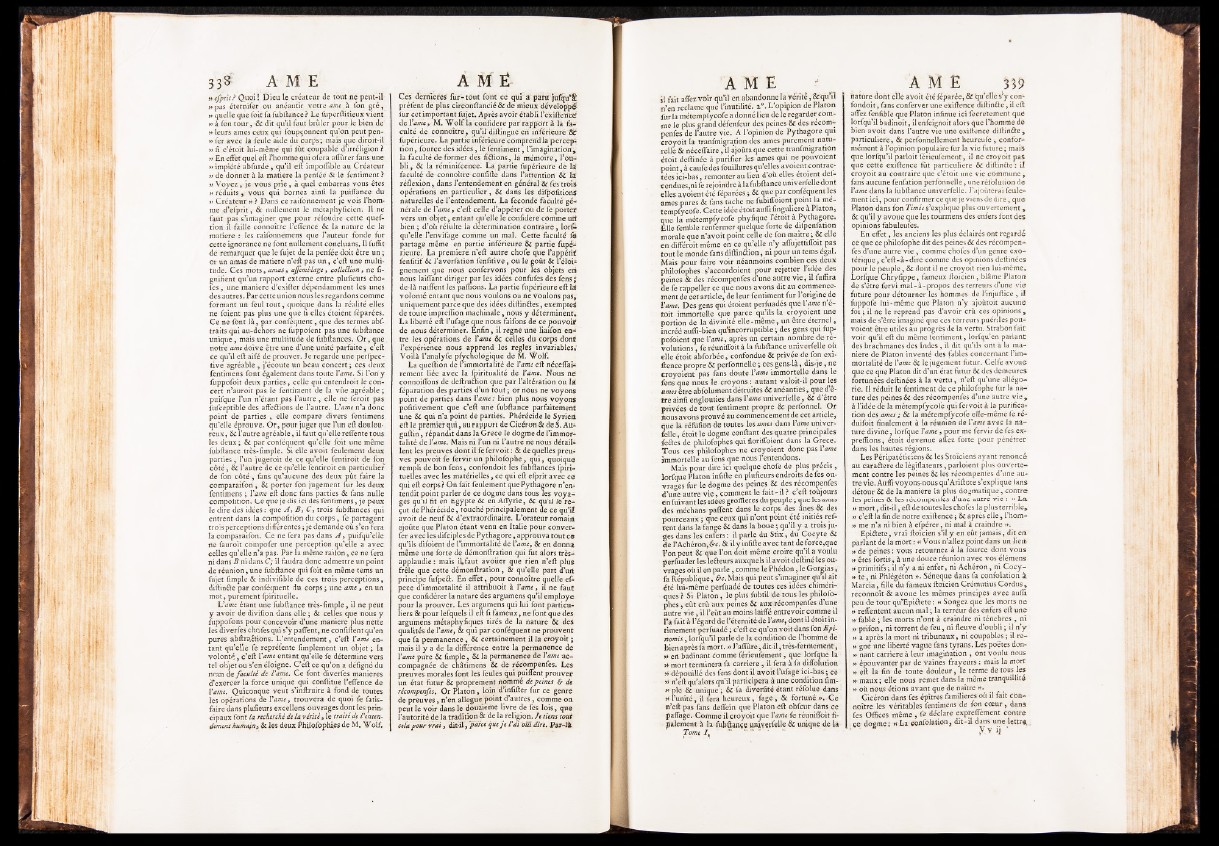
g j P A M E
« efprit ? Quoi ! Dieu le créateur de tout ne peut-il
»pas éternifer ou anéantir votre aine à fon g ré ,
» quelle qlie Toit fa fubftance ? Le fuperftitieux vient
» à fon tour, & dit qu’il faut brûler pour le bien de
» leurs âmes ceux qui foupçonnent qu’on peut pen-
» fer avec la feule aide du corps ; mais que diroit-il
» fi c’étoit lui-même qui fût coupable d’irréligion ?
» En effet quel eft l’homme qui ofera affûrer fans une
» impiété abfurde, qu’il eft impoffible au Créateur
» de donner à la matière la penfée & le fentiment ?
» V o y e z , je vous prie, à quel embarras vous êtes
» réduits ,■ vous qui bornez ainfi la puiffance du
>; Créateur » ? Dans ce raifonnement je vois l’homme
d’efprit, & nullement le métaphyficien. Il ne
faut pas s’imaginer que pour réfoûdre cette question
il faille connoître l’effencé & la nature de la
matière : les raifonnemens que l’auteur fonde fur
cette ignorance ne font nullement concluans. Il fuffit
dé remarquer que le fujet de la penfée doit être un ;
or un amas de matière n’eft pas un, c’eft une multitude.
Ces mots, amas , ajfemblage , collection, ne fi-
gnifient qu’un rapport externe entre plufieurs cho-
fes , une maniéré d’exifter dépendamment les unes
des autres. Par cette union nous les regardons comme
formant un féul tout, quoique dans la réalité elles
ne foient pas plus une que fi elles étoient féparées.
Ce ne font là , par conféquent, que des termes abf-
traits qui au-dehors ne fuppofent pas une fubftance
unique, mais une multitude de fubftances. O r , que,
notre ame doive être une d’une unité parfaite, c’eft
ce qu’il eft aifé de prouver. Je regarde une perfpec-
tive agréable, j’écoute un beau concert ; ces deux
fentimens font également dans toute Y ame. Si l’on y
fuppofoit deux parties, celle qui entendroit le concert
n’auroit pas le fentiment de la vûe agréable ;
puifque l’un n’étant pas l’autre, elle ne feroit pas
fufceptible des affeâions de l’autre. L'ame n’a donc
point de parties , elle compare divers fentimens
qu’elle éprouve. Or, pour juger que l’un eft douloureux,
& l’autre agréable, il faut qu’elle reffente tous
les deux ; & par conféquent qu’elle foit une même
fubftance très-fimple. Si elle avoit feulement deux
parties, l’un jugeroit de ce qu’elle fentiroit de fon
cô té, & l’autre de ce qu’elle fentiroit en particulier
de fon côté-, fans qu’aucune des deux pût faire la
comparaifori , & porter fon jugement fur les deux
fentimens ; Y ame eft donc fans parties & fans nulle
compofition. Ce que je dis ici des fentimens, je peux
le dire des idées : que A , B , C , trois fubftances qui
entrent dans la compofition du corps, fe partagent
trois perceptions différentes ; je demande où s’en fera
la comparaifon. Ce ne fera pas dans A , puifqü’elle
rie fauroit compofer une perception qu’elle a avec
celles qu’elle n’a pas. Par la même raifon, ce ne fera
ni dans B ni dans C; il faudra donc admettre un point
de réunion, une fubftance qui foit en même tems un
fujet fimple & indivifible de ces trois perceptions,
diftinôe par conféquent du corps ; une ame , en un
mot, purement fpirituelle.
L'ame étant une fubftance très-fiipple, il ne peut
y avoir de divifion dans elle ; & celles que nous y
luppofons pour concevoir d’une maniéré plus nette
les diverfes chofes qui s’ÿ paffent, ne confiftent qu’en
pures abftra.ctions. L ’entendement, c’eft Y ame entant
qu’elie fé repréfente fimplement un objet ; la
volonté, c’eft Y ame entant qu’elle fe détermine vers
tel objet ou s’en éloigne. C’eft ce qu’on a défigné du
ncym de faculté de l'ame. Ce font diverfes maniérés
d’exercer la force unique qui conftitue l’effence de
Y ame. Quiconque veut s’inftruire à fond de toutes
les opérations de Y ame, trouvera de quoi fe fatis-
faire dans plufieurs excellens ouvrages dont les principaux
font la recherché de la vérité , le traite de l'entendement
humain, & les deux Philofophies de M. Wolf.
A M É
Ces dèniieres fur-tout font ce qüi a paru jüfqu*£
préfent de plus circonftancié & de mieux développé
fur cet important fujet. Après avoir établi l’exiftèricef
de Y ame ,■ M. W olf là confidere par rapport à là faculté
de connoître, qu’il diftingue en inférieure 8È
fupérieure. La partiéinférieûre comprend la perception,
fource des idées, le fentiment, rimâgination',
la faculté de former dés fixions, la méritoire, l’oubli
, & la réminifcence. La partie fupérieure dé là
faculté de connoître corififtè dans l'attention & la‘
réflexion, dans l’entendemerit en général & fës trois
opérations en particulier , & dans les difpofitionS
naturelles de l’entendement. La fécondé faculté générale
de Y ame , c’eft celle d’appéter où de fe porter
vers un objet, entant qu’elle le corifideré comme urt
bien ; d’où réfulte la détermination contraire, lorf-
qu’elle l’envifage comme un mal. Cette faculté fé
partage même en partie inférieure & partie fupé-i
rieure. La première n’eft autre chofe que l’appétiiî
fenfitif & l’averfation fenfitive, ou le goût & l’élôi*
gnement que nous confervons pour les objets eii
nous laiffant diriger par les idées confufes des fens £
de là naiffent les pallions. La partie fupérieure eft lat
volonté entant que nous voulons ou ne voulons pas»
uniquement parce que des idées diftiriétes, exemptes
de toute imprelïïon machinale, nous y déterminent.
La liberté eft l’ufage que nous faifons de ce pouvoir
de nous déterminer. Enfin, il régné une liaifon en^
tre les opérations de Y ame & celles du corps dont
l’expérience nous apprend les réglés invariables«
Voilà l’analyfe pfycholôgique de M. Wolf.
La queftion de l’immortalité de Yàrtie eft néceffai*
rement liée avec la fpiritualité de Yâme. Nous né
connoiffons de deftrudiori que par l’altération ou là.
féparation des parties d’un tout ; or noüs ne voyons
point de parties dans Yame: bien plus nous voyons
pofitivertient que c’eft une fubftance parfaitement
une & qui n’a point de partiés. Phérécide le Syrieii
eft le premier qui, au rapport de Cicéron & de S. Au*
guftin, répandit dans la Grece le dogme de l’immor*
talité de Yame. Mais ni l’un ni l’autre ne nous détail*
lent les preuves dont il fe fervoit : & de quelles preuves
pouvoit fe fervir un philofophe, qui, quoique
rempli de bon fens, confondoit les fubftances fpiri-
tuelles avec les matérielles, ce qui eft efprit avec ce
qui eft corps? On fait feulement que Pythagore n’entendit
point parler de ce dogme daris tous les voyages
qu’il fit en Egypte & en Affyrie, & qu’il le reçut
de Phérécide, touché principalement de ce qu’il
avoit de neuf &c d’extraordinaire. L’orateur romain
ajoûte que Platon étant venu en Italie pour conver-
fer avec les difciples de Pythagore, approuva tout ce
qu’ils difoient de l’immortalité de Yame, & en donna
même une forte de démoriftration qui fut alors très-
applaudie : mais il»faut avoiier qué rien n’eft plus
frêle que cette démonftration, & qu’elle part d’uii
principe fufpeéL En effet, pour connoître quelle efc
pece d’immortalité il attribùoit à Yame, ii ne faut
que confidérer la nature des argumens qu’il employé
pour la prouver. Les argumens qui lui font particuliers
& pour lefquels il eft fi fameux, ne font que des
argumens métaphyfiques tirés de la nature & deS
qualités de Yame, & qui par conféquent ne prouvent
que fa permanence, & certainement il la croyoit ;
mais il y a de la différence entre la permanence de
Yame pure & fimple, & la permanence de Yame accompagnée
de châtimens & dè récompenfes. Les
preuves morales font les feules qui puiffent prouver
un état futur & proprement nommé de peines & de
récompenfes. Or Platon, loin d’infifter fur ce genre
de preuves, n’en allégué point d autres, comme on
peut le voir dans le douzième livre de fes lois, que
l’autorité de la tradition & de la religion. Je tiens tout
cela poiir vrai , dit-il, parce qüejel'di oui dire. Par-là
A M E U fâit affez voir qu’il en abandonne la vérité, & qu’il
m’en reclame que l’inutilité. z°. L ’opipion de Platon
fur la métempfycofe a donné lieu de le regarder comme
le plus grand défenfeur des peines & des récompenfes
de l’autre vie. A l ’opinion de Pythagore qui
croyoit la tranfmigration des âmes purement naturelle
& néceffaire, il ajoûta que cette tranfmigration
étoit deftinée à purifier les âmes qui ne pouvoient
point, à caufe des feuillures qu’elles a voient contractées
ici-bas, remonter au lieu d’ou elles etoient del-
cendues,ni fe rejoindre à lafubftanee univerfelle dont
elles avoient été féparées ; & que par confequent les
âmes pures & fans tache ne fubiffoient point la me-
tempfycofe. Cette idée étoit auffifinguhere à Platon,
que la métempfycofe phyfique l’etoit à Pythagore.
Elle femble renfermer quelque forte de difpenfation
morale que n’avoit point celle de fon maître; & elle
en différoit même en ce qu’elle n’y affujettiffoit pas
jtout le monde fans diftinftion, ni pour un tems égal.
Mais pour faire voir néanmoins combien ces deux
philofophes s’accordoient pour rejetter l’idée des
peines & des récompenfes d’une autre v ie , il fuflira
de fe rappeller ce que nous avons dit au commencement
de cet article, de leur fentiment fur l ’origine de
Yame. Des gens qui étoient perfuades que 1 ame n e-
îoit immortelle que parce qu’ils la croyoient une
portion de la divinité elle-même, urt être éternel,
incréé auffi^bien qu’incorruptible ; des gerts qui fup-*
pofoient que Yame, après un certain nombre de révolutions
, fe réunifient à la fubftance univerfelle ou
elle étoit abforbée, confondue & privée de fon exi-
ftence propre & perfonnelle ; ces gens-là, dis-je, ne
croyoient pas fans doute Yame immortelle dans le
fens que nous le croyons : autant valoit-il pour les
urnes être abfolument détruites & anéanties , que d’être
ainfi englouties dans Yame univerfelle, & d être
privées de tout fentiment propre & perfonnel. Or
nous avons prouvé au commencement de cet article,
que la réfufion de toutes les âmes dans Yame univers
felle, étoit le dogme confiant des quatre principales
feâes de philofophes qui floriffoient dans la Grece.
Tous ces philofophes ne croyoient donc pas Yame
immortelle aü fens que nous l’entendons. ^
Mais pour dire ici quelque chofe de plus précis,
lorfque Platon infifte en plufieurs endroits de fes ouvrages
fur le dogme des peines & des récompenfes
d’une autre v ie , comment le fait-il ? c’eft toûjours
Cnfuivant les idées groflieres du peuple ; cjue les âmes
des méchâns paffent dans le corps des ânes & des
pourceaux ; que ceux qui n’ont point été initiés refirent
darts la fange & dans la boue ; qu’il y a trois juges
dans les enfers: il parle du Stix, du Cocyte &
de l’Achéron,^. & i ly infifte avec tant de force,que
Èon peut & que l’on doit même croire qu’il a voulu
perfuader les le&eurs auxquels il avoit deftiné les ouvrages
où il en parle, comme le Phédon, le Gofgias,
fa République, &c. Mais qui peut s’imaginer qü’U ait
été lui-même perfuadé de toutes ces idées chimériques?
Si Platon, le plus fubül'de tous les philofophes
, eût crû aüx peines & aux'réeompenfes d’une
autre v ie , il l’eût au moins laiffé entrevoir comme il
l'a fait à l’égard de l’éternité de Yame, dont il étoit intimement
perfuadé ; c’eft ce qu’on voit dans fon Epi-
nomis, lorfqu’il parle de la condition de l’homme dè
bien après fa mort. » J’affûre, dit-il, très-ferriiemërtt,
» ert badinant comme férieufemertt, que lôrfqüè la
» mort terminera fa Carrière, il fera à fa diffoliition
» dépouillé des fens dont il avoit l’üfagé ici-bas ; ce
» n’eft qu’alors qu’il participera à une condition fim-
»plé & unique; & fa diverfité étant réfolue dans
^l’unité, il fera heureux, fag e, & fortuné». Ce
n’eft pas fans dêffein que Platon eft obfeur dans ce
paffage. Comme i l croyoit que Yame fe réuniffôit fi-
flalement à la fubftanee univerfelle & unique de la
Tome 1^
 M Ë W9
hatüre dont elle avoit été féparée, & 'qu’élle s’ÿ corn
fondoit, fans confervèr une exiftence diftinéle -, il eft
affez fenfible que Platon irifinue ici fecre’tement què
lorfqù’il badinoit, il enfeigrioit alors que l’homme de
bien avoit dans l’autre vie une exiftence diftinéfe ,
particulière, & perfonhellement heureufe -, conformément
à l’opinion populaire fur la vie future ; mais
que lorfqu’il parloit férieufement, il ne croyoit pas
que cette exiftence fût particulière & diftintte : il
croyoit au contraire que c’étoit une vie commune ,
fans aucune fenfation perfonnelle, une réfolution de
Yame dans la fiibftancé univerfelle. J’ajoûterai feulement
ic i, pour confirmer ce que je viens de dire, que
Platon dans fon Timée s’explique plus ouvertement,
& qu’il y avoue que les tourmens des enfers font des
opinions fabuleuiès.
En effet, les anciens les plus éclairés ont regardé
ce que ce philofophe dit des peines & des récompenfes
d’une autre vie , comme chofes d’un genre exo-
térique, c’eft-à-dire comme des opinions deftinées
pour le peuple, & dont il ne croyoit rien lui-même.
Lorfque Chryfippe, fameux ftoïcien, blâme Platon
de s’être fervi mal-à-propos des terreurs d’une vie
future pour détourner les hommes de l’injuftice , il
fuppofe lui - même que Platon n’y ajoûtoit aucune
foi ; il rie le reprend pas d’avoir crû ces opinions ,
mais de s’être imaginé que ces terreurs puériles pouvoient
être utiles au progrès de la vertu. Strabon fait
voir qu’il eft du même fentiment, lorfqu’en parlant
des brachmanes des Indes, il dit qu’ils ont à la maniéré
de Platon inventé des fables concernant l’immortalité
de Yame & le jugement futur. Celfe avoué
que ce que Platon dit d’un état futur & des demeures
fortunées deftinées à la vertu, n’eft qu’une allégorie.
Il réduit lé fentiment de ce philofophe fur la nature
des peines & des récompenfes d’une autre vie ,
à l’idée de la métempfycofe qui fervoit à la purification
des âmes ; & la métempfycofe elle-même fe ré*
duifoit finalement à la réunion de Yame avec la nature
divine, lorfque Yame, pour me fervir de fes ex*
prefliôns, étoit devenue affez forte pour pénétrer
dans les hautes régions.
Les Péripatéticiens & les Stoïcienà ayant renoncé
au càraftere de légiflateurs, parloient plus ouvertement
contre les peines & les récompenfes d’une autre
vie. Auffi voyons-nôus qu’Ariftote s’explique fans
détour & dè la maniéré la plus dogmatique, contre
les peines & les récompenfes d’une autre vie : « La
» mort, dit-il, eft de toutes les chofes la plus terrible,
» c’eft la fin de nôtre exiftence ; & après elle -, l’hom-
» me n’a ni bien à efpérer, ni mal à craindre ».
Epiûete, vrai ftoïcien s’il y en eût jamais, dit en
parlant de la mort : « Vous n’allez point dans un lieu,
» de peines: vous retournez à la fource dont vous
» êtes fortis, à une douce réunion avec vôs élémens
» primitifs ; il n’ÿ a ni enfer, ni Achéron, ni C o c y -
» te , ni Phlégéton ». Séneque dans fa confolation à
Marcia, fille du fameux ftoïcien Crémutius Cordus »
reconnoît & avoue les mêmes principes avec auflï
peu de tour qu’Epiôete : « Songez que les morts ne
» reffentent aucun mal ; la terreur des enfers eft une
» fable ; les morts n’ont à craindre ni tértebres , ni
»-prifon, ni torrent de feu, ni fleuve d’oubli ; il n’ÿ
» a après la mort ni tribunaux, ni coupables ; il re-
» gne une liberté vague fans tyrans. Les poètes don-
» nant cârriere à leur imagination , ont voulu nous
’ » épouvanter par de vaines frayeurs : mais la mort
» eft la fin de toute douleur, le terme de tous les
» maux ; elle nous remet darts la iriême tranquillité
» où nous étions avant que de naître ».
Cicéron dans fes épîtres familières où il fait connoître
les véritables fentimens de fon coeur, dana
fes Offices même , fe déclare expreffement contre
. ce dogme; « La confolation, dit-il dans une lettré
• y. Y ij ’