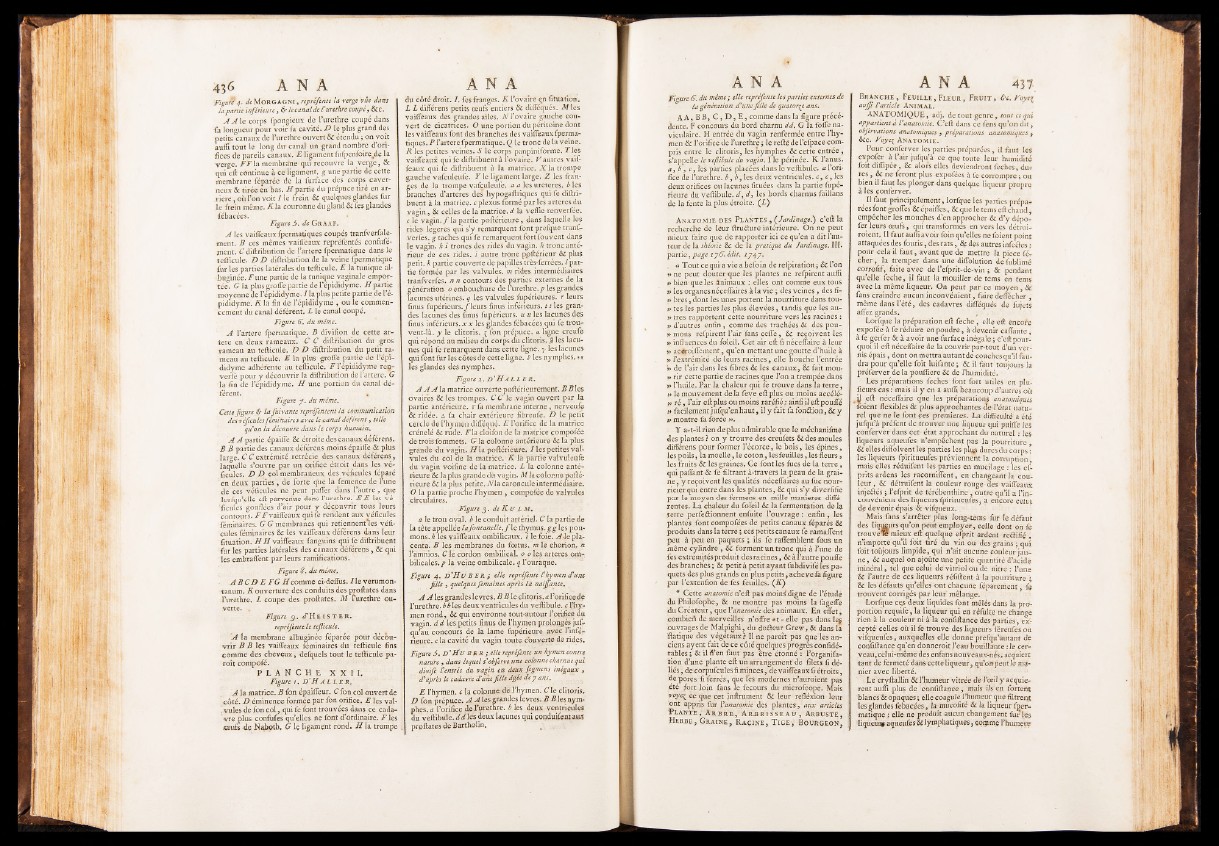
Figu$4 . de MORGAGNI, repréfinte la verge vue dans
la parue inférieure , & le canal de l'urethre coupé , 8cc.
A A le corps fpongieux de l’urethre coupé dans
fa longueur pour voir fa cavité. D le plus grand des
petits canaux de l’urethre ouvert & étendu ; on voit
aufli tout le long du* canal un grand nombre d’orifices
de pareils canaux. E ligament fufpenfoire^de la
verge. F F la membrane qui recouvre la verge, &
qui eft continue à ce ligament, g une partie de cette
membrane féparée de là furface des corps^ caverneux
& tirée en bas. H partie du prepuce tire en arriéré
, où l’on voit I le frein 8c quelques glandes fur
le frein même. K- la couronne du gland 8c fes glandes
fébacées.
Figure à . de G R A A F .
A les vaiffeaux fpermatiques coupés tranfverfale-
ment. B ces mêmes vaifleaux repréfentés confufé-
ment. C diftribution de l’artere fpermatique dans le *
tefticule. D D diftribution de la veine fpermatique
fur les parties latérales du tefticule. E la tunique al-
buginée. F une partie de la tunique vaginale emportée.
G la plus groffe partie de l’épididyme. Apartie •
moyenne de l’épididyme. I la plus petite partie de l’épididyme.
K la fin de l’épididyme , ou le commencement
du canal déférent. L le canal coupé.
Figure G. du même.
A l’artere fpermatique. B divifion de cette artère
en deux rameaux. C C diftribution du gros
rameau au tefticule. D D diftribution du petit rameau
au tefticule. E la plus groffe partie de l’épididyme
adhéfente au tefticule. F l’épididyme rep-
verfé pour y découvrir la diftribution de l’artere. G
la fin de l’épididyme. H une, portion du canal dé- ;
férent. ^ *
Figure y . du même.
Cette figure & la fuivante tepréfentent la communication
des véjicules féminaires avec le canal déférent, telle
qu'on la découvre dans le corps humain.
A A partie épaiffe & étroite des canaux déférens.
B B partie des canaux déférens moins épaiffe & plus
large. C C extrémité rétrécie des canaux déférens,
laquelle s’ouvre par un orifice étroit dans les ve-
ficules. D D col membraneux des véficules féparé
en deux parties, de forte cfue la femence de l’une
de ces véficules né peut paffer dans l’antre, que
lorfqu’elle eft parvenue dans l’urethre. E E les vé-
'ficules gonflées d’air pour y déçpuvrir tous leurs
contours. F F vaiffeaux qui île rendent aux véficules
féminaires. G G membranes qui retiennent les véficules
féminaires 8c les vaiffeaux déférens dans leur
fituation. H H vaiffeaux fanguins qui fe diftribuent
fur les parties latérales des canaux déférens, 8c qui
les embraffent par leurs ramifications.
Figure 8. du même,
A B C J? E F G H comme ci-deffus. / le verumon-
tanum. K ouverture des conduits des proftates dans
l’urethre. L coupe des proftates. M l’urethre ouverte.
*
Figure </’H e i s T E R .
repréfente le tefticule.
A la membrane albuginée féparée pour découvrir
B B les vaiffeaux féminaires du tefticule fins
comme des cheveux, defquels tout le tefticule pa-
roît compofé.
P L A N C H E X X I I .
Figure 1. D’H a l l é R.
A la matrice. B fan épaiffeur. C fon col ouvert de
coté. D éminence formée par fon orifice. E les val-
, vuies de fon co l, qui fe font trouvées dans ce cadavre
plus confufes qu’elles ne font d’ordinaire. F les
ceufs de Na^pth. G le ligament rond. H la trompe
du côté droit. I. fes franges. K l’ovaire e.n fituation.
L L différens petits oeufs entiers & difféqués. M les
vaiffeaux des grandes ailes. A l’ovaire gauche couvert
de cicatrices. O une portion du péritoine dont
les vaiffeaux font des branches des vaiffeaux fperma-
tiques. P l’artere fpermatique. Q le tronc de la veine.
R les petites veines. S le corps panpiniforme. Tles
vaiffeaux qui fe diftribuent à î’ovaire. Vautres vaiffeaux
qui fe diftribuent à la matrice. X la trompe
gauche vafculeufe. F le ligament large. Z les franges
de la trompe vafculeufe. a a les ureteres. b les
branches d’arteres des hypogaftriques qui fe diftribuent
à la matrice, c plexus formé par les arteres du
vagin, & celles de la matrice, d la veflie renverfée.
e le vagin, ƒ la partie poftérieure, dans laquelle les
rides legeres qui s’y remarquent font prefque tranf-
verfes, g taches qui fe remarquent fort fouvent dans
le vagin, h i troncs des rides du vagin, h tronc antérieur
de ces rides. 1 autre tronc ppftérieur & plus
petit, k partie couverte de papilles très-ferréçs. I partie
formée par les valvules, m rides intermédiaires
tranfverfes. n n contours des parties externes de la
génération, o embouchure de l’urethre./> les grandes
lacunes utérines, q les Valvules fupérieures. r leurs
finus fupérieurs. ƒ leurs finus inférieurs. 11 les grandes
lacunes des finus fupérieurs. u u les lacunes des
finus inférieurs. ?c x les glandes fébacées qui fe trouvent
là. y le clitoris. 1 fon prépuce, a ligne creüfe
qui répond au milieu du corps du clitoris. # les lacunes
qui fe remarquent dans cette ligne, y les lacunes
qui font fur les côtes de cette ligne. S'les nymphes, $ ?
les glandes des nymphes.
Figure z . d ' H a l l e r .
A A A la matrice ouverte poftérieurement. B 5 les
ovaires & les trompes. C C le .vagin ouvert par la
partie antérieure, r fa membrane interne, neryeufe
8c ridée, a fa chair extérieure fibreufe. D le petit
cercle de l’hymen difféqué. E l’orifice de la matrice
crénelé & rude. F la çloifon de la matrice çompofée
de trois fommets. G la colonne antérieure 8c la plus
grande du vagin. H la poftérieure. I les petites valvules
du col de la matrice. • K la partie valvuleufe
du vagin voifine de la matrice. L la colonne antérieure
& la plus grande dû vagin. M la colonne po.fté-
rieure 8c la plus petite. A l a caroncule intermédiaire.
O la partie proche l’hymen , çompofée de valvules
circulaires.
Figure 3 . de K U L M.
a le trou oval. b le conduit artériel. C la partie de
la tête appellée lafontanelle.fie thymus, g g les poumons.
kle s vaiffeaux ombilicaux, i le foie, ^-le placenta.
B les membranes du foetus, m le ehorion, n
l’amnios. C le cordon ombilical. 0 o les arteres ombilicales.
p la veine ombilicale, q l’ouraque.
Figure 4. d 'H u B ER ; elle repréfinte l'hymen d?une
fille , quelques femaines après là naiffance.
A A les grandes levres. B B le clitoris, a l’orificede
l ’urethre. b b les deux ventricules du veftibule. ç l’hymen
rond, 8c qui environne tout-autour l’prifice d(i
vagin, d d les petits finus de l’hymen prolongés jusqu’au
concours de la lame fupérieure avec l’infér
rieure. e la cavité du vagin toute d'ouverte de rides.
Figure 5 . d 'H U B f, R ; elle repréfinte un hymen contre
nature , dans lequel s ’obfirve une colonne charnue qui
divifi Centrée du vagin en deupç, figrnens inégaux ,
d'après le cadavre d'une fille âgée dey ans.
E l’hymen, c la colonne de J’hymen. (71e clitoris,
D fon prépuce. A -d les grandes levres. 5 5 les nymphes,
a l’orifice de l’urethre. b les deux ventricules
du veftibule. d d lès deux lacunes qui conduifent au?
proftates de Bartholin.
Figure €. du même ; elle repréfinte les parties externes de
* la. génération d'une fille de quatorze ans.
A A , B B , C , D , E , comme dans la figure précédente.
F concours dû bord charnu dd. G la foffe na-
viculaire. H entrée du vagin renfermée entre l’hymen
& l’orifiçe de l’urethre ; le refté de l’efpace compris
entre le clitoris, les nymphes & cette entrée,
s’appelle U veflibfile du vagin. I le périnée. K. l’anus.
a, b 9 çy les parties placées dans le veftibule. a l’orifice
de l’urethre. b, b, les deux ventricules, .ç, c , les
deux orifices ou lacunes fituées dans la partie fupérieure
du veftibule. d 9d, les bords charnus faillans
de la fente la plus étroite. ( / )
A n a t o m ie des Pl a n t e s , ( Jard ina gec’eft la
recherche de leur ftruûure intérieure. On ne peut
mieux faire que de rapporter ici ce qu’en a dit l’auteur
de la théorie 8c de la pratique du Jardinage. III.
partie, page lyG. édit. iy4y.
, « Tout ce qui a vie a befoin de refpiration ; & l’on
» ne peut douter que les plantes ne refpirent aufli
» biemqueles ânimaux : elles ont comme eux tous
» les organes néceffaires à la vie ; des veines, des fi-
>> bres , dont les unes portent la nourriture dans tou-
» tes les parties les plus élevées, tandis que les au-
» très rapportent cette nourriture vers les racines :
» d’autres enfin , comme des trachées & des pou-
» mons refpirent l’air fans ceffe, & reçoivent les
» influences du foleil. Cet air eft fi néceffaire à leur
» ac#roiffement 9 qu’en mettant une goutte d’huile à
» l’extrémité de leurs racines, elle bouche l’entrée
»> de l’air dans les fibres & les canaux, & fait mou-
» rir cette partie de racines que l’on a trempée dans
>> l’huile. Par la chaleur qui fe trouve dans la terre,
>> le mouvement de la feve eft plus ou moins accélér
é , l’air eft plus ou moins raréfié.: ainflil eft pouffé
» facilement jufqu’en haut, il y fait fafon&ion, & y
»> montre fa force ».
Y a-t-il rien déplus admirable que le méchanifme
des plantes ? on y trouve des creufets & des moules
differens pour former l’écorce, le bois, les épines,
les poils, la moelle, le coton, les feuilles, les fleurs,
les fruits & les graines. Ce font les fucs de la terre,
qui paffant & fe filtrant à-travers la peau de la grain
e , y reçoivent les qualités néceffaires au fuc nourricier
qui entre dans les plantes, & qui s’y diverfifie
par le moyen des fermens en mille maniérés différentes.
La chaleur du foleil & la fermentation de la
terre perfectionnent enfuite l’ouvrage : enfin , les
plantes font compofées dé petits canaux féparés &
produits dans la terre ; ces petits canaux fe ramaffent
peu à peu en paquets ; ils fe raffemblent fous un
même cylindre , & forment un tronc qui à l’une de
fes extrémités produit des racines, & à l’autre pouffe
des branches ; & petit à petit ayant fubdivifé les paquets
des plus grands en plus petits, achevé fa figure
par l ’extenfion de fes feuilles. (JC)
* Cette anatomie n’eft pas moinfdigne de l’étudé
du Philofophe, & ne montre pas moins la fageffe
du Créateur, que l’anatomie des animaux. En effet,
combieft de merveilles n’offre -»t relie pas dans le^
ouvrages de Malpighi, du dorieur Grew, & dans la
ftatique des végétaux? Il ne paroît pas que les anciens
ayent fait de ce côté quelques progrès confidé-
rables ; & il A’en faut pas être étonné : l’organifa-
ïion d ’une plante eft un arrangement' de filets fi déliés
, de corpufcules fi minces, de vaiffeaux fi étroits,
de pores fi ferrés, que les modernes n’auroiént pas
été fort loin fans le fecours du microfeope. Mais
voye^ ce que cet inftrument 8c leur refléxion leur
:ont appris fur l'anatomie des plantes, aux articles
P l a n t e , A r b r e , A r j r i s s e a u , A r b u s t e ,
N e r b e , G r a in e , R a c in e , T iG jE y B o u r g e o n ,
Br a n c h e , Fe u i l l e , F l e u r , F r u i t , bc.Voye1
aujji l'article A n im a l .
ANATOMIQUE, adj. de tout genre, tout ce qui
appartient â l'anatomie. C ’eft dans ce fens qu’on d i t ,
obfirvations anatomiques , préparations anatomiques ,
&c. Voye^ A n a t o m ie .
Pour conferver les parties préparées, il faut les
expofer à l’air jufqu’à ce que toute leur humidité
foit diflipee, & alors elles deviendront feches, du-
res, & ne feront plus expofées à fe corrompre ; ou
bien il faut les plonger dans quelque liqueur propre
à les conferver.
II faut principalement, lorfque les parties préparées
font groffes & épaiffes, & que le tems eft chaud ,
empêcher les mouches d’en approcher & d’y dépo-
fer leurs oeufs, qui transformés en vers les détrui-
roient. Il faut aufli avoir foin qu’elles ne foient point
attaquées des fouris, des rats, 8c des autres infetffes ;
pour cela il faut, avant que de mettre la piece fér
cher, la tremper dans une diffolution de fublimé
corrofif, faite avec de l’efprit-de-vin ; & pendant
qu’elle feche, il faut la mouiller de tems en tems
avec la même liqueur. On peut par ce moyen , &
fans craindre aucun inconvénient, faire deflècher ,
même dans l’été, des cadavres difféqués de fujets
a fiez grands.
Lorfque la préparation eft feche, elle eft encore
expofée à fe réduire en poudre, à devenir caffante,
à fe gerfer & à avoir une furface inégale ; c’eft pourquoi
il eft néceffaire de la couvrir par-tout d’un vernis
épais, dont on mettra autant de couches qu’il faudra
pour qu’elle foit luifante ; 8c il faut toujours la
préferver de la poufliere 8c de l’humidité.
Les préparations feches font fort utiles en plu-
fieurs cas : mais il y en â aufli beaucoup d’autres oii
ü eft néceffaire que les préparations anatomiques.
foient flexibles & plus approchantes ae l'éta t naturel
que ne le font ces premieres. La difficulté a été
jufqu’à préfent de trouver une liqueur qui puiffe les
conferver dans cet- état approchant du naturel : les
liqueurs aqueufes n’empêchent pas la pourriture
& elles diffolvent les parties lés plqs dures du corps :
les liqueurs fpiritueufes préviennent la corruption,
mais elles réduifent les parties en mucilage : les ef-
prits ardens les racorniffent, en changeant la couleur
, 8c détruifent la couleur rouge des vaiffeaux
injectés ; l’efprit de térébenthine , outre qu’il a l’inconvénient
des liqueursfpiritueufes, a encore celui
de devenir épais & vifqueux.
Mais fans s’arrêter plus long-tèms fur le défaut
des liqueurs qu’on peut employer, celle dont on fe
trouvère mieux eft quelque efprit ardent redifiç ,
n’importe qu’il foit tiré du vin ou des grains ; qui
foit toujours limpide, qui n’ait aucune couleur jaune,
8c auquel on ajoute une petite quantité d’acide
minéral, tel que celui de vitriol ou de nitre : l’une
& l’autre de ces liqueurs réfiftent à la pourriture %
8c les défauts qu’elles ont chacune féparement, fo
trouvent corrigés par leur mêiange.
Lorfque cqs deux liquides font mêlés dans la proportion
requife, la liqueur qui ei? réfùlte ne change
rien à la couleur ni à la confiftance des parties-, exr
cepté celles oîi il fe trouve des liqueurs féreufes ou
Vifqueufes, auxquelles elle donne prefqu’autant de
copfiftance qu’en donneroit l’eau bouillante : le cerveau,
celui-même desenfans nouveaux-nés> acquiert
tant de fermeté dans cette liqueur, qu’on peut le manier
avec liberté.
Le cryftallin & l’hiuneur vitrée de l ’oeil y acquièrent
aufli plus de confiftance, mais ils en fortent
blancs & opaques elle coagule l’humeur que filtrent
les glandes febacées, -la mucofitë & la liqueur fpermatique
; elle ne produit aucun changement fur les
liqueur aqueufes & lymphatiques, coipme i’humera?