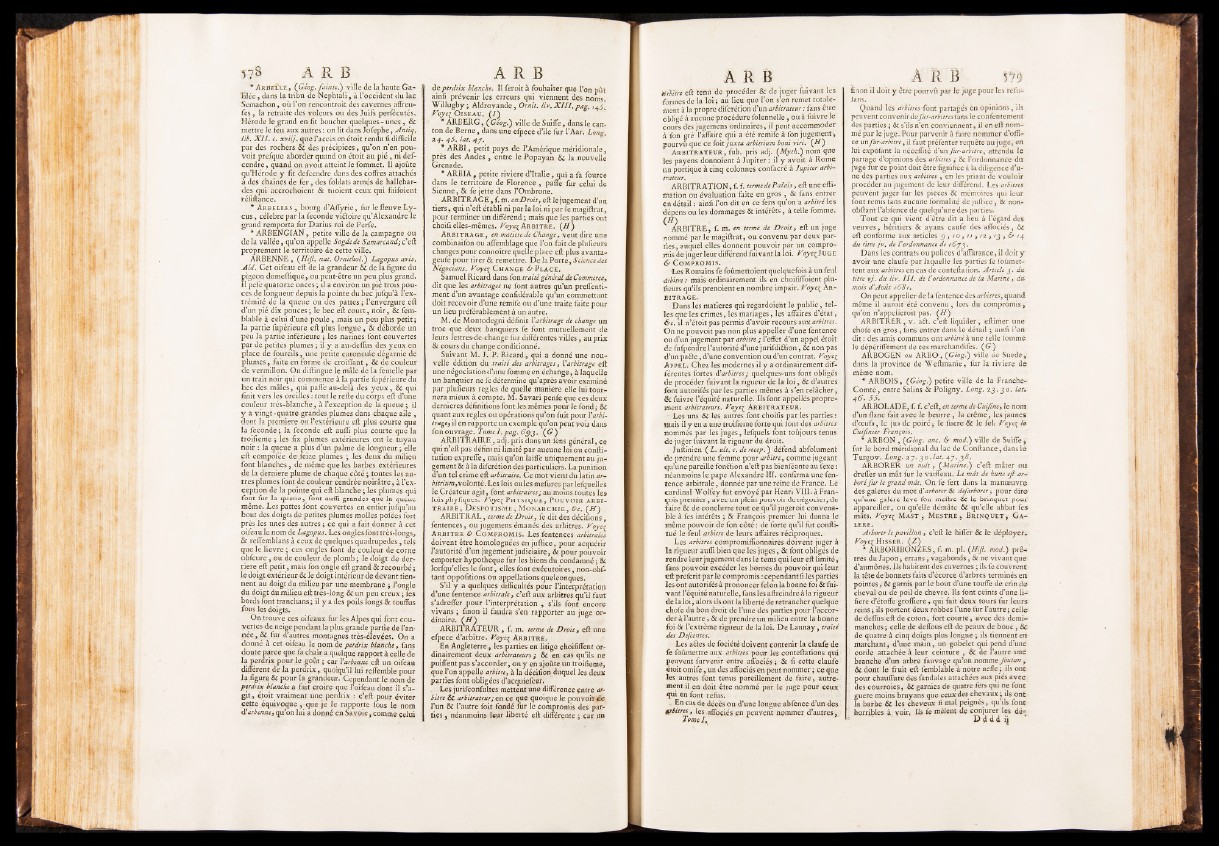
| g j | À R B
* A rbeXLE , (Géog. fûnte,) ville de la haute G alilée
, dans la tribu de Ncphtali, à l’occident du lac
Semachon, où l’on rencontroit des cavernes affreu-
fe s , la retraite des voleurs ou des Juifs perfécutés.
Hérode le grand en fit boucher quelques - unes, &
mettre le feu aux autres : on lit dans Jofephe, Antiq.
lib. X I I . c. xviij. que l’accès en étoit rendu fi difficile
par des rochers & des précipices, qu’on n’en pou-
voit prefque aborder quand on étoit au pié , ni def-
cendre, quand on avoit atteint le fommet. Il ajoute
qu’Hérode y fit defcendre dans des coffres attachés
à des chaînes de fer, des foldats armés de hallebardes
qui accrochoient & tuoient ceux qui faifoient
réfifiance.
* A r b e l l e s , bourg d’Affyrie, fur le fleuve Ly -
cu s , célébré par la fécondé v iâoire qu’Alexandre le
grand remporta fur Darius roi de Perfe.
* ARBENGIAN, petite ville de la campagne ou
de la vallée, qu’on appelle Sogdede Samarcand; c’eft
proprement le territoire de cette ville.
ARBENNE , (N i f . nat. Ornkhol.) Lagopus avis.
Aid. Cet oifeau eft de la grandeur & de la figure du
pigeon domeftique, ou peut-être un peu plus grand.
Il pefe quatorze onces ; il a environ un pié trois pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à l’extrémité
de la queue ou des pattes ; l’envergure eft
d’un pié dix pouces; le bec eft court, noir, & fem-
blable à celui d’une poule, mais un peu plus petit ;
la partie fupérieure eft plus longue , & déborde un
peu la partie inférieure ; les narines font couvertes
par de petites plumes ; il y a au-deffus des yeux en
place de fourcils, une petite caroncule .dégarnie de
plumes, faite en forme de croiflant, & de couleur
de vermillon. On diftingue le mâle de la femelle par
un trait noir qui commence à la partie fupérieure du
bec des mâles, qui paffe au-delà des y e u x , & qui
finit vers les oreilles : tout le refte du corps eft d’une
couleur très-blanche, à l’exception de la queue ; il
y a vingt-quatre grandes plumes dans chaque aile ,
dont la première ou l’extérieure eft plus courte que
la fécondé ; la fécondé eft auffi plus courte que la
troifieme ; les fix plumes extérieures ont le tuyau
noir : la queue a plus d’un palme de longueur ; elle
eft compofée deieize plumes ; les deux du milieu
font blanches, de même que les barbes extérieures
de la derniere plume de chaque côté ; toutes les autres
plumes font de couleur cendrée noirâtre, à l’exception
de la pointe qui eft blanche ; les plumes qui
font fur la queue , font auffi grandes que la queue
même. Les pattes font couvertes en entier jufqu’au
bout des doigts de petites plumes molles pofées fort
près les unes des autres ; ce qui a fait donner à cet
oifeau le nom de Lagopus. Les ongles font très-longs,
.& reffemblans à ceux de quelques quadrupèdes, tels
que ie lievre ; ces ongles font de couleur de corne
obfcure, ou de couleur de plomb ; le doigt de derrière
eft petit, mais fon ongle eft grand & recourbé ;
le doigt extérieur & le doigt intérieur de devant tiennent
au doigt du milieu par une membrane ; l’ongle
du doigt du milieu eft très-long & un peu creux ; fes
bords font tranchans ; il y a des poils longs & touffus
fous les doigts.
On trouve ces oifeaux fur les Alpes qui font couvertes
de neige pendant la plus grande partie de l’année
, & fur d’autres montagnes très-élevées. On a
donne à cet oifeau le nom de perdrix blanche, fans
doute parce que fa chair a.quelque rapport à celle de
la perdrix pour le goût ; car Xarbenne eft un oifeau
différent de la perdrix, quoiqu’il lui reffemble pour
la figure & pour la grandeur. Cependant le nom de
perdrix blanche a fait croire que l’oifeau dont il s’agit
, étoit vraiment une perdrix : c’eft pour éviter
cette équivoque , que je le rapporte fous le nom
üarbtnne, qu’on lui a donné en Sayoie, comme celui
A R B
de perdrix blanche. Il feroit à fouhaiter que l’on put
ainfi prévenir les erreurs qui viennent des noms.
"Willugby; Aldrovande, Omit. liv .X I I I . pag. Voyei O is e a u . (/)
* ARBERG, (Géog.') ville de Suiffe, dans le canton
de Berne, dans une efpece d’île fur l’Aar. Long.
2.4. 46. lat. 4 j .
* ARBI, petit pays de l’Amérique méridionale,
près des Andes , entre le Popayan & la nouvelle
Grenade.
* ARBIA , petite riviere d’Italie, qui a fa fource
dans le territoire de Florence , paffe fur celui de
Sienne, & fe jette dans l’Ombrone.
ARBITRAGE, f. m. enDroit, eft le jugement d’un
tiers , qui n’eft établi ni par la loi ni par le magiftrat,
pour terminer un différend ; mais que les parties ont
choifi elles-mêmes. Voyez A r b it r e , (H )
A r b i t r a g e , en matière de Change, veut dire une
combinaifon ou affemblage que l’on fait de plufieurs
changes pour connoître quelle place eft plus avanta-
geufe pour tirer & remettre. De la Porte, Science des
Négocions. Voyez CH AN G E & P L A C E .
Samuel Ricard dans fon traité général de Commerce,
dit que les arbitrages ne font autres qu’un preffenti-
ment d’un avantage confidérable qu’un commettant
doit recevoir d’une remife ou d’une traite faite pour
un lieu préférablement à un autre.
M. de Montodegni définit Xarbitrage de change un
troc que deux banquiers fe font mutuellement de
leurs lettres-de-change fur différentes villes, au prix
& cours du change conditionné.
Suivant M. J. P. Ricard, qui a donné une nouvelle
édition du traité des arbitrages, Xarbitrage eft
une négociation d’une fomme en échange, à laquelle
un banquier ne fe détermine qu’après avoir examiné
par plufieurs réglés de quelle maniéré elle lui tournera
mieux à compte. M. Savari penfe que ces deux
dernieres définitions font les mêmes pour le fond ; &
quant aux réglés ou opérations qu’on fuit pour Xarbitrage,
il en rapporte un exemple qu’on peut voir dans
fon ouvrage. Tome 1. pag. &£)3. (G )
ARBITRAIRE, adj. pris dans un fens général, ce
qui n’eft pas défini ni limité par aucune loi ou confti-
tution expreffe, mais qu’on laiffe uniquement au jugement
& à la diferétion des particuliers. La punition
d’un tel crime eft arbitraire. Ce mot vient du latin ar-
bitrium,volonté. Les lois ouïes mefures par lefquelles
le Créateur agit, font arbitraires; au moins toutes les
loisphyfiques. Voyez P h y s iq u e , P o u v o ir a r b i t
r a ir e , D e s p o t i sm e , M o n a r c h i e , & c. ( H )
ARBITRAL, terme de Droit, fe dit des dédiions ,
fentences, ou jugemens émanés des arbitres. Voyez
A r b it r e & C o m p r o m i s . Les fentences arbitrales
doivent être homologuées en juftice, pour acquérir
l’autorité d’un jugement judiciaire, & pour pouvoir
emporter hypotheque fur les biens du condamné ; &
lorlqu’elles le font, elles font exécutoires, non-obf-
tant oppofitions ou appellations quelconques.
S’il y a quelques difficultés pour l’interprétation
d’une ièntence arbitrale, c’eft aux arbitres qu’il faut
s’adreffer pour l’interprétation , s’ils font encore
vivans ; finon il faudra s’en rapporter au juge ordinaire.
(H )
ARBITRATEUR , f. m. terme de Droit, eft une
efpece d’arbitre. Voyez A r b it r e .
En Angleterre, les parties en litige choififfent ordinairement
deux arbitrateurs ; & en cas qu’ils ne
puiffent pas s’accorder, on y en ajoute un troifieme,
que l’on appelle arbitre, à la décifion duquel les deux
parties font obligées d’acquiefcer.
Les jurifconfultes mettent une différence entre arbitre
& arbitrateur; en ce que quoique le pouvoir «de
l’un & l’autre foit fondé fur le compromis des parties
, néanmoins leur liberté eft différente ; car .un
A R B
Arbitre eft tenu de procéder & de juger fuivant les
formes de la loi ; au lieu que l’on s’en remet totalement
à la propre diferétion d’un arbitrateur: fans être
obligé à aucune procédure folennelle, 'ou à fuivrele
cours dés jugemens ordinaires, il peut accommoder
à fon gré l’affaire qui a été remife à fon jugement-,
pourvu que ce foit juxta arbitrium boni viri. (H )
A r b it r a t e u r , fub. pris adj. (Myth.) nom que
les payens donnoient à Jupiter : il y avoit à Rome
Un portique à cinq colonnes confacré à Jupiter arbitrateur,
ARBITRATION, f. f. termedePaldis, èft une efti-
mation ou évaluation faite en gros , & fans entrer
en détail : ainfi l’on dit en ce fens qu'on a arbitré les
dépens ou les dommages & intérêts, à telle fomme.
( H) .
ARBITRE, f. m. tn terme de Droit, eft un juge
nommé par le magiftrat, ou convenu par deux parties
, auquel elles donnent pouvoir par un compromis
de juger leur différend fuivant la loi. Voyez Juge
& C o m p r o m is .
•Les Romains fe foûmettoient quelquefois à un feul
Arbitre : mais ordinairement ils en choififfoient plufieurs
qu’ils prenoient en nombre impair. Voyez A r b
i t r a g e .
Dans les matières qui fegardoient le public, telles
que les crimes, les mariages, les affaires d’état,
&c. il n’étoit pas permis d’avoir recours aux arbitres.
On ne pouvoit pas non plus appeller d’une fentence
ou d’un jugement par arbitre ; l’effet d’un appel étoit
de fufpendre l’autorité d’une jurifdiélion, & non pas
d’un pa£le, d’une convention ou d’un contrat. Voyez
A p p e l . Chez les modernes il y a ordinairement différentes
fortes d’arbitres; quelques-uns font obligés
de procéder fuivant la rigueur de la lo i, & d’autres
font autorifés par les parties mêmes à s’en relâcher,
& fuivre l’équité naturelle. Ils font appellés proprement
arbitrateurs. Voyez ARBITRA TEU R.
Les uns & les autres font choifis par les parties i
mais il y en a une troifieme forte qui lont des arbitres
nommés par les juges, lefquels font toujours tenus
dê juger fuivant lâ rigueur du droit-.
Jùftmien ( L. ult. c. de recep. ) défend abfolument
de prendre une femme pour arbitre, comme jugeant
qu’une pareille fonction n’eft pas bienféante au fexe :
néanmoins le pape Alexandre III. confirma une fentence
arbitrale, donnée par une reine de France. Le
cardinal "Wolfey fut envoyé par Henri VIII» à François
premier, avec un plein pouvoir de négocier, de
faire & de conclurre tout ce qu’il jugeroit convenable
à fes intérêts ; & François premier lui donna le
même pouvoir de fon côté : de forte qu’il fut confti-
tué le feul arbitre de leurs affaires réciproques.
Les arbitres compromiffionnaires doivent juger à
la rigueur auffi bien que les juges, & font obligés de
rendre leur jugement dans le tems qui leur eft limité,
fans pouvoir excéder les bornes du pouvoir qui leur, eft preferit par le compromis : cependant fi les parties
les ont autorifés à prononcer félon la bonne foi & fuivant
l’équité naturelle, fans les aftreindre à la rigueur
de la loi, alors ils ont la liberté de retrancher quelque
chofe du bon droit de l’une des parties pour l’accorder
à l'autre, & de prendre un milieu entre la bonne
foi 8f l’extrême rigueur de la loi. De Launay, traité
des Defcentes.
Les aftes de fociété doivent contenir la claufe de
fe foûmettre aux arbitres pour les conteftations qui
peuvent furvenir entre affociés ; & fi cette claufe
étoit omife, un des affociés en peut nommer ; ce que
les autres font tenus pareillement de faire, autrement
il en doit être nommé par le juge pour ceux
qui en font refus.
I Eu cas de décès ou d’une longue abfence d’un des
gfbures, les affociés .en peuvent nommer d’autres,
Tome I y
À R B $7 0
finon il doit y être pourvu par le juge pour les refù-
làns.
Quand lès arbitres -font partagés èn opinions, ils
peuvent convenir defur-arbitres fans le confentement
des parties ; & s’ils n’en conviennent, il en eft nommé
par le juge. Pour parvenir à faire nommer d’office
un fur-arbitre, il faut préfenter requête au juge, en
lui éxpofant la néceffité d’un fur-arbitre-, attendu le
partage d’opinions des arbitres ; & l’ordonnance du
juge lùr ce point doit être fignifiée à la diligence d’une
des parties aux arbitres , en les priant de vouloir
procéder au jugement de leur différend. Les arbitres
peuvent juger fur les pièces & mémoires qui leur
font remis la ns aucune formalité de juftice, & non-
obftant l’abfence de quelqu’une des parties-.
Tout ce qui vient d’être dit a lieu à l’égard des
veuves, héritiers & ayans caufe des affociés, &
eft conforme aux articles 9 , 10, 1 1 , 12 ,13 , & 14
du titre jv. de l'ordonnance de 16y3 .
Dans les contrats ou polices d’affûrance, il doit y
avoir une claufe par laquelle les parties fe foûmer-
tent aux arbitres en cas de conteftation. Article 3 . du
titre vj. du liv. I II. de l'ordonnance de la Marine , du
mois d'Août 1C81 i
On peut appeller de la fëntehee des arbitres, quand
même il auroit été convenu, lors du compromis,
qu’on n’appeiieroit pas. (H )
ARBITRER, v. a£t. c’eft liquider, eftimer une
chofe en gros, fans entrer dans le détail ; ainfi l’on
dit : des amis communs ont arbitré à une telle fomme
le dépériffement de ces marchandifes. ( G )
ARBOGEN ou ARBO, (Géog.) ville de Suede ,
dans la province de Weftmanie, fur la riviere dé
même nom.
* ARBOIS, (Géog.) petite Ville de la Franche-
Comté, entre Salins & Poligny. Long. 2 3.30 . lat.'
46 . 3 5 .
ARBOLADÈj f. f. c ’eft, en terme de Cuijine, le nom
d’un flanc fait avec le beurre, la crème, les jaunes
d’oeufs, le jus de poiré, le fucre & le fel. Voyez le
Cuijinier François.
* ARBON , (Géog. dnc. & mod.) ville de Suiffe
fur le bord méridional du lac de Confiance, dans lé
Turgow. Long. x j . 30. lat. 47. 38.
ARBORER un mât, (Marine.) c’eft mâter ou
dreffer un mât fur le vaiffeau. Le mât de hune ejl arboré
fur le grand mât. On fe fert dans la manoeuvre
des galeres du mot d’arborer & defarborer j pour dire
qu’une galere leve fon mettre & le brinquet pour
appareiller, ou qu’elle démâte & qu’elle abbat fes
mâts. Voye{ Ma s t , M e s t r e , Br in q u e t , Ga lè
r e .
Arborèr le pavilloà, c’eft lé hiffer & le déployer^
Voy ez His s e r . ( Z )
* ARBORIBONZES, fi m. pl. (Hijl. mod.) prêtres
du Japon, errans, vagabonds, & ne vivant que
d’aumônes. Ils habitent des cavernes ; ils fe couvrent
la tête de bonnets faits d’écorce d’arbres terminés en
pointes i & garnis par le bout d’une touffe de crin de
cheval ou de poil de chevre. Ils font ceints d’une li-
fiere d’étoffe groffiere , qui fait deux tours fur leurs
reins ; ils portent deux robbes l’une fur l’autre ; celle
de deffus eft de coton, fort courte ; avec des demi-
: manches ; celle de deffous eft de peaux de bouc, &
de quatre à cinq doigts plus longue ; ils tiennent en
marchant, d’une main, urt gobelet qui pend d’une
• corde attachée à leur ceinture , & de l’autre une
branche d’un arbre fauvage qu’on nomme foutan y
& dont le fruit eft femblable à notre nefle ; ils ont-
pour chauffure des fandales attachées aux pies avec
des courroies, & garnies de quatre fers qui ne font
guere moins bruyans que ceux des chevaux ; ils ont
la barbe & les cheveux fi mal peignes, qu iis font
horribles à voir, Ils fe mêlent de conjurer les dé-;
D d d d ij