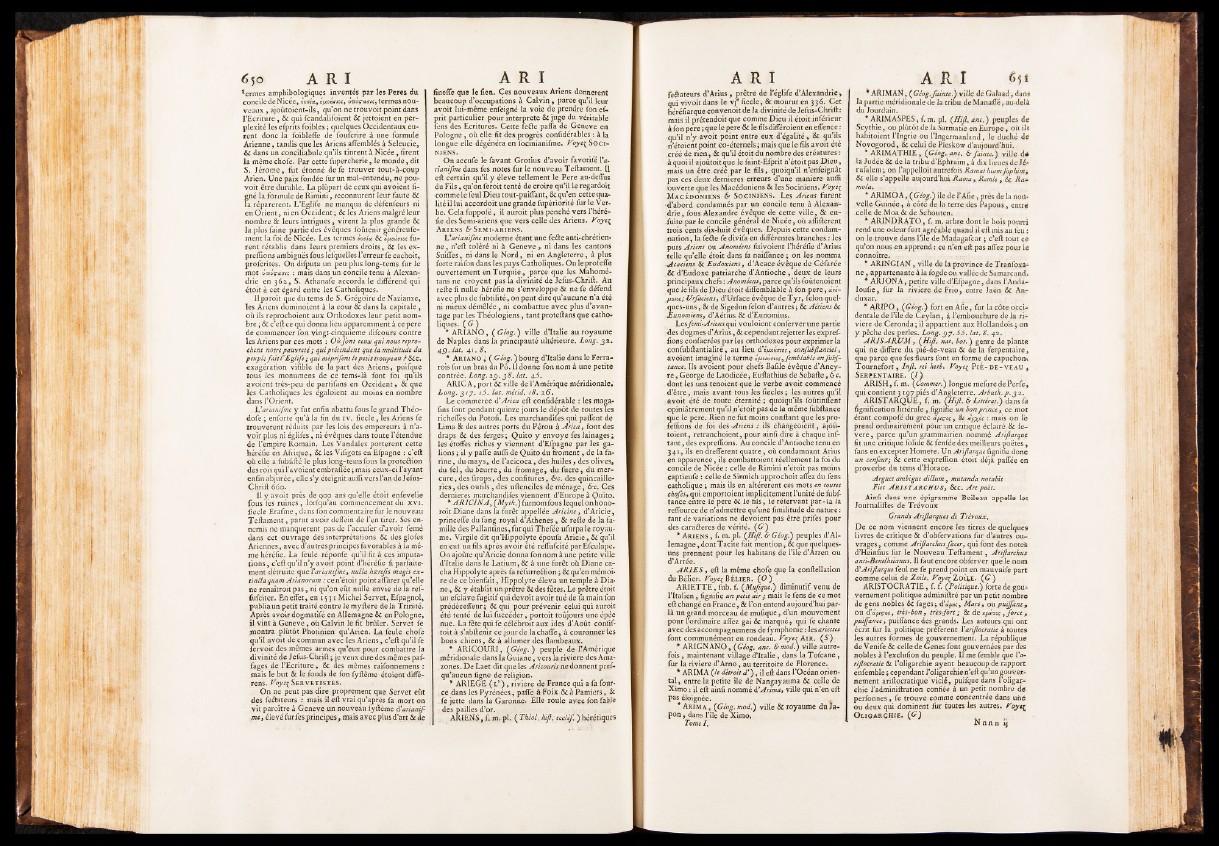
t crmes amphibologiques inventés par les Pere* du
concile de Nicee, oW/ci, ôjuouno;, v7rog-uaii, termes nouveaux
, ajoûtoient-ils, qu’on ne trouvoit point dans
l’Ecriture, & qui fcandalifoient 8c jettoient en perplexité
les efprits foibles ; quelques Occidentaux eurent
donc la foibleffe de foufcrire à une formule
Arienne, tandis que les Ariens affemblés à Seleucie,
& dans un conciliabule qu’ils tinrent à Nicée, firent
la même chofe. Par cette fupercherie, le monde, dit
S. Jérome, fut étonné de fe trouver tout-à-coup
Arien. Une paix fondée fur un mal-entendu, ne pou-
voit être durable. La plupart de ceux qui avoient ligné
la formule de Rimini, reconnurent leur faute 8c
la réparèrent. L’Eglife ne manqua de défenfeurs ni
en Orient, ni en Occident ; & les Ariens malgré leur
nombre & leurs intrigues, virent la plus grande 8c
la plus faine partie des évêques foûtenir généreufe-
ment la foi de Nicée. Les termes oW/* 8c èpowioc furent
rétablis dans leurs premiers droits, 8c les ex-
prefîions ambiguës fous lefquelles l’erreur fe cachoit,
profcrites. On difputa un peu plus long-tems fur le
mot CtsôçctiTiç : mais dans un concile tenu à Alexandrie
en 362, S. Athanafe accorda le différend qui
étoit à cet égard entre les Catholiques.
Ilparoît que du tems de S. Grégoire de Nazianze,
les Ariens dominoient à la cour 8c dans la capitale,
où ils reprochoient aux Orthodoxes leur petit nombre
; 8c c’eft ce qui donna lieu apparemment à ce pere
de commencer fon vingt-cinquieme difcours contre .
les Ariens par ces mots : Où font ceux qui nous reprochent
notre pauvreté j qui prétendent que La multitude du
peuple fait VEglife ; qui mèprifent le petit troupeau ? 8cc.
exagération vifible de la part des Ariens, puifque
tous les monumens de ce tems-là font foi qu’ils
avoient très-peu de partifans en Occident, & que
les Catholiques les égaloient au moins en nombre
dans l’Orient.
L’arianifme y fut enfin abattu fous le grand Théo-
dofe ; enforte qu’à la fin du iv . fiecle, les Ariens fe
trouvèrent réduits par les lois des empereurs à n’avoir
plus ni églifes, ni évêques dans toute l’étendue
de l’empire Romain. Les Vandales portèrent cette
héréfie en Afrique, 8c les Vifigots en Efpagne : c’eft
çù elle a fubfifté le plus long-tems fous la prote&ion
des rois qui l’a voient embraffée ; mais ceux-ci l’ayant
enfin abjurée, elle s’y éteignit aufli vers l’an de Jefus-
Chrift 660.
Il y à voit près de 900 ans qu’elle étoit enfevelie
fous fes ruines , lorfqu’au commencement du x v i .
fiecle Erafme, dans fon commentaire fur le nouveau
Teftament, parut avoir defl'ein de l’en tirer. Ses ennemis
ne manquèrent pas de l’accufer d’avoir femé
dans cet ouvrage des interprétations 8c des glofes
Ariennes, avec d’autres principes favorables à la même
héréfie. La feule réponfe qu’il fit à ces imputations
, c’eft qu’il n’y avoit point d’héréfie fi parfaitement
détruite que Y arianifme, nülla hærefis magis ex-
tincla quam Arianorum : ce n’étoit point aflïirer qu’elle
ne renaîtrait pas, ni qu’on eût nulle envie de la ref-
fufciter. En effet, en 1531 Michel Servet, Efpagnol,
publia un petit traité contre le myftere delà Trinité.
Après avoir dogmatifé en Allemagne 8c en Pologne,
il vint à G eneve, où Calvin le fit brûler. Servet fe
montra plûtôt Photinien qu’Arien. La feule chofe
qu’il avoit de commun avec les Ariens, c’eft qu’il fe
fervoit des mêmes armes qu’eux pour combattre la
divinité de Jefus-Chrift • je veux dire des mêmes paf-
fages de l’Ecriture, 8c des mêmes raifonnemens :
mais le but & le fonds de fon fyftême étoient diffé-
rens. Voye^ Servetistes.
On ne peut pas dire proprement que Servet eût
des feéfateurs : mais il eft vrai qu’après fa mort on
vit paraître à Geneve. un nouveau fyftème à'arianif
me, élevé fur fes principes, mais avec plus d’art & de
fîneffe que le lien. Ces nouveaux Ariens donnèrent
beaucoup d’occupations à Ca lv in , parce qu’il leur
avoit lui-même enfeigné la voie de prendre fon ef-
prit particulier pour interprète & juge du véritable
lens des Ecritures. Cette leâe paffa de Geneve en
Pologne, où elle fit des progrès confidérables : à la
longue elle dégénéra en focmianifme. V S o c i-
NIENS.
On accufe le favant Grotius d’avoir favorifé l’a.
rianifme dans fes notes fur le nouveau Teftament. Il
eft certain qu’il y éleve tellement le Pere au-deffus
du F ils, qu’on feroit tenté de croire qu’il le regardoit
comme le feul Dieu tout-puiffant, 8c qu’en cette qualité
il lui accordoit une grande fupériorité fur le Verbe.
Cela fuppofé, il aurait plus penché vers l’héré-
fie des Semi-ariens que vers celle des Ariens. Voye^
A r ie n s & Se m i -a r ie n s .
L’arianifme moderne étant une feâ e anti-chrétienne
, n’eft toléré ni à Geneve > ni dans les cantons
Suiffes, ni dans le Nord, ni en Angleterre , à plus
forte raifon dans les pays Catholiques. On le profeffe
ouvertement en Turquie, parce que les Mahomé-
tans ne croyent pas la divinité de Jefus-Chrift. Au
refte fi nulle hérefie ne s’enveloppe & ne fe défend
avec plus de fubtilité, on peut dire qu’aucune n’a été
ni mieux démêlée, ni combattue avec plus d’avantage
par les Théologiens, tant proteftans que catholiques.
( G )
* ARIANO, ( Géog. ) ville d’Italie au royaume
de Naples dans la principauté ultérieure. Long. 32.
4 9- lat. 41. 8.
* A r ia n o i ( Géog. ) bourg d’Italie dans le Ferra-
rois fur un bras du Pô. 11 donne fon nom à une petite
contrée. Long. 29.3#. lat. 4 5 .
ARICA, port 8c ville de l’Amérique méridionale*
Long. 3 1 7 . i 5 . lat. mérid. 18. 2.6.
Le commerce d'Arica eft confidérable : les maga-
fins font pendant quinze jours le dépôt de toutes les
richeffes du Potofi. Les marchandifes qui paffent de
Lima & des autres ports du Pérou à Ar ica, font des
draps 8c des ferges ; Quito y envoyé fes lainages ;
les étoffes riches y viennent d’Efpagne par les galions
; il y paffe aufti de Quito du froment, de la farine
, du mays, de l’acicoca, des huiles > des olives,
du fe l, du beurre, du fromage, du fucre, du mercure,
des firops, des confitures, 6*c. des quincailleries
, des outils , des uftenciles de ménage, & c. Ces
dernieres marchandifes viennent d’Europe à Quito.
* A R IC IN A , (Myth.) furnom fous lequel onhono-
roit Diane dans la forêt appellée Aricine , d’Aricie,
princeffe du fang royal d’Athènes, & refte de la famille
des Pallantines,furqui Thefée ufurpale royaume.
Virgile dit qu’Hippolyte époufa Aricie, 8c qu’il
en eut un fils après avoir été reffufcité par Efculape.
On ajoûte qu’Aricie donna fon nom à une petite ville
l d’Italie dans le Latium, 8c à une forêt où Diane cacha
Hippolyte après fa réfurreélion ; 8c qu’en mémoire
de ce bienfait, Hippolyte éleva un temple à Diane,
& y établit un prêtre & des fêtes. Le prêtre étoit
un efclave fugitif qui devoit avoir tué de fa main fon
prédéceffeur ; & qui pour prévenir celui qui aurait
été tenté de lui fuccéder, portoit toûjours une épée
nue. La fête qui fe célébrait aux ides d’Août confif-
toit à s’abftenir ce jour de la chaffe, à couronner les
bons chiens, 8c à allumer des flambeaux.
* ARICOURI, ( Géog. ) peuple de l’Amérique
méridionale dans la Guiané, vers la rivière des Ama-
. zones. De Laet dit que les Aricouris ne donnent pref-
qu’aucun ligne de religion. :
* ARIEGE ( l’ ) , rivière de France qui a fa four-
. ce dans les Pyrénées* paffe à Foix & à Pamiers, &
.fe jette dans la Garonne. Elle roule avec fon fabje
; des pailles d’or.
ARIENS, f. m. pl, ( Théol, hiß. eccléfl ) hérétiques
feàateurs d’Arius , prêtré dé i’églife d’Alexandrie*
qui vivoit dans le vje fiecle* & mourut en 336. Cet
héréfiarque convenoit de la divinité de Jefus-Chrift :
mais il prétendoit que comme Dieu il étoit inférieur à fon pere ; que le pere & lefilsdifféraient en effence :
•qu’il n’y avoit point entre eux d’égalité * 8c qu’ils
n’étoient point co-éternels ; mais que le fils avoit été
.créé de rien, & qu’il étoit du nombre des créatures :
à quoi il ajoûtoit que le faint-Efprit n’étoit pas Dieu,
mais un être crée par le fils, quoiqu’il n’enfeignât
pas ces deux dernieres erreurs d’une maniéré aufli
ouverte que les Macédoniens & les Sociniens. Voye^
Macédoniens & Sociniens. Les Ariens, furent
•d’abord condamnés par un concile tenu à Alexandrie
, fous Alexandre évêque de cette ville, & en-
fuite par le concile général de Nicée, où aflifterent
trais cents djx-huit évêques. Depuis cette condamnation
, la feâe fe divifa en différentes branches : les
purs Ariens ou Anoméens fuivoient l’héréfie d’Arius
telle qu’elle étoit dans fa naiffance ; on les nomma
Acaciens 8c Eudoxiens, d ’Acace évêque dé Géfarée
& d’Eudoxe patriarche d’Antioche , deux de leurs
.principaux chefs : Anoméens, parce qu’ils foûtenoient
que le fils de Dieu étoit diflemblable à fon pere, aW-
jjotoç; Zfrfaciens, d’Urface évêque de T y r , félon quelques
uns , & de Sigedun félon d’autres ; 8c Aétiens 8c
Euno miens, d’Aétius 8c d’Eunomius.
Lesfemi-Aritns qui vouloient conferver une partie
des dogmes d’Arius, & cependant rejetter les expref-
fions confacrées par les orthodoxes pour exprimer la
confubftantialité, au lieu d’a/uoB«off, confubfantiel,
avoient imaginé le terme ôy.oiémoi ,femblable en fubf-
tance. Ils avoient pour chefs Bafile évêque d’Ancy-
r e , George de Laodicée* Euftathius de Sebafte, 6 c.
dont les uns tenoient que le verbe avoit commencé
. d’être, mais avant tous les fiecles ; les autres qu’il
avoit été de toute éternité ; quoiqu’ils foûtinffent
opiniâtrement qu’il n’étoit pas de la même fubftanee
que le pere. Rien ne fut moins confiant que les procédions
de foi des -Ariens ; ils changeoient, a jouraient,
retranchoient, pour ainfi dire à chaque inf-
tant, des expreflions. Au concile d’Antioche tenu en
341, ils en drefferent quatre, où condamnant Arius
en apparence, ils combattoient réellement la foi du
concile de Nicée : celle de Rimini n’étoit pas moins
captieufe : celle de Sirmich approchoit affez du fens
catholique.; mais ils en altérèrent ces mots en toutes
chofes, qui emportoient implicitement l’unité de fubf-
tance entre le pere & le fils, fe réfervant par-là la
reffource de n’admettre qu’une fimilitude de nature :
tant de variations ne dévoient pas être prifes pour
des caraéteres de vérité. (G )
* A r ie n s , fi m. pl. (Hift* & Géogi) peuples d’Allemagne
, dont Tacite fait mention, 8c que quelques-
uns prennent pour les habitans de l’île d’Arren ou
d’Arrée.
A R IE S , eft la même chofe que la conftellation
du Bélier. Voye^ B é l ie r . (O )
ARIETTE, füb. f. ( Mufique.) diminutif venu de
l’ Italien, fignifie un petit air ; mais le fens de ce mot
eft changé en France, & l’on entend aujourd’hui par-
là un grand morceau de mufique, d’un mouvement
pour l’ordinaire affez gai & marqué, qui fe chante
avec des accompagnemens de fymphome i - l ariettes
font communément en rondeau, f^oye^ A ir . ( f )
* ARIGNANO, (Géog. anc. &mod.) ville autrefois
, maintenant village d’Italie, dans la Tofcane,
fur la riviere d’Arno, au territoire de Florence.
* ARIM A (le détroit d’ ) , il eft dans l’Océan oriental
, entre la petite île de Nangayauma 8c celle de
Ximo : il eft ainfi nommé à'A rima, ville qui n’en eft
pas éloignée.
* Ar im a , (Géog. mod.) ville & royaume du Japon
, dans l’île de Ximo.
Tome /,
* ARIM AN, (Géog.fainteï) vi lié dé Galaad * daris
la partie méridionale de la tribu de Manaffé, au-delà
du Jourdain.
* ARIMASPES, f. m. pl. (Hift. anc.') peuples de
Scythie, ou plûtôt de la Sarmatieen Europe, où ils
habitoient l’Ingrie ou l’Ingermaniand, le duché dé
Novogorod, 8c celui de Pleskôw d’aujourd’hui.
* ARIMATHIE, (Géog. anc. & fainte.) ville dé
la Judée 8c de la tribu d’Ephraïm , à dix lieues de Jé^
rufalem ; on l’appelloit autrefois Ramat hiamfophint*
8c elle s’appelle aujourd’hui Rama, Remle , 8c Ra*
mola-. r:.
* ARIM O À , (Géog.) île de l’Aiie, près de la nôü*
velle Guinée, à côté de la terre des Papous, entré
celle de Moà & de Schouten.
* ARINDRATO, f. m. arbre dont le bois pourri
rend une odeur fort agréable quand il eft mis au feu :
on le trouve dans l’île de Madagafcar ; c’eft tout çé
qu’on nous en apprend : ce n’en eft pas affez pour le
connoître. r:-,
* ARINGIAN, ville de la province de Tranfoxâ-
ne - appartenante à la fogde ou vallée de Samarcande
* ARJONA, petite ville d’Efpagne, dans l’Ânda-
loufie, fur la riviere de Frio, entre Jaën 8c A tir
duxar.
* ARIPO, (Géog,) fort en A fie, fur la côte occidentale
de l’île de Çeylan, à l’embouchure de la riviere
de Ceronda; il appartient aux Hollandois ; on
y pêche des perles. Long. g.7.65, lat. 8 .42.
AR ISA R UM , (Hifl. nat. bot.) genre de plante
qui ne diffère du pié-ae-veau & de la ferpentaire,
que parce que fes fleurs font en forme de capuchons
Tournefort, Injl. rei herb. Voye{ PiÉ-DE-VEAü *
Serpentaire. ( / )
ARISH, f. m. (Commer.) longue mefurede î?erfe$
qui contient 319 7pies d’Angleterre. A rb u th.p .3 2 .
ARISTARQUE, fi m. (Hifl. & Littérat.) dans fa
lignification littérale, fignifie un bon prince, ce mot
étant compofé du grec élf/ç-oç, & àpxoe : mais on lê
prend ordinairement pour un critique éclairé 8c fe-
v e ré , parce qu’un grammairien nommé Ariflarquc
fît une critique folide 8c fenfée des meilleurs poëtes,
fans en excepter Homefe. Un Ariflarque fignifie donc
un cenfeur; 8c cette èxpreflion etoit déjà paffée en
proverbe du tems d’Horace.
Arguet ambiguë diclum, mutanda notabit
Fiet A r i s t a r c h u s , 8cc. Ar t poèt.
Ainfi dans une épigramme Boileau appelle les
Joufrialiftes de Trévoux
Grands Arifldrqüès dé Trévoux.
De ce nom viennent encore les titres de quelques
livres de critique & d’obfervations fur d’autres o u - .
vrages, comme Ariflarchus facer, qui font des notes
d’Heinfius fur le Nouveau Teftament, Ariflarchus
anti-Bentlhéianus. Il faut encore obferver que le nom
dé Ariflarque feul ne fe prend point en mauvaife part
comme celui de Zoïle, Foye{ Zoï\E. (G )
ARISTOCRATIE, f. f. (Politique.) forte de gou^
vernement politique adminiftré par un petit nombre
de gens nobles 8c fages ; d’«pç, Mars , oü puijfant,
ou d’apiç-oç, très-bon, très-fort ; 8c de xpd'roç, force ,
pùijfance, puiffance des grands. Les auteurs qui ont
écrit fur la politique préfèrent Yartflocratit à toutes
les autres formes de gouvernement. La république
de Venife 8c celle de Genes font gouvernées par des
nobles à l’exçlufion du peuple. Il me femble que Va-
riflocratie 8c l’oligarchie ayent beaucoup de rapport
enfemble ; cependant l’oligarchie n’eft qu’un gouvernement
ariftocratique vicié, püifquedans l’oligar-
chié i’adminiftration confiée à un petit nombre dé
perfonnes , fe trouve comme concentrée dans uhé
ou deux qui dominent fur toutes les autres. Voye.£
Olig a r ch ie . (G )
N n r in ij