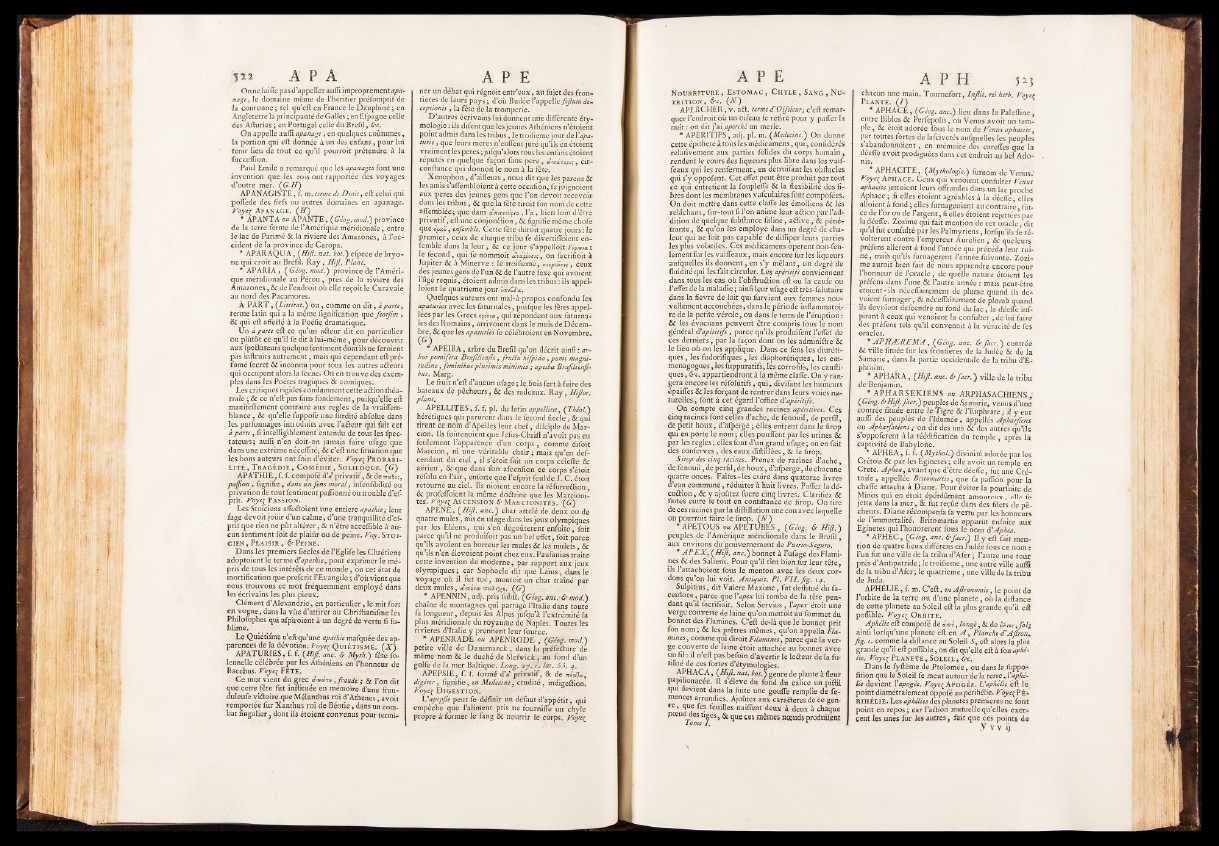
122 A P A
On ne laide pas d’appeller auffi improprement apanage,
le domaine même de l’héritier préfomptif de
la couronne ; tel qu’eft en France le Dauphiné ; en
Angleterre la principauté de Galles ; en Efpagne celle
des Afturies ; en Portugal celle du Brefil, &c. On appelle auffi apanage, en quelques coûtumes,
la portion qui eft donnée à un des enfans, pour lui
tenir lieu de tout ce qu’il pourroit prétendre à la
fucceffion.
Paul Emile a remarqué que les apanages font une
invention que les rois ont rapportée des voyages
^d’outre mer. ( G-H)
APANAGISTE, f. m. terme de D roit, eft celui qui
poffede des fiefs ou autres domaines en apanage.
Voyez A p a n a g e . {H )
* APANTA ou APANTE, (Géog. mod.) province
de la terre ferme de l’Amérique méridionale, entre
le lac de Parimé & la riviere des Amazones, à l’occident
de la province de Caropa.
* APARAQUA, {Hiß. nat. bot.') efpece de bryo-
ne qui croît au Brefil. Ray, Hifl. Plant. * APARIA, {Géog. mod.) province de l’Amérique
méridionale au Pérou, près de la riviere des
Amazones, & de l’endroit où elle reçoit le Curavaie
au nord des Pacamores.
À PART, {Littérat.) ou, comme on dit, a parte,
terme latin qui a la même lignification que feorfim,
& qui eft affe&é à la Poéfie dramatique.
Un à parte eft ce qu’un a&eur dit en particulier
ou plutôt ce qu’il fe dit à lui-même, pour découvrir
aux fpe&ateurs quelque fentiment dont ils ne feroient
pas inftruits autrement, mais qui cependant eft pré-
îumé fecret & inconnu pour tous lés autres aûe'urs
qui occupent alors la feene. On en trouve des exemples
dans les Poètes tragiques & comiques.
Les critiques rigides condamnent cette aftion théâtrale
; & ce n’eft pas fans fondement, puifqu’elle eft
manifeftement contraire aux réglés de la vraiffem-
blance, & qu’elle fuppofe une lurdité abfolue dans
les perfonnages introduits avec l’afteur qui fait cet à parte, fi intelligiblement entendu de tous les fpec-
tateurs; auffi n’en doit-on jamais faire ufage que
dans une extrême néceffité, & c’eft une fituationque
les bons auteurs ont foin d’éviter. Voyez P r o b a b i l
i t é , T r a g é d i e , C o m é d i e , S o l i l o q u e . {G )
APATHIE, f. f. compofé dV privatif, & derrdQoç,
paffion , lignifie , dans un fens moral, infenfibilité ou '
privation de tout fentiment paffionné ou trouble d’ef-
prit’ Voyez PASSION.
Les Stoïciens affe&oient une entière apathie; leur
fage devoit joiiir d’un calme, d’une tranquillité d’ef-
prit que rien ne pût altérer, & n’être acceffible à aucun
fentiment foitde plaifirou de peine. Voy. S t o ï c
i e n , P l a i s i r , & P e in e ;
Dans les premiers liéclesde l’Eglife les Chrétiens
âdoptoient le terme d'apathie,: pour exprimer le mépris
de tous les intérêts de ce monde, ou cet état de
mortification que preferit l’Evangile ; d’où vient que
nous trouvons ce mot fréquemment employé dans
les écrivains les plus pieux.
Clément d’Alexandrie, en particulier, le mit fort
en vogue, dans la vûe d’attirer au Chriftianifme les
Philofophes qui afpiroient à un degré de vertu fi fu-
blime.
Le Quietifme n’eft qu’une apathie mafquée des apparences
de la dévotion. Foyer Q u i é t i s m e . (X Y
APATURIES, f. f. {Hiß. anc. & Myth.) fête fo-
lennelle célébrée par les Athéniens en l’honneur de
Bacchus. Voyez F ê t e .
Ce mot vient du grec «W™ , fraude. ; & l’on dit
que cette fête fut inftituée en mémoire d’une frau-
duleufe viâoire queMélanthus roi d’Athenes avoit
remportée fur Xanthus roi de Béotie, dans un combat
fmgulier, dont ils étoient convenus pour terrni-
A P E
ner un débat qui régnoit entr’eux, au fiijèt des frontières
de leurs pays ; d’où Budée l’appelle fefium de- cepiionis , la fête de la tromperie.
D’autres écrivains lui donnent une différente étymologie
: ils difent que les jeunes Athéniens n’étoient
point admis dans les tribus, le troifieme turie, jour de Yapa- que leurs meres n’euffent juré qu’ils en étoient
vraiment les peres ; jufqu’alors tous les enfans étoient
réputés en quelque façon fans pere, «WTopf, cir-
conftance qui donnoit le nom à la fête.
Xenophon, d’ailleurs, nous dit que les parens &
les amis s’affembloient à cetté occafion, fe joignoient
aux peres des jeunes gens que l’on devoit recevoir
dans les tribus, & que la fête tiroit fon nom de cette
affemblee; que dans aVaToup/a, l’a, bien loin d’être
privatif, eft une conjonâion, & fignifïe même chofe
que ofxoZ, enfemble. Cette fête duroit quatre jours : le
premier, ceux de chaque tribu fe divertiffoient enfemble
dans la leur, & ce jour s’appelloit S'optsua :
le fécond, qui fe nommoit dvdppveiç, on facrinoit à
Jupiter & à Minerve : le troifieme, xovpiSrn, ceux
des jeunes gens de l’un & de l’autre fexe qui a voient
l’âge requis, étoient admis dans les tribus : ils appelaient
le quatrième jour ïmÇS'a.
Quelques auteurs ont mal-à-propos confondu les apaturies avec les faturnales, puifque les fêtes appelle
s par les Grecs xpôv/a,, qui répondent aux faturnales
des Romains, arrivoient dans le mois de Décembre,
& que les apaturies fe célébroient en Novembre.
H* APEIBA, arbre du Brefil qu’on décrit ainfi : ar- tbuodri pnoemifera Braßlienßs , fruclu hifpido, pomi magni- bus. , feminibus plurimis minimis ; apeiba Brafllienfi- Marg.
Le fruit n’eft d’aucun ufage ; le bois fert à faire des
pblaatneta,ux de pêcheurs, & des radeaux. Ray, Hflor.
APELLITES, f. f. pl. du latin appellitce, {Tkéol.)
hérétiques qui parurent dans le fécond fieclé, & qui
tirent ce nom d’Apelles leur chef, difciple de Mar-
cion. Ils foûtenoient que Jefus-Chrift n’avoit pas eu
feulement l’apparence d’un corps, comme difoit
Marcion, ni une véritable chair; mais qu’en def-
cendant du ciel, il s’étoit.fait un corps célefte &
aerien , & que dans fon afeenfion ce corps s’étoit
réfolu en l’air, enforte que l’efprit ieulde J. C. étoit
retourne au ciel. Ils nioient encore la réfurreôion,
& profeffoient la même doârine que les Mârcioni-
tes. Voye^Ascension 6* Marcionites. (G)
APÉNE, ( Hifl. anc. ) char attelé de deux ou de
quatre mules, mis en ufage dans les jeux olympiques
par les Eléens, qui s’en dégoûtèrent enfuite, foit
parce qu’il ne produifoit pas un bel effet, foit parce
qu’ils avoient en horreur les mules & lés mulets, &
qu’ils n’en élevoient point chez eux. Paufanias traite
cette invention de moderne, par rapport aux jeux
olympiques; car Sophocle'dit que Laïus, dans le
voyage oii il fut tué, montoit un char traîné par
deu*x mules, a’wi'wiruixtfo. {G) APENNIN, adj. pris fubft. {Géog. anc.'& mod.)
chaîne de montagnes qui partage l’Italie dans toute
fa longueur, depuis les Alpes jufqu’à l’extrémité la
plus méridionale du royaume de Naples. Toutes les
rivières d’Italie y prennent leur fource.
* APENRADE oh APÈNRODE , {Géog. mod.)
petite, ville de Danemarck , dans la préfeâure de
même nom & le duché de Slefwick; au fond d’un
golfe de la mer Baltique. Long, zy. 'ii làt. 66. 4.
APEPSIE, f. f. formé d’« privatif, & de 9reV7û>,' digérer, fignifïe, en Medecine, crudité, indigeftion. V'oyé^ D ig e s t io n . Vapepfie peut fe définir un défaut d’appétit, qui
empêche que l’aliment pris ne fournifïe un chyle
propre à former le fang & nourrir le Corps. Voyez
A P E
No u r r it u r e , Es t o m a c , C h y l e , Sa n g , N ut
r i t i o n , &c. { N )
APERCHER, v. a£t. terme d'Oifeleur; c’eft remarquer
l’endroit où Un oifeaü fe retire pour y paffer la
nuit : on dit j’ai aperché un merle.
* APÉRITIFS, adj. pl. m. {Medecine.) On donne
cette épithete à tous les médicamens, qui, confidérés
relativement aux parties folides du corps humain,
rendent le cours des liqueurs plus libre dans les vaif-
feaux qui les renferment, en détruifant les obftacles
qui s’y oppofent. Cet effet peut être produit par tout
ce qui entretient la foupleffe & la flexibilité des fibres
dont les membranes Vafculaires font compofées.
On doit mettre dans cette claffe les émolliens & les
relâchans, fur-tout fi l’on anime leur aétion par l’addition
de quelque fubftance faline, aftive, & pénétrante
, & qu’on les employé dans Un degré de chaleur
qui ne foit pas capable de diffiper leurs parties
les plus volatiles. Ces médicamens opèrent noft-feu-
lementfur les vaiffeaux, mais encore furies liqueurs
aufquelles ils donnent, en s’y mêlant, un degré de
fluidité qui les fait circuler. Les apéritifs conviennent
dans tous les cas où l’obftruâion eft ou la caufe ou
l’effet de la maladie ; ainfi leur ufage eft très-falutaire
dans la fîevre de lait qui furvient aux femmes nouvellement
accouchées, dans le période inflammatoire
de la petite vérole, ou dans le tems de l’éruption :
& les évacuans peuvent être compris fous le nom
général d'apéritifs , parce qu’ils produifent l’effet de
Ces derniers, par la façon dont Un les adminiftre &
le lieu où on les applique. Dans ce fens les diurétiques
, les fudorifiques, les diaphorétiques, les em-
menagogues, les fuppuratifs, les corrofifs, les caufti-
ques, &c. appartiendront à la hiême claffe. On y rah-
^era encore lès réfolutifs, qui, divifant les humeurs
épaiffes & les forçant de rentrer dans leurs voies naturelles,
font à cet égard l’office d?apéritifs. On compte cinq grandes racines apéritives. Ces
cinq racines font celles d’ache, de fenouil, de perfil,
de petit houx, d’afperge ; elles entrent dans le firop
qui en porte le noni; èllës pouffent par les urines &
par les réglés ; elles font d’un grand ufage ; on en fait
des confèrves, des eaux diftillées, & le firop. Sirop des cinq racines. Prenez de racines d’ache,
de fenouil, de perfil, de hôuJe, d’afperge, de chacune
quatre onces. Faites-les cuiré dans quatorze livres
d’eau commune, réduites à huit livres. Paffez la dé-
co&ion, & y âjoûtez fixere cinq livres^ Clarifiez &
faites cuire le tout en confiftancê de! firop. On tire
de ces racines par la diftillation uné eau avec laquelle
on pourroit faire le firop. { N ) * APETOUS vu APETUBES , {Géog. & H iß .)
peuples de l’Amérique méridionale dans le Brefil,
aux environs du gouvernement de Puerta-Seguro. * APEX, {Hiß. anc.) bonnet à l’ufage desFlami-
nes & des Saliens. Pour qu’il tînt bien fur leur tête,
ils l’âttachoient fous le mentort avec les deux cof-
dons qu’on lui voit. Antiquit. Pl. VII. fig. 14.
Sulpitius, dit Valere Maxime, fut deftitué du fa-
Cerdoce, parce que Y apex lui tomba de la tête pendant
qu’il facrifioit. Selon Servius, Y apex étoit une
verge couverte de laine qu’on mettoit au fömmet du
bonnet des Flamines* C’eft de-là que le bonnet prit
fmoinn enso,m ; & les prêtres mêmes, qu’on appella Fla- comme qui diroit Filamines, parce que la verge
couverte de laine étoit attachée au bonnet avec
un fil ; il n’eft pas bêfoin d’avertir le lefteur de la futilité
de ces fortes d’étymologies.
APHACA, {Hiß. nat. bot.) genre de plante à fleur
papilionacee. Il s’élève dix fond du calice un piftil
qui devient dans la fuite une goufle remplie de fe-
mences arrondies. Ajoutez aux caraâeres de ce gen-
re » y e feuilles naiffent deux à deux à chaque
poeuddes tiges, & qUe ces mêmes noeuds produisent j
A P H 523
chacun une main, Tournefort, Inflit. rci hetb. Voyet Pl a n t e . ( / )
* APHACE, {Géog. anc.) lieu dans la Paleftine ,
entre Biblos & Perfepolis, où Venus avoit un temple
, & etoit adorée fous le nom de Venus aphacite,
Par toutes fortes de lafeivetés aufquelles les peuples
s’abandonnoient, en mémoire des careffes que la
déeffe avoit prodiguées dans cet endroit au bel Ado^
nis.
APHACITE, (Mythologie.) furnom de Venus.' aVpohyaec^i_t Aep h a c e . Ceux qui venoient confulter Venus jettoient leurs offrandes dans un lac proche
Aphace ; fi elles étoient agréables à la déeffe, elles
alloient à fond ; elles furnageoient au contraire, fût-
ce de l’or ou de l’argent , fi elles étoient rejettées par
la déeffe. Zozime qui fait mention de cet oracle, dit
qu’il fut confulté par les Palmyriens, lorfqu’ils fe révoltèrent
contre l’empereur Aurelien, & queleurs
préfens allèrent à fond l’année qui précéda leur ruine,
mais qu’ils furnagerent l’année fuivante. Zozime
auroit bien fait de nous apprendre encore pour
l’honneur de l’oracle, de quelle nature étoient les
préfens dans l’une & l’autre année : mais peut-être
étoient-ils néceffairement de plume quand ils dévoient
furnager, & néceffairement de plomb quand
ils-devoient defeendre au fond du lac, la déeffe inf-
pirant à ceux qui venoient la confulter, de lui faire
des préfens tels qu’il convenoit à la véracité de fes
oracles. * APHALR.EMA, {Geog. anc, <S* facr. ) contrée
& ville fituée fur les frontières de la Judée & de la
Samarie, dans la partie occidentale de la tribu d’E-
phraï’m. '
* APHARÀ, {lïijl. anc. & facr, ) ville de la tribu
de Benjamin.
* APHARSEKIENS ou ARPHASACHIENS {Géog. &Hifl. facr.) peuples de Samarie, venus d’üné
contrée fitüée entre le Tigre & l’Euphrate ; il y eut
auffi des peuplés de l’Idumée, Appelles Aphàrfien* ou Apharfatéens ; on dit des uns & des autres qu’ils
s’oppoferent à la réédificatiôn du temple , après la
captivité de Babylone.
* APHEA, f. f. {Mythol.) divinité adorée par les
Crétois & par les Eginetes ; elle avoit un tertiple eri
Crete. Aphea, avant que d’être déeffe, fut une Cré->
toife , appellée Britomartis, que fa paffion pour la
chaffe attacha à Diane. Pour éviter la pourfuite de
Minos qui en étoit épérdûment amoureux, elle fé
jetta dans la mer, & fut reçue dans des filets de pê^
cheurs. Diane récompenfa fa vertu par les hohneurs
de l’immortalitéi Britomartis apparut enfuite aux
Egi*netes qui ITiohorerent fous le noni d'Aphea. APHEC, {Géog. anc. &facr.) II y eft fait mention
de quatre lieux différens en Judée fous ce nom :
l’un fut une ville de la tribu d’Afer ; l’autre une tour
près d’Antipatride ; le troifieme, une autre ville aufli
de la tribu d’Afer ; le quatrième, une ville de la tribu
de Juda.
APHELIE, f. m. C’eft, enAJlronomie, le point de
l’orbite de la terre ou d’une planete, où la diftance
de cette planete au Soleil eft la plus grande qu’il eft
poffible. Voyez ORb î t é .
A p h é lie eft compofé de d-iso, Ib n g ï, & de iÎA/o? ,fol;
ainfi lorfqu’üne planete eft en A , Plan che d 'A f lr o n *
fig . 1. comme la diftance au Soleil A, eft alors la plus
grande qu’il eft poffible, on dit qu’elle eft à fon aphélie.
V oy e z P l a n e t e , S o l e i l , & c.
Dans le fyftème de Ptolomée, ou dans la fuppo*
lfiietion que le Soleil fe meut autour de la terre, Yaphé
devient Y apogée. Voyez APO GEE . Vaphélie eft lè
point diamétralement oppofé au périhélie. Vjy^PÉ*
Ri HÉLIE. Les aphélies des planètes premières ne font
point en repos ; car l’a&ion mutuelle qu’elles exercent
les unes fur les autres, fait que \cres points de ::