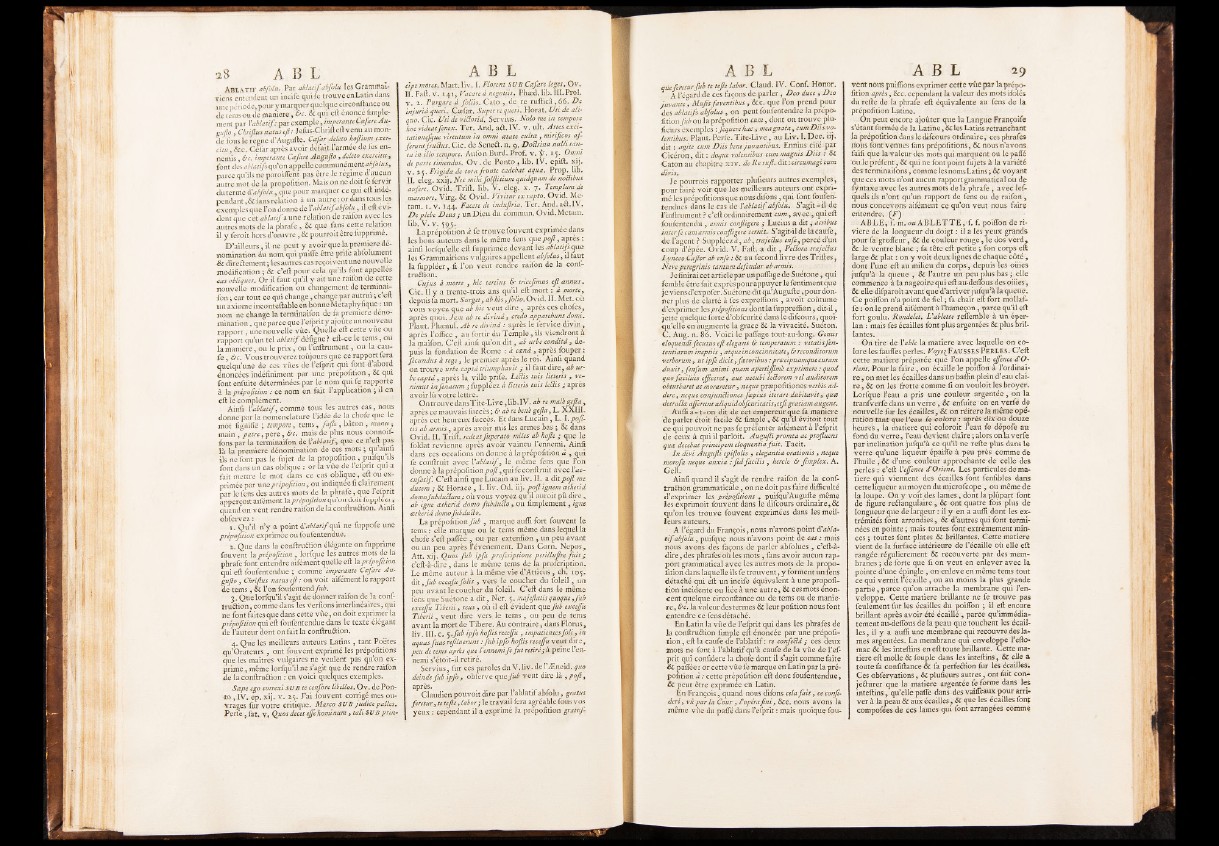
*3 A B L Ablatif abfolu. Par ablatif abfolu les Grammairiens
entendent un incife quife trouve en Latin dans
une période, pour y marquer quelque circonftanceou
cle teins ou de maniéré, &c. 8c qui eft énoncé fimple-
ment par Vablatif: par exemple, imperante Coefare Au-
guflo, Chrillus natusefi: Jefus-Chrift eft venu.au monde
fous le régné d’Augufte. Coefar deltto hofiiu/n exer-
citu, & c . Cefar après avoir défait. 1 armee de fes ennemis
, &c. imperante Coefare Augùflo , deleto exercitu ,
font des ablatifs qu’on appelle communément abfqluSy
parce qu’ils ne paroiffent pas être le régime d aucun
autre mot de la propofition. Mais on ne doit fefervir
du terme c¥ abfolu, que pour marquer ce qui eft inder
pendant, & fans relation à un autre : or dans tous les
exemples quei’on donne de V ablatif abfolu, il eft évident
que cet ablatif a une relation.de raifon avec les
autres mots de la phrafe , & que fans cette relation
il y feroit hors d’oe uvre, & pourr.oit etre fupprime.
D ’ailleurs, il ne peut y avoir que la première dénomination
du nom qui puiffe être prilé abfolument
& dire&ement; les autres cas reçoiventune nouvelle
modification ; & c’eft pour cela qu’ils font appelles
cas obliques. Or il faut qu’il y ait une raifon de cette
nouvelle modification ou changement de terminai-
fon ; car tout ce qui change, change par autrui ; c’eft
un axiome inconteftable en bonne Metaphyfique : un
nom ne change la terminaifon de fa première déno- j
mination, que parce que l’efprit y ajoute un nouveau |
rapport, une nouvelle vue. Quelle eft cette vue ou j
rapport qu’un tel ablatif defigne ? eft-ce le tems, ou ]
la maniéré, ou le p rix, ou l’inftrument, ou la cau-
f e , &c. Vous trouverez toûjours que ce rapport fera
quelqu’une de ces vues de l’efprit qui font d abord
énoncées indéfiniment par une prepofition, & qui
font enfuite déterminées par le nom qui fe rapporte
à la prepofition: ce nom en fait l’application j il en
eft le complément.
Ainfi l’ablatif, comme tous les autres cas, nous
donne par la nomenclature l’idée de la^chofe que le
mot lignifie ; tempore, tems, f ufte , bâton , manu,
main , pâtre, pere, &c. mais de plus nous connoil-
fons par la terminaifon de l’ablatif, que ce n’eft pas
là la première dénomination de ces mots ; qu ainfi
ils ne font pas le fujet de la propofition, piiifqu’ils
font dans un cas oblique : or la vue de 1 efprit qui a
fait mettre le mot dans ce cas oblique, eft ou exprimée
par une prepofition, -ou indiquée fi clairement
par le fens des autres mots de la phrafe, que l’efprit
app.erçoit aifément la prepofition qu’on doit fu p p le e r .
quand ojî veut rendre raifon de la conftru&ion. Ainfi
obfervez :
1. Qu’il n’y a point à’ablatif qui ne fuppofe une
prepofition exprimée ou foufentendue.
2. Que dans la conftru&ion élégante on fupprime
fouvent la prepofition , lorfque les autres mots de la
phrafe font entendre aifément quelle eft \a. prépofition
qui eft foufentendue ; comme imperante Coefare Au-
gufto, Chrifius natus ejl : on voit aifément le rapport
de tems , &c l’on foulentend fub.
3. Que lorfqu’il s’agit de donner raifon de la conf-
tru&ion, comme dans les verfions interlinéaires, qui
ne font faites que dans cette v u e , on doit exprimer la
prepofition qui eft foufentendue dans le texte élégant
de l’auteur dont on fait la conftru&ion.
4. Que les meilleurs auteurs Latins , tant Poètes
qu’Orateurs , ont fouvent exprimé les prépofitions
que les maîtres vulgaires ne veulent pas qu’on exprime
, même lorfqu’il ne s’agit que de rendre raifon
de la conftruûion : en voici quelques exemples.
Soepe ego correxi s u B te cenfore libellos. Ov. de Pon-
■ to, IV. ep. xij. v . 25. J’ai fouvent corrigé mes ouvrages
fur votre critique. Marco SU B judice pâlies.
Perle, fat. y . Quos decet effe hominum , tali SU B prin-
A B L
cipt mores. Mart.liv. I. Florent s u B Coefare leges, Ov.
IL Faft. v . 141, Vacare à negotiis. Phæd. lib. IlI.Prol.
v . 2. Pur gare à foins. Cato ,-de re rufticâ, 66. De
injuriâ quer\. Gæfar. Super requeri. Horat. Uti de ali-
quo. Cic.U ti de victoria. Servius. Nolo me in tempore
hoc yideatfenex. Ter. And. aû. IV. v. ult. Artes exci-
tationefque vïrtutum in omrii oetate cultoe , mirificos af-
feruntfruclus. Cic. de Seneéh n. 9. Doclrina nulli tanta
in illo tempore. Aufon Burd. Prof. v . fi. 15. Omni
de parte timendos. O v . de Ponto , lib. IV. epift. xij.
V. 25. Frigida de tot a fronte cadebat aqua. Prop. lib.
II. eleg. xxij . FJec mihi folftitium quidquam de noclibus
aufert. Ovid. Trift. lib. V . eleg. x. 7. Templum de
marmore. Virg. & Ovid. Vivitur ex rapto. Ovid. Me-
tam. 1. V. 144* Facere de indufiria. Ter. And. aéLIV.
De plebe Deus ; un Dieu du commun. Ovid.Metam.
lib. V. v . 595. . , ,
La prépofition à fe trouve fouvent exprimée dans
les bons auteurs dans le même fens quz pofi, après :
ainfi lorfqu’eUe eft fupprimée devant les ablatifs que
les Grammairiens vulgaires appellent abfolus, il faut
la fuppléer, fi l’on veut rendre raifon de la construction.
Cuj us d morte , hic tertius 6* tricefimus ejl annus.
Cic. Il y a trente-trois ans qu’il eft mort : à morte,
depuis la mort. Sur get) ab his, folio. Ovid. II. Met. ou
vous voyez, que ab his veut dire , apres ces chofes,
après quoi. Jam ab re divinâ , credo apparebunt domi.
Plaut. Phænul. Ab re divinâ : après le Service divin ,
après l’office , au fortir du Temple, ils viendront à
ja maifon. C ’eft ainfi qu’on d it , ab iirbe conditâ , depuis
la fondation de Rome : a coena, apres fouper :
fecundus à rege, le premier après le roi. Ainfi quand
I on trouve urbe capta triumphavit ; il faut dire, ab ur-
be capta y après ta ville prife. Leclis tuis litteris , ve-
nimus in fenatum ; fuppleez à litteris tuis lectis ; après
avoir lû votre lettre.
On trouve dansTite-Live ,lib. IV. ab re mail gefla,
après ce mauvais fuccès; & ab re benl gefia, L. XXIII.
après cet heureux fuccès. Et dans Lucain, L. I. pofi-
tis ab,armis, après avoir mis les armes bas ; & dans
Ovid. IL Trift. redeat fuperato miles ab hofte ; que le
foldat revienne après avoir vaincu l’ennemi. Ainfi
dans ces occafions on donne à ta prépofition à , qui
fe conftruit avec ¥ ablatif y le meme fens que l’on
donne à 1a prépofition pofi, qui fe conftruit avec ¥ac~
cufatif. C ’eft ainfi que Lucain au liv. IL a dit pofi me
ducem ; & Horace , I. liv. Od. iij. pofi ignem oetheriâ
domofubductum; où vous voyez qu’il auroit pu dire,
ab igné oetheriâ domo fubduclo , ou Amplement, igné
oetheriâ domo fubducto.
La prépofition fub , marque auffi fort fouvent le
tems : elle marque ou le tems même dans lequel ta
chofe s’eft paffée , ou par extenfion , un peu avant
ou un peu après l’évenement. Dans Corn. Nepos,
Att. xij. Quos fub ipfa profcriptione perillufire fuit ;
c’eft-à-dire , dans le même tems de 1a prolcription.
Le même auteur à 1a même vie d’Atticus, ch. 105.
dit ,fub occafu folis , vers le coucher du foleil, un
peu avant le coucher du foleil. Ç ’eft dans le même
fens que Suétone a d it, Ner. 5. majefiatis quoque >fub
excejju Tiberii, reus , où il eft évident que fub excejfu
Tiberii , veut dire vers., le tems , ou .peu de tems
avant ta mort de Tibere. Au contraire , dans Florus,
liv. III. C. 5 .fub ipfo hofiis receffu , impatientesfoli , in
aquas fia s refiluerunt : fub ipfo hofiis receffu veut dire,
peu de tems après que Vennemife fut retiré; à peine l’ennemi
s’étôit-il retiré. . :‘f ‘ ,
Servius, fur ces paroles du V .liv. de l’Æneid. quo
deinde fub ipfo , obferve que fub veut dire là , pofi,
après.
Claùdien pouvoit dire par l’ablatif abfolu, gratin
feretury te tefie, labor ; le travail fera agréable fous vos
yeux : cependant il a exprimé la prepofition gratufi
A B L
que fereturfub te tefie labor. Claud. IV. Conf. Honor.
A l’égard de ces façons de parler, Deo duce , Deo
juvante y Mufis faventibùs , & c . que l’on prend pour
des ablatifs abfolus, on peut foufentendre ta prepofition
fub ou 1a prépofition cum, dont on trouve plu-
fieurs exemples : Jequerehac ;■ meagnata, cumDiisvo-
lentibus: Plaut. Perle. Tiûe-Live, au L iv. I. D ec, iij.
dit : agite cum Diis bene juvantibus. Ennius cité par
Cicéron, dit : doque volehtïbus cum magnis Diis. :
Caton au chapitre x i v . de Re rufi.. dit vcircumagi cum
divis.
Je pourrois rapporter plufieurs autres exemples,
pour fairè voir que les meilleurs auteurs ont exprimé
les prépofitions que nous difons, qui font foulen- ,
tendues dans le cas de ¥ ablatif abfolu. S’ag it- il de
l ’inftrument ? c’eft ordinairement cum , avec ,, qui eft
foufentendu , armis confligere ; Lucius a d i t acribus
inter fe cum armis confligere cernit. S’agit-il de 1a caufe,
de l’agent ? Suppléez à , ab,trajeclus enfe, percé d’un
coup d’épée. Ovid. V . Faft. a d i t , Peclora trajeclus
Lynceo Cafior ab enfe : & au fécond livre des Triftes,
Neve peregrinis tantum defendar ab armis.
Je finirai cet article par un paflage de Suétone, qui
femble être fait exprès pour appuyer le fentiment que
je viens d’expofer. Suétone dit qu’Augufte, pour donner
plus de clarté à fes exprelfions , avoit coûtume
d’exprimer les prépofitions dont la fuppreffion., dit-il,
jette quelque forte d’obfcurité dans le difcours j quoiqu’elle
en augmente 1a gracp & la vivacité. Sueton.
C. Aug. n. 86. Voici le paflage tout-audong, Genus
eloquendi fecutus efl elegans & temperatum : vitatisfen-
tentiarum ineptiis , atqueinconcinnitate, & reconditorum
verborum, ut ipfe dicit yfoetorïbus : proecipuamque curam
duxityfenfum animi quam apertijfiml exprimere : quod
quo faciliiis ejficeret, aut necubi lectorem vel auditorem
obturbaret ac moraretur, neque præpofitiones verbis ad-
dere, neque conjuncliones foepius iterare dubitavity quoe
detracloe afferunt aliquidobfcuritatisyetfi gratiamaugent.
Auffi a - t-on dit de cet empereur que fa maniéré
de parler étoit facile & fimple , & qu’il évitoit tout
ce qui pouvoit ne pas fe préfenter aifément à l’efprit
de ceux à qui il parloit. Augufli promta ac profluens
quoe decebat principem eloqueritia fuit. Tacit.
In divi Augufli epiftolis , elegantia orationis , neque
morofa neque anxia : fedfacilis , her cle & fimplex. A .
Ge11-
Ainfi quand il s’agit de rendre raifon de la conf-
truûion grammaticale., on ne doit pas faire difficulté
d’exprimer les prépofitions , puifqu’Augufte même
les exprimoit fouvent dans le difcours ordinaire, &
_qu’on les trouve fouvent exprimées dans les meilleurs
auteurs.
A l’égard du François, nous n’avons point S ablat
i f abfolu , puifque nous n’avons point ae cas : mais
nous avons des façons de parler abfolues , c’eft-à-
dire, des phrafes où les mots , fans avoir aucun rapport
grammatical.avec les autres mots de 1a propo-
lition dans laquelle ils fe trouvent, y forment un lens
détaché qui eft un incife équivalent à une propofition
incidente ou liée à une autre, & ces mots énoncent
quelque circonftance ou de tems ou de maniéré
, &c. 1a valeur des termes & leur pofition nous font
entendre ce fens détaché.
En Latin 1a vue de l’eforit qui dans les phrafes de
la conftruftion fimple eft énoncée par une prépofition
, eft ta caufe de l’ablatif : re confectâ ; ces deux
mots ne font à l’ablatif qu’à caufe de 1a vûe de l’efprit
qui confidere 1a choie dont il s’agit comme faite
& paflee : or cette vûe fe marque en Latin par 1a pré-
poution d : cette prépofition eft donc foufentendue,
df peut être exprimée en Latin.
En François, quand nous difons cela fa it, ce confidere
y vû par la Cour , C opérafini, & c . nous avons. 1a
même vue du pafle dans l’efprit : mais quoique fou-
A B L 29
vent nous puiffions exprimer cette vûe par la prépofition
après, &c. cependant ta valeur des mots ifolés
du refte de 1a phrale eft équivalente au fens de la
prépofition Latine.
On peut encore ajoûter que la Langue Françoife
s’étant formée de 1a Latine, & les Latins retranchant
Ja prépofition dans le difcours ordinaire, ces phrafes
ftous font venues fans prépofitions, & nous n’avons
faifi que la valeur des mots qui marquent ou le paffé
ou ,1e préfent, & qui ne font point fujets à 1a variété
des terminaifons, comme les noms Latins ; & voyant
que ces mots n’ont aucun rapport grammatical ou de
iyntaxe avec les autres mots de 1a phrafe , avec lef-
quéls ils n’ont qu’un rapport de fens ou de raifon ,
nous concevons aifément ce qu’on veut nous faire
entendre-. (T1)
A B L E i'f . m. ou A B L E T T E ,T . f. poiffon de rivière
de ta longueur du doigt : il a les yeux grands
pour fa grofleur, & de couleur rouge, le dos verd,
& . le ventre blanc ; fa tête eft petite ; fon corps eft
large & plat ; on y voit deux lignes de chaque cô té,
dont l’une eft au milieu du corps, depuis les oüies
jufqu’à ta queue , & l’autre un peu plus bas ;.èlle
commence à la nageoire qui eft au-deflous des oiiies,
& elle difpàroît avant que d’arriver jufqu’à la queue.
Ce poiffon n’a point de fiel ; fa chair eft fort môltaf-
fe : on le prend aifément à l’hameçon, parce qu’il eft
fort goulu. Rondelet. L'ablette reffemble à un éper-
lan : mais fes écailles font plus argentées & plus brillantes.
Ori tire' de ¥able la matière avec laquelle on colore
les faillies perles. Voye^Fa u s s e s Pe r l e s . C ’eft
cette matière préparée que l’on appelle ejfence dO-
rient. Pour 1a faire, on écaille le poiffon à l’ordinair
e , on met les écailles dans un baflin plein d’eau clair
e , & on les frotte comme fi on vouloit les broyer.
Lorfque Beau a pris une couleur argentée, on 1a
tranfverfe dans u n v e fre , & enfuite on en verfe de
nouvelle fur les écailles, & on réitéré la même opé-
ratiOn tant que Peau fe colore : après dix Ou douze
heures, 1a matière qui coloroit l’eau fe dépofe ait
fond du v erre, l’eau devient claire ; alors on la verfe
par inclination jufqu’à ce qu’il ne refte plus dans le
verre qu’une liqueur épaiffe à peu près comme de
l’huile, & d’une couleur approchante de celle des
perles : c’eft ¥ ejfence d O rient. Les particules de matière
qui viennent des écailles font fenfibles dans
cette liqueur aumoyen du microfcope , ou même de 1a loupe. On y voit des lames, dont ta plûpart font
de figure rectangulaire, & ont quatre fois plus de
longueur que de largeur : il y en a auffi dont les extrémités
font arrondies, & d’autres qui font terminées
en pointe ; mais toutes font extrêmement minces
; toutes font plates & brillantes. Cette matière
vient de la furface intérieure de l’écaille où elle eft
rangée régulièrement & recouverte par des membranes
; de forte que fi on veut en enlever avec la
pointe d’une épingle, on enleve en même tems tout
ce qui vernit l’écaille , ou au moins la plus grande
partie, parce qu’on arrache 1a membrane qui l’enveloppe.
Cette matière brillante ne fe trouve pas
feulement fur les écailles du poiffon ; il eft encore
brillant après avoir été écaillé , parée qu’immédia-
tement au-deffous de 1a peau que touchent les écailles
, il y a auffi une membrane qui recouvre des la*
mes argentées. La membrane qui enveloppe l’efto-
mac & les inteftins en eft toute brillante. Cette matière
eft molle & fouple dans les inteftins, & elle a
1 toute fa confiftance & fa perfeéfion fur les écailles.
Ces obfervations, & plufieurs autres, ont fait con-
jeâurer que 1a matière argentée fe forme dans les
inteftins, qu’elle paffe dans des vaiflèaux pour arriver
à 1a peau & aux écailles, & que les écaillés fonf
compofées de ces lames qui font arrangées comme