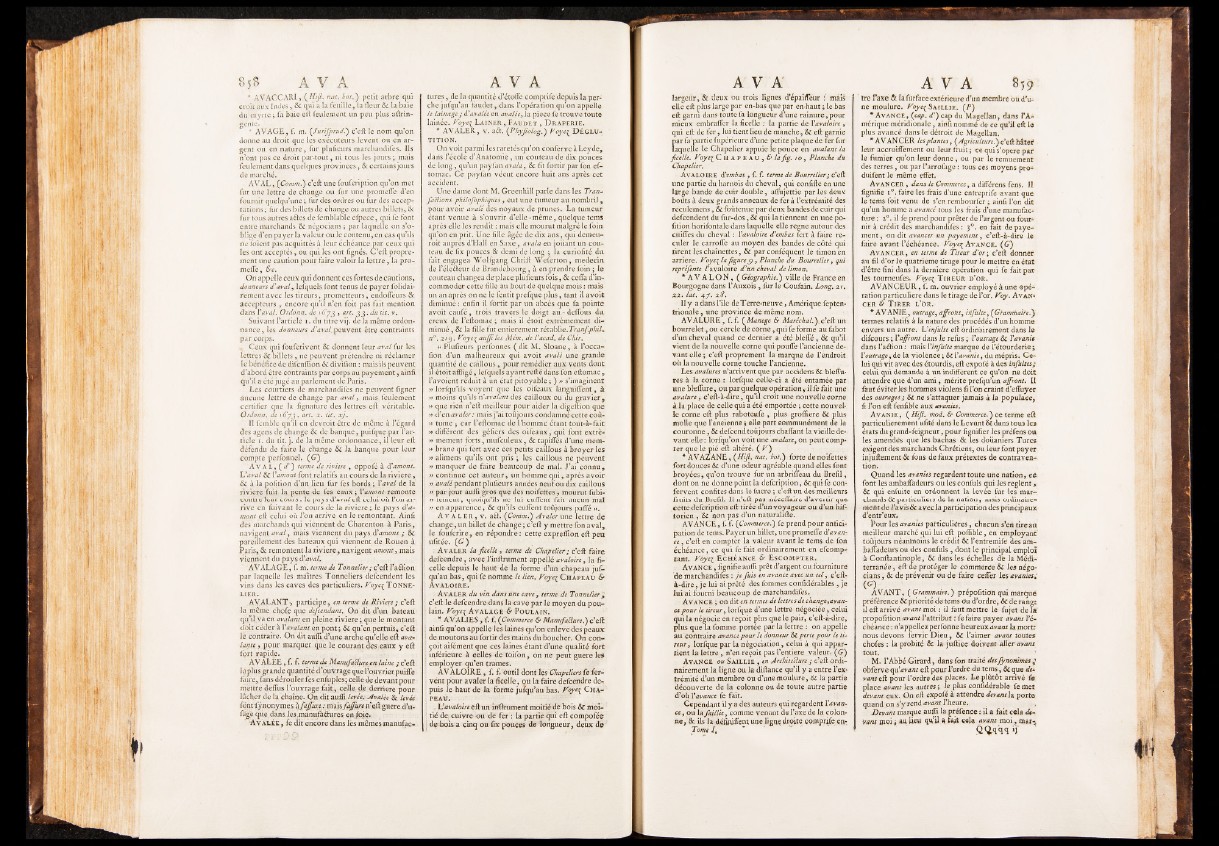
s 5s A V A
* AVA CCAR t, ÿm /k nat. bot.') petit arbre qui
croît aux Indes, 6c qui a la feuille, la fleur 6c la baie
du myrte ; fa baie elt feulement un peu plus aftrin-
gente.
+ AV AGE , f. m. ( Jurifprud.) c’eft le nom qu’on
donne au droit que les exécuteurs lèvent ou en argent
ou en nature, fur plufieurs marchandifes. Ils
n’ont pas ce droit par-tout, ni tous les jours ; mais
feulement dans quelques provinces, & certains jours
de marché.
AV A L , (Comm.) c’eft une foufcription qu’on met
fur une lettre de change ou fur une promeffe d’en
fournir quelqu’une ; fur des ordres ou mr des acceptations
; fur des billets de change ou autres billets, &
fur tous autres aétes de femblable efpece, qui fe font
entre marchands 6c négocians ; par laquelle on s’oblige
d’en payer la valeur ou le contenu, en cas qu’ils
ne l'oient pas acquittés à leur échéance par ceux qui
les ont acceptés, ou qui les ont lignés. C ’eft proprement
une caution pour faire valoir la lettre, la pro-
meffe, &c.
On appelle ceux qui donnent ces fortes de cautions,
donneurs d'aval, lesquels font tenus de payer folidai-
rement avec les tireurs, prometteurs, endoffeurs &
accepteurs , encore qu’il n’en foit pas fait mention
dans Vaval. Ordonn. de i C'yj , art. 3 3 , dutit. v.
Suivant l’article 1. du titre vij. delà même ordonnance
, les donneurs, d'aval, peuvent être contraints
par corps.
„ Ceux qui foufcrivent & donnent leur aval fur les
lettres & billets, ne peuvent prétendre ni réclamer
le bénéfice de difcuflion 6c divifion : mais ils peuvent
d’abord être contraints par corps au payement, ainli
qu’il a été jugé au parlement de Paris.
Les courtiers de marchandifes ne peuvent ligner
aucune lettre de change par aval, mais, feulement
certifier que la fignature des lettres eft véritable.
Ordonn. de 1673. art. 2. tit. xj.
Il l'emble qu’il en devroit être de même à l’égard
des agens de change 6c de banque, puifque par l’article
1. du tit. j. de la même ordonnance, il leur eft
défendu de faire le change 6c la banque pour leur
compte perfonnel. (G)
A V A L , ( d ') terme de riviere , oppofé à d’amont.
"L'aval 6c l’amont font relatifs au cours de la riviere,
& à la pofition d’un lieu fur fes bords ; Y aval de la
riviere fuit la pente de fes eaux ; Y amont remonte
contre leur cours : le pays d'aval eft celui oh l’on arrive
en fuivant le cours de la riviere ; le pays d'amont
eft celui où l’on arrive en le remontant. Ainfi
des marchands qui viennent de Charenton à Paris,
navigent aval, mais viennent du pays dû amont ; 6c
pareillement des bateaux qui viennent de Rouen à
Paris, & remontent la riviere, navigent amont, mais
viennent du pays dd aval.
AVALAGE, f. m. terme de Tonnelier ; c’eft l’aâion
par laquelle les maîtres Tonneliers defcendent les
vins dans les caves des particuliers. Voye^ T o n n e l
i e r .
AVALANT ■) participe, en terme de Riviere ; c’eft
la même chofe que defcendant. On dit d’un bateau
qu’il va en avalant en pleine riviere ; que le montant
dbit céder à Y avalant.zn pont; 6c qu’en per,tuis, c’eft •
lé contraire. On dit auffi d’une arche qu’elle eft avalante
, pour marquer que le courant des eaux y eft
fort rapide.
AVALÉE, f. f. terme de Manufacturera laine ; c’eft
la plus grande quantité d’ouvrage que Fouvrier puiffe
faire, fans dérouler fes enfuples; celle de devant pour
mettre deflus l ’ouvrage fait, celle:de derrière pour
lâcher de la chaîne. On dit auffi levée. Avalée & levée
fqftrfÿnpnymes fyfaffurermais faffure n’eft guere d’u-
fagê que dans les jnanufàâures. envoie.
A v a l é e , fe dit encore dans lés mêmes manufac-
A V A
tures, de la quantité d’étoffe comprile depuis la perche
jufqu’au faudet, dans l’opération qu’on appelle
le lainage ; dû avalée en avalée, la piece fe trouve toute
Iainée. Voye1 La in e r , Fa u d e t , D r a p e r ie .
* AVALER, v . att. (Phyfiolog.) Voye{ D é g l u t
i t i o n .
On voit parmi les raretés qu’on conferve àLeyde,
dans l’école d’Anatomie, un couteau de dix pouces
de long, qu’un payfan avala, 6c fit fortir par fon ef-
tomac. Ce payfan vécut encore huit ans après cet
accident.
Une dame dont M. Greenhill parle dans les Tran-
faclions philofophiques, eut une tumeur au nombril,
pour avoir avalé des noyaux de prunes. La tumeur
étant venue à s’ouvrir d’elle-même, quelque tems
après elle les rendit : mais elle mourut malgré le foin
qu’on en prit. Une fille âgée de dix ans, qui demeu-
roit auprès d’FIall en Saxe, avala en joiiant un couteau
de fix pouces & demi de long ; la curiofité du
fait engagea Wolfgang Chrift Weferton, médecin
de l’éleûeur de Brandebourg, à en prendre foin ; le
couteau changea derplace plufieurs fois, & ceffa d’incommoder
cette fille au bout de quelque mois : mais
un an après on ne le fentit prefque plus, tant il avoit
diminué : enfin il fortit par un abcès que fa pointe
avoit caufé, trois travers le doigt au - deffous du
creux de l’eftomac ; mais il ctoit extrêmement diminué
, & la fille fut entièrement rétablie. Tranf.phiU
n°. 21Q. V?ye{ auffi les Mém. de l'acad. de Chir.
« Plufieurs perfonnes ( dit M. Sloane, à l’occa-
fion d’un malheureux qui avoit avalé une grande
quantité de caillous, pour remédier aux vents dont
il étoit affligé, lefquels ayant refté dans fon eftomac ,
l’avoient réduit à un état pitoyable ; ) » s’imaginent
» lorfqu’ils voyent que les oifeaux languiffent, à
» moins qu’ils n’avalent des cailloux ou du gravier ,
» que rien n’eft meilleur pour aider la digeftion que
» d’en avaler: mais j'ai toujours condamne cette coû-
» tume , car l’eftomac de l ’homme étant tout-à-fait
» différent des géfiers des oifeaux, qui font extrè-
» mement forts, mufculeux, 6c tapiffés d’une mem-
» brane qui fert avec ces petits caillous à broyer les
» alimens qu’ils ont pris ; les caillous ne peuvent
»manquer de faire beaucoup de mal. J’ai connu,
» continue cet auteur, un homme qui, après avoir
» avalé pendant plufieurs années neuf ou dix caillous
» par jour auffi gros que des noifettes, mourut fubi-
î » tement, quoiqu’ils ne lui euffent fait aucun mal
» en apparence, 6c qu’ils euffent toujours paffé ».
A v a l e r , v . a&. (Çomm.) Avaler une lettre de
change, un billet de change ; c ’eft y mettre fon aval,
le foufcrire, en répondre : cette expreffion eft peu
ufitée. (G )
: A v a l e r la ficelle, terme de Chapelier ; c’eft faire
: defcendre, avec l’inftrument appellé avaloire, la ficelle
depuis le haut de la forme d’un chapeau ju fqu’au
bas, qui fe nomme le lien. Voye[ C h a p e a u &.
A v a l o ir e .
A v a l e r du vin dans une cave , terme de Tonnelier ,
c’eft le defcendre dans la ca v e pa r le moyen du pou-
: lain. Voye^ A v a l a g e 6* Po u l a in .
* AVALIES , f. f, (Commerce & Manufacture.) c’eft
[ ainfi qu’on appelle les laines qu’on enleve des' peaux
■ de moutons au fortir des mains du boucher. On con-
; çoit aifément que ces laines étant d’une qualité fort
; inférieure à celles de toifon, on ne peut guere les
employer qu’en trames.
AVALOIRE , f. fi outil dont les Chapeliers fe fervent
pour avaler la ficelle, ou la faire defcendre depuis
le haut de la forme jufqu’au bas. V<ry*l C ha-
, PEAU.
, Vavaloire eft un inftrument moitié de bois & moitié
de cuivre ou de fer : la partie qui eft compofée
■ dubois a cinq ou fix pouces de longueur, deux de
A V A
largetir, & deux ou trois lignes d’épaiffeur f mais
elle eft plus large par en-bas que par en-haut ; le bas
eft garni dans toute fa longueur d’une rainure, pour
mieux embraffer la ficelle : la partie de Y avaloire ,
qui eft de fe r , lui tient lieu de manche, 6c eft garnie
par fa partie fupérieure d’une petite plaque de fer fur
laquelle le Chapelier appuie le pouce en avalant la
ficelle. Vjyeç C H A P E A U , & la fig. 10, Planche du
Chapelier.
A v a l o ir e dütmbas, f. fi terme de Bourrelier; c’eft
une partie du harnois du cheval, qui confifté en une
large bande de cuir double, affujettie par les deux
boilts à deux grands anneaux de fer à l’extrémité des
réculemehs, & foûtenue par deux bandes de cuir qui
defcendent dit fur-dos, 6c qui la tiennent en une pofition
horifontale dans laquelle elle régné autour des
cuiffes du cheval : Y avaloire d'embas lert à faire reculer
le carroffe au moyen des bandes de côté qui
tirent lés chaînettes, 6c par conféquent le timon en
arriéré. Voye^la figure g , Planche du Bourrelier, qui
reprèfente /’avaloire d'un cheval de limon,
* A V A L O N , ( Géographie.) ville de France en
Bourgogne dahs l’Auxois, fur le Coufain. Long. 21.
22. lat. 47. 28.
Il y a dans l’île de Terre-neuve, Amérique fepten*
trionale, une province de même nom.
AVALURE, f. fi ( Manege & Maréchal. ). c’eft un
bourrelet, ou cercle de corne, qui fe forme au fabot
d’un cheval quand ce dernier a été bleffé, 6c qu’il
vient de la nouvelle corne qui pouffe l’ancienne devant
elle ; c’eft proprement la marque de l’endroit
oh la nouvelle corne touche l’ancienne.
• Les avalures n’arrivent que par accidens 6c bleffu-
res à la corne : lorfque celle-ci a été entamée par
une bleffure, ou par quelque opération ,■ il fe fait une
avalure, e’eft-à-cfire, qu’il croit une nouvelle corne
à la place de celle qui a été emportée ; cette nouvel**
le corne eft plus raboteufe , plus groffiere 6c plus
molle que l’ancienne ; elle part communément de la
couronne, & defcend toujours chaffant la vieille devant
elle : lorfqu’on voit une avalure, on peut compter
que le pié eft altéré. ( V )
* AVAZANE, {flifl. nat. bot.) forte de noifettes
fort douces 6c d’une odeur agréable quand elles font
broyées , qu’on trouve fur un arbriffeau du Brefil,
dont on ne donne point la defcription, 6c qui fe con-
fervent confites dans le fucre ; c’eft un des meilleurs
fruits du Brefil. Il n’eft pas néceffaire d’avertir que
cette defcription eft tirée d’un voyageur ou d’un hifi
torien , & non pas d’un naturalifte.
AVANCE, f. fi (Commerce.) fe prend pour anticipation
de tems. Payer un billet, une promeffe ddavan-,
ce, c’eft en compter la valeur avant le tems de fon
échéance, ce qui fe fait ordinairement en efcomp-
tant. yàye{ E ch é a n c e & E s c o m p t e r .
A v a n c e , lignifie auffi prêt d’argent ou fourniture
de marchandifes : je fuis en avance avec un tel, c’eft-
à-dire, je lui ai prêté des femmes confidérables , je
lui ai fourni beaucoup de marchandifes.
AVANCE ; on dit en termes de lettres de change,avance
pour le tireur, lorfque d’une lettre négociée, celui
qui la négocie en reçoit plus que le pair, c’eft-à-dire,
plus que la femme portée par la lettre : on appelle
au contraire avance pour le donneur & perte pour le tireur,
lorfque par la négociation, celui à qui appartient
la lettre, n’en reçoit pas l’entiere valeur, (G)
A v a n c e ou S a il l ie , en Architecture ,• c’eft ordinairement
la ligne ou la diftance qu’il y a entre l’ex*
trémité d’un membre ou d’une moulure, 6c la partie
découverte de la colonne ou de toute autre partie
d’oh Y avance fe fait.
Cependant il y a des auteurs qui regardent Y avance
, ou la faillie, comme venant de l’axe de la colonne,
& ils la défhüffent une ligne droite comprife en-
Tome /,
A V A 859
tre l ’axe & la furfàce extérieure d’un membre bu d’une
moulure. Voye^Sa il lie i. ( P)
* A v a n c e , (cap. d') cap du Magellan, dans l’Amérique
méridionale, airifi nommé de ce qu’il eft le
plus avancé dans le détroit de Magellan.
* AV AN CÈR les plantes, {Agriculture.) c’eft hâtef
leur accroiffement ou leur fruit ; ce qui s’opère par
le fumier qu’on leur donne, ou par le remuement
des terres, ou par l’arrofage : tous ces moyens pro*
duifent le même effet.
A v a n c e r , dans le Commerce, a différens fens. Il
fignifie i° . faire les frais d’une entreprife avant que
le tems foit venu de s’en rembourfer ; ainfi l’on dit
qu’un homme a avancé tous les frais d’une manufacture
: x°. il fe prend pour prêter de l’argent ou fournir
à crédit des marchandifes : 30. en fait de payement
, on dit avancer un payement, c’eft-à-dire le
faire avant l’échéance. Voye.ç Av a n c e . (G)
A v a n c e r , en terme de Tireur d'or; e’eft donner
au fil d’or le quatrième tirage pour le mettre en é tat
d’être fini dans la derniere opération qui fe fait par
les tourneufes, Voye^ T ir e u r d ’o r .
AVANCEUR, f. m. ouvrier employé à une opération
particulière dans le tirage de l’or. Voy. A v an-*
c e r & T iRër l ’ô r .
* AVANIE, outrage, affroht, iAfülte, {Gramrhaire.)
termes relatifs à la nature des procédés d’un homme
envers un autre; L'infulte eft ordinairement dans le
difcours ; Y affront dans le refus ; Y outrage & Yavanie
dans l’aélion : mais Y infulte marque de l’étourderie ;
Y outrage, de la violence ; 6c Y avanie, du mépris. Celui
qui vit avec des étourdis, eft expofé à des infultes;
celui qui demande à un indifférent ce qu’on ne doit
attendre que d’un ami, mérite prefqu’un affront. Il
faut éviter les hommes violens fi l’on craint d’effuyer
des outrages ; 6c ne s’attaquer jamais à la populace,
fi l’on eft fenfible aux avanies.
A v a n i e , {tiifl. mod. & Commerce*) ce terme eft
particulièrement ufité dans le Levant 6c dans tous les
états du grand-feigneur, pour lignifier les préfens ou
les amendés que les bachas & les douaniers Turcs
exigent des marchands Chrétiens, ou leur font payer
injuftement & fous de faux prétextes de contravention.
Quand les avanies regardent toüte une nation, ce
font les ambaffadeurs ou les confuls qui les reglënt >
6c qui enfuite en ordonnent la levée fur les mar-,
chands 6c particuliers de la nation, mais ordinairement
de l ’avis & avec la participation des principaux
d’entr’eux,
î?our les avanies particulières, chacun s’en tire au
meilleur marché qui lui eft poffible, en employant
toûjoürs néanmoins le crédit 6c l’entremifé des am-
baffadeürs ou dès confuls , dont le principal ertiploï
à Conftantinople, 6c dans les échelles de la Méditerranée
, eft de protéger le commerce 6c les négocians
, & de prévenir ou de faire ceffer les avaniesl
(C?) ^ V -
AV AN T, ( Grammaire.) prépofitioh qui marque
préférence 6c priorité dé tems ou d’ordre, & de rangt
il eft arrivé avant moi : il faut mettre le fujet de l â f
propofition avant l’attribut ! fe faire payer avant l’échéance
: n’appeliez perfenne heureux avant la mortt
nous devons fervir D ieu , 6c l’aimer avant toutes
chofes : la probité 6c la juftice doivent aller avant
tout;
M. l’Abbé Girard, dans fon traité desfynommés^
obferve au'avant eft pour l’ordre du tems, 6c que devant
eft pour l’ordre des places. Le plûtôt arrivé fis
place avant les autres ; le plus confidérable fe met
devant eux. On eft expofé à attendre devant h porte
quand on s’y rend avant i’heure;
Devant marque auffi la préfence : il a fait cela devant
moi i au lieu qu’il a fait cela avant moi, mar-
£< Jc fq q i f