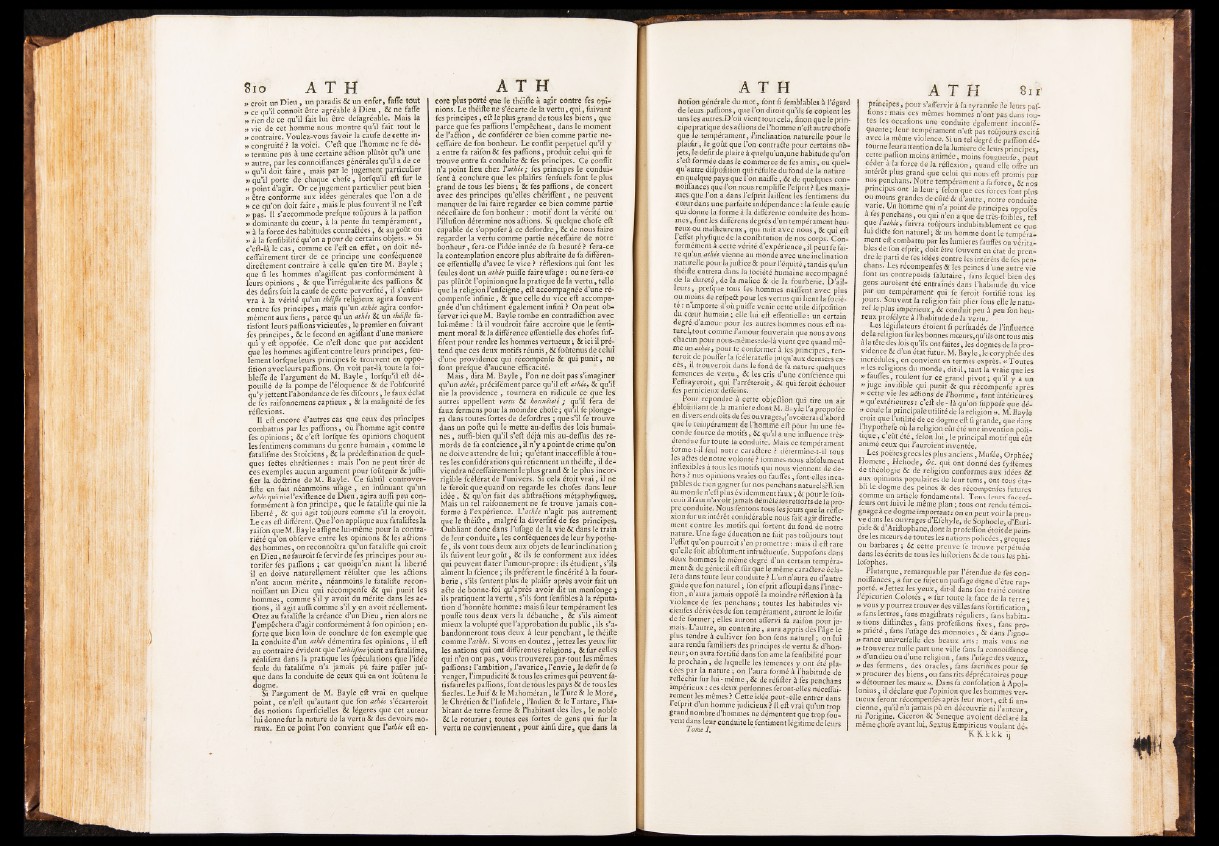
» croit un D ieu , un paradis & un enfer, faffe tout
» ce qu’il connoît être agréable à Dieu , & ne faffe
» rien de eè qu’il fait lui être defagréable. Mais la
„ vie de cet homme nbus montre qu’il fait tout le
» contraire. Voulez-vous favoir la caufe de cette in-
„ congruité ? la voici. C ’eft que l’homme ne fe dé-
» termine pas à une certaine aftion plûtôt qu’à une
» autre, par les connoiffances générales qu’il a de ce
» qu’il doit faire, mais par le jugement particulier
» qu’il porte de chaque chofe, lorfqu’il eft fur le
»> point d’agir. Or ce jugement particulier peut bien
» être conforme aux idées générales que l’on a de
» ce qu’on doit faire, mais le plus fouvent il ne l’eft
» pas. Il s’accommode prefque toûjours à la paffion
» dominante du coeur, à la pente du tempérament,
» à la force des habitudes contraftées, & au goût ou
» à la fenfibilité qu’on a pour de certains objets. » Si
c’eft-là le cas, comme ce l’eft en effet, on doit né-
ceffairement tirer de ce principe une conféquence
directement contraire à celle qu’en tire M. Bayle ;
que fi les hommes n’agiffent pas conformément à
leurs opinions , & que l’irrégularité des pallions &
des defirs foit la caufe de cette perverfité, il s’enfui-
vra à la vérité qu’un théijie religieux agira fouvent
contre fes principes, mais qu’un athée agira conformément
aux fiens, parce qu im athée & un théijie fa-
tisfont leurs paflions vicieufes, le premier en fuivant
fes principes, & le fécond en agiffant d’une maniéré
qui y eft oppofée. Ce n’eft donc que par accident
que les hommes agiffent contre leurs principes, feulement
lorfque leurs principes fe trouvent en oppo-
iition avec leurs paflions. On voit par-là toute la foi-
bleffe de l’argument de M. Bayle , lorfqu’il eft dé- ,
pouillé de la pompe de l’éloquence & de l’obfcurité
qu’y jettent l’abondance de fes difeours, le faux éclat
de fes raifonnemens captieux , & la malignité de fes
réflexions.
Il eft encore d’autres cas que ceux des principes
combattus par les paflions, ou l’homme agit contre
fes opinions ; & c’eft lorfque fes opinions choquent
les fentimens communs du genre humain, comme le
fatalifme des Stoïciens, & la prédeftination de quelques
fettes chrétiennes : mais l’on ne peut tirer de
ces exemples aucun argument pour foûtenir & jufti-
fier la doctrine de M. Bayle. Ce fubtil controver-
fifte en fait néanmoins ufage , en infinuant qu’un
athée quiniel’exiftence de D ieu , agira aufli peu conformement
à fon principe, que le fatalifte qui nie la
liberté , & qui agit toûjours comme s’il la croyoit.
Le cas eft différent. Que l’on applique aux fataliftesla
raifon queM. Bayle afligne lui-même pour la contrariété
qu’on obferve entre les opinions &l les avions
des hommes, on reconnoîtra qu’un fatalifte qui croit
en Dieu, ne fauroit fe fervir de fes principes pour au-
torifer fes paflions ; car quoiqu’en niant la liberté
i l en doive naturellement réfulter que les avions
n’ont aucun mérite, néanmoins le fatalifte recon-
noiffant un Dieu qui récompenfe & qui punit les
Ëommes, comme s’il y avoit du mérite dans les actions
, il agit aufli comme s’il y en avoit réellement.
Otez au fatalifte la créance d’un D ieu , rien alors ne
l’empêchera d’agir conformément à fon opinion ; en-
forte que bien loin de conclure de fon exemple que
la conduite d’un athée démentira fes opinions, il eft
au contraire évident que 1yathéifme joint au fatalifme,
réalifera dans la pratique les Spéculations que l’idée
feule du fatalifme n’a jamais pû faire paffer juf-
que dans la conduite de ceux qui en ont foûtenu le
dogme.
Si l’argument de M. Bayle eft vrai en quelque
point, ce n’eft qu’autant que fon athée s’écarteroit
des notions fuperficielles & légères que cet auteur
lui donne fur la nature de la vertu & des devoirs moraux.
En ce point l’on convient que Yathée eft encote
plus porté que le théifte à agir contre fes opinions.
Le théifte ne s’écarte de la vertu, qui, fuivant
fes principes, eft le plus grand de tous les biens, que
parce que fes paflions l’empêchent, dans le moment
de l’aéfion, de conïidérer ce bien comme partie ne-
ceffaire de fon bonheur. Le conflit perpétuel qu’il y
a entre fa raifon & fes paflions, produit celui qui fe
trouve entre fa conduite & fes principes. Ce conflit
n’a point lieu chez Y athée; fes principes le condui-
fent à conclure que les plaiflrs fenfuels font le plus
grand de tous les biens ; & fes paflions, de concert
avec des principes qu’elles chériffent, ne peuvent
manquer de lui faire regarder ce bien comme partie
néceffaire de fon bonheur : motif dont la vérité o u -
l’illufion détermine nos aftions. Si quelque chofe eft:
capable de s’oppofer à ce defordre, & de nous faire
regarder la vertu comme partie néceffaire de notre
bonheur, fera-ce l’idée innée de fa beauté ? fera-ce
la contemplation encore plus abftraite de fa différence
effentielle d’avec le vice ? réflexions qui font les
feules dont un athée puiffe faire ufage : ou ne fera-ce
pas plûtôt l’opinion que la pratique de la v ertu, telle
que la religion l’enfeigne, eft accompagnée d’une récompenfe
infinie, & que celle du vice eft accompagnée
d’un châtiment egalement infini ? On peut ob-
ferver ici que M. Bayle tombe en contradiôion avec
lui-même : là il voudroit faire accroire que le fenti-
ment moral & la différence effentielle des chofes fu£-
fifent pour rendre les hommes vertueux ; & ici il prétend
que Ces deux motifs réunis, & foûtenus de celui
d’une providence qui récompenfe & qui punit, ne
font prefque d’aucune efficacité.
Mais, dira M. Bayle, l’on ne doit pas s’imaginer
qu’un athée, précifément parce qu’il eft athée, & qu’il
nie la providence , tournera en ridicule ce que les
autres appellent vertu & honnêteté ; qu’il fera de
faux fermens pour la moindre chofe ; qu’il fe plongera
dans toutes fortes de defordres ; que s’il fe trouve
dans un pofte qui le mette au-deffus des lois humaines
, aufli-bien qu’il s’eft déjà mis au-deffus des remords
de fa conlcience, il n’y a point de crime qu’on
ne doive attendre de lui ; qu’étant inacceflïble à toutes
les confidérations qui retiennent un théifte, il deviendra
néceffairement le plus grand & le plus incorrigible
fcélérat de l’univers. Si cela étoit v rai, il ne
le feroit que quand on regarde les chofes dans leur
idée, & qu’on fait des abftraâions métaphyfiques.
Mais un tel raifonnement ne fe trouve jamais conforme
à l’expérience. L'athée n’agit pas autrement
que le théifte, malgré la diverfite de fes principes*
Oubliant donc dans l ’ufage de la v ie & dans le train
de leur conduite, les conféquences de leur hypothe-
fe , ils vont tous deux aux objets de leur inclination ;
ils fuivent leur goût, & ils fe conforment aux idées
qui peuvent flater l’amour-propre : ils étudient-, s’ils
aiment la fcience ; ils préfèrent le fincérité à la fourberie
, s’ils fentent plus de plaifir après avoir fait uft
aûe de bonne-foi qu’après avoir dit un menfonge ;
ils pratiquent la vertu, s’ils font fenfibles à la réputation
d’honnête homme: mais fi leur tempérament les
pouffe tous deux vers la débauche , & s’ils aiment
mieux la volupté que l’approbation du public, ils s’ abandonneront
tous deux à leur penchant, le théifte
comme Y athée. Si vous en doutez, jettez les yeux fur
les nations qui ont différentes religions, & fur celles
qui n’en ont pas, vous trouverez par-tout les mêmes
paflions : l’ambition, l’avarice, l’envie, le defir de fe
venger, l’impudicité & tous les crimes qui peuvent fa-
tisfaire les paflions, font de tous les pays & de tous les
fiecleS. Le Juif & le Mahométan, le Turc & le More,
le Chrétien & l’Infidele, l’Indien & leTartare, l’hà-
1bitant de tefre-ferme & l’habitant des îles, le noble & le roturier ; toutes ces fortes de gens qui fur la
vertu ne conviennent, pour ainfi dire, que dans la
hotîon générale du mot , font fi femblables à l’égard
de leurs paflions, que l’on diroit qu’ils fe copient les
uns les autres.D’où vient tout cela, finon que le principe
pratique des allions de l’homme n’eft autre chofe
que le tempérament, l’inclination naturelle pour le
plaifir, le goût que l’on contracte pour certains objets,
le defir de plaire à quelqu’un,une habitude qu’on
s’eft formée dans le commerce de fes amis , ou quel-
qu’autre difpofition qui réfulte du fond de la nature
en quelque pays que l’on naiffe, & de quelques connoiffances
que l’on nous rempliffe l’efprit ? Les maximes
que l’on a dans l’efprit laiffent les fentimens du
coeur dans une parfaite indépendance : la feule caufe
qui donne la forme à la différente conduite des hommes
V font les différens degrés d’un tempérament heureux
qu malheureux, qui naît avec nous, & qui eft
l’effet phyfique de la conftitution de nos corps. Conformément
a cette vérité d’expérience, il peut fe faire
qu’un athée vienne au monde avec une inclination
naturelle pour la juftice & pour l’équité, tandis qu’un
theifte entrera dans la focieté humaine accompagné
de la dureté,de la malice & de la fourberie. D ’ailleurs,
.prefque tous les hommes naiffent avec plus
ou moins de refpeû pour les vertus qui lient la focié-
te : n’importe d’où puiffe venir cette utile difpofition
du coeur humain ; elle lui eft effentielle: un certain
degre.d amour pour les autres hommes nous eft naturel,
tout comme l’amour fouverain que nous avons
chacun pour nous-mêmes:de-là vient que quand mê- j
me un athée, pour le conformer à fes principes, ten-
teroit de pouffer la fcelérateffe julqu’aux derniers ex-
ces, il trouveroit dans le fond de fa nature quelques
femences de vertu, & les cris d’une confcience qui
1 effrayeroit, qui l’arrêteroit, & qui feroit échouer
fes pernicieux deffeins.
Pour répondre à cette obje&ion qui tire un air
ébloüifl'ant de la maniéré dont^M. Bayle l’apropofée
en divers endroits de fes ouvrages,j’a voüerai d’abord
que le tempérament de l’homme eft pour lui une féconde
fource de motifs, & qu’il a une influence très-
etendue fur toute fà conduite. Mais ce tempérament
forme-t-il foui notre caraétere ? détermine-t-il tous
les a êtes de notre volonté ? fommesnous abfolument
inflexibles a tous les motifs qui nous viennent de dehors
? nos opinions vraies ou fauffes, font-elles incapables
de rien gagner fur nos penchans naturels?Rien
au monde n’eft plus évidemment faux ; & pour le foû-
tenirilfaut n avoir jamais démêlé les refforts de fa propre
conduite. Nous fentons tous les jours que la réflexion
fur un intérêt confidérable nous fait agir directement
contre les motifs qui fortent du fond de notre
nature. Une fage éducation ne fait pas toûjours tout
l’effet qu’on pourroit s’en promettre : mais il eft rare
qu’elle foit abfolument infru&ueufe. Suppofons dans
deux hommes le même degré d’un certain tempérament
& de génie:il eft fûr que le .même caraétere éclatera
dans toute leur conduite ? L ’un n’aura eu d’autre
guide que fon naturel ; fon efprit affoupi dans l’inaction
, n’aura jamais oppofé la moindre réflexion à la
violence de les penchans ; toutes les habitudes vicieufes
dérivées de fon tempérament, auront le loifir
de fe former ; elles auront affervi fa raifon pour jamais.
L’autre, au contraire, aura appris dès l’âge le
plus tendre à cultiver fon bon fens naturel ; on lui
aura rendu familiers des principes de vertu & d’honneur
; on aura fortifié dans fon ame la Ienfibilité pour
le prochain, de laquelle les femences y ont été placées
par la nature ; on l’aura formé à l’habitude de
réfléchir fur lui - même, & de réfifter à fes penchans
impérieux : ces deux perlonnes feront-elles néceffairement
les mêmes ? Cette idée peut-elle entrer dans 1 efprit d’un homme judicieux ? Il eft vrai qu’un trop
grand nombre d’hommes ne démentent que trop fouvent
dans leur conduite le fentiment légitime de leurs
Tome I,
principes , pour s’affervir à la tyrannie de leurs paf-
fions : mais ces mêmes hommes n’ont pas. dans toutes
les occafions une conduite également inconfé-
quente;-leur tempérament n’eft pas toûjours excité
avec la même violence. Si un tel degré de paflîon détourne
leur attention de la lumière de leurs principes,
cette paflion moins animée, moins fougueufe, peut
ceder à la force de la réflexion, quand elle offre un
intérêt plus grand que celui qui nous eft promis par
nos penchans. Notre tempérament a fa force, & nos
principes ont la leur ; félon que ces forces font plus
ou moins grandes de côté & d’autre, notre conduite
varie. Un homme qui n’a point de principes oppofés
a les penchans , ou qui n’eri a que dé très-foibles, tel
Que Y athée, (mvrdi toûjours indubitablement ce que
lui d iae fon naturel; & un homme dont le tempérament
eft combattu par les lumières fauffes ou véritables
de fon efprit, doit être fouvent en état de prendre
le parti de fes idées contre les intérêts de fes penchans.
Les recompenfes & les peines d’une autre vie
font un contrepoids falutaire, fans lequel bien des
gens auroient été entraînés dans l’habitude du v ice
par un tempérament qui fe feroit fortifié tous les
jours. Souvent la religion fait plier fous elle le naturel
le plus impérieux, & conduit peu à peu fon heureux
profelyte à l’habitude de la vertu.
Les légiflateurs étoient fi perfuadés de l’influence
de la religion fur les bonnes moeurs,qu’ils ont tous mis
à la tete des lois qu’ils ont faites ; les dogmes de la providence
& d’un état futur. M. Bayle , 1e coryphée des
incrédules, en convient en termes exprès. «Toutes
» tes religions du monde, dit-il, tant la vraie que tes
» fauffes, foulent fur ce grand pivot; qu’il y a un
» juge invifible qui punit •& qui récompenfe après
» cette vie les aérions de l’homme, tant intérieures
» qu extérieures : c’eft de - là qu’on fuppofe que dé-
» coule la principale utilité de la religion ». M. Bayle
croit que l’utilité de ce dogme eft fi grande, que dans
1 hypothefe où la religion eût été une invention politique
, c eût été, félon lui, le principal motif qui eût
animé ceux qui l’auroient inventée.
_ Les poètes grecs tes plus anciens, Mufée, Orphée;
Homere, Hefiode, &c. qui ont donné des fyftèmes
de théologie & de religion conformes aux idées &
aux opinions populaires de leur tems, ont tous établi
1e dogme des peines & des récompenfes futures
comme un article fondamental. Tous leurs fuccef-
feurs ont fuivi le même plan ; tous ont rendu témoignage
à ce dogme important: on en peut voir la preuve
dans les ouvrages d’Efchyle, de Sophocle, d ’Euripide
& d’Ariftophane,dont la profeflion étoit de peindre
tes moeurs de toutes tes nations policées, greques
ou barbares ; & cette preuve fe trouve perpétuée
dans tes écrits de tous tes hiftoriens & de tous tes phi-
lofophes.
Plutarque, remarquable par l’étendue de fes connoiffances
, a fur ce nijet un paffage digne d’être rapporté.
« Jettez tes yeux, dit-il dans fon traité contre
’épicurien Colorés , « fur toute la face de la terre *
» vous y pourrez trouver des villes fans fortification*
» fans lettres, fans magiftrats réguliers, fans habita-
» tions diftinftes, fans profeflions fixes, fans pro- ■
» priété , fans l’ufage des monnoies, & dans l’igno-
» rance univerfelle des beaux arts : mais vous ne
» trouverez nulle part une ville fans la connoiffance
» d’un dieu ou d’une religion, fans l’ufage des voeux,
» des fermens, des oracles, fans facrifices pour fe
» procurer des biens, ou fans rits déprécatoires pour
» détourner tes maux ». Dans fa confolation à Apollonius
, il déclare que l’opinion que tes hommes vertueux
feront récompenfésaprès leur mort, eft fi ancienne
, qu’il n’a jamais pû en découvrir ni l’auteur
ni l’origine. Cicéron & Seneque a voient déclaré la
même chofe avant lui, Sextus Empiricus voulant dé-
K K k k k ij