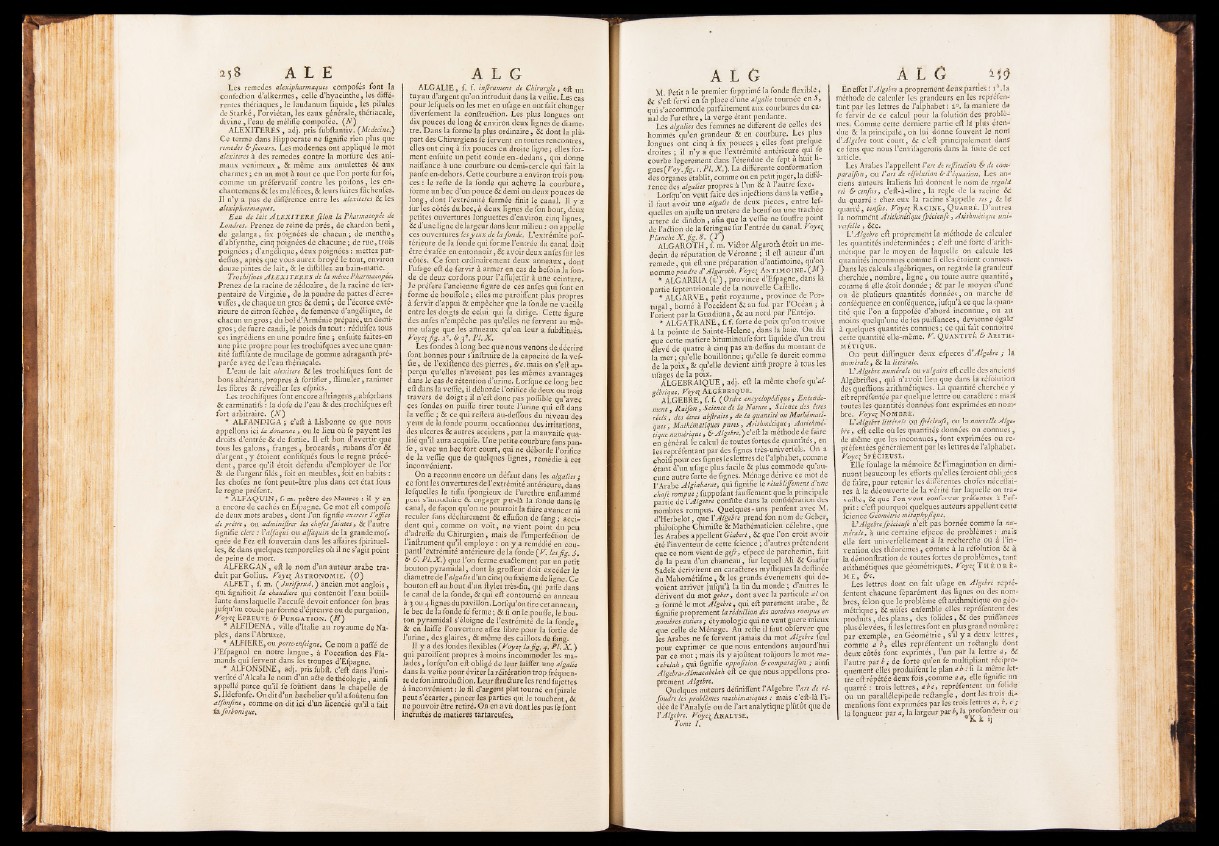
*58 ALE Les remedes alexipharmaques compofés font la
confection d’alkermes, celle d’hyacinthe, les différentes
thériaques, le laudanum liquide, les pilules
de Starké, l’orviétan, les eaux générale, thériacale,
divine, l’eau de méliffe compofée. (N )
ALEXITERES , adj. pris fubftantiv. (Médecine.')
Ce terme dans Hippocrate ne lignifie rien plus que
remedes & fecours. Les modernes ont appliqué le mot
alexiteres à des remedes contre la morfure des animaux
venimeux, & même aux amulettes & aux
charmes ; en un mot à tout ce que l’on porte fur foi,
comme un préfervatif contre les poifons, les en-
chantemens & les maléfices, & leurs fuites fâcheufes.
Il n’y a pas de différence entre les alexiteres & les
alexipkarmaques.
Eau de lait A L E X I T E R E félon la Pharmacopée de
Londres. Prenez de reine de prés, de chardon béni,
de galanga, fix poignées de chacun ; de menthe,
d’abfynthe, cinq poignées de chacune ; de rue, trois
poignées ; d’angélique, deux poignées : mettez par-
deffus, après que vous aurez broyé le tout, environ
douze pintes de lait, & le diftillez au bain-marie.
Trochifmes A L E X IT E R E S de la même Pharmacopée.
Prenez de la racine de zédoaire, de la racine de fer?
pentaire de Virginie, de la poudre de pattes d’écre-
viffes, de chaque un gros 8c demi ; de l’écorce extérieure
de citron féchée, de femence d’angélique, de
chacun un gros ; du bol d’Arménie préparé, un demi-
gros ; de fucre candi, le poids du tout : réduifez tous
ces ingrédiens en une poudre fine ; enfuite faites-en
une pâte propre pour les trochifques avec une quantité
îuffifante de mucilage de gomme adraganth préparée
avec de l’eau thériacale.
L ’eau de lait alexitere & les trochifques font de
bons altérans, propres à fortifier, ftimufér, ranimer
les fibres & réveiller les elprits.
Les trochifques font encore aflringens ^abfçrbans
& carminatifs : la dofe de l’eau & des trochifques eft
fort arbitraire. (N )
* ALFANDIGA ; c’eft à Lisbonne ce que nous
appelions ici la douanne, ou le lieu où fe payent les
droits d’entrée 8t de fortie. Il eft bon d’avertir que
tous les galons, franges, brocards, rubans d’or &
d’argent, y étoient confifqués fous le régné précédent,
parce qu’il étoit défendu d’employer de l’or
& de l’argent filés, foit en meubles, foit en habits :
les chofes ne font peut-être plus dans cet état fous
le régné préfent.
* ALFAQUIN, f. m. prêtre des Maures : il y en
a encore de cachés en Efpagne. Ce mot eft compofé
de deux mots arabes, dont l’un fignfie exercer Poffice
de prêtre , ou administrer les chofes faintes, & l’autre
fignifie clerc : Yalfaqui oit alfaquin de la grande mof-
quée de Fez eft fouverain dans les affaires fpirituel-
les, & dans quelques temporelles où il ne s’agit point
de peine de mort.
ALFERGAN, eft le nom d’un auteur arabe traduit
par Golius. Voye^ Astronomie. (O)
ALFET, f. m. ( Jurifprud. ) ancien mot anglois,
qui fignifioit la chaudière qui contenoit l ’eau bouillante
dans laquelle l’accufé devoit enfoncer fon bras
jufqu’au coude par forme d’épreuve ou de purgation.
Voye^ Epreuve & Purgation. (H )
* ALFIDENA, ville d’Italie au royaume de Na- I
pfés, dans l’Abruzze.
* ALFIERE, ou porte-enfeigné. Ce nom a paffé de
l ’Efpagnol en notre langue, à l’occafion des Flamands
qui fervent dans les troupes d’Efpagne.
* ALFONSINE, adj. prisfubft. c’eft dans l’uni-
verfité d’Alcala le nom d’un afte de théologie, ainfi
appellé parce qu’il fe foûtient dans la chapelle de
S. lldefonfe. On dit d’un bachelier qu’il afoûtenu fon
alfonjine, comme on dit ici d’un licencié qu’il a fait
la forbonique.
A L G
ALGALIE, f. f. inflrument de Chirurgie , eft un
tuyau d’argent qu’on introduit dans la veffie. Les cas
pour lefquels on les met en ufage en ont fait changer
diverfement la conftruâion. Les plus longues ont
dix pouces de long 8c environ deux lignes de diamètre.
Dans la forme la plus ordinaire, 8c dont la plû-
part des Chirurgiens fe fervent en toutes rencontres,
elles ont cinq à fix pouces en droite ligne ; elles forment
enfuite un petit coude en-dedans, qui donne
naiffance à une courbure ou demi-cercle qui fait la
panfe en-dehors. Cette courbure a environ trois pouces
: le refte de la fonde qui achevé la courbure,
forme un bec d’un pouce 8c demi ou deux pouces de
long, dont l’extrémité fermée finit le canal. II y a
fur les côtés du bec, à deux lignes de fon bout, deux
petites ouvertures longuettes d’environ cinq lignes,
& d’une ligne de largeur dans leur milieu : on appelle
ces ouvertures les yeux de la fonde. L’extrémité pof-
térieure de là fonde qui forme l’entrée du canal doit
être évafée en entonnoir, & avoir deux anfes fur les
côtés. Ce font ordinairement deux anneaux, dont
l’ufage eft de fervir à armer en cas de befoin la fonde
de deux cordons pour l’affujettir à une ceinture.
Je préféré l’ancienne figure de ces anfes qui font en
forme de bouffole ; elles me paroiffent plus propres
à fervir d’appui & empêcher que la fonde ne vacille
entre les doigts de celui qui la dirige. Cette figure
des anfes n’empêche pas qu’elles ne fervent au même
ufage que les anneaux qu’on leur a fubftitués.
roye^fig.?. &3 e. P l.X .
Les fondes à long bec que nous venons de décrire
font bonnes pour s’inftruire de la capacité de la vef-
f ie , de l’exiftence des pierres, &c. mais on s’eft ap-
perçu qu’elles n’avoient pas les mêmes avantages
dans le cas de rétention d’urine. Lorfque ce long bec
eft dans la veffie, il déborde l’orifice de deux ou trois
travers de doigt ; il n’eft donc pas poflible qu’avec
ces fondes on puiffe tirer toute l ’urine qui eft dans
la veffie ; & ce qui reliera au-deffous du niveau des
yeux de la fonde pourra occafionner des irritations
des ulcérés 8c autres accidens, par la mauvaife qualité
qu’il aura acquife. Une petite courbure fans panfe
, avec un bec fort court, qui ne déborde l ’orifice
de la veffie que de quelques lignes, remédie à cet
inconvénient.
On a reconnu encore un défaut dans les algalies ;
ce font les ouvertures de l’extrémité antérieure, dans
lefquelles le tiffu fpongieux de l’urethre enflammé
peut s’introduire 8c engager par-là la fonde dans le
canal, de façon qu’on nepourroit la faire avancer ni
reculer fans déchirement 8c effufion de fang ; accident
qui, comme on vo it, ne vient point du peu
d’adreffe du Chirurgien, mais de l’imperfeCtion de
l’inftrument qu’il employé : on y a remédié en cou-
pantl’extrénuté antérieure delà fonde (V. les fig. 5.
& 6. P l.X .) que l’on ferme exactement par un petit
bouton pyramidal, dont la groffeur doit excéder le
diamètre de Y algalie d’un cinq ou fixieme de ligne. Ce
bouton eft au bout d’un ftylet très-fin, qui paffe dans
le canal de la fonde, & qui eft contourné en anneau
à 3 ou 4 lignes du pavillon. Lorfqu’on tire cet anneau,
le bec de la fonde fe ferme ; & fi on leNpoufle, le bouton
pyramidal s’éloigne de l’extrémité de la fonde,
& en laiffe l’ouverture affez libre pour la fortie de
l’urine, des glaires, & même des caillots de fang.
Il y a des fondes flexibles ( Voye£ la fig. 4. PI. X . )
qui paroiffent propres à moins incommoder les malades
, lorfqu’on eft obligé de leur laiffer une algalie
dans la veffie pour éviter la réitération trop fréquente
de fon introduction. Leur ftruCture les rend fujettes
à inconvénient : le fil d’argent plat tourné en fpirale
peut s’écarter, pincer les parties qui le touchent &
ne pouvoir être retiré. On en a vu dont les pas fe font
incruftés de matières tartareufes»
A L G M. Petit a le premier fupprimé la fonde flëxiblé,
& s’eft fervi en fa place d’une algalie tournée en S,
qui s’accommode parfaitement aux courbures du canal
de l’urethré, la verge étant pendante.
Les algalies des femmes ne different de celles des
hommes qu’en grandeur & en courbure. Les plus
longues ont cinq à fix pouces elles^ font prefque
droites ; il n’y a que l’extrémité antérieure qui le
courbe legerement dans l’étendue de fept à huitdignes
(Voy.fig. i.P l. X .). Là différente conformation
des organes établit, eonirtte on en peut jugër, là diffe-
tence des algalies propres à l’un ot à 1 autre fexe.
Lorfqu’on veut faire des injeftions dans la veffie,
il faut avoir une algalie de deux pièces, entre lefquelles
on ajufte un uretere de boeuf ou une trachee
artere de dindoh, afin que la Veffie ne fôuffre point
de l’aétion de la feringuefur l’entrée du Canal. Voye£
Planche X . fig. 8. ( T ) .
ALGAROTH, i. m. ViCtof Algaroth étoit itn médecin
de réputation de Véronne ; il eft auteur d’un
remede, qui eft une préparation d’antimoine, qu’on
nomme poudre d'Algaroth. Voye£ Antimoine. (M )
* ALGARRIA (l’) , province d’Efpagne, dans la
partie feptentrionale de la nouvelle Caftille.
* ALGARVE, petit royaume, province de Portugal
, borné à l’occident 8c au fud par l’Océan ; à
l’orient par la Guadiana, & au nord par l’Erttéjo,' -
* ALGATRANE, f. f. forte de poix qu’on troitve
à la pointe de Sainte-Helene, dans la baie. On dit
que cette matière bitumineufe fort liquide d’un trou
elevé de quatre à cinq pas au-deffus du montant de
la mer ; qu’elle bouillonne ; qu’elle fe durcit comme
de la poix, & qu’elle devient ainfi propre à tous les
ufages de la poix. ' . ,'
ALGEBRAIQUE, adj. eft la menïe chofe qu algébrique.
Voyt£ ALGEBRIQUE. ^
ALGEBRE, f. f. (Ordre encyclopédique, Entendement
, Raifon , Science dé la Nature, Science des êtres
réels, des êtres abftraits, de la quantité ou Mathématiques,
Mathématiques pures, Arithmétique y Aarithmè-
tique numérique, & Algèbre.) c’eft la méthode de faire
en général le calcul de toutes fortes de quantités , en
les repréfentant par des fignes trës-univerfels. On a'
choifi pour ces fignes les lettres de l’alphabet, comme
étant d’un ufage plus facile & plus commode qu’aucune
autre forte de fignes. Ménage dérive ce mot de
l ’Arabe Algiabarat, qui fignifie le rétablifftrhent d'une
chofe rompue ; fuppofant fauffement que la principale
partie de Y Algèbre confifte dans la cônfidératiort des
nombres rompus. Quelques-uns penfent avec M.
d’Herbelot, que Y Algèbre prend fort nom de Geber,
philofophe Chimifte & Mathématicien célébré, que
les Arabes appellent Giaberi, & que l’on croit avoir
été l’inventeur de cette fcience ; d’autres prétendent
que ce nom vient de gefr, efpece de parcheinirt, fait
de la peau d’un chameau, fur lequel Ali & Giafur
Sadek écrivirent en caraCteres myftiques la deftinée
du Mahométifme, & les grands evenemens qui dévoient
arriver jufqu’à la fin du monde ; d’autres le
dérivent du mot geber, dont avec la particule al on
a formé le mot Algèbre, qui eft purement arabe, 8c
fignifie proprement la réduction des nombres rompus en
nombres entiers ; étymologie qui ne vaut guere mieux
que celle de Ménage. Au refte il faut obferver que
les Arabes ne fe fervent jamais du mot Algèbre feul
pour exprimer ce que nous entendons aujourd’hui
par ce mot ; mais ils y ajoûtent toujours le mot ma-
cabelah , qui fignifie oppofition & comparaifon ; ainfi
Algebra-AÏmacabclah eft ce que nous appelions proprement
Algèbre.
Quelques auteurs définiffent l’Algebre Y art de réfoudre
les problèmes mathématiques : mais c ’eft-là l’idée
de l’Analyfe ou de l’art analytique plûtôt que de
Y Algèbre. Voye£. ANALYSE,
Tome I.
À L G Èn effet ŸAlgèbre a proprement deitx parties i î° . la
méthode de calculer les grandeurs en les repréfentant
par les lettres de l’alphabet} ±°. la maniéré da
fe fervir de te calcul pour la folutidn des problèmes;
Comme cette derhiere partie eft là plus étendue
& la principale, oh lui donne fouveht le non!
d'Algèbre tout court, & c ’eft principalement dans
ce fehs que nous l’enVifageroris dans la fuite de cet
'article.
LeS Arabes fappelleht l'art de refiitutioh & de tôrtu
pdrdifoh, Oü l'art de refoluiiôn & d'équation. Les anciens
auteurs Italieris lui dorthent le nom de reguld
rei & cenfus, c’eft-à-dirë, la réglé de la racine Sc.
du quarré i chez eüx la racine s’appelle tes ; & le
quarfé, tenfus. Voye^ Racine, Quarré. D ’autres
la nomfhént Arithmétique fpécieufe, Arithmétique uni-
verfelle , &c.
L’Algèbre eft proprement là méthode de calculer
les quantités indéterminées ; c’eft uné forte d’arithmétique
par le moyen de laquelle on calcule leà
quantités inconnues comme fi elles étoient connues.
Dans les Calculs algébriques, on regarde la grandeur
cherchée, nombre, ligne, ou toute autre quantité ,
comme fi elle étoit donnée ; & par le moyen d’und
Oü dè plufieürs quantités données, on marche de
Conféqtience en conféquence, jufqu’à ce que la quantité
que l’on a fuppofée d’abord incpnrtue, ou au
moins quelqu’une de fes puiffances, devienne égale
à quelques quantités connues ; ce qui fait conrtoître
cette quantité elle-même. V , Quantité & Arithmétique.
On peut diftinguer deux efpeces à*Algèbre ; la
humérale > Si la littétdle.
L’Algèbre numérale ou vulgaire eft celle des anciens
Algébriftes, qui n’aVoit lieu que dans la réfolutiorl
des queftions arithmétiques. La quantité cherchée y
eft repréféntée par quelque lettre ou cara&ere : niais
toutes les quantités données font exprimées en nom*
bre. Voye%_ Nombrè.
U Algèbre littérale OU fpécieufe, Ou la nouvelle Algè*
bté, eft celle où les quantités données ou connues,
de mêrtie que les inconnues , font exprimées ou re-
préfëhtées généralement par les lettres de l’alphabet«
Voye{ SpÏ cieusé»
Elle foulage la mémoire & l’imagination en diminuant
beaucoup les efforts qu’elles feroient obligées
de faire, pour retenir les différentes chofes néceffai-*
res à la découverte de la vérité fur laquelle on tra-<
vaille, & que i’ofl veut conferver préfentes â l’ef-*
prit : c’eft pourquoi quelques auteurs appellent cette
fcience Géométrie méiaphyjîque.
VAlgèbre fpécieufe n’eft pas bornée Comme la rïu*
mérale, à Une certaine efpece de problèmes : mais
elle fert univerfellëment à la recherche ou. à l’in-
vention des théorèmes , comme à la réfolution & à
la démônftrâtion de toutes fortes de problèmes, tant
arithmétiques que géométriques. Voye{ T h é o r è m
e , &c.
Les lettres dont on fait ufage en Algèbre répré-»
fentent chacune féparément des lignes ou des nom»
bres, félon que le problème eft arithmétique ou géo-»
métrique ; & mifes enfemble elles repréfentent des
produits, des plans , des folides, & des puiffances
plus élevées, fi les lettres font en plus grand nombre.‘
par exemple, en Géométrie, s il y a deux lettres,
comme a 1 , elles repréfentent un re&angle dont
deux côtés font exprimés, l’un pat la lettre à , &S
l’autre par b; de forte qu’en fe multipliant réciproquement
elles produifent le plan db : fi la même lettre
eft répétée deux fois, comme a a, elle fignifie un
quarré : trois lettres, abc, repréfentent un fohde
ou un parallélépipède reftangle , dont les trois di-
mehiions font exprimées par les trois lettres a, b> c ;
la longueur par a, la largeur par b, ^profondeur ou