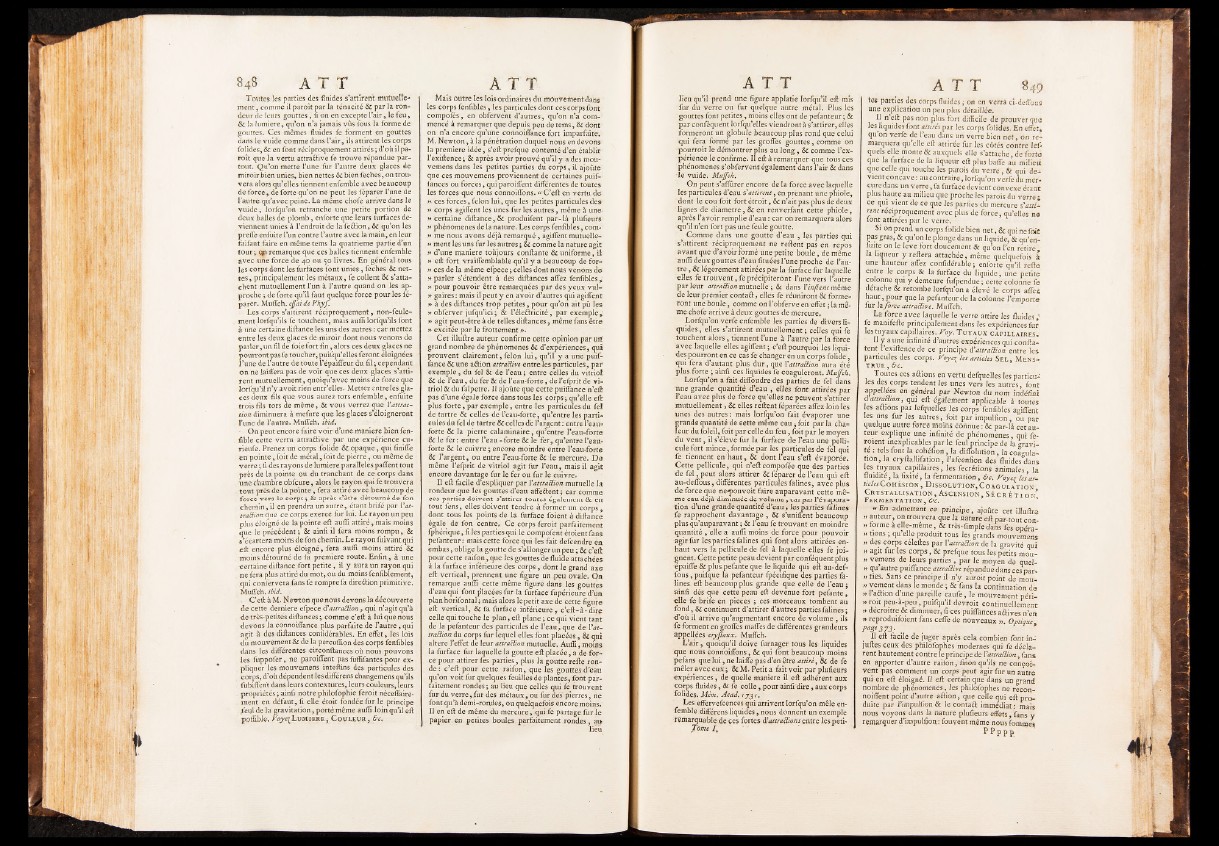
Toutes les parties des fluides s’attirent mutuellement
, comme il paroît par la ténacité & par la rondeur
de leurs gouttes, li on en excepte l’air, le feu,
& la lumière, qu’on n’a jamais vûs fous la forme de
gouttes. Ces mêmes fluides fe forment en gouttes
dans le vuide comme dans l’air, ils attirent les corps
folides, & en font réciproquement attirés ; d’oii il paroît
que la vertu attra#ive fe trouve répandue partout.
Qu’on mette l’une fur l’autre deux glaces de
miroir bien unies, bien nettes & bien feches, on trouvera
alors qu’elles tiennent enfemble avec beaucoup
de force, de forte qu’on ne peut les féparer l’une de
l ’autre qu’avec peine. La même chofe arrive dans le
Vuide, lorfqu’on retranche une petite portion de
deux balles de plomb, enforte que leurs liirfaces deviennent
unies à l’endroit de la feftion, & qu’on les
preffe enfuite l’un contre l’autre avec la main, en leur
faifant faire en même tems la quatrième partie d’un
tour; qp remarque que ces balles tiennent enfemble
avec une force de 40 ou 50 livres. En général tous
les corps dont les furfaces font unies, feches & nettes,
principalement les métaux, fe collent & s’ attachent
mutuellement l’un à l’autre quand on les approche
; de forte qu’il faut quelque force pour les féparer.
Muffch. effai de Phyf.
Les corps s’attirent réciproquement, non-feulement
lorfqu’ils fe touchent, mais auffi lorfqu’ils font
à une certaine diftance les uns des autres : car mettez
entre les deux glaces de miroir dont nous venons de
parler, un fil de foie fort fin, alors ces deux glaces ne
pourront pas fe toucher, puifqu’elles feront éloignées
l ’une de l’autre de toute l’épaiffeur du fil ; cependant
on ne laiffera pas de voir que ces deux glaces s’attirent
mutuellement, quoiqu’avec moins de force que
lorfqu’ii n’y a voit rien entr’elles. Mettez entre les glaces
deux fils que vous aurez tors enfemble, enfuite
trois fils tors de même, & vous verrez que Y attraction
diminuera à mefure que les glaces s’éloigneront
l’une de l’autre. Muffch. ibid.
- On peut encore faire voir d’une, manxefe bien fen-
fible cette vertu attra#ive par une expérience eu*
rieufe. Prenez un corps folide & opaque, qui finiffe
en pointe, foit de métal, foit de pierre, ou même de
verre ; li des rayons de lumière parallèles paffent tout
près de la pointe ou du tranchant de ce corps dans
une chambre obfcure, alors le rayon qui fe trouvera
tout près de la pointe, fera attire avec beaucoup de
force vers le corps ; & après s’êtfe détourné de fon
chemin, il en prendra un autre, étant brifé par Y attraction
que ce corps exerce fur lui. Le rayon un peu
plus éloigné de la pointe eft aufîi attiré, mais moins
que le précédent ; & ainli il fera moins rompu, &
s’écartera moins de fon chemin. Le rayon fuivant qui
eft encore plus éloigné, fera auffi moins attiré &
moins détourné de fa première route. Enfin, à une
certaine diftance fort petite, il y aura un rayon qui
ne fera plus attiré du mot, ou du moins fenfiblement,
qui confervera fans fe rompre fa direction primitive.
Muffch. ibid.
. C ’eft à M. Newton que nous devons la découverte
de cette derniere efpece à?attraction, qui n’agit qu’à
de très-petites diftances ; comme c’eft à lui que nous
devons la connoiffance plus parfaite de l’autre, qui
agit à des diftances confidérables. En effet, les lois
du mouvement & de la percuffion des corps fenfibles
dans les différentes circonftances où nous pouvons
les fuppofer, ne paroiffent pas fuffifantes pour expliquer
les mouvemens inteftins des particules des
corps, d’où dépendent les différens changemens qu’ils
fubifl'en't dans leurs contextures, leurs couleurs, leurs
. propriétés ; ainli notre philofophie feroit néceffaire-
ment en défaut, li elle étoit fondée fur le principe
jfeul de la gravitation, porté même auffi loin qu’il eft
poffible. Poye{ LUMIERE , CpULEUR, &C,
Mais outre les lois ordinaires du mouvement dans
les corps fenfibles, les particules dont ces corps font
compofés, en obfervent d’autres, qu’on n’a commencé
à remarquer que depuis peu de tems, & dont
on n’a encore qu’une connoiffance fort imparfaite.
M. Newton, à la pénétration duquel nous en devons-
la première idée , s’eft prefque contenté d’en établir
l’exiftence; & après avoir prouvé qu’il y a des mouvemens
dans les petites parties du Corps, il ajoute
que ces mouvemens proviennent de certaines puif-
lances ou forces, qui paroiffent différentes de toutes
les forces que nous connoiffons. « C ’eft en vertu de
». ces forces, félon lui, que les petites particules des
» corps agiffent les unes fur les autres, même à une-
»certaine diftance, & produifent par-là plufieurs
» phénomènes de la nature. Les corps fenfibles, com-
» me nous avons déjà remarqué, agiffent mutuelle-
» ment les uns fur les autres ; & comme la nature agit
» d’une maniéré toujours confiante & uniforme, il
» eft fort vraiffemblable qu’il y a beaucoup de for-
» ces de la même efpece ; celles dont nous venons de
» parler s’étendent à des diftances affez fenfibles,
» pour pouvoir être remarquées par des yeux vul-
» gaires : mais il peut y en avoir d’autres qui agiffent
» à des diftances trop petites, pour qu’on ait pû les
» obferver jufqu’ici ; & l’éleftricité, par exemple,'
» agit peut-être à de telles diftances, même fans être
» excitée par le frottement »<
Cet illuftre auteur confirme cette opinion par unf
grand nombre de phénomènes & d’expériences, qui
prouvent clairement, félon lui, qu’il y a une puif-
fance & une a#ion attractive entre les particules, par4
exemple, du fel & de l’eau ; entre celles du vitriol
& de l’eau, du fer & de l’eau-forte, de l’efprit de v itriol
& du falpetre. Il ajoûte que cette puiffance n’eft
pas d’une égale force dans tous les corps; qu’elle eft
plus forte, par exemple, entre les particules du fel
de tartre & celles de l’eau-forte, qu’entre les particules
du fel de tartre & celles de l’argent : entre l’eau-
forte & la pierre calaminaire, qu’entre l’eau-forte
& le fer: entre l’eau - forte & le fer, qu’entre Peau-
forte & le cuivre ; encore moindre entre l’eau-forte
& l’argent, ou entre Peau-forte & le mercure. D e
même l’efprit de vitriol agit fur Peau, mais il agit
encore davantage fur le fer ou fur le cuivre.
Il eft facile d’expliquer par Y attraction mutuelle la
rondeur que les gouttes d’eau affe#ent; car comme
ces parties doivent s’attirer toutes également & en
tout fens, elles doivent tendre à former un corps ,
dont tous les points de la furface foient à diftance
égale de fon centre. Ce corps feroit parfaitement
fphérique, fi les parties qui le compofent étoient fans
pefanteur : mais cette force qui les fait defeendre en
embas, oblige la goutte de s’allonger un peu ; & c’eft
pour cette raifon, que les gouttes de fluide attachées
à .la furface inférieure des corps, dont le grand axe
eft vertical, prennent une figure un peu ovale. On
remarque auffi cette même figure dans les gouttes
d’eau qui font placées fur. la furface fupérieure d’un
plan horifontal; mais alors le petit axe de cette figure
eft vertical, & fa furface inférieure, c’eft-à-dire
celle qui touche le plan, eft plane ; ce qui vient tant
de la pefanteur des particules de Peau, que d e Y attraction
du corps fur lequel elles font placées, & qui
altéré l’effet de leur attraction mutuelle. Auffi, moins
la furface fur laquelle la goutte eft placée, a de force
pour attirer fes parties, plus la goutte refte ronde:
c’eft pour cette raifon, que les gouttes d’eau
qu’on voit fur quelques feuilles de plantes , font parfaitement
rondes ; au lieu que celles qui fe trouvent
fur du verre, fur des métaux, ou fur des' pierres, ne
font qu’à demi-rondes, ou quelquefois encore moins.
Il en eft de même du mercure, qui fe partage fur le
papier.en petites boules parfaitement rondes, au
lieu
lieu qu’il prend une figure applatie lorfqu’il eft mis
fur du verre ou fur quelque autre métal. Plus les
gouttes font petites, moins elles ont de pefanteur ; &
par conféquent lorfqu’elles viendront à s’attirer, elles
formeront un globule beaucoup plus rond que celui
qui fera forme par les groffes gouttes, comme on
pourroit le démontrer plus au long, & comme l’expérience
le confit me. Il eft à remarqner que tous ces
phénomènes s’obfervent également dans l’air & dans
le vuide. Muffch.
On peut s’affûrer encore de la force avec laquelle
les particules d’eau battirent, en prenant une pniole,
dont le Cou foit fort étroit, 8c n’ait pas plus de deux
lignes de diamètre,& en renverfant cette phiole,
après l’avoir remplie d’eau : car on remarquera alors
qu’il n’en fort pas une feule goutte.
Comme dans une goutte d’eau , les parties qui
s’attirent réciproquement ne reftent pas en repos
avant que d’avoir formé une petite boule, de même
auffi deux gouttes d’éau fituées l’une proche de l’aut
re , & légèrement attirées par la furface fur laquelle
elles fe trouvent, fe précipiteront l’une vers l’autre
par leur attraction mutuelle ; & dans Yinftant même
de leur premier conta#, elles fe réuniront & formeront
une boule, comme on l’obferve en effet ; la même
chofe arrive à.deux gouttes de mercure.
Lorfqu’on verfe enfemble les parties de divers liquides
, elles s’attirent mutuellement ; celles qui fe
touchent alors, tiennent l’une à l’autre par la force
avec laquelle elles agiffent ; c’eft pourquoi les liquides
pourront en ce cas fe changer en un corps folide,
qui fera d’autant plus dur, que Y attraction aura été
plus forte ; ainfi ces liquides fe coaguleront. Muffch.
Lorfqu’on a fait diffoudre des parties de fel dans
‘fine grande quantité d’eau , elles font attirées par
l’eau avec plus de force qu’elles ne peuvent s’attirer
mutuellement -, 8c elles reftent féparées affez loin les
unes des autres : mais lorfqu’on fait évaporer une
grande quantité de cette même eau, foit par la chaleur
du foleil, foit par celle du feu , foit par le moyen
du vent, il s’élève fur la furface de l’eau une pellicule
fort mince, formée par les particules de fel qui
fe tiennent en haut, & dont l’eau s’eft évaporée.
Cette pellicule, qui n’eft compofée que des parties
de fe l, peut alors attirer & féparer de l’eau qui eft
àu-deffous, différentes particules falines, avec plus
de force que ne-pouvoit faire auparavant cette même
eau déjà diminuée de volume ; car par l’évaporation
d’une grande quantité d’eau, le s parties fa lin e s
fe rapprochent davantage , & s’uniffent beaucoup
plus qu’auparavant ; & l’eau fe trouvant en moindre
quantité , elle a auffi moins de force pour pouvoir
agir fur les parties falines qui font alors attirées en-
haut vers la pellicule de fel à laquelle elles fe joignent.
Cette petite peau devient par conféquent plus
epaiffe & plus pefante que le liquide qui eft au-def-
fous, puifque la pefanteur fpécifique des parties falines.
eft beaucoup plus grande que celle de l’eau ;
ainfi dès qué cette peau eft devenue fort pefante,
«lie fe brile en pièces ; ces morceaux tombent au
fond, & continuent d’attirer d’autres parties falines ;
d’où il arrive qu’augmentant encore de volume , ils
fe forment en groffes maffes de différentes grandeurs
appellées cryftaux. Muffch.
L’a ir , quoiqu’il doive furnager tous les liquides
que nous connoiffons, & qui font beaucoup moins
pefans que lu i, ne laiffe pas d’en être attiré, 8c de fe
mêler avec eux; 8c M. Petit a fait voir par plufieurs
expériences, de quelle maniéré il eft adhérent aux
corps fluides, & fe colle, pour ainfi dire, aux corps
folides. Mém. Acad. 1731.
Les effervefcences qui arrivent lorfqu’on mêle enfemble
différens liquides, nous donnent un exemple
remarquable de ces fortes à-attractions entre lespeti- fome /,
tes parties des corps fluides ; on en verra ci-deffouS
une explicatiou un peu plus détaillée.
Il n’eft pas non plus fort difficile de prouver que
les liquides font attirés par les corps folides. En effet,
qu on verfe de 1 eau dans un verre bien net, on remarquera
qu’elle eft attirée fur les côtés contre lesquels
elle monte & auxquels elle s’attache, de forte
que la furface de la liqueur eft plus baffe au milieu
que celle qui touche les parois du verre, & qui devient
concave : au contraire, lorfqu’on verfe du mer-
çuredans un verre, fa furface devient convexe étant
plus haute au milieu que proche les parois du verre ;
ce qui vient de ce que les parties du mercure s’attil
rent réciproquement avec plus de force, qu’elles ne
font attirées par le verre.
Si on prend un corps folide bien net, 8c qui ne foit
pas gras, & qu’on le plonge dans un liquide, & qu’en*
fuite on le leve fort doucement & qu’on l’en retire
la liqueur y reftera attachée, même quelquefois à
une hauteur affez confidérable ; enforte qu’il refte
entre le corps & la furface du liquide, une petite
colonne qui y demeure fufpendue ; cette colonne fe
détache 8c retombe lorfqu’on a élevé le corps affe«
haut, pour que la pefanteur de la colonne l’emporte
fur la force attractive. Muffch.
La force avec laquelle le verre attire les fluides
fe manifefte principalement dans les expériences fut
les tuyaux capillaires. Foy. T u y a u x c a p i l l a ir e s .
Il y a. une infinité d’autres expériences qui confta-
tent l’exiftence de ce principe d’attraction entre les
particules des corps. Foye%_ les articles Se l , M e n s t
r u é , &c.
Toutes cës a#ions en vertu defqüelles les particules
des corps tendent les unes vers les autres, font
appellées en général par Newton du nom indéfini
à’attraction, qui eft également applicable à toutes
les aétiôns par lefquelles les corps fenfibles agiffent
les üns fur les autres, foit par impulfion, ou par
quelque autre force moins connue : 8c par-là cet au*
teur explique une infinité de phénomènes, qui fêl
e n t inexplicables par le feul principe de la gravité
: tels font la cohéfion, la diffolution, la coagulation,
la cryftallifation, l’afeenfion des fluides dans
les tuyaux capillaires, les fecrétions animales, U
fluidité, la fixité, la fermentation, &c. Foyeç les ar-
ric/esC o h é s io n , D i s s o l u t io n , C o a g u l a t io n
CRYSTALLIS ATION , ASCENSION , S1 C R É T I O N*
Fe r m e n t a t io n , ^ . .
« En admettant ce principe, ajoûte cet illuftre
» auteur, on trouvera que la nature eft par-tout con-
» forme à elle-meme, & très-fimple dans fes opéra-
» tions ; qu’elle produit tous les grands mouvemens
» des corps céleftes par Y attraction de la gravité qui
» agit fur les corps, 8c prefque tous les petits mou-
» vemens de leurs parties , par le moyen de quel-
» qu’autre puiffance attractive répandue dans ces par-
» lies. Sans ce principe il n’y auroit point de mou-
» vement dans le monde ; & fans la, continuation de
» l’a#ion d’une parçille caufe, le mouvement péri-
» roit peu-à-peu, puifqu’il devfoit continuellement
» décroître & diminuer, fi ces puiffances aétives n’eti
» reproduifoient fans ceffe de nouveaux ». Optique,
Page3 7 3 i
Il eft facile de juger après cela combien font in-
juftes ceux des philofophes modernes qui fe déclarent
hautement coqtre le principe de l’attraction, fans
en apporter d’autre raifon, fin on qu’ils ne conçoivent
pas comment un corps peut agir fur un autre
qui en eft éloigné. Il eft certain que dans un grand
nombre de phenomenes, les philofophes ne recon-
noiffent point d’autre aftion, que celle qui eft produite
par l’impulfion & le conta# immédiat : mais
nous voyons dans la nature plufieurs effets, fans y
remarquer d’impulfion: fouyent même nous fommes