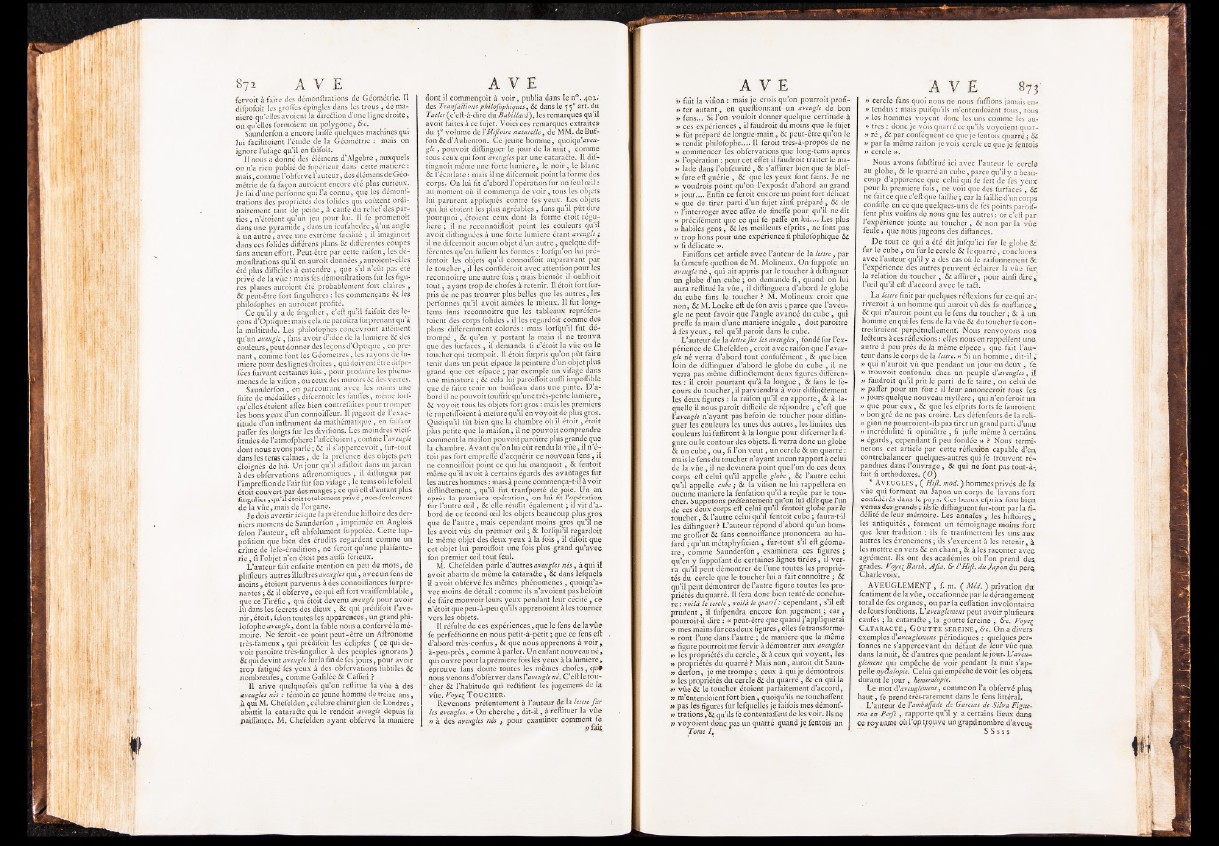
fervoit à faire des demonftrations de Geométne. Il
difpofôit les groffes épingles dans les trous , de maniéré
qu’elles avoient la direction d’une ligne droite,
ou qu’elles formoient un polygone, &c.
Saunderfon a encore laiffe quelques machines qui
lui facilitoient l’étude de la Géométrie ; mais on
ignore l’ufage qu’il en faifoit.
Il nous a donné des élémens d’Algèbre , auxquels
on n’a rien publié de fuperieur dans cette matière :
mais, comme l’obferve l’auteur, des elemens de Géométrie
de fa façon auroient encore été plus curieux.
Je fai d’une perfonne qui l’a connu, que les démonstrations
des propriétés des folides qui coûtent ordinairement
tant de peine, à caufe du relief des parties
, n’étoient qu’un jeu pour lui. Il fe promenoit
dans une pyramide, dans un icofahedre, d’un angle
à un autre, avec une extrême facilité ; il imaginoit
dans ces folides différens plans & différentes coupes
fans aucun effort. Peut-être par cette raifon, les dé-
monftrations qu’il en auroit données, auroient-elles
été plus difficiles à entendre , que s’il n’eût pas été
privé de la vue : mais fes démonftrations fur les figures
planes auroient été probablement fort claires ,
& peut-être fort fingulieres les commençans Sc les
philofophes en auroient profité.
Ce qu’il y a de fmgulier, c’eft qu’il faifoit des leçons
d’Optique : mais cela ne paroîtra furprenant qu’à
la multitude. Les philofophes concevront aifément
qu’un aveugle , fans avoir d’idée de la lumière & des
couleurs, peut donner des leçons d’Optique , en prenant
, comme font les Géomètres, les rayons de lumière
pour des lignes droites, qui doivent être difpc-
fées fuivant certaines lois , pour produire les phénomènes
de la vifion, ou ceux des miroirs & des verres.
Saunderfon , en parcourant avec les mains une
fuite de médailles, difeernoit les fauffes, même lorf-
qu’elles étoient affez bien contrefaites pour tromper
les bons yeux d’un connoiffeur. Il jugeoit de l’exactitude
d’un infiniment de mathématique , en faifant
paffer fes doigts fur les divifions. Les moindres vicif-
fitudes de l’atmofpherel’affeaoient, comme Y aveugle
dont nous avons parlé ; & il s’appercevoit, fur-tout
dans les tems calmes, de la préfence des objets peu
éloignés de lui. Un jour qu’il afliftoit dans un jardin
à des obfervations aflronomiques , il diflingua par
l’impreffion de l’air fur fon vifage, le tems oiile foleil
étoit couvert par des nuages ; ce qui eft d’autant plus
fmgulier, qu’il étoit totalement privé, non-feulement
de la vûe, mais de l’organe. _
Je dois avertir ici que la prétendue hifloire des derniers
momens de Saunderfon , imprimée en Anglois
félon l’auteur, eft abfolument fuppofée. Cette iùp-
pofition que bien des érudits regardent comme un
crime de lefe-érudition, ne feroit qu’une plaifante-
rie, fi l’objet n’en étoit pas aufîi férieux.
L’auteur fait enfuite mention en peu de mots, de
plufieurs autres illuftres aveugles qui, avec un fens de
moins , étoient parvenus à des connoiffances furpre-
nantes ; & il obferve, ce qui eft fort vraiffemblable,
que ce Tiréfiê , qui étoit devenu aveugle pour avoir
lu dans les fecrets des dieux , & qui prédifoit l’avenir
, étoit, félon toutes les apparences, un grand phi-
lofophe aveugle, dont la fable nous a confervé la mémoire.
Ne feroit-ce point peut-être un Aftronome
très-fameux, qui prédifoit les éclipfes ( ce qui de-
voit paroître très-fingulier à des peuples ignorans )
& qui devint aveugle fur la fin de fes jours, pour avoir
trop fatigué fes yeux à des obfervations fubtiles &
nombreufes, comme Galilée & Caffini ?
Il arive quelquefois qu’on reftitue la vûe à des
aveugles nés : témoin ce jeune homme de treize ans,
à qui M. Chefelden, célébré chirurgien de Londres ,
abattit la cataraâe qui le rendoit aveugle depuis fa
jiaiffance. M. Chefelden ayant obfcrvé la maniéré
dont il commençoit à voir, publia dans le n°. 401.'
des Tranfactionsphilofophiquts, & dans le 5 5e art. du
Tatler (c’eft-à-dire du Babillard'), les remarques qu’il
avoit faites à ce fujet. Voici ces remarques extraites
du 3® volume de YHifioire naturelle, de MM. de Buf-
fon & d’Aubenton. Ce jeune homme, quoiqu’«ve«-
gle , pouvoit diftinguer le jour de la nuit, comme
tous ceux qui font aveugles par une cataraôe. Il dif-
tinguoit même une forte lumière, le noir, le blanc
&c l’écarlate : mais il ne difeernoit point la forme des
corps. On lui fit d’abord l ’opération fur un feul oeil :
au moment où il commença de vo ir , tous les objets
lui parurent appliqués contre fes yeux. Les objets
qui lui étoient les plus agréables , fans qu’il pût dire
pourquoi, étoient ceux dont la forme étoit régulière
; il ne reconnoiffoit point les couleurs qu’il
avoit diftinguées à une forte lumière étant aveugle ;
il ne difeernoit aucun objet d’un autre, quelque différentes
qu’en fuffent les formes : lorfqu’on lui pré-
fentoit les objets qu’il connoifToit auparavant par
le toucher, il les confidéroit avec attention pour les
reconnoître une autre fois ; mais bientôt il oublioit
tout, ayant trop de chofes à retenir. Il étoit fort fur-
pris de ne pas trouver plus belles que les autres, les
perfonnes qu’il avoit aimées le mieux. Il fut long-
tems fans reconnoître que les tableaux repréfen-
toient des corps folides , il les regardoit comme des
plans différemment colorés : mais lorfqu’il fut détrompé
, & qu’en v portant la main il ne trouva
que des furfaces , il demanda fi c’étoit la vûe ou le
toucher qui trompoit. 11 étoit furpris qu’on put faire
tenir dans un petit efpace la peinture d’un objet plus
grand que cet efpace ; par exemple un vifage dans
une miniature ; & cela lui paroiffoit auffi impoffible
que de faire tenir un boiffeau dans une pinte. D ’abord
il ne pouvoit louffrir qu’une très-petite lumière ,
& voyoit tous les objets fort gros : mais les premiers
fe rapetifloient à mefure qu’il en voyoit de plus gros.
Quoiqu’il fût bien que la chambre où il étoit, étoit
plus petite que la maifon, il ne pouvoit comprendre
comment la maifon pouvoit paroître plus grande que
la chambre. Avant qu’on lui eût rendu la vûe, il n’e-
toit pas fort empreffé d’acquérir ce nouveau fens, il
ne connoiffoit point ce qui lui manquoit, & fentoit
même qu’il avoit à certains égards des avantages fur
les autres hommes : mais à peine commença-t-il à voir
diftinftement , qu’il fut tranfporté de joie. Un an
après la première opération, on lui fit l’opération
fur l’autre oe il, Sc elie réuffit également ; il v it d’abord
de ce fécond oeil les objets beaucoup plus gros
que de l’autre, mais cependant moins gros qu’il ne
les avoit vûs du premier oeil ; 8c lorfqu’il regardoit
le même objet des deux yeux à la fois , il difoit que
cet objet lui paroiffoit une fois plus grand qu’avec
fon premier oeil tout feul.
M. Chefelden parle d’autres aveugles nés, à qui il
avoit abattu de même la catara&e, & dans lefquels
il avoit obfervé les mêmes phénomènes, quoiqu’a-
vec moins de détail : comme ils n’avoient pas befoin
de faire mouvoir leurs yeux pendant leur cécité, cô
n’étoit que peu-à-peu qu’ils apprenoient à les tourner
Vers les objets.
Il réfulte de ces expériences, que le fens de la vûe
fe perfectionne en nous petit-à-petit ; que ce fens eft
d’abord très-confus, 8c que nous apprenons à voir ,
à-peu-près, comme à parler. Un enfant nouveau né ,
qui ouvre pour la première fois lès yeux à la lumière ,
éprouvé fans doute toutes les mêmes chofes, qu#
nous venons d’obferver àansYaveugle né. C ’eft le tou-
• cher & l’habitude qui rectifient les jugemens de la
vûe. Poye^ T o u c h e r .
Revenons préfentement à l’auteur dé la lettre fur
les aveugles. « On cherche , dit-il, à reftituer la vue
» à des aveugles nés } pour examiner comment fe
p f a i t
h fait la vifion : mais je crois qu’on poùrroit profî-
» ter autant, en queftionnant un aveugle de bon
» fens... Si l’on vouloit donner quelque certitude à
» ces expériences , il faudroit du moins que le fujet
» fût préparé de longue-main, & peut-être qu’on le
» rendît philofophe.... Il feroit très-à-propos de ne
» commencer les obfervations que long-tems après
» l’opération : pour cet effet il faudroit traiter le ma-
v lade dans l’obfcurité, 8c s’affûrer bien que fa blef-
» fure eft guérie , & que les yeux font fains. Je ne
» voudrais point qu’on l’exposât d’abord au grand
» jour.... Enfin ce feroit encore un point fort délicat
» que de tirer parti d’un fujet ainfi préparé , & de
» l’interroger avec affez de fineffe pour qu’il ne dît
» précifément que ce qui fe paffe en lui.... Les plus
» habiles gens, & les meilleurs efprits, ne font pas
» trop bons pour une expérience fi philofophique &c
» fi délicate ».
Finiffons cet article avec l’auteur de la lettre, par
lafameufe queftion de M. Molineux. On fuppofe un
aveugle n i , qui ait appris par le toucher à diftinguer
un globe d’un cube ; on demande f i, quand on lui
aura reftitué la v û e , il diftinguera d’abord le globe
du cube fans le toucher ? M. Molineux croit que
non, & M. Locke eft de fon avis ; parce que l’aveugle
ne peut favoir que l’angle avancé du cube , qui
preffe fa main d’une maniéré inégale , doit paroître
à fes y e u x , tel qu’il paroît dans le cube.
L ’auteur de la-lettre fur les aveugles, fondé fur l’expérience
de Chefelden, croit avec raifon que Y aveugle
né verra d’abord tout confùfément, & que bien
loin de diftinguer d’abord le globe du cube , il ne
verra pas même diftinftement deux figures différentes
: il croit pourtant qu’à la longue , & fans le fe-
cours du toucher, il parviendra à voir diftinélement
les deux figures : la raifon qu’il en apporte, 8c à laquelle
il nous paroît difficile de répondre , c’eft que
Y aveugle n’ayant pas befoin de toucher pour diftinguer
les couleurs les unes des autres, les limites des
couleurs lui fuffiront à ladongue pour difeerner la figure
ou le contour des objets. Il verra donc un globe
& un cube, ou, fi l’on v eu t, un cercle 8c un quarré :
mais le fens du toucher n’ayant aucun rapport à celui
de la v û e , il ne devinera point que l’un de ces deux
corps eft celui qu’il appelle globe , & l’autre celui
qu’il appelle cube ; & la vifion ne lui rappellera en
aucune maniéré la fenfation qu’il a reçûe par le toucher.
Suppofons préfentement qu’on lui dife que l’un
de ces deux corps eft celui qu’il fentoit globe par le
toucher, & l’autre celui qu’il fentoit cube ; faura-t-il
les diftinguer ? L’auteur répond d’abord qu’un homme
grofîier & fans connoiffance prononcera au ha-
fard ; qu’un métaphyficien , fur-tout s’il eft géomètre
, comme Saunderfon, examinera ces figures ;
qu’en y fuppofant de certaines lignes tirées, il verra
qu’il peut démontrer de l’une toutes les propriétés
du cercle que le toucher lui a fait connoître ; &
qu’il peut démontrer de l’autre figure toutes les propriétés
du quarré. II fera donc bien tenté de conclur-
re : voilà le cercle, voilà le quarré : cependant, s’il eft
prudent, il fufpendra encore fon jugement ; car ,
pourroit-il dire : « peut-être que quand j’appliquerai
» mes mains fur ces deux figures, elles fe transforme-
» ront l’une dans l’autre ; de maniéré que la même
à> figure poùrroit me fervir à démontrer aux aveugles
»> les propriétés du cercle, & à ceux qui voyent, les
» propriétés du quarré ? Mais non, auroit dit Saun-
» derfon, je me trompe ; ceux à qui je démontrois
» les propriétés du cercle & du quarré , &c en qui la
*> vûe & le toucher étoient parfaitement d’accord,
» m’entendoient fort bien, quoiqu’ils ne touchaffent
» pas les figures fur lefquelles je faifois mes démonf-
» trations, 8c qu’ils fe contentaffent de les voir. Ils ne
t> voyoient donc pas un quarré quand je fentois un
Tome /,
>> cercle fans quoi nous ne nous fulîîorts jamais en-
» tendus : mais puifqu’ils m’entendoient tous, tous
» les hommes voyent donc les uns comme les au-
»> très : donc je vois quarré ce qu’ils voyoient quar-
» r é , & par conféquent ce que je fentois quarré ;
» par la même raifon je vois cercle ce que je fentois
» cercle ».
Nous avons fubftitué ici avec l’aüteur le cercle
au globe, & le quarré au cube, parce qu’il y a beaucoup
d’apparence que celui qui fe fert de fes yeux:
pour la première fois, ne voit que des furfaces , &
ne fait ce que c’eft que faillie ; car la faillie d’un corps
confifte en ce que quelques-uns de fes points paroif-
fent plus voifins de nous que les autres: or c’eft par
l’expérience jointe au toucher , & non par la vûe
feule, que nous jugeons des diftances.
De tout ce qui a été dit jufqu’ici fur le globe 8c
fur le cube, ou fur le cercle & le quarré, concluons
avec l’auteur qu’il y a des cas où le raifonnement 8c
l’expérience des autres peuvent éclairer la vûè -ftjr.
la relation du toucher , & affûrer, pour ainfi dire ,
l’oeil qu’il eft d’accord avec le taél.
La lettre finit par quelques réflexions fur ce qui aN
riveroit à un homme qui auroit vû dès fa naiflance,1
& qui n’auroit point eu le fens du toucher ; 8c à un
homme en qui les fens de la vûe Sc du toucher fe con-
trediroient perpétuellement; Nous renvoyons nos
leéleurs à ces réflexions : elles nous en rappellent une
autre à peu près de la même efpece, que fait l’au-'
teur dans le corps de la lettre. « Si un homme, dit-il ;
» qui n’auroit vû que pendant un jour ou deux , fe
» trouvoit confondu chez un peuple à?aveugles, il
» faudroit qu’il prît le parti de fe taire, ou celui de
» paffer pour un fou : il leur annoncerait tous les
» jours quelque nouveau myftere, qui n’en feroit un
» que pour eux, & que les efprits forts fe fauroient
» bon gré de ne pas croire. Les défenfeurs de la reli-
» gion ne pourroient-ils pas tirer un grand parti d’une
» incrédulité fi opiniâtre , fi jufte même à certains
» égards, cependant fi peu fondée » ? Nous terminerons
cet article par cette réflexion capable d’en,
contrebalancer quelques-autres qui fe trouvent répandues
dans l’ouvrage, 8c qui ne font pas tout-à-
fait fi orthodoxes. (O)
* A veugles , ( Hiß. mod. ) hommes privés de la'
vûe qui forment au Japon un corps de favans fort
confidérés dans le pays. Ces beaux efprits font bien
venus des grands ; ils fe diftinguent fur-tout par la fidélité
de leur mémoire. Les annales , les hiftoires
les antiquités, forment un témoignage moins fort
que leur tradition : ils fe tranfmettent les uns aux
autres les évenemens ; ils s’exercent à les retenir, à
les mettre envers & en chant, 8c à les raconter avec
agrément. Ils ont des académies où l’on prend des
grades. Voye^Barth. Afia. 6* T Hiß. du Japonàn perç
Charlevoix.
AVEUGLEMENT , f. m. f Méd. ) privation dut'
fentiment de la vûe, occafionnee par le dérangement
total de fes organes, ou par la ceffation involontaire
de leurs fonctions. Uaveuglement peut avoir plufieurs
caufes ; la catara&e , la goutte fereinc , &c. Voye.£
C a t a r a c t e , G o u t t e s e r e in e , &c. On a divers
exemples d’aveuglernens périodiques : quelques perfonnes
ne s’appercevant du défaut de leur vûe que
dans la nuit, & d’autres que pendant le jour. L ’ave«-,
glement qui empêche de voir pendant la nuit s’appelle
nyaalopie. Celui qui empêche devoir les objets
durant le jour , héméralopie.
Le mot à?aveuglement, comme on l’a obfervé plu$
haut, fe prend très-rarement dans le fens littéral.
L’auteur de Yambaffade de Gardas de Silva Figue-
roa en Perfe , rapporte qu’il y a certains lieux dans
ce royaiune oùl’ontrouve ungrandnombre d’ayeu^
S S s s s