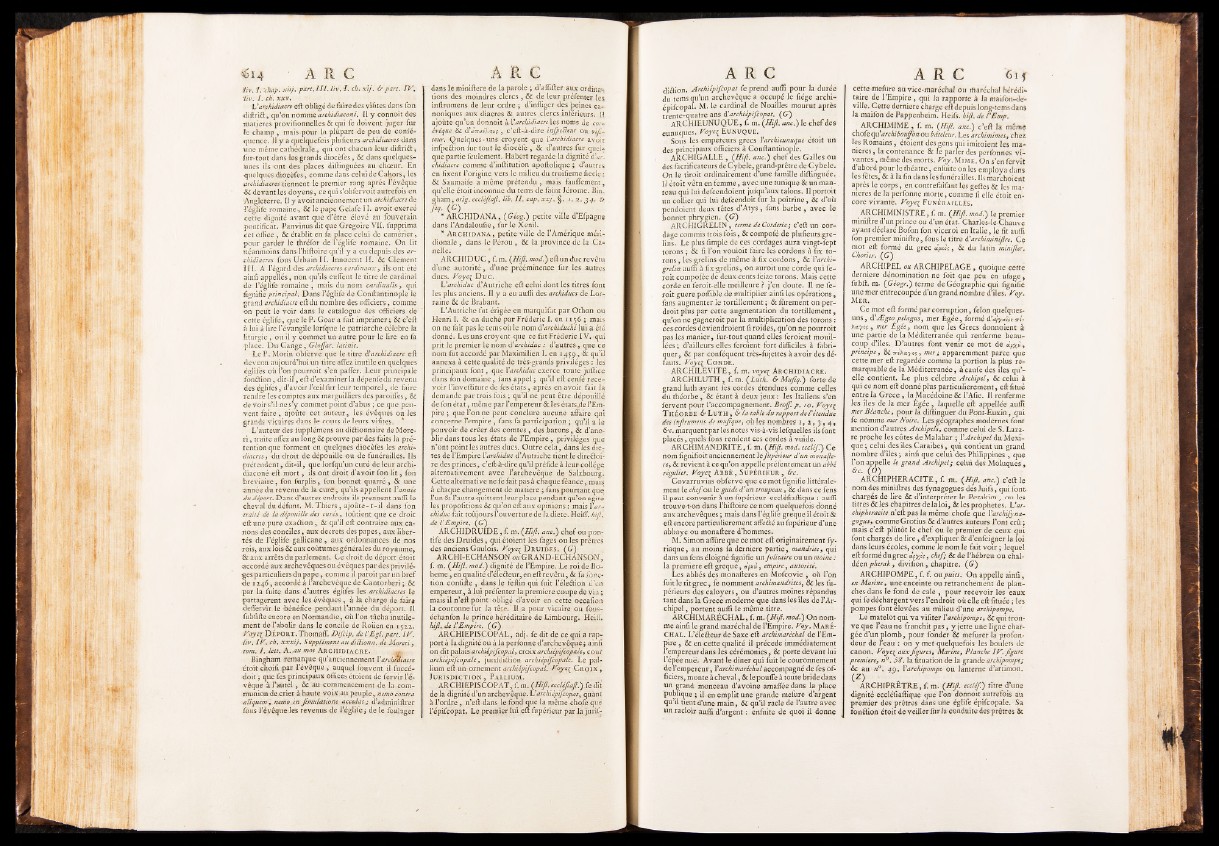
€i4 à R G
Ÿiv. I . 'thdp. x i i j . part. I I I . liv . I . ch. x i j . & p art. I V .
i iv . I . ch. x x v .
U archidiacre eft obligé de faire des vifites dans fon
diftrift, qu’on nomme archidiaconé. Il y connoît des
matières provifionnelles & qui fe doivent juger fur
le champ , mais pour la plupart de peu <le conséquence.
Il y a quelquefois plufieurs archidiacres dans
Une même cathédrale, qui ont chacun leur diftriô,
fur-tout dans les grands diocèfes, & dans quelques-
unes ils ont des places diftinguées au choeur. En
quelques diocèfes, comme dans celui de Ca-hors, les
archidiacres tiennent le premier rang après l’évêque
& devant les doyens, ce qui s’obfervoit autrefois en
Angleterre. Il y avoit anciennement un archidiacre de
l ’églife romaine, & le pape Gelafe II. avoit exercé
cette dignité avant que d’être élevé au fouverain
pontificat. Panvinus dit que Grégoire VII. Supprima
cet office -, & établit en fa place celui de camérier,
pour garder le thréfor de ‘l’églife romaine. On lit
néanmoins dans l’hiftoire qu’il y a eu depuis.des <zr-
thidiacres fous Urbain 11. Innocent II. & Glement
III. A l’égard des archidiacres cardinaux, ils ont été
ainfi appellés, non qu’ils euffent le titre de cardinal
de l’églife romaine , mais du nom ca rd in a lis, qui
Signifie prin cip a l. Dans l’églife de Conftantinople le
grand archidiacre eft du nombre des officiers, comme
on petit le voir dans le catalogue des officiers de
cette églife, que le P. Goar a fait imprimer ; & c’eft
à lui à lire l’évangile lorfque le patriarche célébré la
liturgie , ou il y commet un autre pour le lire en fa
place. Du Gange ; Gloffar. latinit.
Le P. Morin obferve que le titre d’archidiacre eft
devenu aujourd’hui un titre affez inutile en quelques
églifés oit l’on pourroit s’enpaffer. Leur principale
fonction, dit-il, eft d’examiner la dépenfe du revenu
des églifes, d’avoir l’oeil fur leur temporel, de faire
rendre les comptes aux marguilliers des paroiffes, &
de voir s’il ne s’y commet point d’abus ; ce que peuvent
faire, ajôûte cet auteur, les évêques ou les
grands vicaires dans le cours de leurs vifites. *
L’auteur des fiipplémens au di&ionnaire de More-
r i , traite affez au long & prouve par des faits la prétention
que forment en quelques diocèfes les archi-
diacres, du droit de dépouille ou de funérailles. Ils
prétendent, dit-il, que lorfqu’un curé de leur archidiaconé
eft mort, ils ont droit d’avoir fon li t , fon
bréviaire, fon furplis, fon bonnet quarré , & une
année du revenu de la cure, qu’ils appellent Vannée
du déport. Dans d’autres endroits ils prennent aufli le
cheval du défunt* M.Thiers , ajoute-t-il dans fon
traité de la dépouille des curés, lburient que ce droit
eft une pure exaâion, & qu’il eft contraire aux canons
des conciles, aux decrets des papes, aux libertés
de l’églife gallicane , aux ordonnances de nos
rois, aux lois & aux coûtumes générales du royaume,
& aux arrêts du parlement. Ce droit de déport étoit
accordé aux archevêques ou.évêques par des privilèges
particuliers du pape, comme il paroît par un bref
de 1246 , accordé à l’archevêque de Cantorberi ; &
par la fuite dans d’autres églifes les archidiacres le
partagèrent avec les évêques , à la charge de faire
deflervir le 'bénéfice pendant l’année du déport. Il
fubfifte encore en Normandie, où l’on tâcha inutilement
de l’abolir dans le concile de Rouen en 1522.
V o y e çD é p o r t . Thomafl. D ifc ip . de l 'E g l .p a r t . I V .
liv . I V . ch . x x x i j , Supplément au dictionn. de Moreri ,
tom. I . le tt. A ..a u mot A r c h i d i a c r e . .
Bingham -remarque qu’anciennement YarchMiacre
étoit choifi par l’évêque , auquel fouvent jl fuccé-
doit ; que fes principaux offices étoient de fervir l’évêque
à l’autel , & au commencement défia-communion
de.crier à haute voix au;peuple, nemo contra
aliquejjit .nemo,iri Jimulatione- accedat - d’adminiftrer
fous l’évêque les revenus de l’églife ; de le foulager
A R C
dans le miniftere de la parole ; d’afîifter aux ordinal
tions des moindres clercs , & de leur préfenter le$
inftrumens de leur ordre ; d’infliger des peines canoniques
aux diacres & autres clercs inférieurs. Il
ajoute qu’on donnoit à l'archidiacre les noms de cor-h
évêque 6c d?<*W4 i%»c, c ’eft-.à-dire infpecleur ou vifi~
teur. Quelques-uns croyent que 1?archidiacre avoir
infpeûion fur tout le diocèfe , & d’autres fur quel*
que partie feulement. Habert regarde la dignité ^archidiacre
comme d’inftitution apoftolique ; d’autres
en fixent l ’origine vers le milieu du troifieme fiecle i
& Saumaife a même prétendu, mais fauffement,
qu’elle étoit inconnue du tems de faint Jérome. Bingham
yorig. ecclèfiafi. lib. II. cap. x x j . §. /. z. gq. &
feq. (G)
* ÀRCHIDANA, {Géog.) petite ville d’Efpàgna
dans l’Andaloufie, fur le Xenih
* A r c h id a n a , petite ville de.^Amérique, méridionale
, dans le Pérou, & la province de la Ca-
nelle.
ARCHIDUC, f. m. (Hiß. mod.) eft un duc revêtu
d’une autorité, d’une prééminence fur les.autres
ducs. Voyc{ Duc*
Warchiduc d’Autriche eft celui dont les titres font
les plus anciens. Il y à eu aufli des archiducs de Lorraine
& de Brabant.
L’Autriche fut érigée en marquifat par Othon ou
Henri I. & en duché par Frédéric I. en 1 1 56 ; mais
on ne fait pas le tems où le nom d'archiduchè lui a été
donné. Les uns croyent que ce fut Frédéric IV . •qui
prit le premier le nom d’archiduc : d’autres, que ce
nom fut accordé par Maximilien 1. en 1459, & qu’il
annexa à cette qualité de très-grands privilèges : les
principaux font, que. Varchiduc exerce toute juftice
dans fon domaine, fans appel ; qu’il eft cenfé recevoir
l’inveftiture de fes états, après en avoir fait la
demande par trois fois ; qu’il ne peut être dépouille
de fon état, même par l’empereur & les états/le l’Empire
; que l’on ne peut conclure aucune affaire qui
concerne l’empire, fans fa participation ; qu’il a le
pouvoir de créer des comtes, des barons, & d’anoblir
dans tous les états de l’Empire, privilèges que
n’ônt point les autres ducs. Outre cela, dans les diej
tes de l’Empire Varchiduc d’Autriche tient le directoire
des princes, c’eft-à-dire qu’il préfide à leur collège
alternativement avec l’archevêque de Salzbourg.
Cette alternative ne fe fait pas à chaque féance, mais
à chaque changement de matière ; fans pourtant que
l’un & l’autre quittent leur place pendant qu’on agite
les propofitions & qu’on eft aux opinions : mais Yar~
chiduc fait toûjours l’ouverture de la diete. Heiff. hiß.
de VEmpire. (6 )
ÀRCHIDRUIDE, f. m. {Hiß. anc.) chef ou pon:
tife des Druides, qui étoient les fages ou les prêtres
des anciens Gaulois. Voye^ D r u i 6.e s . (G)
ARCHI-ECHANSON ou GR AND-ECHANSON,
f. m. {Hiß. mod.) dignité de l’Empire. Le roi de Boheme
, en qualité d’éleéteur, en eft revêtu, & fa fonction
conflue , dans le feftin qui fuit FéleCHoh d’en
empereur, à lui préfenter la première coupe de vin ;
mais il n’eft point • obligé d?avoir en cette occafion
la couronne fur la tête. Il a pour vicaire ou fous-
échanfon le prince héréditaire de Limbourg. Heiff.
hiß., de VEmpire, (G)
ARCHIEPISCOPAL, adj. fe dit de ce qui a rapport
à la dignité ou à la perfonne d’archevêque ; ainfi
on dit palais archiépifcopal, croix archièpifcopale, cour
archiépifcopale, jurildiCiion archièpif copale. Le pallium
eft un-ornement archièpif copal. Voye£ C r o ix ,
Ju r i s d i c t io n , Pa l l iu m .
ARCHIEPISCOPAT, f. m. {Hfi. ecclèfiafi f fe dit
de la dignité d’un archevêque. L’archiépfcopatt quant
à l’ordre, n’eft dans le fond que la même chofe que
l’épifcopat. Le premier lui eft fupérieur par la.jurif-
A R C
diétion. Archièpif copat fe prend aufli pour la durée
du tems qu’un archevêque a occupé le fiége archi-
épifcopal. M. le cardinal de Noailles mourut après
trente-quatre ans d’archiépifcopat. (G)
ARCHIEUNUQUE, f. m. {Hifi. anc.) le chef des
eunuques. Voye^ Eunuque. ^
Sous les empereurs grecs Yarchicunuque étoit un
des principaux officiers à Conftantinople.
ARCHIGALLE , {Hifi. anc.) çhef des Galles ou
des facrificateurs deCybele, grand-prêtre de Cybele.
On le tiroit ordinairement d’une famille diftinguée.
Il étoit vêtu en femme, avec une tunique & un man-.
teau qui lui defeendoient jufqu’aux talons. Il portoit
un collier qui lui defeendoit fur la poitrine, & d’où
pendoient deux têtes d’A ty s , fans barbe, avec le
bonnet phrygien. (G)
ARCHIGRELIN, terme deCorderie; c’eft un cordage
commis trois fois, & compofé de plufieurs.gre-
lins- Le plus Ample de ces cordages aura vingt-fept
torons ; & fi l’on vouloit faire les cordons à fix torons
, les grelins de même à flx cordons, & l'archi-
grelin aufli à flx grelins-, on auroit une corde qui fe-
roit compofée de deux cents feize torons. Mais cette
corde en feroit-elle meilleure ? j’en doute. Il ne fe-
roit guere poflible de multiplier ainfi les opérations,
fans augmenter le tortillement ; & fûrement on per-
droit plus par cette augmentation du tortillement,
qu’on ne gagneroit par la multiplication des torons :
ces cordes deviendroient fi roides, qu’on ne pourroit
pas les manier, fur-tout quand elles feroient mouillées
; d’ailleurs elles feroient fort difficiles à fabriquer
, & par conféquent très-fujettes à avoir des défauts.
Voye1 C orde.
ARCHILEVITE, f. m. voye% Archidiacre.
ARCHILUTH , f. m. {Luth. & Mufiq.) forte de
grand luth ayant fes cordes étendues comme celles
du théorbe, & étant à deux jeux : les Italiens s’en
fervent pour l’accompagnement. Brojf. p. 10. Voye[
T héorbe G Luth, & la table du rapport de l'étendue
des infirumens. de mufique, où les nombres 1, 2, 3 ,4 ,
&c. marquent par les notes vis-à-vis lefquelles ils font
placés, quels fons rendent ces cordes à vuide.
ARCHIMANDRITE, f. m. {Hifi. mod. eccléf.) Ce
nom fignifïoit anciennement le fupérieur d'un monafle-
ref & revient à ce qu’on appelle préfentement un abbé
régulier. Voye{ Abbé, Supérieur , &c.
Covarruvias obferve que ce mot fignifie littéralement
le chef ou 1 q guide d'un troupeau, & dans Ce fenS
il peut convenir à un fupérieur eccléfiaftique : aufli
trouve-t-on dans l’hiftoire ce nom quelquefois donné
aux archevêques ; mais dans l’églife greque il étoit &
eft encore particulièrement affeaé au fupérieur d’une
abbaye ou monaftere d’hommes.
M. Simon affûre que ce mot eft originairement fy-
riaque, au moins faderniere partie,. mandrite, qui
dans un fens éloigné fignifie un Jolitaire ou un moine :
la première eft greque, à pu», empire, autorité.
Les abbés des monafteres en Mofcovie y où l’on
fuit le rit g r e c f e nomment archimandrites, & les fu-
périeurs aescaloyers, ou d’autres moines répandus
tant dans la Grece moderne que dans les îles de l’Archipel
, portent aufli le même titre.
ARCHIMARÉCHA L , f . m. {Hifi. mod.) On nomme
ainfi le grand maréchal de l’Empire. Voy. Maréchal.
L’éieûeur de Saxe eft ârchimaréchal de l’Empire
, & en cette qualité il précédé immédiatement
l’empereur dans les cérémonies, & porte devant lui
l’épée nuë. Avant le dîner qui fuit le couronnement
de l’empereuf, Yarchimaréchal accompagné de fes officiers,
monte à cheval, & le pouffe à toute bride dans
-un grand monceau d’avoine amaffée dans la place
publique ; il en emplit une grande mefure d’argent
qu’il tient d’une main, & qu’il racle de l’autre avec
un radoir aufli d’argent : enfuite de quoi il donne
A R C 6M
cette ttiefüre au vice-maréchal ou maréchal hérédi*
taire de l’Empire , qui la rapporte à la maifon-de-
ville. Cette derniere charge eft depuis long^tems dans
la maifon de Pappenheim. Heifs. hifi. de l'Emp.
ARCHIMIME, f. m. {Hifi. anc.) c’eft la même
chofe q f archi bouffon ou bateleur. Les archimimesf chez
les Romains, étoient des gens qui imitoient les maniérés
, la contenance & le parler des perfonnes vivantes
, même des morts. Voy. Mime. On s’en fervit
d’abord pour le théâtre, enfuite on les employa dans
les fêtes, & à la fin dans les funérailles. Ils marchoient
après le corps, en contrefaifant les geftes & les maniérés
de la perfonne morte, comme fi elle étoit encore
vivantë. Voye{ Funérailles.
ARCHIMINISTRE, f. m. {Hifi. mod,) le premier
miniftre d’un prince ou d’un état. Charles-le-Chauve
ayant déclaré Bofon fon viceroi en Italie, le fit aufli
fon premier miniftre, fous le titre à'archimiûifire. Cç
mot eft formé du grec àpKoç, & du latin minißer,
Chorier. (G)
ARCHIPEL ou ARCHIPELAGE, quoique cette
derniere dénomination ne foit que peu en ufage >
fubft. m. {Géogr.) terme de Géographie qui fignifie
une mer entrecoupée d’un grand nombre d’îles. Voy.
M e r .
Ce mot eft formé par corruption, félon quelques-
uns , d’Ægeo pelagus, mer Égée, formé d’aj-yaTov ni-
hayoç, mer Égée, nom que les Grecs donnoient à
une partie de la Méditerranée qui renferme beaucoup
d’îles. D ’autres font venir ce mot de àpx* ,
principe , & vrlhay oc, mer ; apparemment parce que
cette mer eft regardée comme la portion la plus remarquable
de la Méditerranée, à caufe des îles qu’elle
contient. Le plus célébré Archipel, & celui à
qui ce nom eft donné plus particulièrement, eft fitué
entre la Grece, la Macédoine & l’Afie. Il renferme
les îles de la mer Égée, laquelle eft appellée auflï
mer Blanche, pour la diftinguer du Pont-Euxin, qui
fe nomme mer Noire. Les géographes modernes font
mention d’autres Archipels, comme celui de S. Lazare
proche les côtes de Malabar. ; Y Archipel du Mexique
; celui des îles Caraibes, qui contient un grand
nombre d’îles ; ainfi que celui des Philippines , que
l’on appelle le grand Archipel; celui des Moluques ,
&c. (O)
ARCHIPHERACITE, f. m. {Hifi. anc.) c’eft le
nom des miniftres des fynagogues des Juifs, qui font
chargés de lire & d’interpréter le Perakim , ou les
titres & le s chapitres de la lo i, & les prophètes. L'ar-
chipheracite n’eft pas la même chofe que Yarchifyna-
gogus, comme Grotius & d’autres auteurs l’ont crû ;
mais c’eft plutôt le chef ou le premier de ceux qui
font chargés de lire, d’expliquer & d’enfeigner la loi
dans leurs écoles, comme le nom le fait voir ; lequel
eft formé du grec àpx^ » ch*f; & de l’hébreu ou chal-
déen pherak , divifion, chapitre. (G)
ARCHIPOMPE, f. f. ou puits. On appelle ainfi,
en Marine, une enceinte ou retranchement de planches
dans le fond de cale , pour recevoir les eaux
qui fe déchargent vers l’endroit où elle eft fituée ; les
pompes font élevées au milieu d’une archipompe.
Le matelot qui va vifiter Y archipompe y & qui trouv
e que l’eau ne franchit pas, y jette une ligne chargée
d’un plomb, pour fonder & mefurer la profondeur
de l’eau : on y met quelquefois les boulets de
canon. Voyeç aux figures t Marine, Planche IV. figure
première, n°. 68. la fituation de la grande archipompe;
& au n°. 49-. Y archipompe- ou lanterne d’artimon.
( Z )
ARCHIPRÊTRE, f. m. {Hifi. eccléf.) titre d’une
dignité eccléfiaftique que l’on donnoit autrefois au
premier des prêtres dans une églife épifcopale. Sa
ron&ion étoit de veiller fur la conduite des prêtres ôc