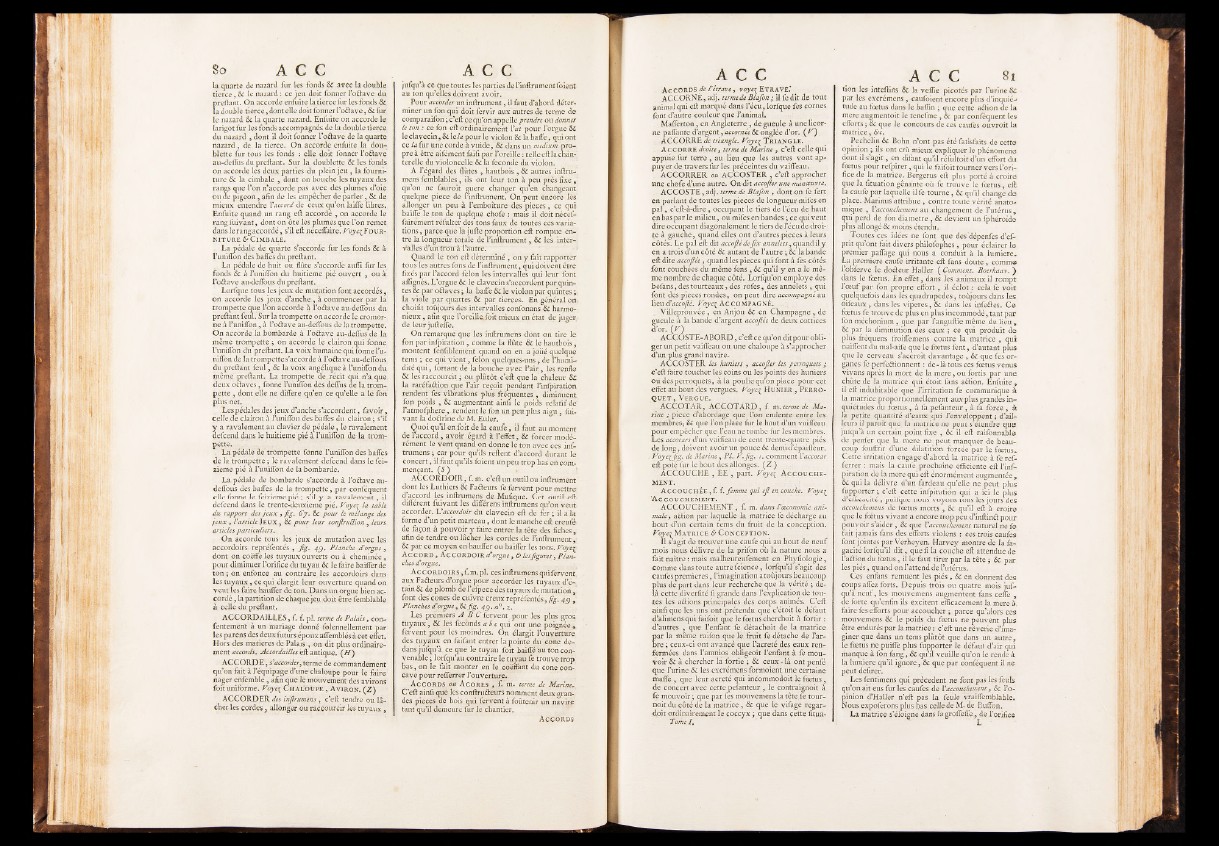
la quarte de nazard fur les fonds & av e c la double
tie r c e , &c le nazard : ce je u doit fonner Foftav e du
preftant. O n accorde enfuite la tierce fur les fonds &
la double tie r c e , dont elle doit fonner F o fta v e , & fur
le nazard & la quarte nazard. Enfuite on accorde le
larigot fur les fonds accompagnés de la double tierce
du nazard , dont il doit fonner Foftave de la quarte
n a za rd , de la tierce. O n accorde enfuite la dou-
blette fur tous les fonds : elle doit fonner l’o ftav e
au-delfus du preftant. Sur la doublette &c les fonds
on accorde les deux parties du plein jeu , la fourniture
&c la cimbale , dont on bouche les tu yau x des
rangs que l’on n’accorde pas av e c des plumes d’o ie
pu de p ig eo n , afin de les empecher de p a r le r , Sc de
mieux entendre Y accord de ceux qu’on laiffe libres.,
Enfuite quand un rang eft accordé , on accorde, le
rang fu iv an t, dont on ô te les plumes que l’on remet
dans leran ga c cord é , s’il eft neceffaire. Voye%_Fourniture
& Cimbale.
La pédale de quarte s’accorde fur les fonds & à
l ’uniffon des baffes du preftant.
La pédale de huit ou flûte s’accorde aufîi fur les
fonds & à Funiflon du huitième pié ouv ert , ou à
l ’o fta v e au-deffous du preftant.
Lorfque tous les jeu x de mutation font accordés
o n accorde les jeu x d’anche., à commencer par la
trompette que l’on accorde à Foftave au-deffous du
preftant feul. Sur la trompette oh accorde le cromor-
n e à Funiflon., à Foftave au-deffous de la trompette.
O n accorde la bombarde à Foftav e au-deffus de la
même trompette ; on accorde le clairon qui fonne
l ’uniflbn du preftant. La v o ix humaine qui fonne l’u-
niffonde la trompette s’accorde à Foftav e au-deffous.
du preftant f e u l l a v o ix angélique à l’uniffon du
même preftant. La trompette de .récit qui n’a que.
d eux b f ta v e s , fonne Funiffoii des deffus de la trompe
tte , dont elle ne différé qu’en ce qu’elle a le fon
plus net.
. Les pédales des je u x d’anche s’a ccordent, fa v o ir ,
celle.de clairon à Funiflon des bafles du clairon ; s’il
y a ravalement au clav ie r de péd ale , le ravalement
defcend dans le huitième pié à l’uniffon de la trompette.
. L a pédale de trompette fonne l’uniffon des baffes
de la .trompette ; le ravalement defcend dans le fe i-
zieme pié à l’uniffon de la bombarde.
L a pédale de bombarde s’accorde à Foftave au-
deffous des baffes de la trompette, .par conféquent
e lle fonne le feizieme pié j s’il y a ra v a lem en t, il
defcend dans le trente-deuxieme pié. Voye^ La table,
du rapport des je u x 3 fig. Gy. & pour le melange des
jeu x y Varticle Jeux , & pour leur confiruclion , leurs
articles particuliers.
O n accorde tous1 les jeu x de mutation a v e c les
accordoirs repréfentés , fig. 4 9 . Planche d’orgue,
dont on coëffe les tu yau x ouverts ou à cheminée ,
pour diminuer l’orifice du tu yau & le faire baiffer de
ton ; on enfonce au contraire les accordoirs. dans
les tu y a u x , ce qui élargit leur ouverture quand on
v eu t les faire hauffer de ton. Dans un orgue bien accordé
, la partition de chaque jeu doit être femblable
à celle du preftant.
A C C O R D A IL LE S, f. f. pl, terme de Palais, con-
fentement à un mariage donné folennellement- par
les parens des deux futurs époux affemblés à cet effet.
Hors des matières de Palais ,oon dit plus ordinairement
accords. Accordailles ëft antique. (H }
A C C O R D E , s ’accorder, terme de commandement
qu’on fait à l’équipage d’une chaloupe pour le faire
nager enfemble, afin que lë mouvement des avirons
foit uniforme. Foye^ Chaloupe , Aviron. (Z)
A C C O R D E R des i/ifirumehs, c’eft tendre ou lâcher
les cordes 3 allonger ou raccourcir les tuyaux ,
jufqu’à ce que toutes les parties d e l’inftrumentfoient
au ton qu’elles doivent avoir.
Pour accorder un inftrument, il faut d’abord déterminer
un fon qui doit fervir aux autres de terme de
comparaifon ; c’eft ce qu’on appelle prendre ou donner
le ton : ce fon eft ordinairement Y ut pour l ’o rgue &
le clavecin , & le la. pour le v io lon &c la b a ffe , qui ont
ce la fur une corde à v u id e , & dans un medium propre
à être aifément. faifi par l’o re ille: telle eft la chanterelle
du Violoncelle & la fécondé du violon.
A l’égard des flûtes , hautbois , & autres inftru-,
mens femblables , ils ont leur ton à peu près fixe 9
qu’on ne fauroit guere changer qu’en changeant
quelque piece de l’inftrument. O n peut encore lès
allonger un peu à l’emboîture des p iè c e s , ce qui
baiffe le ton de quelque chofe : mais il doit nécef-
fairëment réfulter des tons faux de toutes ces v a r ia tions
, parce que la jufte proportion eft rompue entre
la longueur totale de l’inilrument, &C les intervalles
d’u n ffo lï'à l’autre.
Quand le ton eft détermine , on y fait rapporter
tous les autres fons de l ’inftiument, qui doivent ê tre
fixés par l’accord félon les intervalles qui leur font
aflignés. L ’orgue & le clavecin s’accordent par quintes
& par o ftav es ; la baffe pc le v io lon par quintes ;
la v io le par quartes & par tierces. En général on.
choifit toûjours des intervalles çonfonans & harmonieux
, afin que l’o re ille jb it m ieux en état de juger,
de leur jufteffe.
O n remarque que les inftrùniens dont on tire le
fon par infpiration , comme la flûte & le hautbois ,
montent fenfiblement quand on en a joiié quelque
tems ; ce qui v ie n t , félon quelques-uns , de l’humidité
q u i, foitant de la bouche av e c l’a i r , les renfle
& les raccourcit ; o u plûtôt c’eft que la' chaleur &
la raréfaftipn que l’air reçoit pendant l’infpiration
rendent fes-vibrations plus fréquentes , diminuent
fop poids , & augmentant ainfi le poids rela tif de
l’atmofphere,. rendent le fon un peu plus a ig u , fuivant
la doftrine de M. Euler.
Q u o i qu’il en fo k de la c a u fe , il faut, au moment
de l’a c c o rd , av o ir égard à l’e ffe t, & fo rcer modérément
le v en t quand on donne le ton av e c ces inf-
trumens ; car pour qu’ils reftent d’accord durant le
con ce rt, il faut qu’ils foient un peu trop bas en commençant.
(é")
A C C O R D O IR , f. m. c’eft un outil ou inftrument
dont les Luthiers & Fafteurs fe fervent pour mettre'
d’accord les inftrumens de Mufique. C e t outil e ft
différent fuivant les différens inftrumens qu’on v e u t
accorder. Vaccordoir du clavecin eft de fer ; i l a la
forme d’un petit marteau, dont le manche eft creufé
de façon à pouvo ir y faire entrer la tête des fiches ,
afin de tendre o u lâcher les cordes de l’inftrument ,•
& par ce mo yen en hauffer ou baiffer les tons. Voye%
A c c o r d , A c CORDOIR d’orgue y & les figures; Planches
£ orgue.
A c cordoirs , f.m. pl. ces inftrumens qui fervent,
aux Fadeurs d’orgue pour accorder les tu yau x d’é-.
tain & de plomb de l’efpece des tu yau xde mutation ,
font des'cônes de cuivre creux repréfentés, fig. 4 g y
Planches cCorgue, & fig. 4g. n°. 2.
Les premiers A B C fervent pour les plus gros,
tu y a u x , & .les féconds a b c qui ont une poignée.,,
fervent pour les moindres. On élargit l’ouverture
des tu yau x en faifant entrer la pointe du cône dedans
jufqu’à. ce que le tuyau fo it baiffé au ton convenable
; lorfqu’au contraire le tuyau fe trouve trop,
b a s , on le fait monter en le coëffant du cône con-.
ca v e pour refferrer l’ouverture.
Accords ou Açores , f. m. terme de Marine
C ’eft ainfi que les conftrufteurs nomment deux grandes
pièces de bois qui fervent à foûtenir un navire
tant qu’il demeure fur le chantier.
A ccords
Accords de L'étrave, voye£ Etrave."
ACCORNÉ, adj. terme de Blafon; il fe dit-de tout
animal qui eft marqué dans l’écu, lorfque fes cornes
font d’autre couleur que l’animal.
Mafferton, en Angleterre , de gueule à une licorne
paffante d’argent ,.accornée Sc onglée d’or. J V )
ACCORRE de triangle. Voye1 T r ia n g l e .
. A c cQ R R E droite t terme de Marine , c’eft celle qui
appuie fur terre , au lieu que les autres vont appuyer
de travers fur les préceintes du vaiffeau.
. ACCORRER ou ACCOSTER , c’eft approcher
une chofe d’une autre. On dit accofier une jnanceuvre.
ACCOSTE,adj. terme de Blafon, dont.on fe fert
en parlant de toutes les pièces de longueur mifes en
p a l, c’eft-à-dire, occupant le tiers de l’pcu de haut
en bas par le milieu , ou mifes en bandes ; ce qui veut
dire occupant diagonalement le tiers del’écude droi-'
te à gauche, quand elles ont d’autres pièces à leurs
côtés. Le pal eft dit accoflé de J îx annelets, quand il y
en a trois d’un côté & autant de l’autre ; & la bande
eft dite accojlée, quand les pièces qui font à fes côtés
font couchées du même fens , & qu’il y en a le même
nombre de chaque côté. Lorfqu’on employé des
befàns, des tourteaux, des rofes, des annelets ,-qui
font des pièces rondes, on peut dire accompagné au
lieu (Yaccoflé. Voyeç A c c o m p a g n é .
Villeprouvée , en Anjou & en Champagne , de
gueule à la bande d’argent accojlée de deux cottices
d’or. (V }
ACCOSTE-ABORD, c’eft ce qu’on ditpour obliger
un petit vaiffeau,ou.une chaloupe à s’approcher
d’un plus, grand navire.
ACCOSTER les huniers , accofier les perroquets ;
c’ eft faire toucher les coins ou les points des huniers
ou des perroquets , à la poulie qu’on place pour cet
effet au bout des vergues. Voye£ H u n ie r , Pe r r o q
u e t , V e r g u e .
‘ A C C O T A R , A C C O T A R D , f. m. terme de Marine
; piece d’abordage que l’on endente entre les -
membres, & que Fon place fur le haut d’un vaiffeau
pour empêcher que l’eau ne tombe fur les membres.
Les accotars d’un vaiffeau de cent trente-quatre piés
de long, doivent avoir un pouce &. demid’épaiffeur.
Voye^fig. de Marine, Pl. V .fig. 1. comment Yaccotar
eft pôle fur le bout des allonges; (Z )
ACCOUCHÉ , ÉE , part. Voyei Accouchement.
ACCOUCHÉE ,f . f. femme qui efi entcouche. Voye£
'Ac c o u c h e m e n t .
ACCOUCHEMENT , f. m. dans l'ceconomie animale
, aétion par laquelle la matrice fe décharge au
bout d’un certain tems du fruit de la conception.
V o y e i M a t r ic e & C o n c e p t io n .
Il s’agit de trouver une caufe qui au bout de neuf
mois nous délivre de la prifon où la nature nous a
fait naître : mais malheureufement en Phyfiologie,
comme dans toute autre fcience, lorfqu’il s’agit des
caufes premières, l’imagination atoûjoiirs beaucoup
plus de part dans leur recherche que la vérité ; delà
cette diverlité fi grande dans l’explication de toutes
les aftions principales des corps animés. C ’eft
ainfi que les uns ont prétendu que c’étoit le défaut
d’alimens qui faifoit que le foetus cherchoit à fortir :
d’autres , que l’enfant fe détachoit de la matrice
par la même raifon que le, fruit fe détache de l’arbre
; ceux-ci ont avancé que l’acreté des eaux renfermées
dans l’amnios obligeoit l’enfant à fe mouvoir
& à chercher là fortie ; & ceux - là ont penfé
que l’urine & les excrémens formoientune certaine
maffe , que leur acheté qui incommodoit le foetus,
de concert avec cette pefanteur , le contraignoit à
fe mouvoir ; que par fes mouvemens la tête, le tour-
noit du côté de la matrice , & que le vifage regarn
i t ordinairement lg coccyx -, que dans cette fitua-
Tome I,
tion les inteftins & la veflie picotés par l’urine êc
par les excrémens , caufoient encore plus d’inquié-*
tude au foetus dans le baflin ; que cette a&ion de la
mere augmentoit le tenefme , & par conféquent les
efforts ; & que le concours de ces caufes o u v ro it la
ma trice , &c.
Pechelin & Bohn n’ont pas été fatisfaits de cette
opinion ; ils ont crû mieux expliquer le phénomène
dont il s’a g i t , en difant qu’il réfultoit d’un effort du
foetus pour refpire r, qui le faifoit tourner vers l’o rifice
de la matrice. Bergerus eft plus porté à croire
que la fituation gênante où fe trouv e le foe tu s , eft
la caufe par laquelle i lfe tourne , & qu’il change de
place. Marinus attribue , contre toute v érité anatomique,
, Yaccouchement au changement de l’u térus ,
qui, perd de fon diamètre , & devient un fphéroïde
plus allongé & moins étendu.
Toutes ces idées ne font que des dépenfes d’ef-
prit qu’ont fait divers philofophes , pour éclairer le
premier paffage qui nous a conduit à la lumière.
La première caufe irritante eft fans doute , comme
l’obferve le docteur Haller ( Comment. Boerhaav. )
dans le foetus. En e ffe t, dans les animaux il rompt
l’oe u f par fon propre e ffo r t , i l é clo t : cela fe v o i t
quelquefois dans ies quadrupèdes, toûjours dans les
oifeaux , dans les v ip e re s , & dans les infefres. C e
foetus fe trouv e de plus en plus incommodé, tant par
fon méchonium, que par Fanguftie même du lieu ,
& par la diminution des eaux ; ce qui produit de
plus fréquens froiffemens contre la matrice , qui
naiffent du mal-aife que le foetus fe n t , d’autant plus
que le cerv eau s’accroît davantage , & que fes organes
fe perfectionnent : d e - là tous ces foetus venus
v iv an s après la mort de la me re , o u fortis par une
chûte de la matrice qui étoit fans aétion. Enfuite ,
il eft indubitable que, l’irritation fe communique à
la matrice proportionnellement aux plus grandes inquiétudes
du toetus , à fa.pefanteur , à fa force , à
la petite quantité d’eaux qui l’enveloppent ; d’ailleurs
il paroît que la matrice ne peut s’étendre qu e
jufqu’à un certain point fixe .,, & il eft raifonnable
de penfer que la mere ne peut manquer de beaucoup
fouffrir d’une dilatition fo rcée par le foetus.
C e tte irritation engage d’abord la matrice à fe refferrer
: mais la caufe prochaine efficiente eft l’infi-
piration de la m ere qui eft énormément augmentée ,
6c qui la délivre d’un fardeau qu’elle ne peut plus
fupporter ; c’eft cette infpiration qui a ici le plus
d’efficacité , puifque nous voyons tous les jours des
accouchemens de foetus morts , & qu’il eft à croire
que le foétus v ivant a encore trop peu d’inftinfr pour
pouvo ir s’a id e r , & que Y accouchement naturel ne fe
fait jamais fans des efforts violens : ces trois caufes
font jointes par V erheyen. Ha rv e y montre de la fa-
gacité lorfqu’il d i t , que fi la couche eft attendue de
l ’aftion du roetus, il le faut tirer par la tête ; & par
les p ié s , quand on l’attend de Futérus.
C es enfans remuent les p ié s , & en donnent des
coups affez forts. Depu is trois o u quatre mois jufqu’à
n e u f , les mouvemens augmentent fans ceffe ,
de forte qu’enfin ils excitent efficacement la mere à
faire fes efforts pour accoucher ; pa rce qu’alors ces
mouvemens & le poids^du foetus ne peuvent plus
être endurés par la m atrice : c’eft une rêverie d’imaginer
que dans un tems plûtôt que dans un au tre ,
le foetus ne puiffe plus fupporter le défaut d’air qui
manque à fon fa n g , & qu’il v eu ille qu’on le rende à
la lumière qu’il ign o re ,.& que par conféquent il ne
peutdefirer.
Les fentimens qui précèdent ne font pas les feuls
qu’on ait eus fu rie s caufes de Y accouchement, & l’o pinion
d’Haller n’eft pas la feule vraiffemblable.
Nous expoferons plus bas cellede M. de Buffon.
La matrice s’éloigne dans la groffeffe,, de l’o rifice
L