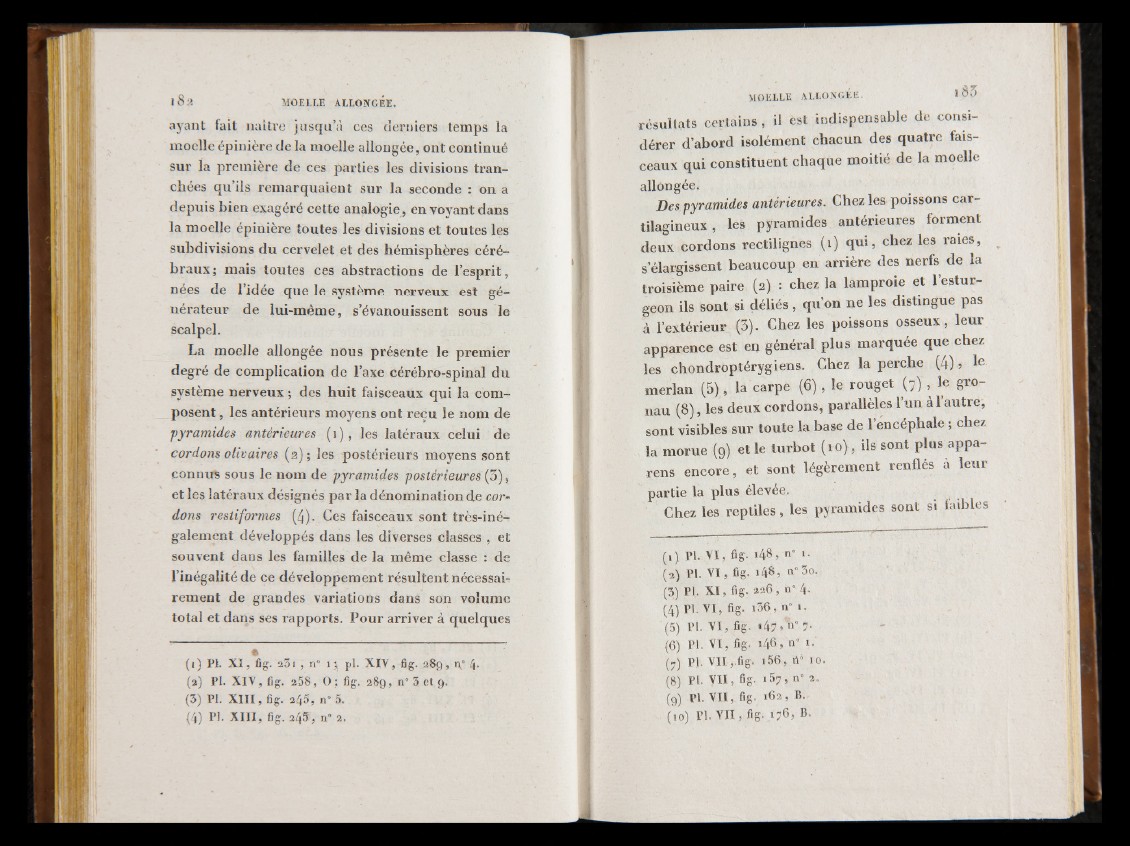
ayant fait naître jusqu’à ces derniers temps la
moelle épinière de la moelle allongée, ont continué
sur la première de ces parties les divisions tranchées
qu’ils remarquaient sur la seconde : on a
depuis bien exagéré cette analogie, en voyant dans
la moelle épinière toutes les divisions et toutes les
subdivisions du cervelet et des hémisphères cérébraux;
mais toutes ces abstractions de l’esprit,
nées de l’idée que le système nerveux est générateur
de lui-même, s’éyanouissent sous le
scalpel.
La moelle allongée nous présente le premier
degré de complication de l’axe cérébro-spinal du
système nerveux ; des huit faisceaux qui la composent
, les antérieurs moyens ont reçu le nom de
pyramides antérieures (i), les latéraux celui de
cordons oliv aires (2) ; les postérieurs moyens sont
connus sous le nom de pyramides postérieures (5),
et les latéraux désignés par la dénomination de cordons
resiiformes (4). Ces faisceaux sont très-inégalement
développés dans les diverses classes , et
souvent dans les familles de la même classe : de
l’inégalité de ce développement résultent nécessab
rement de grandes variations dans son volume
total et dans ses rapports. Pour arriver à quelques
(1) PI. XI, fig. 23 » , n° 1;, pl. XIV, fig. 289, iÇ 4*
(2) PI. XIV, fig. 258, O ; fig. 289, n° 3 et 9.
(3) Pl. XIII, fig. 245, n° 5.
(4) PI. XIII, fig. 245, n” 2.
moelle allongée. i83
résultats certains, il est indispensable de considérer
d’abord isolément chacun des quatre faisceaux
qui constituent chaque moitié de la moelle
allongée.
Des pyramides antérieures. Chez les poissons cartilagineux
, les pyramides antérieures forment
deux cordons rectilignes ( 1 ) qui, chez les raies,
s’élargissent beaucoup en arrière des nerfs de la
troisième paire (2) : chez la lamproie et 1 esturgeon
ils sont si déliés, qu’on ne les distingue pas
à l’extérieur (3). Chez les poissons osseux, leur
apparence est en général plus marquée que chez
les chondroptérygiens. Chez la perche (4) ?
merlan (5), la carpe (6) , le rouget (7) , le gro-
nau (8), les deux cordons, parallèles l’un à l’autre,
sont visibles sur toute la base de l’encéphale ; chez
la morue (9) elle turbot (io>, ils sont plus appa-
rens encore, et sont légèrement renflés a leur
partie la plus élevée.
Chez les reptiles, les pyramides sont si faibles
(1) Pl. VI, fig- 148, n° *•
(2) Pl. VI, fig- n°3o.
(3) Pl. XI, fig. 226, n° 4-
(4) Pl. VI, fig- i36, n” »,
(5) PI- VI, fig. »4? 3 ° 7-
(6) Pl. VI, fig. 146 ? n° l -
(7) Pl. VII, fig- i 56, ù1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(8) PL VII, fig. i 57, n° 2.
(9) Pl. VII, fig. 162, B.