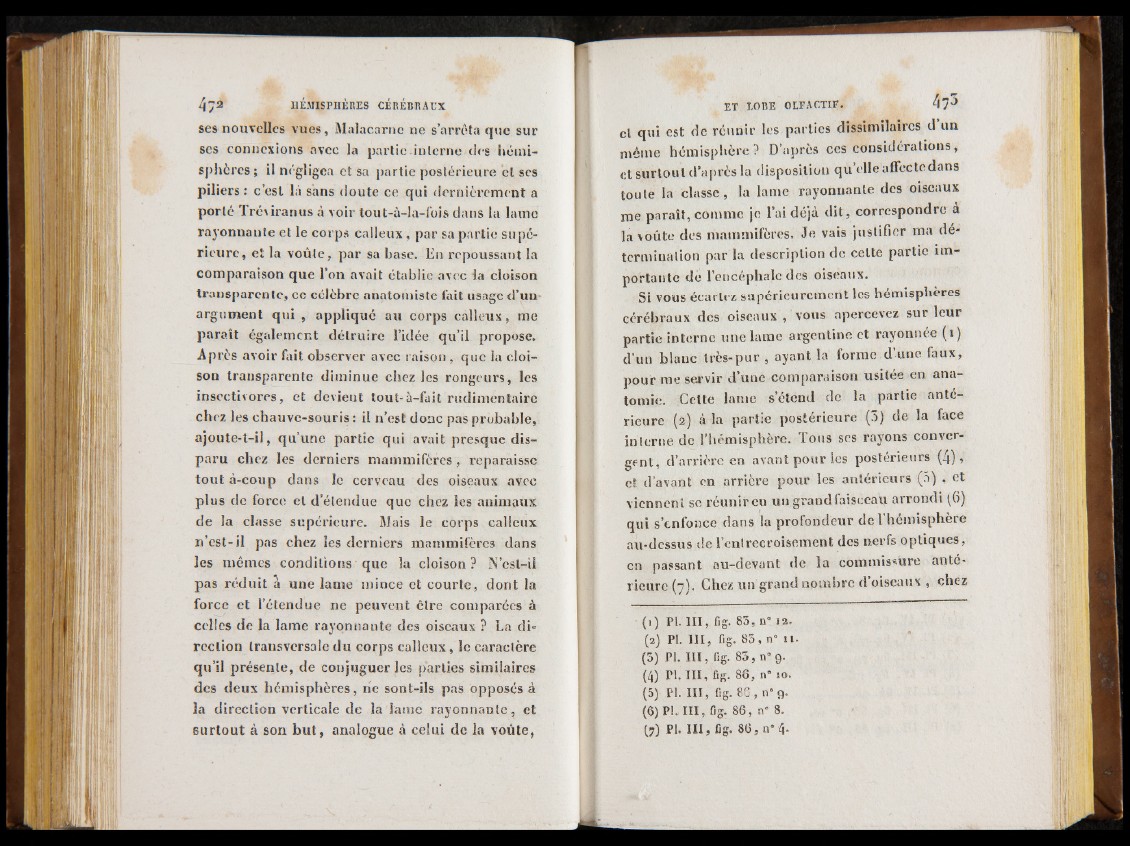
ses nouvelles vues, Malacarne ne s’arrêta que sur
ses connexions avec la partie interne des hémisphères;
il négligea et sa partie postérieure cl ses
piliers: c’est là sans doute ce qui dernièrement a
porté Tréviranus a voir tout-à-ia-fois dans la lame
rayonnante et le corps calleux, par sa partie supérieure,
et la voûte, par sa base. En repoussant la
comparaison que l’on avait établie avec la cloison
transparente, ce célèbre anatomiste fait usage d’un-
argument qui , appliqué au corps calleux, me
paraît également détruire l’idée qu’il propose.
Après avoir fait observer avec raison , que Sa cloison
transparente diminue chez les rongeurs, les
insectivores, et devient tout-à-fait rudimentaire
chez les chauve-souris: il n’est donc pas probable,
ajoute-t-il, qu’une partie qui avait presque disparu
chez les derniers mammifères, reparaisse
tout à-coup dans le cerveau des oiseaux avec
plus de force et d’étendue que chez les animaux
de la classe supérieure. Mais le corps calleux
n’est-il pas chez les derniers mammifères dans
les mêmes conditions que la cloison? IN’cst—il
pas réduit à une lame mince et courte, dont la
force et l’étendue ne peuvent cire comparées à
celles de la lame rayonnante des oiseaux ? La direction
transversale du corps calleux, le caractère
qu’il présente, de conjuguer les parties similaires
des deux hémisphères, rie sont-ils pas opposés à
la direction verticale de la lame rayonnante, et
surtout à son but, analogue à celui de la voûte,
cl qui est de réunir les parties dissimilaircs d un
même hémisphère? D’après ces considérations,
e t surtout d’après la disposition qu’elle affecte dans
toute la classe, la lame rayonnante des oiseaux
me paraît, comme je l’ai déjà dit, correspondre à
la voûte des mammifères. Je vais justifier ma détermination
par la description de celte partie importante
de l’encéphale des oiseaux.
Si vous écartez supérieurement les hémisphères
cérébraux des oiseaux , vous apercevez sur leur
partie interne une lame argentine et rayonnée (1)
d’un blanc très-pur , ayant la forme d’une faux,
pour me servir d’une comparaison usitée en anatomie.
Cette lame s’étend de la partie antérieure
(2) à la partie postérieure (3) de la face
interne de l’hémisphère. Tous ses rayons convergent,
d’arrière en avant pour les postérieurs (4),
et d’avant en arrière pour les antérieurs (5) , et
viennent se réunir eu un grand faisceau arrondi ffi)
qui s’enfonce dans la profondeur de l’hémisphère
au-dessus de l’entrecroisement des nerfs optiques,
en passant au-devant de la commissure antérieure
(7b Chez un grand nombre d oiseaux , chez
(1) Pt. III, fig. 85, n° ia.
(а) Pl. III, fig. 83, n° 11.
(5) PL III, fig. 85, n“ 9.
(4) PL III, fig. 88, n- 10.
(5) PL III, fig. 88 , n°Q.
(б) PL III, fig. 86, a° 8.
(7) PL III, fig. 86, n° 4*