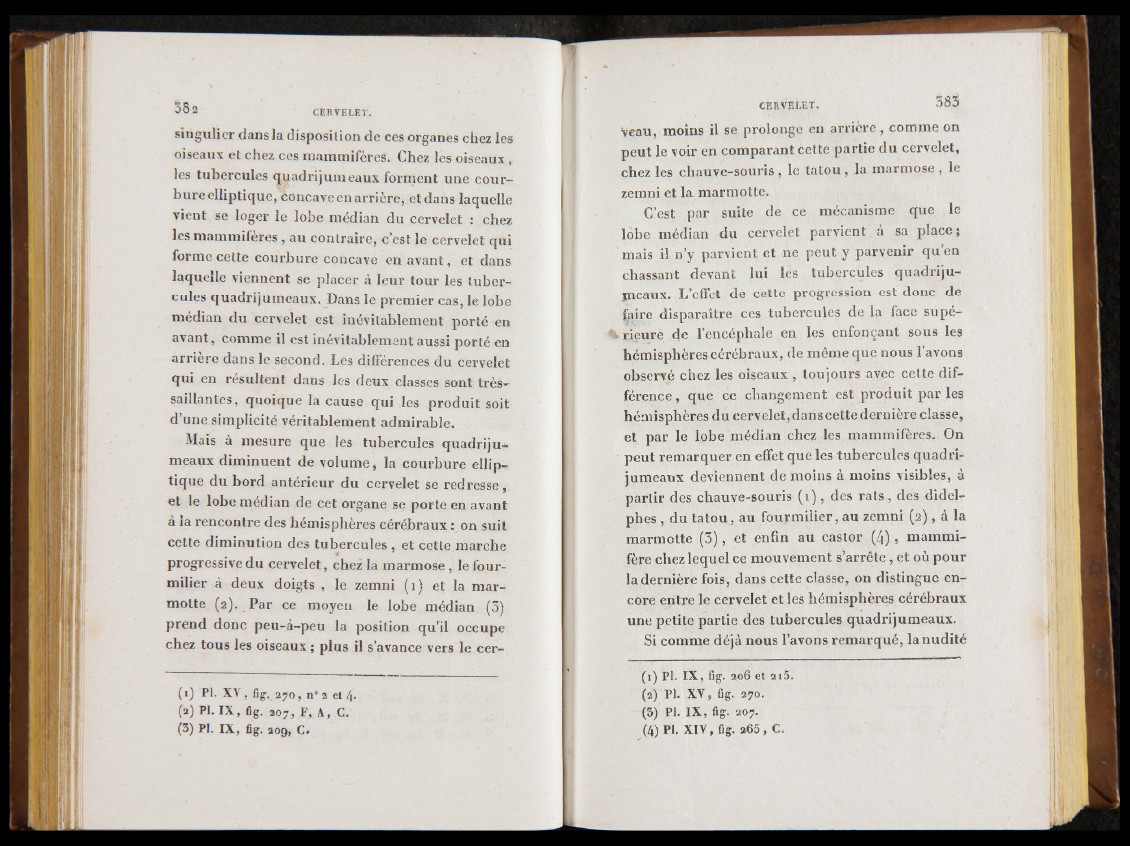
singulier dans la disposition de ces organes chez les
oiseaux et chez ces mammifères. Chez les oiseaux,
les tubercules quadrijumeaux forment une courbure
elliptique, concave en arrière, et dans laquelle
vient se loger le lobe médian du cervelet : chez
les mammifères , au contraire, c’est le cervelet qui
forme cette courbure concave en avant, et dans
laquelle viennent se placer à leur tour les tubercules
quadrijumeaux. Dans le premier cas, le lobe
médian du cervelet est inévitablement porté en
avant, comme il est inévitablement aussi porté en
arriéré dans le second. Les différences du cervelet
qui en résultent dans les deux classes sont très-
saillantes, quoique la cause qui les produit soit
d’une simplicité véritablement admirable.
Mais à mesure que les tubercules quadriju*
meaux diminuent de volume, la Courbure elliptique
du bord antérieur du cervelet se redresse,
et le lobe médian de cet organe se porte en avant
a la rencontre des hémisphères cérébraux : on suit
cette diminution des tubercules , et cette marche
progressive du cervelet, chez la marmose , le fourmilier
à deux doigts , le zemni (1) et la marmotte
(2). Par ce moyen le lobe médian (3)
prend donc peu-a-peu la position qu’il occupe
chez tous les oiseaux ; plus il s’avance vers le cer-
(1) PI. XV, fig. 270, n" 2 et (\.
(2) PI. IX, fig. 207, F, k , C.
(3) PI. IX, fig. 209, C.
Veau, moins il se prolonge en arrière, comme on
peut le voir en comparant cette partie du cervelet,
chez les chauve-souris , le ta to u , la marmose , le
zemni et la. marmotte,
C’est par suite de ce mécanisme que le
lobe médian du cervelet parvient a sa place ;
mais il n’y parvient et ne peut y parvenir qu’en
chassant devant lui les tubercules quadriju-
jmeaux. L’effet de cette progression est donc de
faire disparaître ces tubercules de la face supérieure
de l’encéphale en les enfonçant sous les
hémisphères cérébraux, de même que nous l’avons
observé chez les oiseaux, toujours avec celte différence
, que ce changement est produit par les
hémisphères du cervelet, dans cette dernière classe,
et par le lobe médian chez les mammifères. On
peut remarquer en effet que les tubercules quadrijumeaux
deviennent de moins à moins visibles, à
partir des chauve-souris (1), des rats, des didel-
phes, du tatou, au fourmilier, au zemni (2), à la
marmotte (3), et enfin au castor (4) , mammifère
chez lequel ce mouvement s’arrête, et où pour
la dernière fois, dans cette classe, on distingue encore
entre le cervelet et les hémisphères cérébraux
une petite partie des tubercules quadrijumeaux.
Si comme déjà nous l’avons remarqué, la nudité
(1) PI. IX , fig. 206 et 215,
(2) PI. XV, fig. 270.
(3) PI. IX , fig. 207.