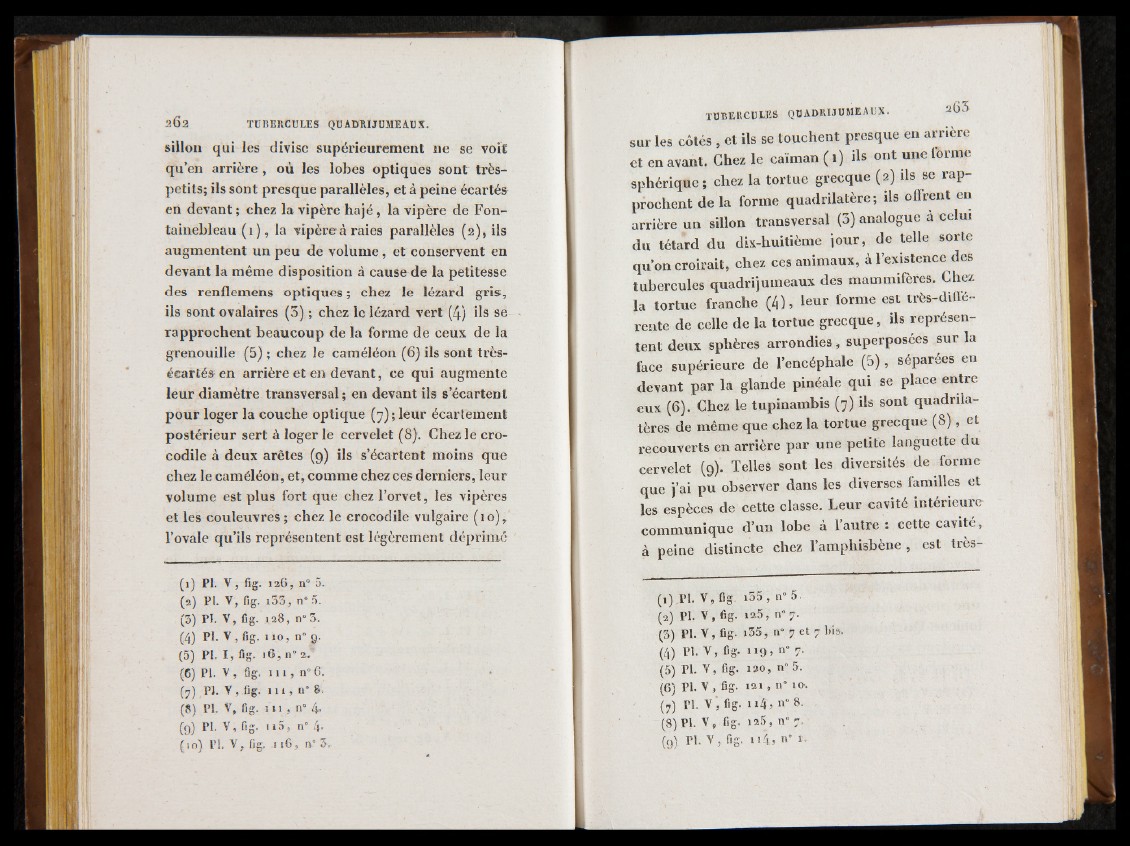
sillon qui les divise supérieurement ne se voit
qu’en arrière , où les lobes optiques sont très-
petits; ils sont presque parallèles, et à peine écartés
en devant ; chez la vipère h a jé , la vipère de Fontainebleau
(1), la vipère à raies parallèles (2), ils
augmentent un peu de volume, et conservent en
devant la même disposition à cause de la petitesse
des renflemens optiques ; chez le lézard gris,
ils sont ovalaires (3) ; chez le lézard vert (4) ils se
rapprochent beaucoup de la forme de ceux de la
grenouille (5) ; chez le caméléon (6) ils sont très-
éearlés en arrière et en devant, ce qui augmente
leur diamètre transversal; en devant ils s’écartent
pour loger la couche optique (7); leur écartement
postérieur sert à loger le cervelet (8). Chez le crocodile
à deux arêtes (9) ils s’écartent moins que
chez le caméléon, et, comme chez ces derniers, leur
volume est plus fort que chez l’orvet, les vipères
et les couleuvres ; chez le crocodile vulgaire (10),
l’ovale qu’ils représentent est légèrement déprimé
(1) PI. V, fig. 126, n” 5.
(2) PI. V, fig. i 33, n° 5.
(3) PI. V, fig. 128, n°3.
(4) PI. V, fig. n o , n" 9.
(5) PI. I , fig. îtî, n° 2..'
(6) PI. Y, fig. m , n° 6.
(7) PI. V, fig. 1 i t , n" 8.
(8) PL V, fig. 1 n , n° 4
(9) PI. V, fig. u 5| n° 4.
(10) PI, V, fig, 1163 n.° 3
tuber cul es q u a d r ijum ea u x . 2 6 5
sur les côtés , et ils se touchent presque en arrière
et en avant. Chez le caïman (1) ils ont uneiorme
sphérique ; chez la tortue grecque (2) ils se rapprochent
de la forme quadrilatère; ils offrent en
arrière un sillon transversal (3) analogue à celui
du têtard du dix-huitième jour, de telle sorte
qu’on croirait, chez ces animaux, à l’existence des
tubercules quadrijumeaux des mammifères. Chez
la tortue franche (4), leur forme est très-différente
de celle de la tortue grecque, ils représentent
deux sphères arrondies, superposées sur la
face supérieure de l’encéphale (5) , séparées en
devant par la glande pinéale qui se place entre
eux (6). Chez le tupinambis (7) ils sont quadrilatères
de même que chez la tortue grecque (8), et
recouverts en arrière par une petite languette du
cervelet (9). Telles sont les diversités de forme
que j’ai pu observer dans les diverses familles et
les espèces de cette classe. Leur cavité intérieure
communique d’un lobe à 1 autre : cette cavité,
à peine distincte chez l’amphisbène , est très-
(1) ,P1. V, fig. i55 , n° 5 .
(2) PI. V , fig- n° 7*
(3) PI. V, fig- i3 5 , n° 7 et 7 bis,
(4) PI. v , fig- 119» n° 7-
(5) PI- V 3 fig. 120, n” 5.
(6) PL y , fig- 1213 n° n>.
(7) PI. V‘, fig- 114> u° 8.
(8) PI. V» fig- 125, n° 7,
(9) n . y , fig- M4 > 8 t -