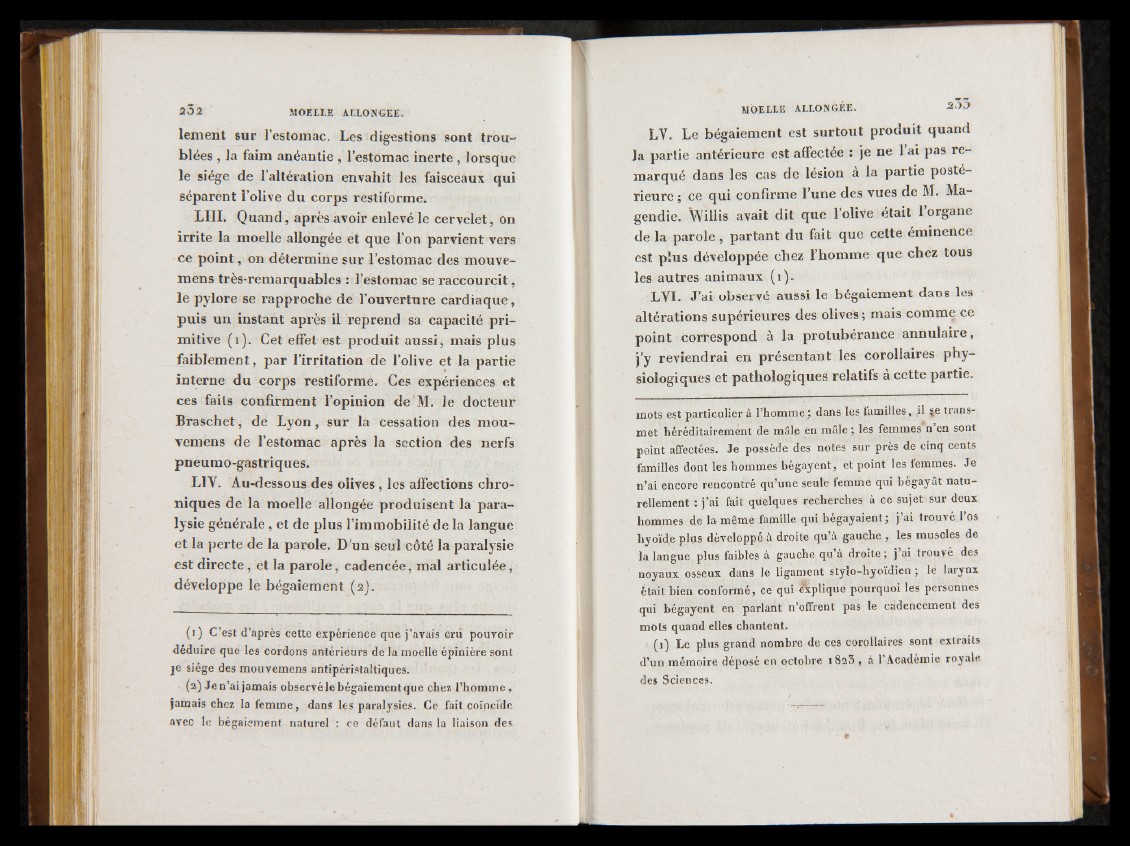
lement sur l’estomac. Les digestions sont trou-'
blées , la faim anéantie , l’estomac inerte , lorsque
le siège de l’altération envahit les faisceaux qui
séparent l’olive du corps restiforme.
LIII. Quand, après avoir enlevé le cervelet, on
irrite la moelle allongée et que l’on parvient vers
ce p oint, on détermine sur l ’estomac des mouve-
mens très-remarquables : l’estomac se raccourcit,
le pylore se rapproche de l’ouverture cardiaque ,
puis un instant après il reprend sa capacité primitive
(1). Cet effet est produit aussi, mais plus
faiblement, par l’irritation de l’olive et la partie
interne du corps restiforme. Ces expériences et
ces faits confirment l’opinion de M. le docteur
Braschet, de Lyon, sur la cessation des mou-
vemens de l’estomac après la section des nerfs
pneumo-gastriques.
LIY. Au-dessous des olives , les affections chroniques
de la moelle allongée produisent la paralysie
générale, et de plus l’immobilité de la langue
et la perte de la parole. Dun seul côté la paralysie
est directe, et la parole, cadencée, mal articulée,
développe le bégaiement (2). 1 2
(1) C’est d’après cette expérience que j’avais crû pouvoir
déduire que les cordons antérieurs de la moelle épinière sont
je siège des mouvemens antipéristaltiques.
(2) Jen’ai jamais observé le bégaiement que chez l’homme,
jamais chez la femme, dans les paralysies. Ce fait coïncide
avec le bégaiement naturel : ce défaut dans la liaison des
LV. Le bégaiement est surtout produit quand
la partie antérieure est affectée : je ne la i pas remarqué
dans les cas de lésion a la partie postérieure
; ce qui confirme l’une des vues de M. Magendie.
Willis avait dit que l’olive était l’organe
de la parole, partant du fait que cette éminence
est plus développée chez l’homme que chez tous
les autres animaux (1).
LYI. J’ai observé aussi le bégaiement dans les
altérations supérieures des olives; mais comme ce
point correspond à la protubérance annulaire,
j’y reviendrai en présentant les corollaires physiologiques
et pathologiques relatifs a cette partie.
mots est particulier à l’homme ; dans les familles, il je transmet
héréditairement de mâle en mâle ; les femmes n en sont
point affectées. Je possède des notes sur près de cinq cents
familles dont les hommes bégayent, et point les femmes. Je
n’ai encore rencontré qu’une seule femme qui bégayât naturellement
: j’ai fait quelques recherches à ce sujet sur deux
hommes de la même famille qui bégayaient; j’ai Irouvé l’os
hyoïde plus développé à droite qu’à gauche , les muscles de
la langue plus faibles à gauche qu’a droite; j ai trouvé des
noyaux osseux dans le ligament stylo-hyoïdien ; lé larynx
était bien conformé, ce qui explique pourquoi les personnes
qui bégayent en parlant n’offrent pas le cddencement des
mots quand elles chantent.
• (1) Le plus grand nombre de ces corollaires sont extraits
d’un mémoire déposé en octobre 1823, à l’Academie royale
des Sciences.