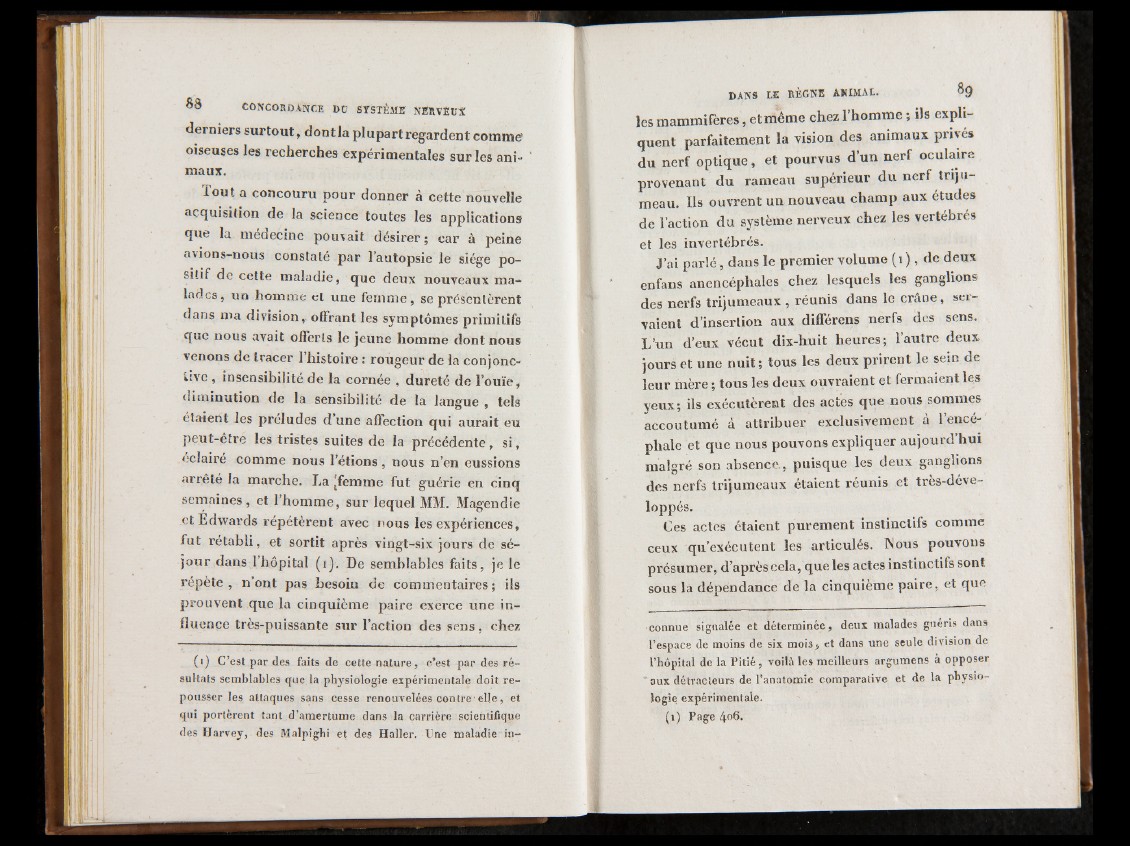
derniers surtout, dont la plupart regardent comme
oiseuses les recherches expérimentales sur les animaux.
Tout a concouru pour donner à cette nouvelle
acquisition de la science toutes les applications
que la médecine pouvait désirer; car à peine
avions-nous constaté par l’autopsie le siège positif
de cette maladie, que deux nouveaux malades,
un homme et une femme, se présentèrent
dans ma division, offrant les symptômes primitifs
que nous avait offerts le jeune homme dont nous
venons de tracer 1 histoire : rougeur de la conjonctive
, insensibilité de la cornée , dureté de l’ouïe,
diminution de la sensibilité de la langue , tels
étaient les préludes d une affection qui aurait eu
peut-etre les tristes suites de la précédente , si ,
éclairé comme nous l’étions , nous n’en eussions
arrêté la marche. La [femme fut guérie en cinq
semaines, et l’homme, sur lequel MM. Magendie
et Edwards répétèrent avec nous les expériences,
fut rétabli, et sortit après vingt-six jours de séjour
dans l’hôpital (1). De semblables faits, je le
répète, n’ont pas besoin de commentaires ; ils
prouvent que la cinquième paire exerce une influence
très-puissante sur l’action des sens, chez
(i) C’est par des faits de cette nature, c’est par des résultats
semblables que la physiologie expérimentale doit repousser
les attaques sans cesse renouvelées contre-elle, et
qui portèrent tant d’amertume dans la carrière scientifique
des Harvey, des Malpîghi et des Haller. Une maladie inles
mammifères, et même chez l’homme ; ils expliquent
parfaitement la vision des animaux prives
du nerf optique, et pourvus d’un nerf oculaire
provenant du rameau supérieur du nerf trijumeau.
Ils ouvrent un nouveau champ aux études
de l’action du système nerveux chez les vertébrés
et les invertébrés.
J’ai parlé -, dans le premier volume (1), de deux
enfans anencéphales chez lesquels les ganglions
des nerfs trijumeaux , réunis dans le crâne, servaient
d’insertion aux différens nerfs des sens.
L’un d’eux vécut dix-huit heures; l’autre deux
jours et une nuit; tous les deux prirent le sein de
leur mère ; tous les deux ouvraient et fermaient les
yeux; ils exécutèrent des actes que nous sommes
accoutumé à attribuer exclusivement à 1 encéphale
et que nous pouvons expliquer aujourd hui
malgré son absence., puisque les deux ganglions
des nerfs trijumeaux étaient réunis et très-déve-
loppés.
Ces actes étaient purement instinctifs comme
ceux qu’exécutent les articulés. Nous pouvons
présumer, d’après cela, que les actes instinctifs sont
sous là dépendance de la cinquième paire, et que
•connue signalée et déterminée, deux malades guéris dans
l’espace de moins de six mois, et dans une seule division de
l’hôpital de la Pitié, voilà les meilleurs argumens à opposer
' aux détracteurs de l’anatomie comparative et de la physiologie
expérimentale.
(1) Page 4°6.