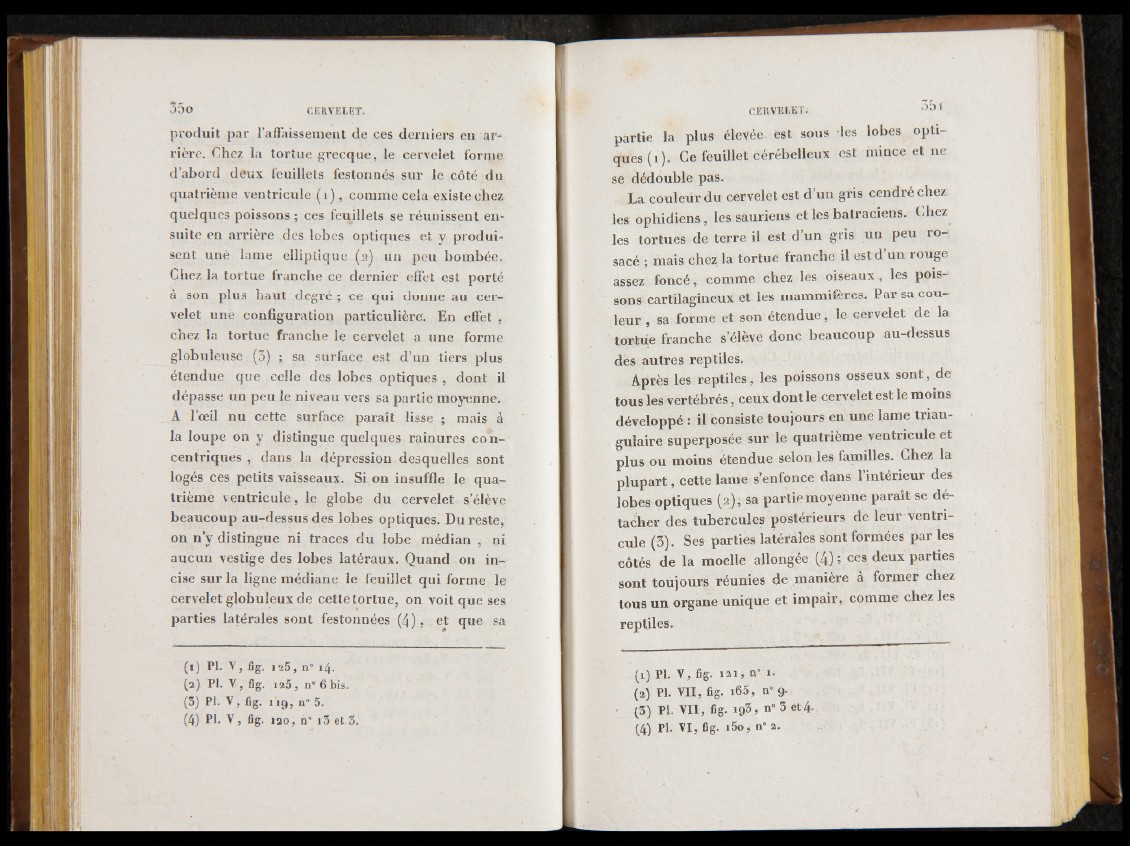
produit par rabaissement de ces derniers en arrière.
Chez la tortue grecque, le cervelet forme
d’abord deux feuillets festonnés sur le côté du
quatrième ventricule (1), comme cela existe chez
quelques poissons ; ces feuillets se réunissent ensuite
en arrière des lobes optiques et y produisent
une lame elliptique (2) un peu bombée.
Chez la tortue franche ce dernier effet est porté
à son plus haut degré ; ce qui donne au cervelet
une configuration particulière. En effet ,
chez la tortue franche le cervelet a une forme
globuleuse (3) ; sa surface est d’un tiers plus
étendue que celle des lobes optiques , dont il
dépasse un peu le niveau vers sa partie moyenne.
A l’oeil nu cette surface paraît lisse ; mais à
la loupe on y distingue quelques rainures concentriques
, dans la dépression desquelles sont
logés ces petits vaisseaux. Si on insuffle le quatrième
ventricule, le globe du cervelet s’élève
beaucoup au-dessus des lobes optiques. Du reste,
on n’y distingue ni traces du lobe médian , ni
aucun vestige des lobes latéraux. Quand on incise
sur la ligne médiane le feuillet qui forme le
cervelet globuleux de cette tortue, on voit que ses
parties latérales sont festonnées (4), et que sa
(1) PI. V, fig. 125, n" 14.
(2) PL V, fig. 125, n° 6 bis.
(3) PL V, fig. 11g, n° 5.
partie la plus élevée, est sous les lobes optiques
(1). Ce feuillet cérébelleux est mince et ne
se dédouble pas.
La couleur du cervelet est d’un gris cendré chez
les ophidiens, les sauriens et les batraciens. Chez
les tortues de terre il est d’un gris un peu rosacé
; mais chez la tortue franche il est d un rouge
assez foncé, comme chez les oiseaux, les poissons
cartilagineux et les mammifères. Par sa couleur
, sa forme et son étendue, le cervelet de la
tortue franche s’élève donc beaucoup au-dessus
des autres reptiles.
Après les reptiles, les poissons osseux sont, de
tous les vertébrés, ceux dont le cervelet est le moins
développé : il consiste toujours en une lame triangulaire
superposée sur le quatrième ventricule et
plus ou moins étendue selon les familles. Chez la
plupart, cette lamé s’enfonce dans l’intérieur des
lobes optiques (2); sa partie moyenne paraît se détacher
des tubercules postérieurs de leur ventricule
(3). Ses parties latérales sont formées par les
côtés de la moelle allongée (4) ; ces deux parties
sont toujours réunies de manière à former chez
tous un organe unique et impair, comme chèz les
reptiles.
(1) PL V, fig. îa i f n° 1.
(2) Pl. VII, fig. i65, n° 9.
(3) PL VII, fig. i95 > n° 3 et 4-